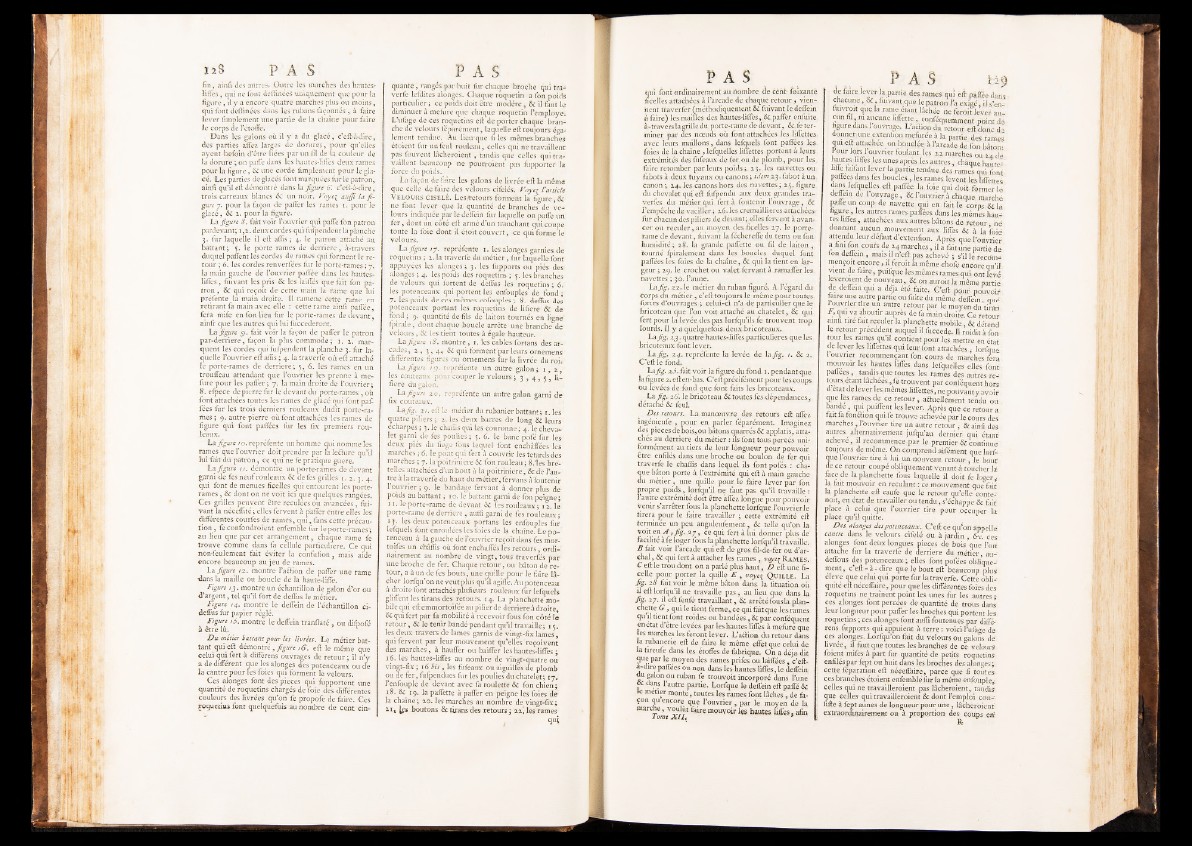
fin, ainfi des autres. Outré lés marches des nautes-
îiffes, qui ne font deftineeS uniquement qvie pour la
figure, il y a encore quatre marches plus ou moins,
qui font deftinées dans les rubans façonnés , à faire
lever Amplement une partie de la chaîne pour faire
le corps de l’étoffe.
Dans les galons oîi il y a dit glacé, c’eft-à-dire,
des parties affez larges de dorures, pour qu’elles
ayent befoin d’être liées par un fil de la couleur de
la dorure ; on paffe dans les hautes-lifi.es deux rames
pour la figure, & une corde Amplement pour le glacé.
Les parties de glacés font marquées fur le patron,
ainA qu’il eft démontré dans la figure G. c’eft-à-dire,
trois carreaux blancs &C un noir. Vcyeç aujfi la figure
y. pour la façon de paffer les rames i . pour le
glacé, & z. pour la figure.
La figure 8. fait voir l’ouvrier qui paffe fon patron
pardevant; 1,1. deux cordes qui fuïpendent la planche
3. fur laquelle il eft aflis ; 4. le patron attaché au
battant; 5. le porte rames de derrière, à-travers
duquel paffent les cordes de rames qui forment le retour
; 6. les cordes renverfées fur le porte-rames ; 7.
la main gauche de l’ouvrier paffée dans les hautes-
liffes, fuivant les pris & les laiffés que fait fon patron
, &c qui reçoit de cette main la rame que lui
préfente la main droite. Il ramene cette rame en
retirant fa main avec elle : cette rame ainfi paffée,
fera mife en fon lieu fur le porte-rames de devant,
ainfr que les autres qui lui fuccederont.
La figure g . fait voir la façon de paffer le patron
par-derriere, façon la plus commode; 1. 2. marquent
les cordes qui fufpendent la planche 3. fur la-
quelle l’ouvrier eft aflis ; 4. la traverfe où eft attaché
le porte-rames de derrière; 5, 6. les rames en un
trouffeau attendant que l’ouvrier les prenne à me-
fure pour les paffer ; 7. la main droite de l’ouvrier ;
8. efpece de pierre fur le devant du porte-rames , où
font attachées toutes les rames de glacé oui font pafi-
fées fur les trois derniers rouleaux dudit porte-rames;
9. autre pierre où font attachées lés rames de
figure qui font paflées fur les fix premiers rouleaux.
La figure 10. repréfente un homme qui nomme les
rames que l’ouvrier doit prendre par la lecfure qu’il
lui fait du patron, ce qui ne fe pratique guère.
La figure 11. démontre un porte-rames de devant
garni de fes neuf rouleaux & de fes grilles 1. z. 3.4.
qui font de menues ficelles qui entourent les porte-
rames , & dont on ne voit ici que quelques rangées.
Ces grilles peuvent être reculées ou avancées, fuivant
la néceflité ; elles fervent à paffer entre elles les
différentes courfes de rames, qui, fans cette précaution
, fe confondroient enfemble fur le porte-rames';
au lieu que par cet arrangement, chaque rame fe
trouve comme dans fa cellule particulière. Ce qui
non-feulement fait éviter la confiifion, mais aide
encore beaucoup au jeu de rames. 7 '
La figure 12. montre l’action de palfer une rame
■ dans la maille ou boucle de la haute-liffe.
Figure ig . montre un échantillon de galon d’or ou
d’argent, tel qu’il fort de deffus le métier.
Figure 14. montre le deffein de l’échantillon ci-
deffus fur papier réglé.
Figure i5. montre le deffein tranflaté , ou difpofé
à être lû.
D u métier battant pour les livrées. Le métier battant
qui eft démontré, figure 16. eft le même que
celui qui fert à différens ouvrages de retour ; il n’y
a de différent que les alonges des potenceaux ou de
la cantre pour les foies qui forment le velours.
Ces alonges font des pièces qui fupportent une
quantité de roquetins chargés de foie des différentes
couleurs des livrées qu’on fe propofe de faire. Ces
roque tins font quelquefois au nombre de cent cinquanté,
rangés par huit fur chaque broche qui traverfe
lefdites alonges. Chaque roquetin a fon poids
particulier ; ce poids doit être modère, & il faut le
diminuer à mefure que chaque roquetin l’employe»
L’ufage de ces roquetins eft de porter chaque branche
de velours féparément, laquelle eft toujours également
tendue. Au lieu'que fi les mêmes branches
étoient furunfeul rouleau, celles qui ne travaillent
pas fouvent lâcheroient , tandis que celles qui travaillent
beaucoup ne pourroient pas fupporter la
force du poids.
La façon de faire les galons de livrée eft la même
que celle de faire des velours cifelés. Voye^ l'article
V elours ciselé. Les/retours forment la figure,&
ne font lever que la quantité de branches de velours
indiquée par le deffein fur laquelle on paffe un
fe r , dont un côté eft armé d’un tranchant qui Coupe
toute la foie dont il étoit couvert, ce qui forme le
velours.
La figure i j . repréfente 1. les alonges garnies de
roquetins ; z. la traverfe du métier, fur laquelle font
appuyées les alonges; 3. les fupports ou piés des
alonges ; 4. les poids des roquetins ; 5 . les branches
de velours qui fortent de deffus les roquetins ; 6.
les potenceaux qui portent les enfouples de fond ;
7. les poids de ces mêmes enfouples ; 8. deffus des
potenceaux portant les roquetins de lifiere & de
fond ; 9. quantité de fils de laiton tournés en ligne
fpirale, dont chaque boucle arrête ■ une branche de
velours, & les tient toutes à égale hauteur.
La figure 18. montre , 1 . les cables fortans des arcades
, z , 3 ,4 , & qui forment'par leurs ornemens
différentes figures ou ornemens fur la livrée du roij
La figure ic). repréfente un autre galon; 1 , z ,
les couteaux pour couper le velours ; 3 , 4 , <r, lifiere
du galon. }
La figun 20, repréfente un autre galon garni de
fix couteaux.
La fig. 21. eftle métier du rubanier battant; 1. les
quatre piliers ; z. les deux barres de long & leurs
écharpés ; 3. le chaflis qui les couronne ; 4. le cheva-
let garni de fes poulies ; 5. 6. le banc pofé fur les
deux piés du fiege fous lequel font enchâffées les
marches ; 6. le pont qui fert à couvrir les têtards des
marches ; 7. la -poitriniere & fon rouleau ; 8.les bretelles
attachées d’un bout à la poitriniere, & de l’autre
à la traverfe du haut du métier, fer vans à'foutenir
l’ouvrier ; 9. le bandage fervant à donner plus de
poids au battant ; 10. le battant garni de fon peigne;
n . le porte-rame de devant & fes rouleaux; 12. le
porte-rame de derrière ,aufli garni de fes rouleaux;
13. les deux potenceaux portans les enfouples fur
lefquels font enroulées les foies de la chaîne. Le po-
tenceau à la gauche de l’ouvrier reçoit dans fes mor-
toifes un chaflis où font enchaffés les retours , ordinairement
au nombre de vingt, tous traverfés par
une broche de fer. Chaque retour, ou bâton de retour,
a à un de fes bouts ; une quille pour le faire lâcher
lorfqu’on ne veut plus qu’il agiffe. Au potenceau
à droite font attachés plufieurs rouleaux fur lefquels
gliflent les tirans des retours. 14. La planchette mobile
qui eft emmortoifée au pilier de derrière à droite
& qui fert par fa mobilité à recevoir fous fon côté le
retour, & le tenir bandé pendant qu’il travaille; 1
les deux travers de lames garnis de vingt-fixlames,
qui fervent par leur mouvement qu’elles reçoivent
des marches, à hauffer ou baiffer les hautes-lifles ;
16. les hautes-lifles au nombre de vingt-quatre ou
vingt-fix; 16 bis , les fufeaux ou aiguilles de plomb
ou de fer, fufpendues fur les poulies du châtelet; 17.
l’enfouple de devant avec fa roulette & fon chien;
i8. & 19. la paffette à palfer en peigne les foies de
la chaîne ; zo. les marches au nombre de vingt-fix ;
2 Ii boutons ôt forans des retours ; 22, les rames
qui
qui font ordinairement au nombre de cènt* foixantë
ficelles attachées à l’arcade de chaque retoiir, viennent
traverfer (méthodiquement & fuivant le deffein
à faire) les mailles des hautes-liflbs, & paffer enfuite
à-travers la grille du porte-rame de devant, &Lfe terminer
par des noeuds où font attachées les Mettes-
avec leurs maillons, dans lefquels.font paffées-les
foies de là chaîne, lefqilelles liuettes portent! fours,
extrémités des fufeaux de fer,ou de plomb, pour les,
faire retomber par leurs poids ;. 23. les navettes ou.
fabots à (deux tuyaux ou canons ; idem 23. fabot à un.
Canon ; 2 4. lés canons hors des navettes ;. 25:. figure
du chevalet qui eft fufpendu aux deux grandes tra-
verfes du métier qui fert.à. foütenir l’ouvrage , &c
f empêche de vaciller ; 26. les cremaillieres-,attachées1
fuir chacun des piliers de dèv.ant;.elles fervent à avancer
oii reculer., au moyen des ficelles 27. le porte-
rame de devant , fuivant la féchereffe du tems ou fon.
humidité; 28. la grande paffette ou fil de laiton,,
tourné fpiralement dans les-boucles duquel font
paffées les foies de la chaîne, & qui la tient en largeur
; 29. le crochet où valet fervant à ramaffer les-
navettes ;3 ô .i ’aune.
La fig. 22. le métier du ruban figuré. A. l’égard du
Corps du métier, c’eft toujours le même pour toutes,
fortes d’ouvrages.; celui-ci. n*a de particulier que le
bricoteau que l’on voit attaché au châtelet, oc qui
fert pour la levée des pas lorfqu’ils fe trouvent trop
lourds. Il y a quelquefois deux bricoteaux.
La fig. 2g . quatre hautes-lifles particulières que les
briGOteaux font lever.;
La fig, 24. repréfente las levée de la fig. 1. & 2.
C’eft le fond»
Lafig. 25. fait voir la figure du fond 1. pendant qpe
la figure 2. eft en-bas. C ’eft précifément pour les coups
ou fovées de fond que font faits les bricoteaux.
La fig. i<£ le brigoteau & toutes fes dépendances,
détaché & feul.
Des retours. La. manoeuvre des fétours eft- affez
ingénieufë , pour en parler féparément. Imaginez
des pièces de bois, ou bâtons quarrés & applatis, attachés
au derrière du.métier 2 ils.font tous pereés unir
formément au tiers de leur- longueur pour pouvoir
être enfilés dans une broche ou boulon de fer qui
traverfe le chaflis dans lequel ils font pofés : chaque
bâton porte à. l’extrémité qui eft. à main gaùche
du métier, une quille pour le faire lever par fon
propre poids,, lorfqu’il ne faut pas. qu’il travaille :
l’autre extrémité doit être affez longue pour pouvoir
venir s’arrêter fous-1a. planchette lorfque l’ouvrier le
tirera pour le faire travailler ; cette extrémité eft
terminée un peu anguleufement, & telle qu’on la,
•voit en A t fig. %y, ce qui fert à lui donner plus de
facilité àfe loger fous la planchette lorfqu’il travaille.
B fait voir l’arcade qui eft de gros fil-de-fer ou d’ar-
chal, & qui fert à attacher les rames, vqyeç Rames.
C eft le trou dont on a parlé plus haut, D eft une ficelle
pour porter la quille E , voye^ Q uille. La
fig. 28 fait voir le même bâton dans la. fituation où
il eft lorfqu’il ne travaille pas, au lieu que dans la-
fig. 27» il eft fenfé travaillant, &c arrêté fousla. planchette
G y qui le tient ferme,, ce qui faitque lesrames
qu il tient font roides ou bandées, & par confisquent
en état d’être levées par les hautes liffés à mefure que
les marches les feront lever. L’aâion du retour dans
la rubanerie eft de faire le même- effet que celui de
la tireufe dans les étoffes de fabrique. On a déjà, dit
que par le moyen des rames prifes ou laiffées, c’eft-
à-dire paffees ou non dans les hautes liffes, le deffein
u galon ou ruban fe trouvoit incorporé dans l’une
, da,n? fautre partie. Lorfque le deffein eft paffé &
le metier monte, toutes les rames font lâ ch e sd e fa- i
çon qu encore que l’ouvrier , par le moyen de la ,
marche, voulût faire mouvoir les hautes liffes, afin
Tome X l l t 1
de faire lever la partie des rames qui èff paffée dans
chacune, & , fuivant que. le patron l ’a exigé ; il s’en-
imvroit que la rame étant lâchée ne feroit lever aucun
fil m aucune hffette.; .co,nféqueniment point dé
figure dans 1 ouvrage. L’adion .du retouri eft donc dé
donner: une.extenfion mefurée à la partie des rames
qui eft attachée onbouclée à l’arcade de fon bâton;
Pour fors 1 ouvrier foulant, fos z z marches ou 24, dé
hautes.hffesfos unes'après. les,autres, . chaque haut*
Wlefaffant lever la partie tendue, des rames qui font
pa.fie.es dans les boucles., les rames lèvent leS liffettes
dans, fofquelles.eft paffée la,foie qui doit former lé
deflein de.l ouvrage, & l’ouvrier; à chaque marché
pafle un coup de navette qui en fait le corps & là
figure, les. autres.rames. paffées dans les mêmes hautes
hfles , attachées aux autres bâtons de retour ; rië
donnant aucun mouvement aux liffes & à la foie
attendu leur défaut d’extenfion. Après' que l’ouvrier
a. fini fon cours de 24 marches, il a fait urié partie dé
fon deffein., mais il n’eft pas achevé ; s’il le recOm-i
mençoit encore, il feroit la même ehofè encore qu’il
vient de faire ; puifique les mêmes rames qui ont levé
leveroient de nouveau , & on auroitla même partie
de deffein qui a déjà, été faite» C ’eft pouf pouvoir
taire une autre partie ou fuite du même, deffein que
1 ouvrier tire un autre retour, par le moyen du’tirart
V ÿ u va aboutir auprès de fa main droite. Ce retour
amfi tire faitreeuler la planchette mobile, & détend
le retour précédent auquel il fiiceede. Il roidit à fort
tour les. rames qu’il contient pour les mettre ert état
de lever les liffettes qpi leur,font attachées,; lorfque
l’ouvrier recommençant fon, cours de marches fora
moiivoir les hautes liffes dans, lefquelles elles font
paffees, tandis, que toutes les rames des autres retours.
étant lâchées., fe trouvent par confisquent hors
d état de lever les mêmes liffettes, ne poitvarity avoir
que lés rames de ce retour, aftuellement tendu où
bande , qui puiffent les lever;» Après que ce retour a
fqitfa fonéhon qui.fe trouye achevée par le cours des
marches, l’buvriér tire un autre retour ; & ainfi dés
autres alternativement jufqu’au. dernier qui étant
achevé, il recommence,par le',premier & continué
toujours de même. On comprend- aifément que lorfque
l’ouvrier tire à lui un. nouveau, retour , le bout
de ce retour coupé obliquement venant à toucher là
face de la planchette fous laquelle il doit fe loger;
la. fait mouvoir en reculant : ce. mouvement que fait
la. plàrichette eft caufe que le retour qu’elle conte-
noit, en état de travailler ou tendu, s’échappe & fait
place à celui qiie l’ouvrier tire pour occuper la
place qu’il quitte.
Des alonges des potenceaux. C’eft ce qu’on appellé
cantre dans le velours çifelé. Ou. à jardin , &ç. ces
alonges font deux longues pièces de bois que l’ori
attache fur la traverfe de derrière du métier au-
deffous des potenceaux-; elles font pofées obliquement,
c’e ft- à -dire que le bout eft beaucoup plus
élevé que celui qui porte fur la,traverfe. Cette obliquité
eft néeeffaire,pour que les différentes foies des
roquetins ne traînent point les unes fur les autres ;
ces alonges font percees de quantité de trous dans
leur longueur pour paffer les broches qui portent les
roquetins ; ces alonges font auflî foutenues par différens
fupports- qui appuient à terre : voici l’ufa^e dé
ces alonges. Lorfqu’on fait du velours ou galons dé
livrée, il fout que toutes les branches de ce velours
foient mifes à part fia- quantité de petits roquetins
enfilés par fept ou huit dans les broches des alonges ;
cette féparation eft néeeflàife, parce que fi toutes
ces branches étoient enfemble fur la même enfoliple,-
celles qui ne travailleroient pas lâcheroient, tandis
que celles qui travailleroient & dont l’emploi cou-
ufte à fept aunes de longueur pour une, lâcheroient
extraordinairement ou à proportion des coups en
R