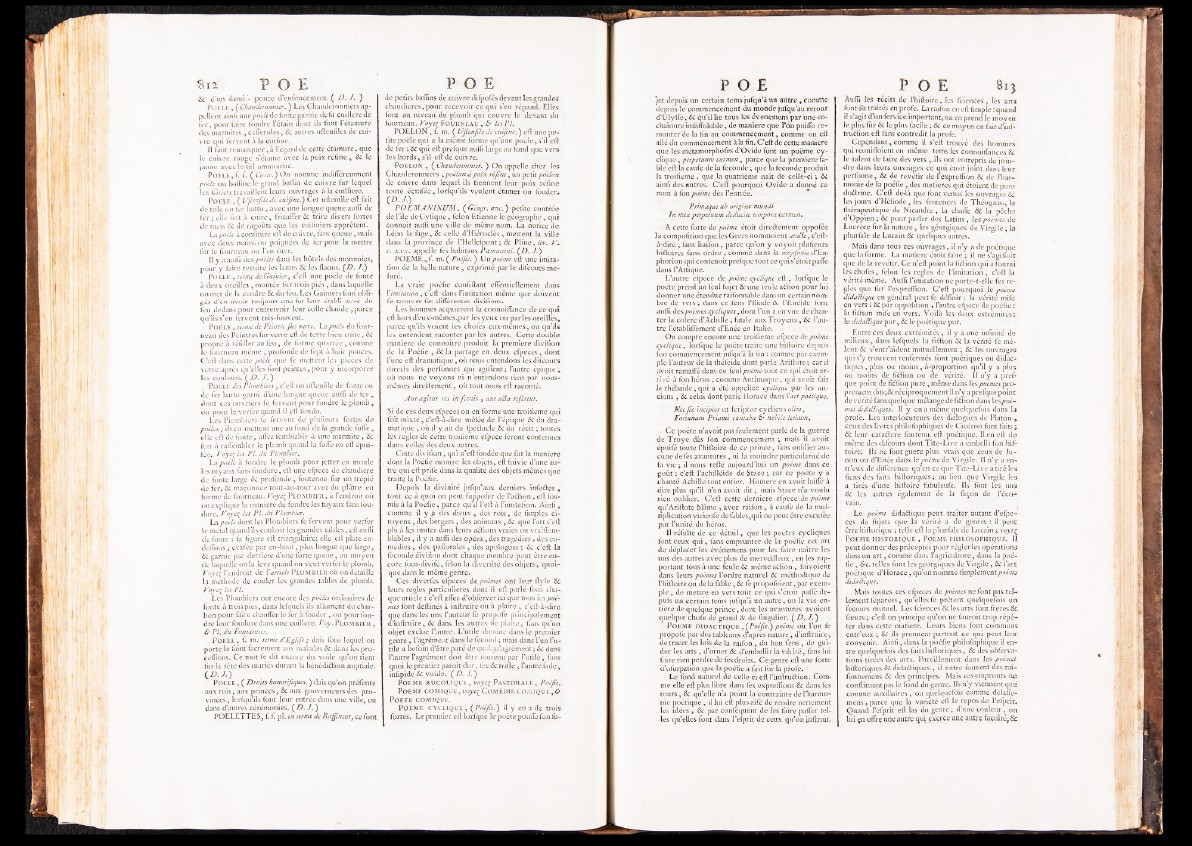
d'un demi - pouce d’enfoncement. ( D .J . )
POELE, ( Chaudtronnur. ) Les Chauderonniers appellent
ainfi une poêle de fonte garnie de fa cuillère de
fe r , pour faire fondre l’étain dont ils font l’étamure
des marmites -, cafferoles, 6c autres uftenfiles de cuivre
qui fervent à la cuiline.
Il faut remarquer, à l’égard de cette étamure, que
le cuivre rouge s’ étame avec la poix réfine , & le
jaune avec le fel ammoniac.
Poele, f. f. ( Cirier.) On nomme indifféremment
polit ou badine le grand baflin de cuivre fur lequel
les Ciriers travaillent leurs ouvrages à la cuilliere.
Poele , ( Uflenjile dt cuifine.') Cet uftenfile eft fait
de tôle ou fer battu, avec une longue queue aufli de
fer ; elle fert à cuire, fricaïïer & frire divers fortes
de mets & d e ragoûts que les cuifiniers apprêtent.
La polit à confiture eft de cuivre, fans queue, mais
avec deux mains ou poignées de fer pour la mettre
fur le fourneau ou l’en ôter.
Il y a aufîi des polies dans les hôtels des monnoies,
pour y faire recuire les lames 6c les flaons. (Z?, ƒ..) '
Poele , terme de Gautier, c’eft une poêle de fonte
à deux oreilles , montée fur trois piés , dans laquelle
on met de la cendre 6c du feu. Les Gaîniers font obli- :
gés d’en avoir toujours une fur leur établi avec du
feu dedans pour entretenir leur colle chaude, parce
cu’ils s’en fervent très-fouvent.
POELE, terme de Peintre fur verre. poele du fourneau
des Peintres fur verre eft de terre bien cuite, 6c
propre à réfifter au feu, de forme quarrée, comme
le fourneau même , profonde de fept à huit pouces.
C ’eft dans cette poele que fe mettent les pièces de
verre après qu’elles font peintes, pour y incorporer
les couleurs. ( D . J. )
Poele des Plombiers, c’eft un uftenfile de fonte ou
de fer battu garni d’une longue queue aufli de fer ,
dont ces ouvriers fe fervent pour fondre le plomb,
ou pour le verfer quand il eft fondu.
Les Plombiers fe fervent de plufieurs fortes de
poêles ; ils en mettent une au fond de la grande fofle,
elle eft de fonte, aflez femblable .à une marmite, 6c
fert à raflëmbler le plomb quand la fofle en eft épui-
■ fée. Voyez les Pl. du Plombier.
La polie à fondre le plomb pour jetter en moule
les tuyaux fans foudure, eft une efpece de chaudière
de fonte large 6c profonde, foutenue fur un trépié
de fer, 6c maçonnée tout-au-tour avec du plâtre en
forme de fourneau. Voye^ Plombier , à l’endroit oii
on explique la maniéré de fondre les tuyaux fans fou-
dure. Voye{ les Pl. du Plombier.
La polie dont, les Plombiers fe fervent pour verfer
le métal quand ils coulent les grandes tables, eft aufli
de fonte : fa figure eft triangulaire; elle eft plate en-
deflous ,• évafée par en-haut, plus longue que large,
6c garnie par derrière d’une forte queue, au moyen
de-laquelle on la leve quand on veut verfer le plomb.
Voyez l’endroit de l’article Plombier oit on détaille
la méthode de couler les grandes tables de plomb.
Voyei Us Pl.
Les Plombiers ont encore des polies ordinaires de
fonte à trois piés, dans lefquels ils allument du charbon
pour faire chauffer le fer à fouder, ou pour fondre
Leur foudure dans une cuillère. Voy. Plombier ,
& Pl. du Fontainier.
Po e l e , f. m. terme tfEglife; dais fous lequel on
porte le faint facrement aux malades 6c dans les procédions.
Ce mot fe dit encore du voile qu’on tient
fur la tête des mariés durant la bénédiftion nuptiale.
( D . / . )
Po ele, ( Droits honorifiques.) dais qu’on préfente
aux rois, aux princes, 6c aux gouverneurs des provinces
, lorfqu’ils font leur entrée dans une ville, ou
dans d’autres cérémonies. (Z?. /. )
POELETTES, f. f. pl. en terme de Rajfîneur, ce font
de petits baflins de cuivre difpofés devant îesgrartdeÿ
chaudières, pour recevoir ce qui s’en répand. Elles
font au niveau du plomb qui couvre le devant du
fourneau. Voye{ Fourneau , 6* lesPl.
POELON , f. m. ( Uflenjile dt cuijine. ) eft une petite
poêle qui a la même forme qu’une poêle, s’il eft
de fer ; 6c qui eft prefque aufli large au fond que vers
les bords, s’il eft de cuivre.
POELON -, ( Ckauderonnier. ) On appelle chez les
Chauderonniers , poêlon à poix réjîne, un petit poêlon
de cuivre dans lequel ils tiennent leur poix réfine
toute écrafée, lorlqu’ils veulent étamer ou fouder. mm PO E MA N I NUM, ( Géogr. ant. ) petite contrée
de l’île de Gyfique, félon Etienne le géographe , qui
connoît aufli une ville de même nom. La notice de
Léon le fage, 6c celle d’Hiéroclès, mettent la ville
dans la province de l’Hellefpont ; 6c Pline, liv. V.
c. x x x . appelle les habitans Pcemaneni. (D . ƒ.)
POEME, f. ni. ( Poljie. ) Un poërne eft une imitation
de la belle nature , exprimé par le difcours me-
furé,
La vraie poéfie confiftailt effentiellement dans
l'imitation, c’eft dans l’imitation même que doivent
fe trouver fes différentes divilions.
Les hommes acquièrent la connoiflànce de ce qui
eft hors d’eux-mêmes,par les yeux ou par les oreilles,
parce qu’ils voient les chofes eux-mêmes, ou qu’ils
les entendent raconter par les autres. Cette double
maniéré de connoître produit la première divifion
de la Poéfie , 6c la partage en deux efpeces, dont
l’une eft dramatique, où nous entendons les difcours
dire fis des perfonnes qui agiflent ; l’autre épique
où nous ne voyons ni n’entendons rien par nous-
mêmes direftement, où tout nous eft raconté.
u4ut agitur res in feenis , dut acta refertur.
Si de ces deux efpeces on en forme une troifieme qui
foit m ixte, c’eft-à-dire mêlée de l’épique 6c du dramatique
, où il y ait du fpeélacle 6c du récit ; toutes
les réglés de cette troifieme efpece feront contenues
dans celles des deux autres.
Cette divifion, qui n’eft fondée que fur la maniéré
dont la Poéfie montre les objets, eft fuivie d’une autre
qui eft prife dans la qualité des objets mêmes que
traite la Poéfie.
Depuis la divinité jufqu’aux derniers infeftes ,
tout ce à quoi on peut fuppofer de l’a&ion, eft fournis
à la Poéfie, parce qu’il l’eft à l’imitation. Ainfi ,
comme il y ÿ. des dieux , des rois , de fimples cifv
toyens , des bergers, des animaux, 6c que l’art s’eft
plu à les imiter dans leurs a&ions vraies ou vraiflem-
blables , il y a aufli des opéra , des tragédies, des comédies,
des paftorales, des apologues ; 6c c’eft la
fécondé divifion dont chaque membre peut être encore
fous-divifé, félon la diverfité des objets, quoique
dans le même genre.
Ces diverfes efpeces de poèmes ont leur ftyle 6c
leurs réglés particulières dont il eft parlé fous chaque
article : c’ eft aflez d’obferver ici que tous les poèmes
font deftinés à inftruire ou à plaire , c’eft*à-dire
que dans les uns l’auteur fe propofe principalement
d’inftruire, 6c dans les autres de plaire, fans qu’un
objet exclue l’autre. L’utile domine dans le premier
genre , l’agréme.it dans le fécond ; mais dans l’un l’utile
a befoin d’être paré de quelqu’agrément; 6c dans
l’autre l’agrément doit être foutenu par l’utile, fans
quoi le premier paroît dur, fec & tr ifte , l’autre fade,
infipide 6c vuide. ( D. J. )
POEME BUCOLIQUE, v o y eç PASTORALE, P o ljie .
POEME COMIQUE, voye^ COMÉDIE COMIQUE,.#
POETE COMIQUE.
POEME cyclique , ( Poéfie.) il y en a de trois
fortes. Le premier eft lorfque le poète pouffe fon fujet
depuis un certain teins jufqu’à un aûtre , comrne
depuis le commencement du monde jufqu’au retour
d’Ulyffe, 6c qu’il lie tous les’ évenemens par une en-
chaînure indiflbluble, de maniéré que l’on puiflfe remonter
de la fin au commencement, comme on eft
allé du commencement à la fin. C’eft de cette maniéré
que les métamorphofes d’Ovide font un poème c y clique
, perpetuum carmen, parce que la première fable
eft la caufe de la fécondé ; que la fécondé produit
la troifieme, que la quatrième naît de celle-ci ; 6c
ainfi des autres. C’eft pourquoi .Ovide a donné ce
nom à fon poërne dès l’entrée. ••
Primaque ab origine mùndi
In rttea perpetuum deducite tempora carmen•
. A cette forte de polme étoit direftement oppofée
3a compofition que les Grecs nommoient atacle, c’eft-
à-dire , fans liaifon, parce qu’on y voyoit plufieurs J
hiftoires fans ordre , comme dans la rnopjonie d’Eu-
phorion qui contenoit prefque tout ce qui s’étoit paflfé
dans l’Attique.
L’autre efpece de polme cyclique e f t , lorfque le
poète prend un feul fujet & une feule aftion pour lui
donner une étendue raifonnable dans un certain nombre
de vers ; dans ce fens l’Iliade 6c l’Enéide font
aufli des pointes cycliques, dont l’un a en vue de chanter
la colere d’Achille, fatale auxTroyens , 6c l’autre
l’établiffement d’Enée en Italie.
. On compte encore une troifieme efpece de poërne
cyclique, lorfque le poète traite une hiftoire depuis
fpn commencement jufqu’à la fin : comme par exemple
l’auteur de la thefeide dont parle Ariftote ; car il
ayoit ramaffé dans ce feul polme tout ce qui étoit arrivé
à fon héros ; comme Antimaque, qui avoit fait
la thébaïde, qui a été appellée cyclique par les anciens
, 6c celui dont parle Horace dans l’art poétique.
Necfie incipies ut feriptor cyclicus olifn,
Fortunam Priami cantabo & nobile lethum.
, Ce poète n’avoit pas feulement parlé de la guerre
de Troye dès fon commencement ; mais il avoit
épuifé toute l’hiftoire de ce prince, fans oublier aucune
de fes avantures, ni la moindre particularité de
fa vie ; il nous refte aujourd’hui un poëme dans c e .
goût : c’eft l’aehilléide de Stace ; car ce poète y à
chanté Achille tout entier. Homere en avoit laifl’é à
dire plus qu’il n’en avoit dit ; mais Stace n’a voulu
rien oublier. C ’eft cette derniere efpece de pointe
qu’Ariftote blâme , avec raifon , à caufe de la multiplication
vicieufe de fables,qui ne peut être exeufée
par l’unité du héros.
Il réfulte de ce détail, que les poètes cycliques
font ceux q u i, fans emprunter de la poéfie cet art
de déplacer les événemens pour les faire naître les
lins des autres avec plus de merveilleux , en les rapportant
tous à une feule 6c même aélion , fuivoient
dans leurs pointes l’ordre naturel 6c méthodique de
l’hiftoire ou de la fable, 6c fe propofoient, par exemple
, de mettre en vers tout ce qui s’étoit pafle depuis
un certain tems jufqu’à un autre, ou la v ie entière
de quelque prince, dont les avantures avoient
quelque choie de grand & de fingulier. ( D . J. )
POEME d id a c t iq u e , ( Poéfie.) polm e où l’on fe
propofe par des tableaux d’après nature, d’inftruire,
de tracer les lois de la raifon, du bon fens , de guider
les arts , d’orner 6c d’embellir la vérité, fans lui
faire rien perdre de fes droits. Ce genre eft une forte
d’ufurpation que la poéfie a fait fur la profe.
Le fond naturel de celle-ci eft l’inftruélion. Comme
elle eft plus libre dans fes expreflions 6c dans fes
tours, 6c qu’elle n’a point la contrainte de l’harmonie
poétique, il lui eft plus aifé de rendre nettement
les idées , 6c par conféquent de les faire paffer telles
qu’elles font dans l ’elprit de ceux qu’on inftniit.
Aufli les récits de l’hiftoire, les fciéhees, les âfts
font-ils traités en profe. La raifon en eft fimple : quand
il s’agit d’un fervice important, on en prend le moyen
le plus fîir 6c le plus facile ; 6c ce moyen en fait d*inf»
truélion eft fans contredit la profe.
Cependant, comme il s’eft trouvé des homrtieâ
qui réuniflbient en même tems les connoiflances 6c
le talent de faire des vers , ils ont entrepris de joindre
dans leurs ouvrages ce qui étoit joint dans leur
perfonne, 6c de revetir de l’exprefîion 6c de l’harmonie
de la poéfie , des matières qui étoient de pure
doÛrine. C’eft de-là que font venus les 'ouvrages 6c
les jours d’Héfiode, les fentences de Théognis/, la
thérapeutique de Nicandre, la chafle 6c la pêche
d’Oppien ; & pour parler des Latins, les pointes de
Lucrèce fur la nature, les géorgiques de Virgile, la
pharfale de Lucain 6c quelques autres»
Mais dans tous ces ouvrages, il n’y a de poétique
que la forme. La matière étoit faite ; il ne s’agiffoit
que de la revêtir. C e n’eft point la fiâion qui a fourni
les chofes, félon les réglés de l ’imitation , c’eft la
vérité même. Aufli l’imitation ne porte-t-elle fes réglés
que fur l’expreflion. C’eft pourquoi le poème
didactique en générai peut fe définir : la vérité mife
en vers : 6c par oppofition , l’autre efpece de poéfie :
la fi&ion mife en vers. Voilà les deux extrémités:
le didactique pur, & le poétique pur.
Entre ces deux extrémités , il y â une infinité de
milieux, dans lefquels la fiction 6c la vérité fe mêlent
6c s’ entr’aident mutuellement ; 6c les ouvrages
qui s’y trouvent renfermés font poétiques Ou didactiques
, plus ou moins, à-proportion qu’il y a plus
ou moins de fiéfiofi ou de vérité. Il n’y a prefque
point de fiétion pure, même dans les pointes proprement
dits;&réciproquement il n’y a prefque point
de vérité fans quelque mélange de fiaion dans les poèmes
didaÛiqueS. Il y en a même quelquefois dans la
profe. Les interlocuteurs des dialogues de Platon ,
ceux des livres philofophiques de Cicéron font faits ;
6c leur cata&ere foutenu. eft poétique. Il en eft de
même des difcours dont T ite-Live a embelli fon hiftoire.
Ils ne font guere plus vrais que ceux de Ju-
non ou d’Enée dans le poëme de Virgile. Il n’y a en-
tr’eux de différence qu’en ce que Tite-Live a tiré les
fiens des faits hiftoriques; au lieu que Virgile les
a tirés 'd’une hiftoire fabuleufe. Ils font les uns
6c les autres également de la façon de l’écrivain.
Le polme dida&ique peut traiter autant d’efpe-’
ces de fujets que Ja vérité a de genres : il peut
être hiftorique ; telle eft la pharfale de Lucain ; voye£
POEME HISTORIQUE , POEME PHILOSOPHIQUE. Il
peut donner des préceptes pour régler les opérations
dans un art, comme dans l’agriculture, dans la poéfie
, &c. telles font les géorgiques de V irgile, 6c l’art
poétique d’Horace, qu’on nomme Amplement poëme
didactique.
Mais toutes ces efpeces de pointes ne font pas tellement
féparées, qu’elles fe prêtent quelquefois un
fecours mutuel. Les fciences 6c les arts font freres 6c
foeurs ; c’eft un principe qu’on ne fauroit trop répéter
dans cette matière. Leurs biens font communs
entr’eux ; 6c ils prennent partout ce qui peut leur
convenir. Ainfi, dans la poéfie philofophique il entre
quelquefois des faits hiftoriques, 6c des obferva-
tions tirees des arts. Pareillement dans lès pointes
hiftoriques 6c didaftiques., il entre fouvent des rai-
fonnemens 6c des principes. Mais ces emprunts ne
conftituentpas le fond du genre. Us n’y viennent que
comme auxiliaires ,' ou quelquefois comme delaffe-
mens, parce que la variété eft le repos de l’efprit.
Quand l’efprit eft las du genre, d’une couleur, on
lui çn offre une une autrç faculté, 6c