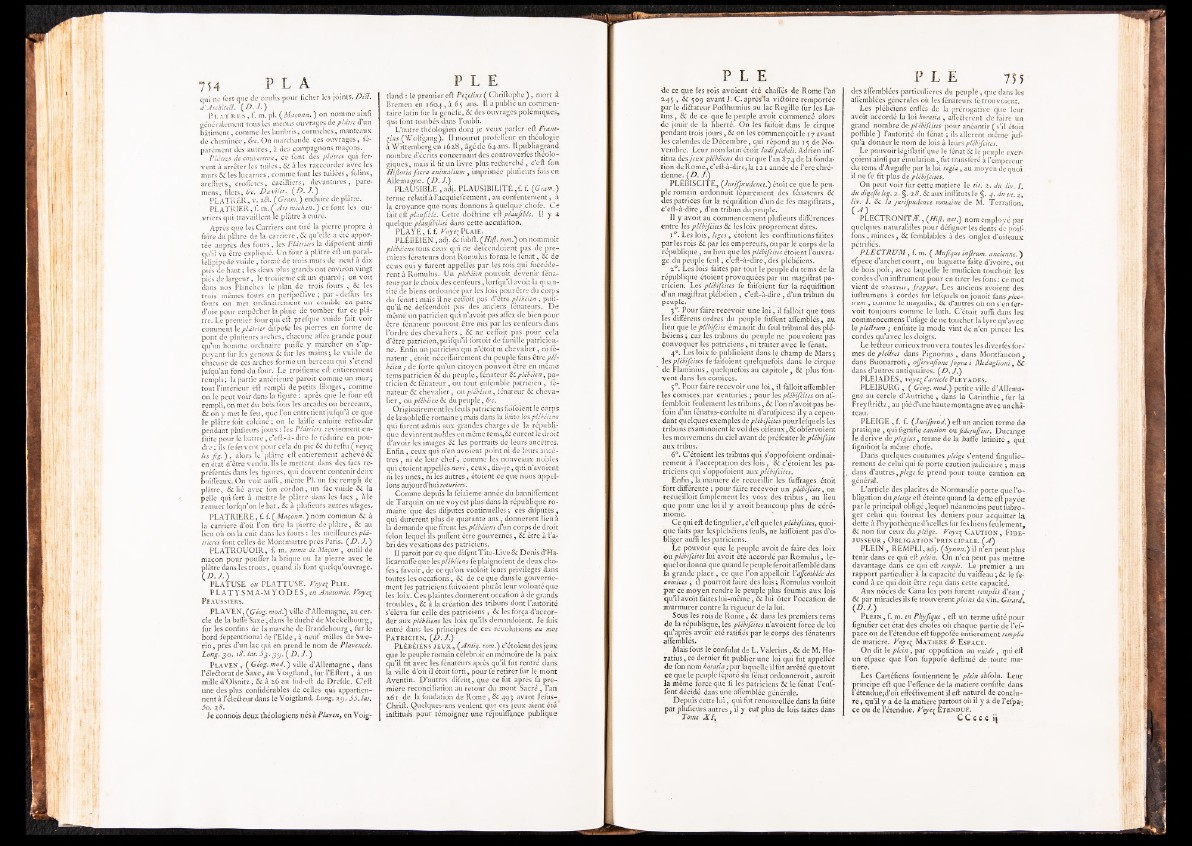
qui ne fert que de coulis pour ficher lëâ joints. Dict.
d'Architecl. (D .J . ) ,
p L a t R E S , fi m. pi. ( Maçonn, ) on nomme ainfi
généralement tous les menus ouvrages de plâtre d’un
bâtiment, comme les lambris ; corniches, manteaux
de cheminée, &c. On marchande ces ouvrages, Séparément
des autres, à des compagnons maçons.
Plâtres de couverture, ce font des plâtres qui fervent
à arrêter les tuiles, & a les racceorder avec les
murs Sc les lucarnes, comme font les tuilées j folins,
areftiers, croffetes, cacilliers, devantures, pare-
mens, filets, &c. Daviler. {D .J . ) a
PLATRER, v. a61. {Gram.') enduire de plâtre.
PLATRIER, f. m. ( A n méchan.) ce font les ou-
vriers qui travaillent le plâtre à cuire.
Après que les Carriers ont tiré la pierre propre à
faire du plâtre de la carrière, Sc qu’elle a été apportée
auprès des fours, les Plâtriers la difpolent ainfi
qu’il va être expliqué. Un four à plâtre eft un paral-
lelipipede vuide , formé de trois .murs de neuf à dix
piés de haut ; les deux plus grands ont environ vingt
pies de largeur, le troiûeme eft un quarré ; on voit
dans nos Planches le plan de trois fours , Sc les
trois mêmes fours en perfpeâive ; par-deflus les
fours on met ordinairement un comble en patte
d’oie pour empêcher la pluie de tomber fur ce plâtre.
Le premier four qui eft prefque vuide fait voir
comment le plâtrier difpofe les pierres en forme de
pont de piufieurs arches, chacune affez grande pour
qu’un homme ordinaire puiffe y marcher en s’appuyant
fur les genoux & lur les mains ; le vuide de
chacune de ces arches forme un berceau qui s’étend
jufqu’àu fond du four. Le troifieme eft entièrement
rempli; la partie antérieure paroit comme un mur;
tout l’intérieur eft rempli de petits libages, comme
on le peut voir dans la figufe : après que le four eft
rempli, on met du bois fous les arcades ou berceaux,
& on y met le feu, que l’on entretient jufqu’à ce que
le plâtre foit calcine ; on le laiffe enfuite refroidir
pendant piufieurs jours : les Plâtriers reviennent en-
fuite pour le battre, c’eft-à- dire le réduire en poudre
; ils fe fervent pour cela du pic Sc duteftu ( voye[
les fig. ) , alors le plâtre eft entièrement achevé Sc
en état d’être vendu. Ils le mettent dans des facs re-
préfentés dans les figures, qui doivent contenir deux
boiffeaux. On voit aufli, même PI. un fac rempli de
plâtre, & lié avec fon cordon, un fac vuide Sc la
pelle qui fert à mettre le plâtre dans les facs , à le
remuer lorfqu’on le bat, & à piufieurs autres ufages.
PLATRIERE, f. f. ( Maçonn. ) nom commun & à
la carrière d’oii l’on tire la pierre de plâtre, Sc au
lieu où on la cuit dans les fours : les meilleures plâ-
trieres font celles de Montmartre près Paris. {D . J .)
PLATROUOIR, f. m. terme de Maçon , outil de
maçon pour pouffer la brique ou la pierre avec le
plâtre dans les trous, quand ils font quelqu’ouvrage.
■
PLATUSE ou PLATTUSE. Voyei Pl ie .
P L A T Y S M A-M Y O D E S , en Anatomie. Voye{
P e a u s s ie r s .
PLAVEN, ( Géog. mod.) ville d’Allemagne, au cercle
de la baffe Saxe, dans le duché de Meckelbourg,
fur les confins de la marche de Brandebourg, fur le
bord feptentrional de l’Elde, à neuf milles de Swe-
r in , près d’un lac qui en prend le nom de Plavencie.
Long.30.j8. ! | | (U . / . )
Pl a v e n , ( Géog. mod.) ville d’Allemagne, dans
l’électorat de Saxe, au Voigtland, fur l’Eftert, à un
mille d’Olsnitz, & à 26 au fud-eft de Drefde. C’ eft
une des plus confidérables de celles qui appartiennent
à l’eleéteur dans le Voigtland. Long. 29. 55. lat.
âo. 28.
Je connois deux théologiens nçs à Plaven, en Voigtland
: le premier eft Peheims ( Chriftophe), mort à
Bremen en 1604, à 65 ans. Il a publié un commentaire
latin fur la genèfe, Sc des ouvrages polémiques,
qui font tombés dans l’oubli.
L’autre théologien don$ je veux parler eft Frant-
fius (Wolfgang). Il mourut profeffeur en théologie
à Wittemberg en 1628, âgé de 643ns. Il publia grand
nombre d’écrits concernant des controverfes théologiques
, mais il fit un livre plus recherché , c’eft fon
Hiftoria Jacra animalium , imprimée piufieurs fois en
Allemagne. (D .J .)
PLAUSIBLE , adj. PLAUSIBILITÉ ,f. f. {Gram.)
terme relatif à l’aequiefeement, au confentement, à
lâ croyance que nous donnons à quelque chofe. Ce
fait eft plaufible. Cette doctrine eft plaufiblc. Il y a
quelque plaufibilitè dans cette accufation.
PLAYE, f. f. Voye{ PLAIE.
PLÉBÉIEN , adj. Sc fubft. {Hiß. rom.) on nommoit
plébéiens tous ceux qui ne defeendoient pas de premiers
fénateurs dont Romulus forma le fénat, Sc de
ceux qui y furent appelles par les rois qui fuccéde-
rent à Romulus. Un plébéien pouvoit devenir fénateur
par le choix des cenfeurs, lorfqu’il avoit la quantité
de biens ordonnée par les lois pour être du corps
du fénat ; mais il ne ceffoit pas d’être plébéien , puif-
qu’il ne defeendoit pas des anciens fénateurs. De
même un patricien qui n’avoit pas affez de bien pour
être fénateur pouvoit être mis parles cenfeurs dans
l’ordre des chevaliers , Sc ne ceffoit pas pour cela
d’être patricien, puifqu’il fortoit de famille patricienne.
Enfin un patricien qui n’étoit ni chevalier, ni fe-
nateur , étoit néceffairement du peuple fans être plébéien
; de forte qu’un citoyen pouvoit être en même
tems patricien Sc du peuple, fenateur Sc plébéien, patricien
Sc fénateur , ou tout enfemble patricien , fénateur
Sc chevalier, ou plébéien, fénateur Sc chevalier
, ou plébéien Sc du peuple, &c.
Originairement les feuls patriciens faifoient le corps
de la nobleffe romaine ; mais dans la fuite les plébéiens
qui furent admis aux grandes charges de la république
devinrent nobles en même tems,& eurent le droit
d’avoir les images Sc les portraits de leurs ancêtres.
Enfin , ceux qui n’en avoient point ni de leurs ancêtres
, ni de leur chef, comme les nouveaux nobles
qui étoient appeliés novi, ceux, dis-je, qui n’a voient
ni les unes, ni les autres, étoient ce que nous appelions
aujourd’hui roturiers.
Comme depuis la feizieme année du banniffement
de Tarquin on ne voyoit plus dans la république romaine
que des difputes continuelles ; ces difputes ,
qui durèrent plus de quarante ans; donnèrent lieu à
la demande que firent les plébéiens d’un corps de droit
félon lequel ils puffent être gouvernés, Sc être à l’abri
des vexations des patriciens.
Il paroit par ce que difgnt Tite-Live Sc Denis d’Ha-
licarnaffe que les plébéiens fe plaignoient de deux cho-
fes ; favoir, de ce qu’on violoit leurs privilèges dans
toutes les occafions, Sc de ce que dans le gouvernement
les patriciens fuivoient plutôt leur volonté que
les loix. Ces plaintes donnèrent occafion à de grands
troubles, Sc à la création des tribuns dont l’autorité
s’éleva fur celle des patriciens , Sc les força d’accorder
aux plébéiens les loix qu’ils demandoient. Je fuis
entré dans les principes de ces révolutions au mot
Pa t r ic ie n . {D. J.)
P l é b é ie n s j e u x , {Antiq. rom.) c’étoiênt des jeux
que le peuple romain célebroit en mémoire de la paix
qu’il fit avec les fénateurs après qu’il fut rentré dans
la ville d’où il étoit forti, pour fe retirer fur le mont
Aventin. D’autres difent, que ce fut après fa première
réconciliation au retour du mont Sacré, l’an
261 de la fondation de Rome , Sc 493 avant Jefus-4
Chrift. Quelques-uns veulent que ces jeux aient été
inftitués pour témoigner une réjouiffance publique
c e ce que les rois avoient été chafîcs de Rome l’an
24ç , Sc 509 avant J. C. après^Ia viéloire remportée
par le dictateur Pofthumius au lac Regille fur les Latins
, Sc de ce que le peuple avoit commencé alors
de jouir de la liberté. On les faifoit dans le cirque
pendant trois jours, Sc on les commençoitle 17 avant
les calendes de Décembre, qui répond au 15 de Novembre.
Leur nom latin étoit ludiplebeii. Adrien inf-
îitua des jeux plébéiens du cirque l’an 874 de, la fondation
de Rome, c’eft-à-dire, la 121 année de l’ere chrétienne.
{D . J.)
PLÉBISCITE, {Jurifprudence?) étoit ce que le peuple
romain ordonnoit féparement des fénateurs Sc
des patrices fiir la réquifition d’un de fes magiftrats,
c ’eft-à-dire, d’un tribun du peuple.
Il y avoit au commencement piufieurs différences
entre les plébifcites Sc les loix proprement dites.
i° . Les lois, leges, étoient les conftitutions faites
par les rois Sc par les empereurs, où par le corps de la
république, au lieu que les plébifcites étoient l’ouvrage
du peuple feu l, c’eft-à-dire, des plébéiens.
2°. Les lois faites par tout le peuple du tems de la
république étoient provoquées par un magiftrat patricien.
Les plébifcites fe faifoient fur la réquifition
d’un magiftrat plébéien, c’eft-à-dire , d’un tribun du
peuple.
30. Pour faire recevoir une lo i, il falloit que tous
les différens ordres du peuple fuffent affemblés, au
lieu que le plébifcite émanoit du feul tribunal des plébéiens
; car les tribuns du peuple ne pouvoient pas
convoquer les patriciens , ni traiter avec le fénatv
4*. Les loix fe publioient dans le champ de Mars ;
les plébifcites fe faifoient quelquefois dans le cirque
de Flaminius, quelquefois au capitôle, Sc plus fou-
yent dans les comices.
50. Pour faire recevoir une lo i, il falloit affembler
les comices par centuries ; pour les plébifcites on af-
iembloit feulement les tribuns, Sc l’on n’avoit pas be-
foin d’un fénatus-confulte ni d’arufpices: i ly a cependant
quelques exemples de plébifcites pour lefquels les
tribuns examinoient le vol des oifeaux, Sc obfervoient
les mouvemens du ciel avant de préfenter le plébifcite
aux tribus.
6°. C’étoient les tribuns qui s’oppofoient ordinairement
à l’acceptation des lois, oc c’étoient les patriciens
qui s’oppofoient aux plébifcites.
Enfin, la manière de recueillir les fuffrages étoit
'fon différente ; pour faire recevoir un plébifcite, on
becueilloit fimplement les voix des tribus , au lieu
que pour une loi il y avoit beaucoup plus de cérémonie.
Ce qui eft de fingulier, c’eft que les plébifcites, quoique
faits par les plébéiens feuls, ne laiffoient pas d’obliger
aufli les patriciens.
Le pouvoir que le peuple avoit de faire des loix
ou plébifcites lui avoit été accordé par Romulus, lequel
ordonna que quand le peuple feroitaffemblé dans
la grande place , ce que l’on appelloit Vaffemblée des
comices , il pourroit faire des lois ; Romulus vouloit
par ce moyen rendre le peuple plus fournis aux lois
qu’il avoit faites lui-même, Sc lui ôter l’ocçafion de
murmurer contre la rigueur de la loi.
Sous les rois de R ome, Sc dans les premiers tems
de la république, les plébifcites n’avoient force de loi
qu’après avoir été ratifiés par le corps des fénateurs
affemblés.
Mais fous le cônfulat de L. Valerius, & de M. Ho-
ratius, ce dernier fit publier une loi qui fut appellée
de fon nom koratia ; par laquelle il fut arrêté que tout
ce que le peuple féparé du fénat ordonneroit, auroit
la même force que fi les patriciens Sc le fénat l’euf-
fent décidé dans une affemblée générale.
Depuis cette lo i, qui fut renouvellée dans la fuite
par piufieurs autres, il y eut plus de lois faites dans
Tome XF%
des àffemblées particulières du peuplé, que dans lés
affemblées generales où les.fénateurs fe trouvoient.
Les plébéiens enflés de la prérogative que leur
avoit accordé la loi horatia > affeélerent de faire un
grand nombre de plébifcites pour anéantir ( s’il étoit
poflible ) l’autorité du fénat ; ils allèrent même jufqu’à
donner le nom de lois à leurs plébifcites.
Le pouvoir légiflatif que le fénat & le peuple exer-
çoient ainfi par émulation, fut transféré à l’empereur
du tems d’Augufte par la loi regia, au moyen de quoi
il ne fe fit plus de plébifcites.
On peut voir fur cette matière le tit. 2. dit liv. I.
du digefteleg, 2. §. 28. Sc aux inftituts le §. 4. du tit. 2-.
liv. I. Sc la jurijpudence romaine de M. Terraffon4
( ^ ) :
PLECTRONITÆ, {Hifl. nat.) nom employé par
quelques naturaliftes pouf défigner les dents de poif-.
fons, minces, Sc femblables à des ongles d’oifeaux
pétrifiés.
P LE CT RUM , f. m. ( Mujîque injlrum. ancienne. )
efpece d’archet court, ou baguette faite d’ivoire, ou
de bois poli, avec laquelle le muficien touchoit les
cordes d’un infiniment pour en tirer les fons: ce mot
vient de nXimuv, frapper. Les anciens avoient des
iuftrumens à cordes fur lefquels on jouoit fans plec-
trum. , comme le magadis ; & d’autres où on s’en fer-
voit toujours comme le luth. C ’étoit aufli dans les
commencemens l’ufage de ne toucher la lyre qu’avec
le plecirum ; enfuite la mode vint de n’en pincer les
cordes qu’avec les doigts.
Le leéleur curieux trouvera toutes les diverfes formes
de plectres dans Pignorius , dans Montfaucon ,
dans Buonarroti, offervajîone fopra i Medaglioni, Sc
dans d’autres antiquaires. {D . J.)
PLEIADES, voye^ l'article Pl e y ADES.
PLEIBURG , ( Géog. mod.) petite v ille d’Allemagne
au cercle d’Autriche , dans la Carinthie, fur la
Frey ftriétz, au pié d’une haute montagne avec un château.
PLEIGE , f. f. {Jurifprud.) eft un ancien terme de
pratique , qui fignifie caution ou fidejujfeur. Ducange
le dérive deplegius, terme de la baffe latinité , qui
fignifioit la même chofe.
Dans quelques coutumes pleige s’entend fingulie-
rement de celui qui fe porte caution judiciaire ; mais
dans d’autres,plege fe prend pour toute caution en
général.
L’article des placites de Normandie porte que l’obligation
du pleige eft éteinte quand la dette eft payée
parle principal obligé, lequel néanmoins peut fubro-,
ger celui qui fournit les deniers pour acquitter la
dette à l’hypothèque d’icelles fur fes biens feulement,
Sc non fur ceux du pleige. Voye\_ C a u t io n , Fid e -
ju s s e u r , O b l ig a t io n 'p r in c ip a l e . {A)
PLEIN , REMPLI, adj. {Synon.) il n’en peut plus
tenir dans ce qui eft plein. Qn n’en peut pas mettre
davantage dans ce qui eft rempli. Le premier a un
rapport particulier à la capacité du vaiffeau ; Sc le fécond
à ce qui doit être reçu dans cette capacité.
Aux noces de Cana les pots furent remplis d’eau
Sc par miracles ils fe trouvèrent pleins de vin. Girard* fin 1
Pl e in , f. m. en Phyfique , eft un terme ufité pour
fignifier cet état des chofes où chaque partie de l’ef-
pace ou de l’étendue eft fuppofée entièrement remplie
de matière. Voye{ Ma t iè r e & Es p a c e .
On dit le plein, par oppofition au vuide , qui eft
un efpace que l’on fuppofe deftitué de toute ma*
tiere.
Les Cartéfiens foutiennent le plein abfolu. Leur
principe eft que l’effence de la matière confifte dans
rétendue;d’où effeélivement il eft naturel de conclure
, qu’il y a de la matière partout où il y a de l’efpa-
ce ou de l’étendue. Hoye^ Etendue.
C C c C C ij