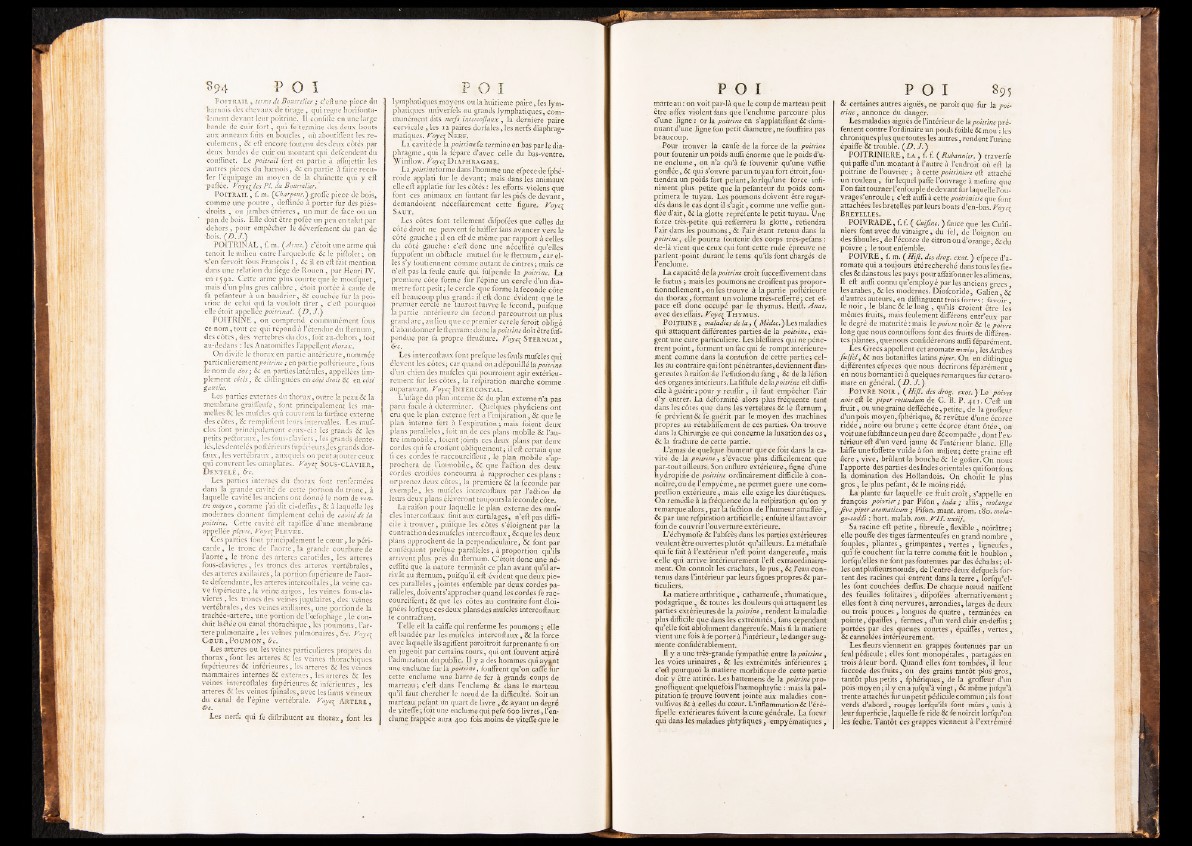
P o it r a il , terme de Bourrelier ; c’eft une piece du
harnois des chevaux de tirage, qui régné horifonta-
dement devant leur poitrine. Il confifte en une large
bande de cuir fo r t , qui fe'termine des deux bouts
■ aux anneaux faits en boucles, où aboutiffent les re-
culemens, 6c eft encore foutenu des deux cotes par
deux bandes de cuir ou montant qui defeendent du
couflïnet. Le poitrail fert en partie A affujettir les
autres pièces du harnois, & en partie à faire reculer
l’équipage au moyen dé la chaînette qui y eft
p allée. Voye? les PL du Bourrelier. '
Po it r a i l , f. m. (Charpenté) greffe piece de bois,
•comme une poutre , delHnée à porter fur despiés-
droits , ou jambes étrieres , un mur de face ou un
'pan de bois. Elle doit être pofée un peu en talut par
dehors, pour empêcher le déverfement du pan de
-bois. (£>. /.)
POITRINAL, f. m. (ArmeS) c’étoit une arme qui
tenoit le milieu entre l’arquebufe & l e piftolet; on
’s’en fervoit fous François I , & il en eft fait mention
dans une relation du'fiége de Rouen , par Henri IV.
en 1592.' Cette arme plus courte que le moufquet,
-mais d’un plus gros calibre, étoit portée à caufe de
fa pefanteur A un baudrier, 6c couchée fur la poitrine
de celui -qui la vouloit tirer , c’eft pourquoi
elle étoit appellee poitrinaL (JD. ƒ.)
POITRINE, on comprend communément fous
ce nom, tout ce qui répond A l’étendue du fternum,
des côtes, des vertebres du dos, foit au-dehors, foit
au-dedans: les Anatomiftes l’appellent thorax.
On divife le thoraren partie antérieure , nommée
particulièrement poitrine ; en partie poftérieure, fous
le nom de dos; 6c en parties latérales, appellées amplement
côtés, 6c diftinguées en côté droit 6c en côté
■ gauche.
Les parties externes du thorax, outre la peau & la
membrane graiffeufe, font principalement lés mamelles
6c les mufcles qui couvrent la furface externe
des côtes, & remplirent leurs intervalles. Les mufcles
font principalement ceux-ci : les grands & les
petits pe£f oraux, les fous-claviers, les grands dentelés,
les dentelés poftérieurs fupérieurs,les grands dor-
faux, les vertébraux, auxquels on peut ajouter ceux
qui couvrent les omoplates. Voye£ So u s -c l a v ie r .,
D e n t e l é , &c.
Les parties internes du thorax font renfermées
dans la grande cavité de cette portion du tronc, A
laquelle cavité les anciens ont donné le nom de ventre
moyen, comme j’ai dit ci-deffus, 6c A laquelle les
modernes donnent Amplement celui de cavité de la
poitrine. Cette cavité eft tapifîee d’une membrane
appellée plevre. Voyeç Pl e v r e .
Ces parties font principalement le coeur, le péricarde,
le tronc de l’aorte, la grande courbure de
l ’aorte, le tronc des arteres carotides, les arteres
fous-clavieres, les troncs des arteres vertébrales,
des arteres axillaires, la portion fupérieure de l’aorte
defeendante, les arteres intercoftales, la veine cave
fupérieure, la veine azigos, les veines foiis-cla- :
vieres , les troncs des veines jugulaires, des veines
vertébrales, des veines axillaires, une portion de la
trachée-artere, une portion de l’oefophage , le conduit
laélée ou canal thorachique, les poumons, l’ar-
tere pulmonaire,. les veines pulmonaires, &c. Voye{
C oe u r ,P o u m o n , &c.
Les arteres ou les veines particulières propres du
thorax, font les arteres 6c les veines thorachiques
fupérieures'& inférieures, les arteres 6c lés veines
mammaires internes 6c externes, les arteres & les
veines intercoftales fupérieures 6c inférieures les
arteres 6c les veines fpinales, avec les finus veineux
du canal de l’épine vertébrale. Voye^ A r-t e r e
& g.
Les nerfs qui fe diftribuent au thorax, font les
lymphatiques moyens ou la huitième pa ire , les lymphatiques
univerfels ou grands lymphatiques, communément
dits nerfs in terco ftaux, la derniere paire
c e rv ic a le ., les 12 paires dorfales, les nerfs diaphragmatiques.
Voye^ N e r f .
La cavité de la poitrin e fe termine en bas par le diaphragme,
qui la fépare d’avec celle du bas-ventre.
’Winflow. Voye%_ DIAPHRAGME.
La poitrine forme dans l’homme une efpece de fphé-
roïde applati fur le devant; mais dans les animaux
elle eft applatie fur les côtés : les efforts violens que
font ces animaux en fautant furlespiés de devant,
demandoient néceffairement cette figure. Voy eç
S a u t .
Les côtes font tellement difpofées que celles du
côté droit ne peuvent fe baiffer fans avancer vers le
côté gauche ; il en eft de même par rapport à celles
du côté gauche: c’eft donc.une néceflité qu’elles
fuppofent un obftacle mutuel fur le fternum, car elles
s’y foutiennent comme autant de cintres; mais ce
n’eft pas la feule caufe qui fufpende la poitrin e. La
première côte forme fur l’épine un cercle d’un diamètre
fort petit; le cercle que forme la fécondé côte
eft beaucoup plus grand: il eft donc évident que le
premier cercle ne lauroit fuivre le fécond, puifque
la partie antérieure du fécond parcourrbit un plus
grand arc, au lieu que ce premier cercle feroit obligé
d’abandonner le fternum : donc la poitrine doit être fuf-
pendue par fa propre ftru&ure. Voye? S t e r n u m ,
&c.
Les intercoflaux font prefque les feuls mufcles qui
élevent les côtes ; car quand on a dépouillé la poitrine
d’un chien des mufcles qui pourroient agir extérieurement
fur les côtes, la refpiration marche comme
auparavant. Voye1 In t e r c o s t a l .
L’ufage du plan interne & du plan externe n’a pas
paru facile A déterminer. Quelques phyficiens ont
cru que le plan externe fert A l’infpiration, 6c que le
plan interne fert A l’expiration ; mais foient deux
plans parallèles, foit un de ces plans mobile 6c l’autre
immobile, foient joints ces deux plans par deux
cordes qui fe croifent obliquement; il eft certain que
fi ces cordes fe raccourciffent, le plan mobile s’approchera
de l’immobile, 6c que l’a&ion des deux
cordes croifées concourra A rapprocher ces plans :
orprenezdeux côtes , la première 6c la fécondé par
exemple, les mufcles intercoftaux par l’aâion de
leurs deux plans éléveront toujours la fécondé côte.
La raifon pour laquelle le plan externe des mufcles
intercoftaux finit aux cartilages, n’ eft pas difficile
A trouver, puifque les côtes s’éloignent par la
contraction des mufcles intercoftaux, 6c que les deux
plans approchent de la perpendiculaire, & font par
conféquent prefque parallèles, A proportion qu’ils
arrivent plus près du fternum. C ’étoit donc une néceflité
que la nature terminât ce plan avant qu’il arrivât
au fternum, puifqu’il eft évident que deux pièces
parallèles, jointes enfemble par deux cordes parallèles,
doivent s’approcher quand les Cordes fe raccourciffent;
6c que les côtes au contraire font éloignées
lorfque ces deux plans des mufcles intercoftaux
fe contrarient.
Telle eft la caiffe qui renferme les poumons ; elle
eft bandée par les mufcles intercoftaux, 6c la force
avec laquelle ils agiffent paroîtroit furprenante fi on
en jugeoit par certains tours, qui ont fouvent attiré
l’admiration du public. Il y a des hommes qui ayant
une enclume fur la p o itr in e , fouffrent qu’on cafle fur
cette enclume une- barre de fer A grands coups de
marteau ; c’eft dans l’enclume 6c dans le marteau
qu’il faut chercher le noeud de la difficulté. Soit un
marteau pefant un quart de livre , 6c ayant un degré
de yiteffe ; foit une enclume qui pefe 600 livres, l’enclume
frappée aura 400 fois moins de viteffe que le
marteau : on voit par-lA que le coup de marteau peut
être affez violent fans que l’enclume parcoure plus
d’une ligne : or la poitrine en s’applatiffant & diminuant
d’une ligne fon petit diamètre,nefouffrira pas
beaucoup.
Pour trouver la caufe de la force de la poitrine
pour foutenir un poids aufli énorme que le poids d’u-
ne enclume, on n’a qu’à fe fouvenir qu’une veflie-
gonflée, 6c qui s’ouvre par un tuyau fort étroit,fou-
tiendra un poids fort pefant,lorfqu’une force infiniment
plus petite que la pefanteur du poids comprimera
le tuyau. Les poumons doivent être regardés
dans le cas dont il s’agit, comme une veflie gonflée
d’air, 6c la glotte repréfente le petit tuyau. Une
force très-petite qui refferrera la glotte, retiendra
l’air dans les poumons, & l’air étant retenu dans la
poitrine, elle pourra foutenir des corps très-pefans :
de-lA vient que ceux qui font cette rude épreuve ne
parlent 'point durant le tems qu’ils font chargés de
l’enclume.
La capacité de fa poitrine croît fucceflivement dans
le foetus ‘9 mais les poumons ne croiffent pas proportionnellement
, on les trouve à la partie poftérieure
du thorax, formant un volume très-refferré; cet ef-
pace eft donc occupé par le thymus. Heift. Anat.
avec des effais. Voye^ T h ym u s .
Po it r in e , maladies de la , ( Médec. ) Les maladies
qui attaquent différentes parties de la poitrine, exigent
une cure particulière. Les bleffures qui ne pénètrent
point, forment un fac qui fe rompt intérieurement
comme dans la contufion de cette partie; celles
au contraire qui font pénétrantes, deviennent cfan-
gereufes A raifon de l’effufiondufang, & de laléfion
des organes intérieurs. La fiftule delà poitrine eft difficile
A guérir ; pour y reuflir , il faut empêcher l’air
d’y entrer. La déformité- alors plus fréquente tant
dans les côtes que dans les vertebres & le fternum ,
fe prévient & fe guérit par le moyen des'machines
propres au rétabliffement de ces parties. On trouve
dans la Chirurgie ce qui concerne la luxation des o s ,
6c la fraâure de cette partie.
L’amas de quelque humeur que ce foit dans la-cavité
de la poitrine, s’évacue plus difficilement que
par-tout ailleurs. Son enflure extérieure, ligne d’une
hydropifie de poitrine ordinairement difficile A con-
noître, ou de l’empyème, ne permet guere une com-
prefîion extérieure, mais elle exige les diurétiques.
On remédie A la fréquence de la refpiration qu’on y
remarque alors, par la futtion de l’humeur amaffée ,
6c par une refpiration artificielle ; enfuite il faut avoir
foin de couvrir l’ouverture extérieure.
L’échymofe & Pabfcès dans les parties extérieures
veulent être ouvertes plutôt qu’ailleurs. Lamétaftafe
qui fe fait A l’extérieur n’eft point dangereufe, mais
celle qui arrive intérieurement l’ eft extraordinairement.
On connoît les crachats, le pus, & l’eau contenus
dans l’intérieur parleurs lignes propres & particuliers.
La matière arthritique, catharreufe, rhumatique,
podagrique, & toutes les douleurs qui attaquent les
parties extérieures de la poitrine , rendent la maladie
plus difficile que dans les extrémités, fans cependant
qu’elle foit abfolument dangéreufe. Mais fi la matière
vient une fois A fe porter A l’intérieur, le danger augmente
confîdérablement.
Il y a une très-grande fympathie entre la poitrine,
les voies urinaires, 6c les extrémités inférieures ;
c’eft pourquoi la matière morbifique de cette partie
doit y être attirée. Les battemens de la poitrine pro-
gnoftiquent quelquefois l’hæmophtyfie : mais la palpitation
fe trouve fouvent jointe aux maladies con-
vulfives 6c A celles du coeur. L’inflammation & l’éré-
fipelle extérieures fuivent la cure générale. La fueur
qui dans les maladies phtyfiques, empyématiques,
& certaines autres aiguës, ne paroît que fur la poitrine,
annonce du danger.
Les maladies aiguës de l’intérieur de la poitrine pré-
fentent contre l’ordinaire un pouls foible &mou : les
chroniques plus que toutes les autres, rendent l’urine
épaiffe & trouble. (D . 7.)
POITRINIERE, l a , f. f. ( Rubannier. ) traverfe
qui paffe d’un montant A l’autre A l’endroit où eft la
poitrine de l’ouvrier ; A cette poitriniere eft attaché
un rouleau , fur lequel paffe l’ouvrage A mefure que
l’on fait tourner l’enfouple de devant fur laquelle l’ouvrage
s’enroule ; c’eft aufli A cette poitriniere que font
attachées les bretelles par leurs bouts d’en-bas. Voye?
B r e t e l l e s .
POIVRADE, f. f. ( Cuifine. ) fauce que les Cuifi-
niers font avec du vinaigre, du fel, de l’oignon ou
des fiboules, de l’écorce de citron ou d’orange, &du
poivre ; le tout enfemble,
POIVRE, f. m. ( Hiß. des drog. exot. ) efpece d’aromate
qui a toujours été recherché dans tous les fie-
cles & dans tous les pays pour affaifonner lès alimens.
Il eft aufli connu qu’employé par les-anciens grecs
les arabes, 6c les modernes. D iofcoride, Galièn 6c
d’autres auteurs, en diftinguent trois fortes ; favoir
le n oir, le blanc & le long , qu’ils croient être les
mêmes fruits, mais feulement différens entr’eux par
le degré de maturité : mais le poivre noir 6c le poivre
long que nous connoiffons font des fruits de différentes
plantes, que nous confidérerons aufli féparément.
Les Grecs appellent cet aromate m-n-ipi, les Arabes
fulfel, 6c nos botaniftes latins piper. On en diftingue
différentes efpeces que nous décrirons féparément
en nous bornant ici a quelques remarques fur cet aromate
en général. ( D. J. )
P o i v r e n o ir , ( Hiß. des drog. exot. ) Le poivre
noir eft. le piper rotundum de C. B. P. 41 1 . C ’eft un
fruit, ou une graine defféchée, petite, de la groffeur
d’un pois moyen, fphérique, & revêtue d’une écorce
ridée, noire ou brune ; cette écorce étant ôtée on
voit une fubftance un peu dure 6c compa&e, dont l’extérieur
eft d’un verd jaune 6c l’intérieur blanc. Elle
laiffe une foffette vuide à fon milieu ; cette graine eft
âcre, vive, brûlant la bouche & le gofier. On rions
l’apporte des parties des Indes orientales quifontfous
la domination des Hollandois. On chbifit le plus
gros, le plus pefant, 6c le moins ridé.
La plante-lur laquelle ce fruit croît, s’appelle en
françois poivrier ; par Pifon , lada ; aliis, molanga
five piper aromaticum ; Pifon. mant. arom. 180. mola-
go-coddi : hört, malab. tom. .VII. xxiij.
Sa racine eft petite, fibreufe, flexible , noirâtre;
elle pouffe des tiges farmenteufes en grand nombre ,
fouples, pliantes, grimpantes, vertes , ligneufes ,
qui fe couchent fur la terre comme feit le houblon ,
lorfqu’elles ne font pas foutenues par des échalas; elles
ontplufieursnoeuds, de l’entre-deux defquels fbr-
tent des racines qui entrent dans la terre, lorfqu’elles
font Couchées deffus. D e chaque noeud naiffent
des feuilles folitaires, difpofées alternativement ;
elles font A cinq nervures, arrondies, larges de deux
ou trois pouces , longues de quatre , terminées en
pointe, épaiffes , fermes , d’un verd clair endeffus ;
portées par des queues courtes , épaiffes, vertes ,
6c cannelées intérieurement.
Les fleurs viennent en grappes foutenues par un
feul pédicule ; elles font monopétales, partagées en
trois A leur bord. Quand elles font tombées, il leur
fuccede des fruits, ou des grains tantôt plus gros,
tantôt plus petits , fphériques, de la groffeur d’un
pois moyen ; il y en a jufqu’A vingt, & même jufqu’A
trente attachés lur un petit pédicule commun ; ils lont
verds d’abord, rouges lonqu’ils font mûrs, unis A
leur fuperficie, laquelle fe ride & fe noircit lorfqu’on
les feche. Tantôt ces grappes viennent A l’extremité