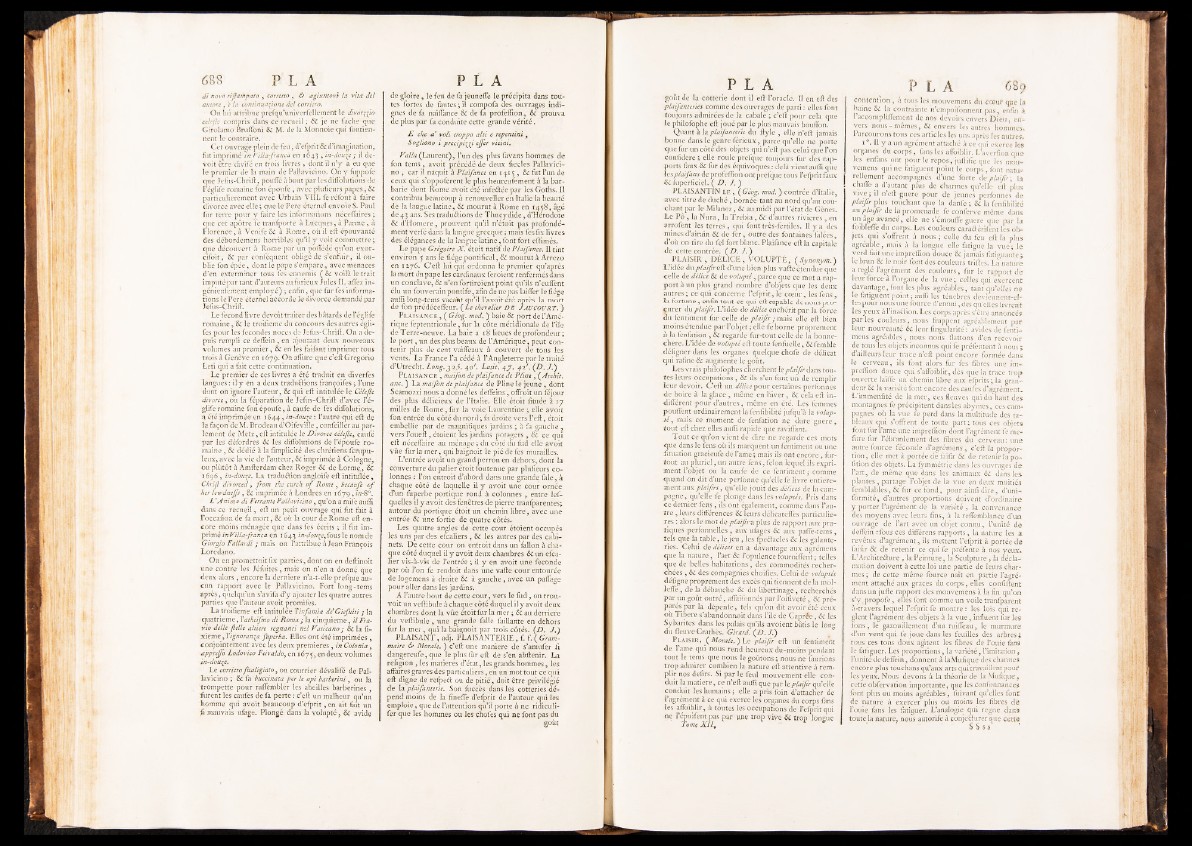
di novo riflatnpato , éorrttto , & agiuritovi la vica del
auton , h la continuanont del corriero.
On lui attribue prefqu’univerfellement le divorçfio
celefle compris dans ee recueil ; &c je ne lâche que
Girolamo Bruffoni & M. de la Monnoie qui foutien-
nent le contraire.
Cet ouvrage plein de feu, d’efprit & d’imagination,
fut imprimé in l'illa-franca en 1643 , in-dou^e ; il de-
voit être divifé en trois livres , dont il n’y a eu que
le premier de la main de Pallavicino. On y fuppofe
que Jefus-Chrift, pouffé à bout par les diffolutions de
l’églife romaine Ion époufe, avec plufieurs papes, &
particulièrement avec Urbain VIII. fe réfout à faire
divorce avec elle; que le Pere éternel envoieS. Paul
fur terre pour y faire les informations néceffaires ;
que cet apôtre fe tranfporte à Lileques, à Parme , à
Florence, à Venife & a Rome, où il eft épouvanté
des débordemens horribles qu’il y voit commettre ;
que découvert à Rome par un poffédé qu’on exor-
cifoit, & par conféquent obligé de s’enfuir , il oublie
fon épée,. dont le pape s’empare, avec menaces
d’en exterminer tous fes ennemis ( & voilà le trait
imputé par tant d’auteurs au furieux Jules II. afl'ez in-
génieufement employé) ; enfin, que fur fes informations
le Pere éternel accorde le divorce demandé par
Jefus-Chrift.
Le fécond livre devoit traiter des bâtards de l’églife
romaine, & le troifieme du concours des autres egli-
fes pour les fécondés noces de Jefus-Chrift. On a depuis
rempli cë deffein , en ajoutant deux nouveaux
volumes au premier, & en les faifant imprimer tous
trois à Genève en 1679. On affure que c’ eft Gregorio
Leti qui a fait cette continuation.
Le premier de ces livres a été traduit en diverfes
langues : il y en a deux traduftions françoifes ; l’une
dont on ignore l’auteur, & qui eft intitulée le Célejle
divorce, ou la féparation de Jefus-Chrift d’avec l’églife
romaine fon époufe, à caufe de fes diffolutions,
a été imprimée'.en 1644, in-dou^e : l’autre qui eft de
la façon de M. Brodeau d’Oifevillc, confeiller au parlement
de Metz, eft intitulée le Divorce célejle, caufé
par les défordres & les diffolutions de I’époufe romaine
, & dédié à la fimplicité des chrétiens fcrupu-
ïeux, avec la vie de l’auteur, & imprimée à Cologne,
ou plutôt à Amfterdam chez Roger & de Lôrme, &
1696, in-dou^e. La traduftion angloife eft intitulée,
Chrifl divorced, from the curch o f Rome , becaufe o f
her ïewdntjjs, & imprimée à Londres en 1679, in$°.
L'Anima di Ferrante Pallavicino, qu’on a mife aufli
dans ce recueil, eft un petit Ouvrage qui fut fait à
l ’occalion de fa mort, & où la cour de Rome eft encore
moins ménagée que dans fes écrits ; il fut imprimé
inVilla-franca en 1643 in-dou^e, fous le nom de
Giorgio Fallardi ; mais on l’attribue à Jean François
Loredano.
On en promettoit fix parties, dont on en deftinoït
une contre les Jéfuites, mais on n’en a donné que
deux alors , encore la derniere n’a-t-elle prefque aucun
rapport avec le Pallavicino. Fort Ion«*-tems
après, quelqu’un s’avifà d’y ajouter les quatre autres
parties que l’auteur avoit promifes.
La troifieme eft intitulée Yinfamia dé’Giefuiti ; la
quatrième, Yatheifmo di Roma ; la cinquième, il Fra-
vio délit Jlelle altiere regnanti nel Vaticano ; & la fi-
xieme, Yignorança fuptrba. Elles ont été imprimées ,
conjointement avec les deux premières, in Colonia,
apprejfo Lodovico Feivaldo, en 1675, en deux volumes
ïn-dou^e.
Le corriero fualigiato, ou courrier dévalifé de Pallavicino
; & fa buccinata per le api barberini , ou la
trompette pour raffemblér les abeilles barberines ,
furent les caufes de fa perte : c’eft un malheur qu’un
homme qui avoit beaucoup d’efprit, en ait fait un
fi mauvais ufage. Plongé dans la volupté, & avide
de g loire, le feu de fa jeuneffe le précipita dans toutes
fortes de fautes ; il compofa des ouvrages indignes
de fa naiflance & de fa profeflion, & prouva
de plus par fa conduite cette grande vérité.
£ che a’ voli troppo alti e repentini ,
Sogliono i precipiçfi ejfer vicini.
Valla (Laurent), l’un des plus favans hommes de
fon tems, avoit précédé de deux fiecles Pallavicino
, car il naquit à Plaifance en 1415 , & fut l’un de
ceux qui s’oppoferent le plus heureufement à la barbarie
dont Rome avoit été infe&ée par les Goths. Il
contribua beaucoup à renouveller en Italie la beauté
de la langue latine, & mourut à Rome en 14*8, âgé
de 43 ans. Ses traductions de Thucydide, d’Herodote
& d’Homere, prouvent qu’il n’étoit pas profondément
verfé dans la langue grecque ; mais fes fix livres
des élégances de la langue latine, font fort eftimés.
Le pape Grégoire X . étoit natif de Plaifance. Il tint
environ 5 ans fe fiége pontifical, 6c mourut à Arrezo
en 1276. C ’eft lui qui ordonna le premier qu’après
la mort du pape les cardinaux feroient renfermés dans
un conclave, & n’en fortiroient point qu’ils n’euffent
élu un fouverain pontife, afin de ne pas laiffer le fiége
aufli long-tems vacaht qu’il l’avoit été après la mort
de fon prédéceffeur. (Z.« chevalier d e J a u c o u r t . )
Plaisance , ( Géog. mod. ) baie & port de l’Amérique
feptentrionale, fur la côte méridionale de l’île
de Terre-neuve. La baie a 18 lieues de profondeur ;
le p o r t, un des plus beaux de l’Amérique, peut contenir
plus de cent vaiffeaux à couvert de tous les
vents. La France l’a cédé à l’Angleterre par le traité
d’Utrecht. Long. 325. 40'. Lotit. 4 J . 42'. (JD. ƒ.)
PLAISANCE , maifon de plaifance de Pline , (Archit.
anc. ) La maifon de plaifance de Pline le jeune , dont
Scamozzi nous a donné les deffeins, offroit un féjour
des plus délicieux de l’Italie. Elle étoit fituée à 17
milles de Rome, fur la voie Laurentine ; elle avoit
fon entrée du côté du nord ; fa droite vers l’eft, étoit
embellie par de magnifiques jardins ; à fa gauche ,
vers l’oueft, étoient les jardins potagers , & ce qui
eft néceffaire au ménage ; du côté du fud elle avoit
vue fur la mer, qui baignoit le pié de fes murailles.
L’entrée avoit un grand perron en dehors, dont la
couverture du palier étoit foutenue par plufieurs colonnes
: l’on entroit d’abord dans une grande fale, à
chaque côté de laquelle il y avoit une cour ornée
d’un fuperbe portique rond à colonnes , entre lef-
quelles il y avoit des fenêtres de pierre tranfparentes;
autour du portique étoit un chemin libre, avec une
entrée &c une fortie de quatre côtés.
Les quatre angles de cette cour étoient occupés
les uns par des efcaliers, & lés autres par des cabinets.
De cette cour on entroit dans un fallon à chaque
côté duquel il y avoit deux chambres & un efcâ-
lier vis-à-vis de l’entrée ; il y en avoit une fecônde
par où l’on fe rendoit dans une vafte cour entourée
de logemens à droite & à gauche, avec un paffage
pour aller dans les jardins.
A l’autre bout de cette cour, vers le fud, on trou-
voit un veftibule à chaque côté duquel il y avoit deux
chambres dont la vue etoit fur la mer ; & au derrière
du veftibule, une grande falle faillante en dehors
fur la mer, qui la baignoit par trois côtés. (D . J.)
PLAISANT, adj. PLAISANTERIE, f. f. ( Grammaire
& Morale. ) c’e'ft une maniéré de s’amufer .fi
dangereufe, que le plus fur eft de s’en abftenir. La
religion , les matières d’état, les grands hommes, les
affaires graves des particuliers, en un mot tout ce qui
eft digne de refpeft ou de pitié, doit être privilégié
de la plaifanterie., Son fuccès dans les cotterieS dépend
moins de la fineffe d’efprit de l’auteur qui les
emploie, que de l’attention qu’il porte à ne riaiculi-
fer que les hommes ou les cnofes qui ne font pas du
goût de la cotterie dont il eft l’oracle. Il en eft: des
plaifanteries comme des ouvrages de parti : elles font
toujours, admirées de la cabale; c’eft pour cela que
le philofophe eft joué par le plus mauvais bouffon.
Quant à la plaifanterie du ftyle , elle n’eft jamais
bonne dans le genre férieux, parce qu’elle ne porte
que fur un côte des objets qui n’eft pas celui que l’on
confidere ; elle roule prefque toujours fur des rapports
faux &c fur des équivoques : delà vient aufli que
lesplaifans de profeflion ont prefque tous l’efpritfaux
& fuperficiel. ( D. J. )
PLAISANTIN le , (Géog. mod. ) contrée d’Italie,
avec titre de duché, bornée tant au nord qu’au couchant
par le Milanez, & au.midi par l’état de Gènes.
Le Pô , la Nura, la Trebia , & d’autres rivières , en
arrofent les terres , qui font très-fertiles. Il y a des
mines d’airain & de fe r , outre des fontaines falées
d’où on tire du fel fort blanc. Plaifance eft la capitale
de cette contrée. ( D . J. )
PLAISIR , DÉL ICE, VOLUPTÉ, (Synonym.)
L’idée duplaifir eff d’une bien plus vafte étendue que
celle de délice & de volupté, parce que ce mot a rapport
à un plus grand nombre d’objets que les deux
autres ; ce qui concerne l’efprit, le coeur, les fens ,
la fortune, enfin tout ce qui eft capable de nous procurer
du plaifir. L’idée de délice enchérit par la force
du fentiment fur celle de plaifir ; mais elle eft bien
moins étendue par l’objet ; elle fe borne proprement
à la fenfation , & regarde fur-tout celle de la bonne-
chere. L’idée de volupté eft toute fenfuelte, &femble
défigner dans les organes quelque chofe de délicat
qui rafine & augmente le goût.
Les vrais philofophes cherchent le plaifir dans toutes
leurs occupations , & ils s’en font un de remplir
leur devoir. C’eft un délice pour certaines perfonnes
de boire à la glace , même en hiver, & cela eft indifférent
pour d’autres, même en été. Les femmes
pouffent ordinairement la fenfibilité jufqu’à la volupté
, mais ce moment de fenfation ne dure guere,
tout eft chez elles aufli rapide que raviffant.
Tout ce qu’on vient de dire ne regarde ces mots
que dans le lens où ils marquent un fentiment ou une
fituation gracieufe de l’ame ; mais ils ont encore, fur-
tout au pluriel, un autre fens, félon lequel ils expriment
l’objet ou la caufe de ce fentiment ; comme
quand on dit d’une perfonne qu’elle fe livre entièrement
aux plaifir s , qu’elle jouit des délices de la campagne
, qu’elle fe plonge dans les voluptés. Pris dans
ce dernier fens , ils ont également, comme dans l’autre
, leurs différences & leurs délicateffes particulières
: alors le mot de plaifir a plus de rapport aux pratiques
perfonnelles , aux ufages & aux paffe-tems,
tels que la table, le jeu , les fpeélacles & les galanteries.
Celui de délices en a davantage aux agrémens
que la nature, l’art & l’opulence fourniffent; telles
que de belles habitations , des commodités recherchées
, & des compagnies choifies. Celui de voluptés
défigne proprement des excès qui tiennent de là mol-
leffe, de la débauche & du libertinage, recherchés
par un goût outré, affaifonnés par l’oifiveté, & préparés
par la dépenfe, tels qu’on dit avoir été ceux
où Tibere s’abandonnoit dans l’île de Caprée, & les
Sybarites dans les palais qu’ils avoient bâtis le long
du fleuve Crathès. Girard. (D . J.)
Pl a is ir , ( Morale. ) Le plaifir eft un fentiment
de l’ame qui nous rend heureux du-moins pendant
tout le tems que nous le goûtons ; nous ne faurions
trop admirer combien la nature eft attentive à remplir
nos defirs. Si par le feul mouvement elle conduit
la matière, ce n’eft aufli que par le plaifir quelle
conduit les humains ; elle a pris foin d’attacher de
l’agrement à ce qui exerce les organes du corps fans
les affoiblir, à toutes les occupations de l’efprit qui
ne l’épuifent pas par une trop vive & trop longue
Tome X I f
contention, à tous les mouvemens du coéuf qjtë là
haine & la contrainte n’empoifonnent pas, enfin à
l’accompliffement de nos devoirs envers Diëti, envers
nous - mêmes, & envers les autres hommes*
Parcourons tous ces articles les uns après les autres*
i° . Il y a un agrément attaché à ce qui exerce le»
organes du corps, fans les affoiblir. L’averfion que
les enfans oht pour le repos, juftifie que les moù-
vemens qui ne fatiguent point le corps, font naturellement
accompagnés d’une forte de plaifir ; là
chaffe a d’autant plus de charmes qu’elle eft plus
vive ; il n’eft guere pour de jeunes perfonnes de
plaifir plus touchant que la danfe ; & la fenfibilité
au plaifir de la promenade fe conferve même dans
un âge avancé, elle ne s’émouffe guere que par la
foibleffe du corps. Les couleurs cara&érilent les Objets
qui s’offrent à nous ; celle du feu eft la pliis
agréable, mais à la longue elle fatigue la vue ; le
verd fait une impreflion douce & jamais fatiguante ;
le brun & le noir font des couleurs triftes. La nature
a réglé l’agrément des couleurs, fur le rapport de
leur force à l’organe de la vue; celles qui exercent
davantage, font les plus agréables, tant qu’elles ne
le fatiguent point; aufli les ténèbres deviennent-elles
pour nous une fource d’ennui, dès qu’elles livrent
les yeux à l’inattion.Les corps après s’être annoncés
par les couleurs, nous frappent agréablement paf
leur nouveauté &: leur fingularité : avides de fenti-
mens agréables, nous nous flattons d’èn recevoir
de tous les objets inconnus qui fe préfentent à nous ;
d’ailleurs leur trace n’eft point encore formée dans
le cerveau, ils font alors fur fes fibres une im*
preflion douce qui s’affoiblit, dès que la tracé trop
ouverte laiffe un chemin libre aux efprits; la grandeur
& la variété font encore des caufes d’agrément.
L’immenfité de la mer, ces fleuves qui du haut des
montagnes fe précipitent dans les abymes, ces campagnes
où la vue le perd dans la multitude des tableaux
qui s’offrent de toute part ; tous ces objets
font fur l’ame une impreflion dont l’agrément fe me-»
fure fur l’ébranlement des fibres du cerveau : une
autre fource féconde d’agrémens , c’eft la proportion,
elle met à portée de faifir & de retenir la po-»
fition des objets. La fymmétrie dans les ouvrages de
l’art, de même que dans les animaux & dans les
plantes, partage l’objet de la vue en deux moitiés ■
lemblables, & fur ee fond, pour ainfi dire, d’uniformité,
d’autres proportions doivent d’ordinaire
y porter l’agrément de la variété , la convenance
des moyens avec leurs fins, à la reffemblance d’un
ouvrage de l’art avec un objet connu, l’unité de
deffein : fous ces différens rapports, la nature les â
revêtus d’agrément, ils mettent l’efprit à portée de
faifir & de retenir ce qui fe préfente à nos yeux*.
L’Architeûure, la Peinture, la Sculpture, la déclamation
doivent à cette loi une partie de leurs charmes
; de cette même fource naît en partie l’agrément
attaché aux grâces du corps, elles confinent
dans un jufte rapport des mouvemens à la fin qu’on
s’y .propofe, elles font comme un Voile tranfparent
à-travers lequel l’efprit fe montre : les lois qui règlent
l’agrément des objets à la vue, influent fur les
fons, le gazouillement d’un ruiflèau, le murmure
d’un vent qui fe,joue dans les feuilles des arbres^
tous ces tons doux agitent les fibres de' l’ouie fans
le fatiguer. Les proportions, la variété, l’imitation,
l’unité de deffein, donnent àlaMufique des charmes
encore plus touchans qu’aux arts qui travaillent pouf*
les yeux. Nous devons à la théorie de la Mufique,
cette obfervation importante, que les confonnances
font plus ou moins agréables, fuivant qu’elles font
de nature à exercer plus ou moins les fibres dâ
l’ouie fans les fatiguer. L’analogie qui régné dans
toute la nature, nous autorife à çonjeéturerque cettâ
S S s s