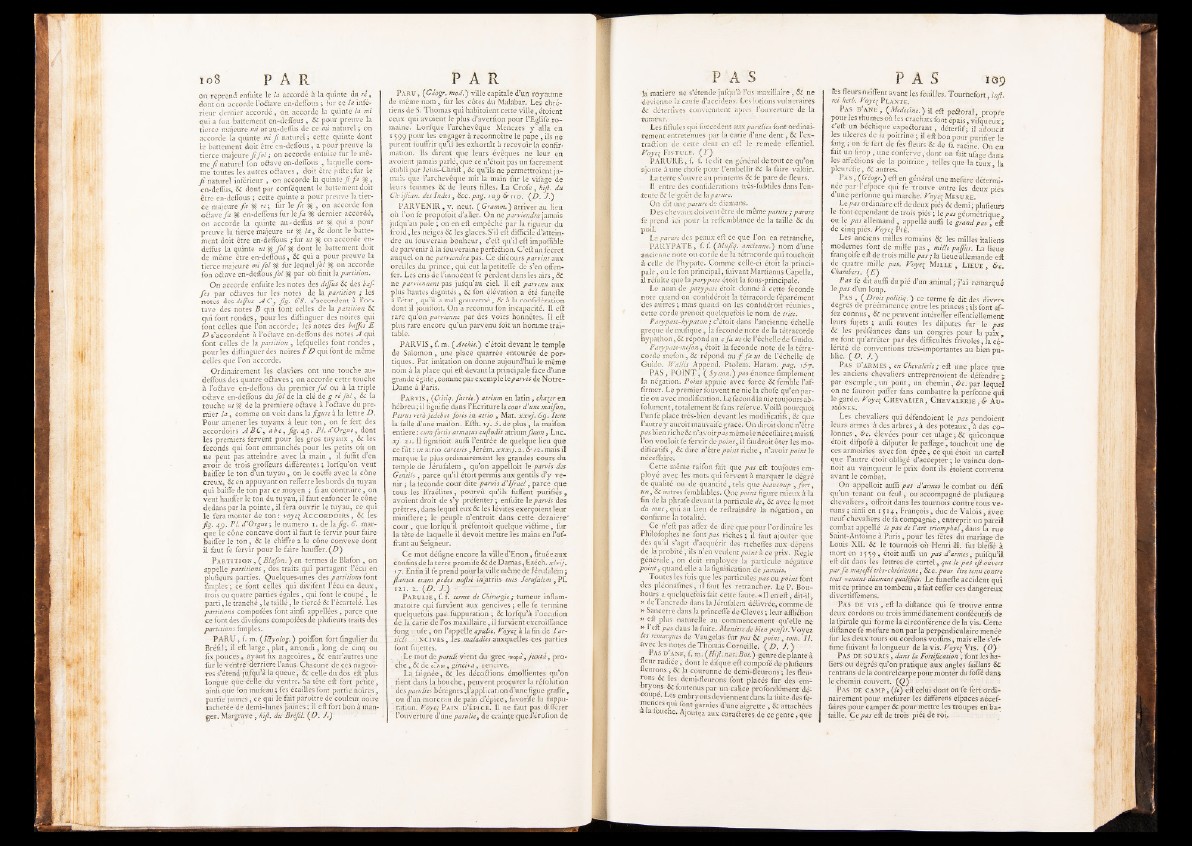
ou reprend enfuite le la accorde à la quinte du te ^
dont on accorde l’oûave en-deffous ; fur ce la inférieur
dernier accordé, on accorde la quinte la mi
qui a fon battement en-deffous, 6c pour preuve la
tierce majeure mi ut au-deffus de ce mi naturel ; on
accorde la quinte mi f i naturel ; cette quinte dont
le battement doit être en-deffous, a pour preuve la
tierce majeure f i fo l ; on accorde enfuite fur le même
ƒ naturel fon ottave en-deffous , laquelle comme
toutes les autres oftaves, doit etre jufte;fùr le
f i naturel inférieur , on accorde la quinte f i fa ^ ,
en-deffus, & dont par conféquent le battement doit
être en-deffous ; cette quinte a pour preuve la tierce
majeure fa % re ; fur le f i % , on accorde fon
oftave fa % en-deffous fur le fa % dernier accordé,
on accorde la quinte au-deffus ut % qui a pour
preuve la tierce majeure ut % la, 6c dont le battement
doit être en-deffous ; fur ut on accorde endeffus
la quinte ut fo l % dont le battement doit
de même etre en-deffous, 6c qui a pour preuve la
tierce majeure mi fo l % fur lequel fo l % on accorde
fon oftave en-deffous fo l % par oii finit la partition.
On accorde enfuite les notes des dejfus 6c des baffes
par oâaves fur les notes de la partition ; les
notes des deffus A C , fig. 68. s’accordent à l’octave
des notes B qui l'ont celles de la partition 6c
qui font rondes, pour les diftinguer des noires qui
font celles que l’on accorde ; les notes des baffes E
D s’accordent à l’o&ave en-deffous des botes A qui
font celles de la partition , lefquelles font rondes ,
pour les diftinguer des noires F D qui font de même
celles que l’on accorde.
Ordinairement les claviers ont une touche au-
deffous des quatre oftaves ; on accorde cette touche
à l’oâave en-deffous du premier fo l ou à la triple
oftave en-deffous du fo l de la clé de g ré f o l , 6c la
touche ut % de la première oftave à l’oâave du premier
la , comme on voit dans la figure à la lettre D.
Pour amener les tuyaux à leur ton , on fe fort des
accordoirs A B C , a b c , fig. 4$. PI. £ Orgue, dont
les premiers fervent pour les gros tuyaux , 6c les
féconds qui font emmanchés pour les petits où on
ne peut pas atteindre avec la main , il fufiit d’en
avoir de trois groffeurs différentes ; lorfqu’on veut
baiffer le ton d’un tuyau, on le coëffe avec le cône
creux, & en appuyant on refferre les bords du tuyau
qui baiffe de ton par ce moyen ; fi au contraire, on
veut hauffer le ton du tuyau, il faut enfoncer le cône
dedans par la pointe, il fera ouvrir le tuyau, ce qui
le fera monter de ton: voye^ A c co rd o ir s , 6c les
fig. 49. PL d'Orgue ; le numéro 1. de la fig. 6. marque
le cône concave dont il faut fe fervir pour faire
baiffer le ton , & le chiffre 1 le cône convexe dont
il faut fe fervir pour le faire hauffer. (D )
Pa rt it io n , ( Blafons) en termes de Blafon , on
appelle partitions, des traits qui partagent l’écü en
plufieurs parties. Quelques-unes des partitions font
fimplës ; “ce font celles qui divifent l’écuen deux,
trois ou quatre parties égales , qui font le-coupé, le
parti, le tranché , le taillé, le tiercé 6c l’écartelé. Les
partitions compofées font ainfi appellées, parce que
ce font des divifions compofées de plufieurs traits des
partitions Amples.
PA RU , f. m. ( lelyolog. ) poiffon fort fingulier du
Bréfil; il eft large , plat , arrondi, long de cinq ou
focpouces, ayant fix nageoires , & entr’autres une
fur lé ventre’ derrière,1’anus. Chacune de.ces nageoires
s’étend jufqu’à la queue , 6c celle du dos ëft plus
longue qiire celle du ventre-Sa tête eft fort petite,
ainfi que fon niufeau ; fes écailles font partie noires,
parti er jaunes-, ce qui le fait pâfoitre de" couleur boire
tachetée- de demi-lunes jaunes ; il eft fort bdh à mander..
Margrave, hifi. du B réfil. (D . J.)
Paru , (Géogr. mod.') ville capitale d’un royaume
de même nom, fur les côtes du Malabar. Les chrétiens
de S. Thomas qui habitoient cette v ille , étoient
ceux qui avoient le plus d’averfion pour l’Eglife romaine.
Lorfque l’archevêque Menezes y alla en
1599 Püur ^es engager à reconnoître le pape , ils ne
purent fouffrir qu’il les exhortât à recevoir la confirmation.
Us dirent que leurs évêques ne leur en
avoient jamais parlé, que ce n’étoit pas un facrement
établi par Jefus-Chrift, 6c qu’ils ne permettroient jamais
que l’archevêque mît la main fur le vifage de
leurs femmes & de leurs filles. La C ro fe, hifi. du
Ckrifiian. des Indes, 6cc.pag. 10g & n o . (D . J.)
PARVENIR, v. neut. ( Gramm. ) arriver au lieu
où l’on fe propofoit d’aller. On ne parviendra jamais
jufqu’au pôle ; on en eft empêché par la rigueur du
froid, les neiges 6c les glaces. S’il eft difficile d’atteindre
au fouverain bonheur, c’eft qu’il eft impoffible
de parvenir à la fouveraine perfeftion. C ’eft un fecret
auquel on ne parviendra pas. Ce difcours parvint aux
oreilles du prince, qui eut la petiteffe de s’en offen-
fer. Les cris de l’innocent fe perdent dans les airs, &
ne parviennent pas jufqu’au ciel. Il eft parvenu aux
plus hautes dignités, 6c fon élévation a été funefte
à l’état, qu’il a mal gouverné, & à la confidération
dont il jouifloit. On a reconnu fon incapacité. Il eft
rare qu’on parvienne par des voies honnêtes. Il eft
plus rare encore qu’un parvenu foit un homme traitable.
PARVIS, f. m. ( Archit.) c’ étoit devant le temple
de Salomon, une place quarrée entourée de portiques.
Par imitation on donne aujourd’hui le même
nom à la place qui eft devant la principale face d’une
grande églife, comme par exemple le parvis de Notre-
Dame à Paris.
P a r v i s , (Cùtiq. facrée.') atrium en latin, chaçer en
hébreu ; il fignifie dans l’Ecriture la cour d'une maifon.
Petrus verb Jedebat forts in atrio , Mat. xxvj. 6$. Item
la falle d’une maifon. Efth. vj. 5. de plus, la maifon
entière: cum fortis armatus cuflodit atriumyùa/7z, Luc.
xj. 2/. Il fignifioit auffi l’entrée de quelque lieu que
ce fut : in atrio carceris , Jérém. xxxij. 2. & 12. mais il
marque le plus ordinairement les grandes cours du
temple de Jérufalem , qu’on appelloit le parvis des
Gentils , parce qu’il étoit permis aux gentils d’y venir
; la fécondé cour dite parvis d'Ifrael, parce que
tous les Ifraélites, pourvu qu’ils fuffent purifies ,
avoient droit de s'y préfenter ; enfuite le parvis des
prêtres, dans lequel eux 6c les lévites exerçoient leur
miniftere ; le peuple n’entroit dans cette derniere*
cour , que lorlqu’il préfentoit quelque viôime, fur
la tête de laquelle il devoit mettre les mains en l’offrant
au Seigneur.
Ce mot défigne encore la ville d'Enon, fituée aux
confins de la terre proihife 6c de Damas, Ezéch. xlvij.
t j . Enfin il fe prend pour la ville même de Jérufalem ;
fiantes erant pedes nofiri in atriis tuis Jerufalem , Pf.
121. z. (D . / .)
Par u l ie , f. f. terme de Chirurgie ; tumeur inflammatoire
qui furvient aux gencives ; elle fe termine
quelquefois par-fuppuration ; ,6c lorfqu’à l’occafion
de la carie de l’os maxillaire, il furvient excroiffance
fong tenfle, on l’appelle'apulie. Voye{ à la fin de l'ar-
iûcL .J l N cives , \zs~maladies auxquelles ces parties
font fujettes.
: Le mot dt.paruU vient du grec -wap«, ju xtà , pro-
- ch e, 6c de olMv , ginciva, gencive.,
La faignée, 6c les décodions, émollientes qu’on
tient dans la bouche, peuvent procurer la réfolution
des paru lies bénignes ^’application d’une figue grafle ,
ou d’un morceau de pain d’épice, favorife la fiippu-
1.ration. Voye\ Pain d’épice. 11 ne faut pas différer
l’ouverture d’iine parulie, de crainte que j ’.érofion de
la matière ne s’étende jufqu’à l’os maxillaire , 6t ne
devienne la caufe d’accidens. Les lotions vulnéraires
6c déterfiyes conviennent après l’ouverture de la
tumeur.
Les fiftules qui fuccedent auxparulies font ordinairement
entretenues par la carie d’une dent, 6c l’ex-
traftion de cette dent en eft le remede effentiel.
F o y ei Fi s t u l e . ( T -)
PARURE, f. f. fe dit en général de tout ce qu’on
ajoute à une chofe pour l’embellir 6c la faire valôir.
La terre s’ouvre au printems 6c fe pare de fleurs.
Il entre des cônfidérations très-fübtiles dans l’entente
6c le goût de la parure.
On dit uneparure de diamans.
Des chevaux doivent être de meme parure ; parure
fe prend ici pour la reffemblance de la taille 6c du
poil.
La parure des peaux eft ce que l’on en retranche,
PARYPATE, f. f. (Mufiq. ancienne.') nom d’une
ancienne note ou corde de la tétracorde qui touchoit
à celle de l’hypate. Comme celle-ci étoit là principale
, ou le fon principal, fuivant Martianus Capella,
Il réfulte que laparypate étoit la fous-principale.
Le nom de parypate étoit donné à cette fécondé
note quand on confidéroit la tétracorde féparément
‘des autres ; mais quand on les confidéroit réunies,
cette corde prenoit quelquefois le nom de trite.
Parypate-hypaton ; c’étoit dans l’ancienne échelle
greque de nuifique, la fécondé note de la tétracorde
hypathon, 6c répond au c fa u tâ t l’échelle de Guido.
Parypate-mefon, étoit la feConde note de la tétra-
corde mefon, 6c répond au f fa u t de l’échelle de
Guido. Wallis Append.- Ptolem. Haram. pag. i5j .
PAS, POINT, ( Synon.') pas énonce Amplement
la négation. Point appuie avec force 6c femble l’affirmer.
Le premier fouvent ne nie la chofe qu”en partie
ou avec modification. Le fécond la nie toujours ab-
folument, totalement 6c fans réferve. Voilà pourquoi
l ’un fe place très-bien devant les modificatifs, & que
l’autre y auroit mauvaife grâce. On diroit donc n’être
pas bien riche & n’avoirpas même le néceffaire ; mais fi
l ’on vouloit fe fervir de point, il faudroit ôter les modificatifs
, 6c dire n’être point riche, n’avoir point le
néceffaire.
Cette même raifon fait que pas eft toujours employé
avec les’ mots qui fervent à marquer le dégré
de qualité ou de quantité, tels ,que beaucoup , fort,
un, 6c autres femblables. Que point figure mieux à la
fin de la phrafé devant la particule de, 6c avec le mot
du tout, qui au lieu de reftraindre la négation, en
confirme la tôt alité.
Ce n’eft pas affez de dire que pour l’ordinaire les.
Philofophes ne font pas riches ; il faut ajouter que
dès qu’il s’apit d’acquérir des- richeflès aux dépens
de la probité, ils n’en veulent point à ce prix. Règle
générale y oh doit employer la particule négative
point, quand-elle a la fignifieàtion de jamais.
Toutes les fois que les particules pas ou point font
des pléônafmes , il faut les retrancher. Le P. Bou-
hours a quelquefois fait cette faute. « Il en eft, dit-il,
» deTancrede dans la Jérufalem délivrée, comme dë
» Sancerre dans la princeffé de Cleves ; leur affli&ion
” plus naturelle au commencement qu’elle ne
» 1 eft pas dans là fuite. Maniéré de bien penfer. Voyez
les remarques de Vaugelas fur pas 6c point , tom. II.
avec les notés de Thomas Corneille. ( D . J. )
Pas d’ane, f. nu (Hifi. Tiat;Bot.') genre de plante à
fleur radiée, dont le dilque eft eompofé de plufieurs
fleurons, 6c la couronne de demi-fleurons ; lés fleurons
6c les demi-fleurons ,font placés fur des embryons
6c foutenus par un calice profondément dé^
coupé. Les embryons deviennent dans la fuitedes fe-
mences qui font garnies d’une aigrette , 6c attachées
a la louche. Ajoutez aux caractères, de ce genre, que
PeS fleurs naiffent avant les feuilles. Tourhefort in(l*
rei herb. Voyt7^ Plante.
Pas d ane , ( Mededne. ) il eft peétoral, propre
pour les rhumes où les crachats font épais, vifqueux':
c’eft un bechique expeftorant, déterfif; il adoucit
les ulcérés de fa poitrine ; il eft bon pour purifier le
fang ; on fe fert de fes fleurs & de fa racine. On en
fait un firop , une conferve, dont on fait ufage dans
les affefrions de la poitrine^ telles que la.toux là
pleuréfie , & autres.
Pas ,^ (Géogr.) eft en général une mefure déterminée
par‘ i’efpace qui fe -trouve entre les deux piés
d’une perfonne qui marche. Voye^ Mesure.
Le/»«m ordinaire eft de deux piés 6c demi ; plufieurs
le font cependant de trois piés ; le pas géométrique ,
ou le / ^ allemand , appellé auffi le grand pas , ef?
de cinq piés. Voye{ Pié .
Les anciens milles romains & les milles italiens
modernes font de mille pas, mille paffus. La lieue
françoife eft de trois mille pas; la lieue allemande eft
de quatre mille pas. Voyez Mille , L ie u e , & c.
Chambers. (E ) - ■
Pas fe dit auffi du pie d’un animal j j ’ai remarqué
le pas d’un loup.
Pas , (Droitpolitiq. ) ce terme fe dit des divers
degres de preeminence entre les princes ; ils font affez
connus, & ne peuvent intéreffer effenti’ellement
leurs fujets ; auffi toutes les difputes fur le pas
6c les préféances dans un congrès pour la paix,
ne font qu’arrêter par des difficultés frivoles, la célérité
de conventions très-importantes au bien public.
(D . J .) F
Pas d’armes , en Chevalerie ; eft une place que
les anciens chevaliers entreprenoient de d.éfendre 5
par exemple, un pont, un chemin, &c. par lequel
on ne fauroit paffer fans combattre la perfonne qui
le garde, Voye^ C hevalier, C hev alerie, & A umônes.
Les chevaliers qui défendoient le pas pendoient
leurs armes à des arbres, à des poteaux, à des colonnes
, &c. élevées pour cet ufage ; 6c quiconque
étoit difpofé à difputer le paffage, touchoit une de
ces armoiries avec fon épee, ce qui étoit un cartel
que l’autre étoit obligé d’accepter ; le vaincu don-
noit au vainqueur le prix dont ils étoient convenu
avant le combat.
On appelloit auffi pas d'armes le combat ou défi
qu’un tenant ou feul, ou accompagné de plufieurs
chevaliers, offroit dans les tournois contre tous ve-
nans ; ainfi en 1514, François, duc de V alois, avec
neuf chevaliers de fa compagnie, entreprit un pareil
combat appellé le pas de l'arc triomphal, dans la rué
Saint-Antoine à Paris, pour les fêtes du mariage de
Louis XIL 6c le tournois où Henri II. fùtbleffé à
mort en 1559? ctoit auffi un pas d1armes, puifqu’il
eft dit dans les lettres de cartel, que.le pas efiouvert
par fa majefié très-chrétienne, 6cc.pour être tenu contre
tous venans duement qualifiés. Le funefte accident qui
mit ce prince au tombeau , a fait ceffer ces dangereux
divertiffemens.
Pas de v is , eft la diftance qui fe trouve entre
deux cordons ou trois immédiatement eonfècutifs de
la fpirale qui forme la circonférence de la visi Cette
diftance fe mefure non par la perpendiculaire menée
fur les deux tours ou cordons voifins, mais elle's’e stime
fuivant la longueur- de la vis. Voye£ Vis. (O)
Pas de souris , dans la Fortification font les ha-
liers ou degrés qu’on pratiqué aux angles faillans 6c
rentrans delà contrefcarpe pour monter du foffé dans
le chémin couvert. (Q)
Pas dé Camp , (le) eft celui dont on fe fort ordinairement
pour mefurer les différens efpaces nécef-
fairés pour camper & pour mettre les troupes en bataille.
Ce pas 'tu. de trois piés. de roi,