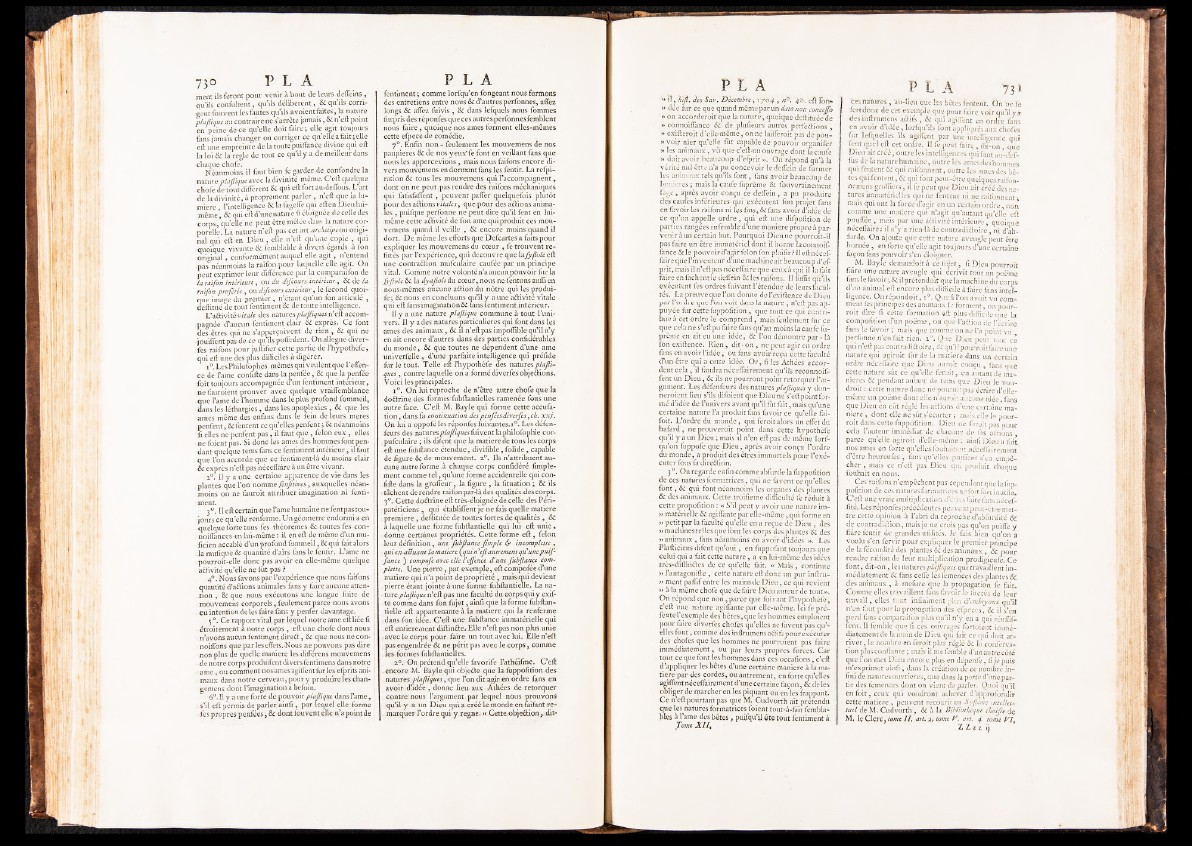
nient ils feront pour venir à bout de leurs deffeins,
qu’ils confultent, qu’ils délibèrent, & qu’ils corrigent
fouvent les fautes qu’ils avoientfaites, la nature
plaflique au contraire ne s’arrête jamais, & n’eft point
en peine de ce qu’elle doit faire; elle agit toujours
fans jamais changer ou corriger ce quelle a fait; elle
eft une empreinte de la toute piulfance divine qui eft
la loi & la réglé de tout ce qu’il y a de meilleur dans
chaque chofe. . . . r , ,
Néanmoins il faut bien fe garder de contondre la
nature plaflique avec la divinité même. C’eft quelque
chofe de tout différent & qui eft fort au-delfous. L’art
de la divinité, à proprement parler , n’eft que la lumière
, l’intelligence & la fageffe qui eft en Dieu lui-
même , & qui eft d’une nature fi éloignée de celle des
corps, qu’elle ne peut être mêlée dans la nature corporelle.
La nature n’eft .pas cet art archeiipe ou original
qui eft en D ie u , elle n’eft qu’une ^copie , qui
quoique vivante & femblable à divers égards à fon
original, conformément auquel elle ag it, n’entend
-pas néanmoins la raifon pour laquelle elle agit. On
peut exprimer leur différence par la comparaifon de
la raifon intérieure, ou du difeours intérieur, & de la
raifon proférée , ou difeours extérieur, le fécond quoique
image du premier, n étant qu un fon articule ,
deftitué de tout fentiment & de toute intelligence.
L’a&ivité vitale des natures plafliques n’eft accompagnée
d’aucun fentiment clair bc exprès. Ce font
des êtres qui ne s’apperçoivent de rien , &c qui ne
-jouiffentpas de ce qu’ils poffedent. On allégué diverses
raifons pour juftifier cette partie de l’hypothèfe,
qui eft une des plus difficiles à digerer.
i°.LesPhilofophes mêmes qui veulent que l’effen-
ce de l’ame confifte dans la penfée, & que la penfée
foit toujours accompagnée d’un fentiment intérieur,
ne fauroient prouver avec quelque vraiffemblance
ue l’ame de l’homme dans le.plus profond fommeil,
ans les léthargies, dans les apoplexies , & que les
âmes même des enfans dans le Fein de leurs meres
penfent, & fentent ce qu’elles penfent ; & néanmoins
fi elles ne penfent pas , il faut que, félon eux , elles
ne foient pas. Si donc les âmes des hommes font pendant
quelque tems fans ce fentiment intérieur, il faut
que l’on accorde que ce fentiment-là du moins clair
& exprès n’eft pas néceffaire à un être vivant.
a0. Il y a une certaine apparence de vie dans les
. plantes que l’on nomme fenfitives, auxquelles néanmoins
on ne fauroit attribuer imagination ni fentiment.
3 °. Il eft certain que l’ame humaine ne fentpas toujours
ce qu’elle renferme. Un géomètre endormi a en
quelque forte tous fes théorèmes & toutes fes con-
noiffances en lui-même : il en eft de même d’un rau-
ficien accablé d’un profond fommeil, & qui fait alors
. la mufique & quantité d-airs fans le fentir. L’ame ne
. pourroit-elle donc pas avoir en eller-même quelque
aâivité qu’elle ne fût pas ?
4° .Nous favons par l’expérience que nous faifons
quantité d?aftions animales fans y faire aucune atten-
. tion , & que nous exécutons une longue fuite de
mouvemens corporels, feulement parce nous avons
. eu intention de les faire fans y penfer davantage.
^ °. Ce rapport vital par lequel notre ame eft liée fi
étroitement a notre corps , eft une chofe dont nous
n’a vous aucun fentiment direft, & que nous ne con-
noiflons que.par leseffets.-Nous ne pouvons pas dire
non plus de quelle maniéré les différons mouvemens
de notre corps produifent divers fentimens dans notre
ame, ou comment nos âmes agiffent fur les efprits animaux
dans notre cerveau, pour y produire les chan-
geniens dont l’imagination a befoin.
6°. I1 y a une forte de pouvoir plaflique dans l’ame,
s’il eft permis de parler ainfi, par lequel elle forme
-fes propres penfées, & dontfouvent elle n’a point de
fentiment ; comme lorfqu’en fongeant nous formons
des entretiens entre nous & d’autres perfonnes, afiez
longs & affez fuivis , & dans lefquels nous fommes
furpris des réponfes que ces autres perfonnesfemblent
nous faire, quoique nos âmes forment elles-mêmes
cette efpece de comédie.
7°. Enfin non - feulement les mouvemens de nos
paupières & de nos yeux*fe font en veillant fans que
nous les appercevions, mais nous faifons encore divers
mouvemens en dormant fans les fentir. La refpi-
ration tk. tous les mouvemens qui l’accompagnent,
dont on ne peut,pas rendre des raifons méchaniques
qui fatisfaffent , peuvent palier quelquefois plutôt
.pour desaftionsvitales, que pour des aérions animales
, puifque perfonne ne peut dire qu’il fent en lui-
même cette aérivité de fon ame qui produit ces mou-
•vemens quand il veille , encore moins quand il
dort. De même les efforts que Defcartes a faits pour
expliquer les mouvemens du coeur , fe trouvent réfutés
par l’expérience, qui decouvre.que.lafyfiole eft
une .contraérion mufculaire caufée-par un principe
vital. Comme notre volonté n’a aucun pouvoir fur la
fy fiole & la dyqflole du coeur, nous ne fentons aufîi en
nous-mêmes aucune aérion du nôtre qui les produi-
fe; & nous, en concluons qu’il y a une activité vitale
qui eft fans imagination & fans fentiment intérieur.
Il y a une nature plaflique commune à tout l ’univers.
Il y a des natures particulières qui font dans les
âmes des animaux, & il n’eft pas impoflible qu’il n’y
en ait encore d’autres dans des parties confidérables
-du monde, & que toutes ne dépendent d’une ame
■ univerfelle, d’une parfaite intelligence qui préfide
fur le tout. Telle eft l’hypothèfe des natures plafli-
-ques, contre laquelle on a formé diverfes objections.
Voici les principales.
i° . On lui reproche de n’être autre chofe que la
doClrine des formes' fubftantielles ramenée fous une
.autre face. C’ ëft M. Bayle qui forme cette accufa-
tion, dans fa continuation des penfées diverfes, ch. x x j.
On lui a oppofé les réponfes fuivantes. i°. Les défendeurs
des natures plafliques fuivent la philofophie cor-
pufculaire ; ils difent que la matière de tous les corps
eft une fubftance étendue, divifible, folide, capable
dé figuré & de mouvement. z°. Ils n’attribuent aucune
autre forme à chaque corps confidéré Amplement
comme te l, qu’une forme accidentelle qui con-
-fifte dans la groffeur, la figure , la fituation ; & ils
■ tâchent de rendre raifon par-là des qualités des corps.
3°. Cette doCtrine eft très-éloignée de celle des Peri-
patéticiens , qui établiffent je ne fais quelle matière
, première, deftituée de toutes fortes de qualités , &:
à laquelle une.forme fubftantielle qui lui eft unie,
■ donne certaines propriétés. Cette forme e f t , félon
leur définition, une fubfiance fimple & incomplette ,
. qui en<a3uant la matière (qui ri*efl autrement qitunepuif-
fance ) compofe avec elle Tejfence d'une fub fiance Com-
plette. Une p ierre, par exemple, eft compofée d’une
matière qui n’a point de propriété, mais (qui devient
-pierre étant jointe à une forme fubftantielle. La na-
■ ture plaflique sfeH. pas une faculté du.corpsquiy exifi
-te comme dans fon fujet, amfique la forme fubftantielle
eft appartenante à. la; matière qui la renferme
dans fqn idée..C ’eft une fubftance immatérielle qui
-eft entièrement diftinCte.-Elle n’eft pas non plus.unie
pàvec le.corps pour faire un toutavec lui. Elle n’eft
ypas engendrée &c ne périt pas avec le corps, comme
- les formes •fubftantielles.
,2°.- On prétend, qu’elle favorife l’athéifine. C’eft
-encore; M. Bayle qui objeâe que la; fuppofition des
mtures plqfliques, que l’on dit agir en ordre fans en
avoir 'd’idée , donne lieu- aux Athées de rétorquer
contre; nous l’argument par lequel nous prouvons
qü’il y a un Dieu quia créé le.monde en faifantre-
... marquer l’ordre q u iy régné. «.Cetterobjeérion dit-
» i l , liifl. des Sav. Décembre -, 7704 , h°. Jj.o. eft îôh3-
» dée fur ce que quand même par un dato non concejfo
» On accorderait que la nature, quoique deftituée de
» connoiffance ôc de phifieurs autres perfections •
'» exifteroit d ’elle^même , on ne laifferoit pas de pou-
» voir nier qu’elle fur capable de pouvoir organifer
» les animaux, vu que c’eft-un ouvrage dont la caufe
» doit avoir beaucoup, d’efprit ». On répond qu’à là
vérité nul être n’a pu concevoir le deffein de former
les animaux tels qu’ils font, fans avoir beaucoup de
lumières ; mais la caufe fuprème & fouveraineiUent
fage, après avoir conçu ce deffein, a pu produire
des caules inférieures qui exécutent fon projet fans
en favoir les raifons ni les fins, & fans avoir d’idée de
ce qu’on appelle ordre, qui eft une difpofitioft dé
parties rangées énfemble d’une maniéré propre à parvenir
à un certain but. Pourquoi Dieu ne pourroit-il
pas faire un être immatériel dont il borne la connoiffance
& le pouvoir d’agir félon fon plaifir ? Il eftnécef-
faire que l’inventeur d’une machineait beaucoup d’efprit,
mais il n’ eft pas néceffaire que ceuxà qui il la fait
faire en fâchent le deffein & les raifons. Il fuffit qu’ils
exécutent fes ordres fuivant l ’étendue de leurs facultés.
La preuve que l’on donne de l’exiftence de Dieu
par l’ordre que l’on voit dans la nature, n’eft: Das ao-
puyée fur cette fuppofition , que tout ce qui contribue
à cet ordre le comprend, mais feulement fur çé
que cela ne s’eft pu faire fans qu’au moins la caufe fuprème
en ait eu une idée, & l’on démontre par - là
fon exiftence. Rien, dit - on , ne peut agir en ordre
fans en avoir l’idée, ou fans avoir reçu cette faculté
d’un être qui a cette idée. O r , fi les Athées accordent
cela, il faudra néceffairement qu’ils reconnoif-
fent un Dieu, & ils ne pourront point rétorquer l’ar^
gument. Les défenfeurs des natures plafliques y don-
neroienî lieu s’ils difoient que Dieu ne s’ eft point formé
d’idée de l’univers avant qu’il fut fait, mais qu’une
certaine nature l’a produit fans favoir ce qu’elle fab
foit. L’ordre du monde, qui feroit alors un effet du
hafard, ne prouveroit point dans cette hypothèfe
qu’il y a un Dieu ; mais il n’en eft pas de même lorf-
qu’on fuppofe que Dieu, après avoir conçu l’ordre
du monde, a produit des êtres immortels pour l’èxé-
cuter fous fa direction.
3 °. On regarde enfin Comme abfufde la fuppofition
de ces natures formatrices, qui ne favent ce qu’elles
fon t, & qui font néanmoins les organes des plantes
& des animaux. Cette troifieme difficulté fe réduit à
cette jjropofition : « S’il peut y avoir une nature im-
» matérielle & agiffante par elle-même, qui forme en
» petit par la faculté qu’elle en a reçue de Dieu , des
» machines telles quefont les corps des plantes & des
» animaux , fans néanmoins en avoir d’idées ». Les
Plafticiens difent qu’o u i, en fuppofant toujours que
celui qui a fait cette nature, a en lui-même des idées
très-diftin&es de cé qu’elle fait. « Mais, continue
» l’antagonifte , cette nature eft donc un pur inftru-
» ment paflif entre les mains de D ieu, ce qui revient
>> à la même chofe que de faire Dieu auteur de tout».
On répond que non, parce que fuivant l’hypothèfe,
c’eft une nature agiffante par elle-même. Ici fe préfente
l’exemple des bêtes, que les hommes emploient
pour faire diverfes chofes qu’elles ne favent pas qu’elles
font, comme des inftrumens aftifs pour exécuter
des chofes que les hommes ne pOurroient pas faire
immédiatement, ou par leurs propres forces. Car
tout ce que font les hommes dans ces occafions, c’eft
d ’appliquer les bêtes d’une certaine maniéré à la matière
par des cordes, ou autrement, en forte qu’elles
agiffent néceffairement d’une certaine façon, & de les
obliger de marcher en les piquant ou en les frappant.
Ce n’eft pourtant pas que M. Cudvorth ait prétendu
que les natures formatrices foient tout-à-fait fembla-
fcks à l’ame des bêtes, pujfqu’il ôte tout fentiment à
Tome X I I ,
tès ftafiirës , aù-ïie'ii que l'es bêtes fentent. Ôn fie fê
fiert donc de cet exemple que pour faire voir qu’il y à
des inftrumens âttifs , & qui agiffent en ordre fans
en avoir d’idée, lorfqu’ils font appliqués aux chofes
fur lefqüelles ils. agiflènt par une intelligence qui
lent quel eft cet Ordre. Il fe peût faire , dit-on, que
Dieu ait Créé, Outre les intelligences qui font au-def-
fus de la nature humaine, Outre lés âmes des hommes
qui fentent '& qui ràifônnent, outré lés âmes des bêtes
qui fentent, & qui font peut-être quelques raifon-
iiemens groffiers, il fe peut que Dieu ait créé des natures
immatérielles qui ne fentent ni ne raifonnent -
mais qui oiit la force d’agir en un certain ordre, non
comme une matière qui n’agit qu’autant qu’elle eft
pquffée -, mais par Une àâivité intérieure, quoique
néceffaire : il n’y a rien-là de contradicloire , ni d’ab-
furde. On ajoute que cette nature aveugle peut être
bornée, en forte qu’elle agit toujours d’une certaine
façon fans pouvoir s’en éloigner.
M. Bayle demandoità ce fujet, fi Dieu pourrait
faire une nature aveugle qui écrivît tout un poème
fans le favoir ; & ilprétendoit que la machine du corps
d’un animal eft encore plus difficile à faire fans intelligence.
Onrépondoit, i°. Que fi l’on avoit vu comment
les principes des animaux fe forment, on pourrait
dire fi cette formation eft plus difficile que la
compofition d’un poème, ou que l’aâion de l’écrire
fans le favoir ; mais que comme on ne Fa point vu
perfonne n’en fait rien. 2°; Que Dieu peut tout ce
qui n’eft pas contradi&oire, & qu’il pourroitfaire uné
nature qui 'agirait fuf de la matière dans un Certain
ordre néceffaire que Dieu aurait conçu , fans que
cette nature sût ce qu’elle feroit, en autant de maniérés
& pendant autîmt de tems que Dieu le voudrait
: cette nature donc ne pouroitpas écrire d’elle-
même un poème dont elle n’auroit aucune idée fans
que Dieu en eût réglé les actions d’une certaine maniéré
i dont elle ne sût s’écarter ; mais elle le pourrait
dans cette fuppofition. Dieu ne feroit pas pour
cela Fauteur immédiat de chacune de fes actions
parce qu’elle agirait d’elle-même ; ainfi Dieu a fait
nos âmes en forte qu’elles fouhaitent nécefiairement
d’être heureufes , fans qu’elles puiffent s’en empêcher
, mais ce n eft pas Dieu qui produit chaque
fouhait en noiis.
Ces raifons n’empêchent pas cependant que la fuppofition
de ces natures formatrices ne foit fort inutile,.
C ’eft une vraie multiplication d’êtres faite fans nécef-
fité. Les réponfes précédentes peuvent peut-être mettre
cette opinion à l’abri du reproche d^abfurdité &
de contradiction, mais je ne crois pas qu’on puiffe ÿ
faire fentir de grandes utilités. Je fais bien qu’on a
Voulu s*en fervir pour expliquer le premier principe
de la fécondité des plantes & des animaux , & pour
rendre raifon de leur multiplication prodigieufe. Ce
font , dit-on , les natures plafliqius qui travaillent immédiatement
& fans ceffe ies lèmences des plantes &
des animaux , à mefure que la propagation fe fait»
Comme elles travaillent fans favoir le fuccès de leur
travail, elles font infiniment plus d’embryons qu’il
n’en faut pour la propagation des efpeces, & il s’en
perd fans comparaifon plus qu’il n’y en a qui réunifient.
Il femble que fi ces ouvragés fortoient immédiatement
de la main de Dieu qui fait ce qui doit arriver,
le nombre en feroit plus réglé & la conferva^
tion plus confiante ; mais il me femble d’un autre côté
que Fon met Dieu encore plus en dépenfe, fi je puis
m’exprimer ainfi, dans la création de ce nombre infini
de natures ouvrières, que dans la perte d’une partie
des femences dont on vient de parler. Quoi qu’il
en fo it , ceux qui voudront achever d’approfondir
cette matière , peuvent recourir au Syfième intellect
tutl de M. Cudvorth , & à là Bibliothèque choifie de
M, le C letc, tome I I, art, i i tome V, art. 4. tàmè V I*
Z Z z z ij