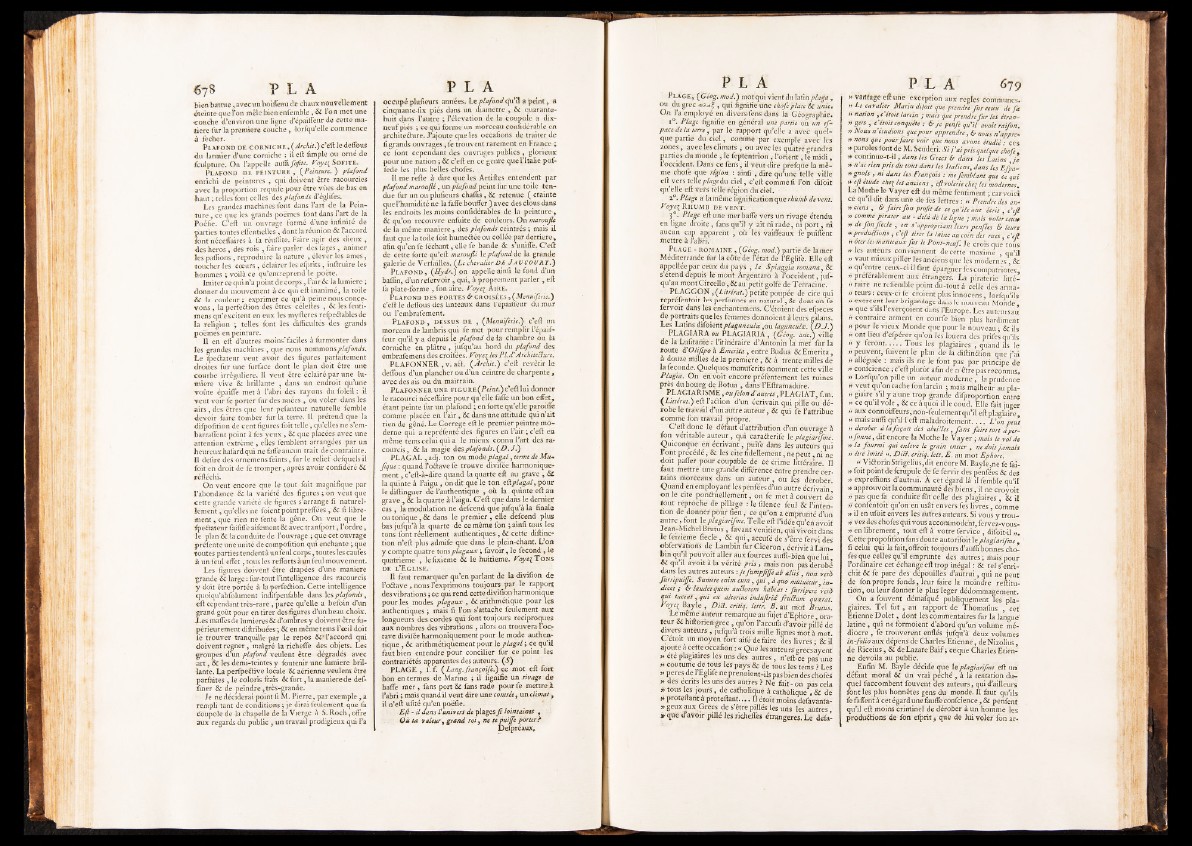
bien battue, avec un boiffeau de chaux nouvellement
éteinte que l’on mêle bien enfemble , & l’on met une
•couche d’environ une ligne d’épaiffeur de cette matière
lur la première couche, -lorfqu’elle commence
à fecher.
P l a fo n d d e c o r n ic h e , (Archit.)c’éft le delîous
-du larmier d’une corniche : il eft fimple ou orné de
fculpture. On l’appelle au ftifofite. Voye\ So f it e .
Pla fo n d d e p e in t u r e , ( Peinture. ) plafond
enrichi de peintures , qui doivent être racourcies
avec la proportion requiie pour etre vues de bas en
•haut ; telles font celles des plafonds d’églifes.
Les grandes machines font dans l’art de la Peinture
, ce que les grands poëmes font dans l’art de la
Poéfie. G’eft un ouvrage formé d’une infinité de
parties toutes effentielles É dont la réunion & L’accord
font néceffaires à la réuffite. Faire agir des dieux ,
•des héros , des rois , faire parler des fages, animer
les pallions , reproduire la nature , élever les âmes,
toucher les coeurs, éclairer les efprits, inftruire les
hommes ; voilà ce qu’entreprend le poëte.
Imiter ce qui n’a point de corps, l’air &c la lumière ;
donner du mouvement à ce qui eft inanimé, la toile
& la couleur ; exprimer ce qu’à peine nous concevons
, la perfe&ion des êtres céleftes , & les fenti-
•mens qu’excitent en eux les myfteres refpe&ables de
la religion ; telles font les difficultés des grands
poëmes en peinture.
Il en eft d’autres moins'faciles àfùrmonter dans
les grandes machines , que nous nommons plafonds.
Le ipe&ateur veut avoir des figures parfaitement
droites fur une furface dont le plan doit être une
courbe irrégulière» Il veut être éclairé par une lumière
vive & brillante , dans un endroit qu’une
voûte épaiffe met à l’abri des rayons du foleil : il
veut voir fe porter fur des nuées , ou voler dans les
a ir s, des êtres que leur pefanteur naturelle femble
devoir faire tomber fur la terre. Il prétend que la
difpofition de cent figures foit telle, qu’elles ne s’em-
barraffent point à fes yeux , 6c que placées avec une
attention extrême , elles femblent arrangées par un
heureux hafard qui ne faffe aucun trait de contrainte.
Il defire des ornemens feints, fur le relief defquels il
foit en droit de fe tromper, après avoir confidéré 6c
réfléchi.
On veut encore que le tout foit magnifique par
l’abondance & la variété des figures ; on veut que
cette grande variété de figures s’arrange fi naturellement
, qu’elles ne foient point prelfées , & fi librement
, que rien ne lente la gêne. On veut que le
fpeftateur faififlè aifément& avectranfport, l’ordre,
le plan 6c la.conduite de l’ouvrage ; que cet ouvrage
prefente une unité de compofition qui enchante ; que
toutes parties tendent à unfeul corps, toutes les caufes
à un feul effet, tous les refforts à un feul mouvement.
Les figures doivent être drapées d’une maniéré
grande & large: fur-tout l’intelligence des racourcis
y doit être portée à la perfeftion. Cette intelligence
quoiqu’abfolument indifpenfable dans les plafonds,
eft cependant très-rare , parce qu’elle a befoin d’un
grand goût pour en tirer desfigures d’un beau choix.
Xes maffes de lumières 6c d’ombres y doivent être fu-
périeurement diftribuées ; & en mêmetems l’oeil doit
fe trouver tranquille par le repos &* l’accord qui
doivent regner, malgré la richeffe des objets. Les
groupes d’un plafond veulent être dégradés avec
a r t , & les demi-teintes y foutenir une lumière brillante.
La perfpeCtive locale 6c aérienne veulent être
parfaites , le coloris frais 6c fort, la maniéré de def-
finer & de peindre,très-grande.
Je ne déciderai point fi M. Pierre, par exemple , a
rempli tant de conditions ; je dirai feulement que fa
coupole de la chapelle de la Vierge à S.Roch,offre
aux regards du public , un travail prodigieux qui l’a
occupé plufieurs années» Le plafond qu’il a peint, a
cinquante-fix piés dans un diamètre , 6c quarante-
huit dans l’autre ; l’élévation de la coupole a dix-
neuf piés ; ce qui forme un morceau conudérable en
architecture. J’ajoute que les occaûoris de traiter de
figrands ouvrages, fe trouvent rarement en France ;
ce font cependant des ouvrages publics , glorieux
pour une nation ; 6c c’eft en ce genre que l’Italie pof*
fede les plus belles chofes.
Il me refte à dire que les Artiftes entendent par
plafond marouflé, un plafond peint fur une toile tendue
fur un ou plufieurs chaffis, 6c retenue ( crainte
que l’humidité ne la faffe bouffer ) avec des clous dans
les endroits les moins confidérables de la peinture,
6c qu’on recouvre enfuite de couleurs. On maroujlç
de la même maniéré, des plafonds ceintrés ; mais il
faut que la toile foit humeCtée ou collée par derrière',
afin qu’en fe féchant, elle fe bande & s’uniffe. C’eft
de cette forte qu’eft marouflé, le plafond de la grande
galerie de Verlaillès. (Le chevalier d e J a v c o u r t .)
Plafond , (Hydr.) on appelle ainfi le fond d’un
baftin, d’unrefervoir, qui, à proprement parler , eft
fa plate-forme , fon aire. Voye^ A ir e . Plafond des portes & croisées, (Menuiferie.)
c’ eft le deffous des linteaux dans l’épaiffeur du mur
ou l’embrafement. P lafond , dessus de , ( [Menuiferie.) c’eft un
morceau de lambris qui fe met pour remplir l’épaiffeur
qu’il y a depuis le plafond de la chambre ou la
corniche en plâtre , jufqu’au bord du plafond des
embrafemens des croiiéès. Vbyt{ les Pl.d' ArchitcSurc.
PLAFONNER , v . a£t. (Archit.) c’eft revêtir la
deffous d’un plancher ou d’un ceintre de charpente ,
avec des ais ou du mairrain. Plafonner une figure (Peint.') c’eft lui donner
le racourci néceffaire pour qu’elle faffe un bon effet,
étant peinte fur un plafond ; en forte qu’elle paroiffe
comme placée en l’a ir , dedans une attitude qui n’ait
rien de gêné. Le Correge eft le premier peintre moderne
qui a repréfenté des figures en l’air ; c’eft en
même tems celui qui a le mieux connu l’art des ra*
courcis, & la magie des plafonds. (D . J.)
PLAGAL , adj. ton ou mode plaçai, terme de Mu»
Jique : quand l’oCtave fe trouve divifée harmoniquement
, c’eft-à-dire quand la quarte eft au grave , de
la quinte à l’aigu , on dit que le ton eftplagal, pour
le diftinguer de l’authentique , où la quinte eft au
grave , & la quarte à l’aigu. C’eft que dans le dernier
cas , la modulation ne defeend que jufqu’à la finale
ou tonique, & dans le premier , elle defeend plus
bas jufqu’à la quarte de ce même fon ; ainfi tous les
tons font réellement authentiques, & cette diftinc-
tion n’eft plus admife que dans le plein-chant. L’on
y compte quatre tons plagaux j favoir, le fécond , le
quatrième , lefixieme 6c le huitième, F'oyei T ons
de l’Eglise.
Il faut remarquer qu’en parlant de la divifion de
l’oétave, nous l’exprimons toujours par le rapport
des vibrations ; ce qui rend cette divifion harmonique
pour les modes plagaux , 6c arithmétique pour lés
authentiques ; mais fi l’on s’attache feulement aux
longueurs des cordes qui font toujours réciproques
aux nombres des vibrations , alors on trouvera l’octave
divifée harmoniquement pour le mode authentique
, de arithmétiquement pour le plaçai ; ce qu’il
faut bien entendre pour concilier fur ce point les
contrariétés apparentes des auteurs. («î)
PLAGE , f. f. ( Lang.françoife.) ce mot eft fore
bon en termes de Marine ; il figriifie un rivage de
baffe mer, fans port de fans rade pourfe mettre à
l’abri ; mais quand il veut dire une contrée, un climat,
il n’eft ufité qu’en poéfie.
E fl- U dans L'univers de plages f i lointaines ,
Ou ta valeur, grand roi, ne tepuijfe porterA
Defpréaux,
Pl a g e , ( Géog. mod.) mot qui vient du latin plaga,
ou du grec -raAeeÇ , qui lignifie une chofeplate 6c unie.
On l’a employé en divers-fens dans la Géographie.
i° . Plage fignifîe en général une partie ou un tf-
pact de la terre, par lé rapport qù’elle à avec quelque
partie du c ie l, coinme par exemple avec lés
zones, avec les climats ; ou avec les quatrë grandes
parties du niondè, le feptèntriori | l’onërftfl le m idi,
î’occident. Dans ce feris,' il Vëiit dire prefqùe' la même
chofe qué régiôri : ainfi , dite qu une telle ville
eft vers telle plage du c iel, c’eft comméfi Fon difoit
qu’elle eft ŸëfS tèllé région dùcièl.
x°. PIdge à' la même lignification que rhümb de vent.
Voye^ R h um b de v e n t .
3 . Plagt eft une nier baffe vers un rivage étendu
en ligne droite, fans qu’il y àït ni rade, ni port, ni
aucun cap apparent , où les va’ifféaux fe puiflént
mettre à Fab’ri.
P^AGE - r o m a in e , (Géog. mod.) partie de la’mer
Méditerranée fut la côté de l’état de l’Eglïfe. Elle eft
appelléepar céùx du pays , là Spiàggia romana, &
s’étend depuis le mont Argentàro à Poccident, jufqu’au
montCitcello, & au petit golfe de Tëfracirïe.
PLAGGON fLittérat.') petite poupée de cire qui
repréfefitoit lés perforines au naturel, & dont on fe
fervoir dans lés enchantemens. C’étoiént des efpeces
de portraits que les femmes donnoient à leurs galahs.
Les Latins difoientplagunculce ,ou lagunculoe. (D J .)
PLAGIARA ou PLAGIARIA , (Géog. àric.) ville
de la Lufitanïè : l’ïtin'éraire d’Antônin la met! fûf la
toute d'Olifipö à Emerita , entré Biidua & Emerita,
à douze milles de la première, & à trente milles de
la fécondé. Quelques mariitfcrits nomment cette ville
Plagia. On éri voit encore préfentement les ruines
près du bourg de Botiia , dahsTEftramadure.
PLAGIARISMEjOkfélon d'autres, PLAGIAT, f.m.
(Littéral.) eft l’adion d’un écrivain qui pille ou dérobe
lé travail d’un autre auteur, & qui fe Fàtfribue
coimmë föh travail propré.
C èft donc lé defaut d’attribution d’un ouvrage à
fon véritable auteur, qui cara&erife le plagiarifmé.
Quicon^ûe en1 écrivant, buife dans lés auteurs qui
l’ont précédé,- & les' cite ndélleiïient, ne peut, ni ne
doit paffer pour coupable de cè crime littérairé. Il
faut mettré fine grahdè différence éntre prendre certains
rïiorceaùx dahs un auteur, où les dérober.
Quand èn employant lès pénfées d’un autre écrivain
on lè cité ponduellenient, on fe met à couvert de
tout reproche de pillage : le ftlence feul & l’infen-
tioù dé doiinér pour fien, ce qu’on a emprunté d’un
autre > fopt le plagiarifmé. Telle èft l’idée qu’ert avoif
Jean-Michel Btutus , favant vénitien, qiti vivoit dans
le féizièmé fîèclè, & qui, accufé de s’êtré fervi dés
©bferVations de Lambin fur Cicéron, écrivit à Lambin
qU’il poùvoït aller aux fources auffi-breii qüélui,
& qu’il avoit à la vérité pris, mais non pas dérobé
dans les autres auteurs : Je fumpfiffe ab aliU, non verb
furripuiffe. Suniére enim eunt, qui, à qud mùtuétür indice
t } & làudet qilcm duclorem hdbédt : furriperé vérb'
qui taceat, qui ex alterius indufiriâ frticlum qüærai.
S ÿ® I WÊÂ Wrn B- au mót Briitus.
Le même auteur remarque au fùjet d’Ephoré, orateur
& hiftorien g rec , qù’ori l’accufa d’avoir pillé de
divers autéùrs , jufqu’à trois mille lignes mót à mot.
C ’etoit un moyen fort aifé défaire des livrés ; & i l
ajouté à céfteoccafion : « Qué lés aüteurs-grecs ayent
>» été plâgiaifes les uns des autres, n’eft-ce pas une
» coutume de tous les pays & de tous les tems ? Les
» peres de 1 Eglife ne prenoient-ilspas bien des chofés
» dés écrits lés unsdes autres ? Ne fait-on pas cela
»toüs lés joufs , de catholique à catholique , & de
proteftant à ptoteftant.. . . Il étoit moins defavanta-
I geux aux Grecs de s’être pillés les mis les autres,
* que d aVoir pillé les richeffes étrangères. L e défa-
» yârttage eft une exeeptiôn aux réglés éomniunes.
» Le cavalier Marin dijdit que prendre fu r ceux de fa
>>' nation , c étoit larcin ; mais que prendre fur les étran-
» gers ,- c'étoit conquête : & je penfe qu'il avoit raifon.
» Nous n'étudions que pour apprendre, 6* nous n'anprc*
» nons que pour faire voir que nous avons étudié ces
» paroles font de M» Scùderi. Si j'ai pris quelque chofe,
>> contïnue-t-il, dans lis Grecs & dans les Latins je
» n'ai rien pris du tout dans les Italiens, dans les EJjm-
» gnols , ni dans les François : nie femblant que ce qui
r ef t f Uc^e °hc{ les anciens , efl volerie che^ les modernes.
La Mothe le Vayer eft du mêmè fentiment ; car voici
cê qu’il dit dans unè de fes lettres: « P rendre des an--
» ciens , & faire fon profit de ce qu'ils ont écrit c'efl
» comme pirater au - delà dé la ligne ; mais voler ceu»
» de fonJiecle , en s'appropriant leurs penfées & leurs
« productions i c èfi tirer là laine au coin des rues, c'efl
» ôter les manteàux fur lePoni-heüf. Je crois que tous
» les autéùrs conviennent de cette maxime , qu’il
» vaut mieux piller les anciens que lés modernes , &
» qu entre ceux-ci il faut épargner fes compatriotes,
»'preferàblëmènt aux étrangers. La piraterie littér
a i r e né reflëmble point du-foùt à celle des arma-
>> teurs : ceùx-ci fe croient plùs innocens, lorsqu’ils
» exercent leur brigandage dans le nouveau Monde,
» que s ils 1 exérçoient dans l’Europe. Les auteurs au
>> contraire arment en côùrfe bien plus hardiment
» pour le vieux Monde que pour le nouveau ; & ils
» ont lieu d’efpérer qu’on les louera des prifes qu’ils
i> y feront........ Tous les plagiaires , quand ils le
» peuvent, fuivent le plan de la diftihftion que j’ai
» alleguee : mais ils ne le font pas par principe de
» conlcience ;c eft plutôt afin de n être pas reconnus»
» Lorfqu’on pille un auteur moderne, la prudence
» veut qu’on cache fon larcin ; mais mqlheur au pla-
» giaire s il y a une trop grande difproportion entre
» ce qu?il vole , & ce à quoi il le coud. Elle fait juger
» aux connoiffeurs, non-feulement qu’il eftplagiaire,
» ma’isaùïfi qu’il lé ft maladroitement.. . . L ’on peut
» dérober à la façon des abeilles, fans faire tort àptr-
»Jqnne, dit encore la Mothe le Vayer ; mais U vol de
» la fourmi qui enlevé le grain entier , ne doit jamais
» êtré imité ». Dicl. critiq. lett. E . au mot Èphorê.
« Viélorin Strigeliùs,dit encore M. Bayle,ne fe fai-
» foit point dé Scrupule de fé fervir des penfées & des
» expreffions d’autrui. À cet égard là il femble qu’il
» approuvoit la commùnàuté des biens, il ne croyoit
» pas que fa conduite1 fût celle des plagiaires', & il
>>• conferitoit qu’on éri u^ât envers fés livres, comme
» il en ufoit envers lès aùtres aüteurs. Si vous y trou-
» vez des chofes qùi vous accommodent, fervez-vous-
» en librement, tout éft à votre fervice , difoit-il ».
Cette propofitïon fans dolité autorifoitle plagiarifmé
1! celui qui la fait.'offroit toujours d’aüffi bonnes chofés
que celles qu’il emprunte des. autres ; rhâis pour
l’ordinaire cet échange eft trop inégal : & tel s’enrichit
& fe pare des dépouilles d’autrui, qui ne peut
de fon propre fonds, leur fairé la moindre réftitu-
tién , ou leur donner fe plus léger dédomriiagement.
On a fouvenf déirialqué publiquement les plagiaires.
Tel fu t , au rapport de Thomafius , cet
Etienne D o le t , dont lés commentaires fur la larigue"
làtine, qui ne forriioierit d’abord qu’un volume médiocre
, fè trouvererit enflés jufqu’à deux volumes
in-folio aux dépens dé Charles Etienné, de Nizolius,
de Riceius, & de Lazàïe Bàif ; ce que Charles Erien-
rie dévoila aù public.
Enfin M. Bayle décide cjue le plagiarifmé eft. un
défaut moral 6c un vrai péché , à la tentation duquel
fuccombènt fouvent dés auteurs, qui d’ailleurs
font les plùs honnêtes gens du monde. Il faut qu’ils
fefafferità cét égaré une fauffe'cônfcience, & penfent
qu’il eft moins criminel de dérober à un homme les
productions de fon efprit j que de lili voler fon ar