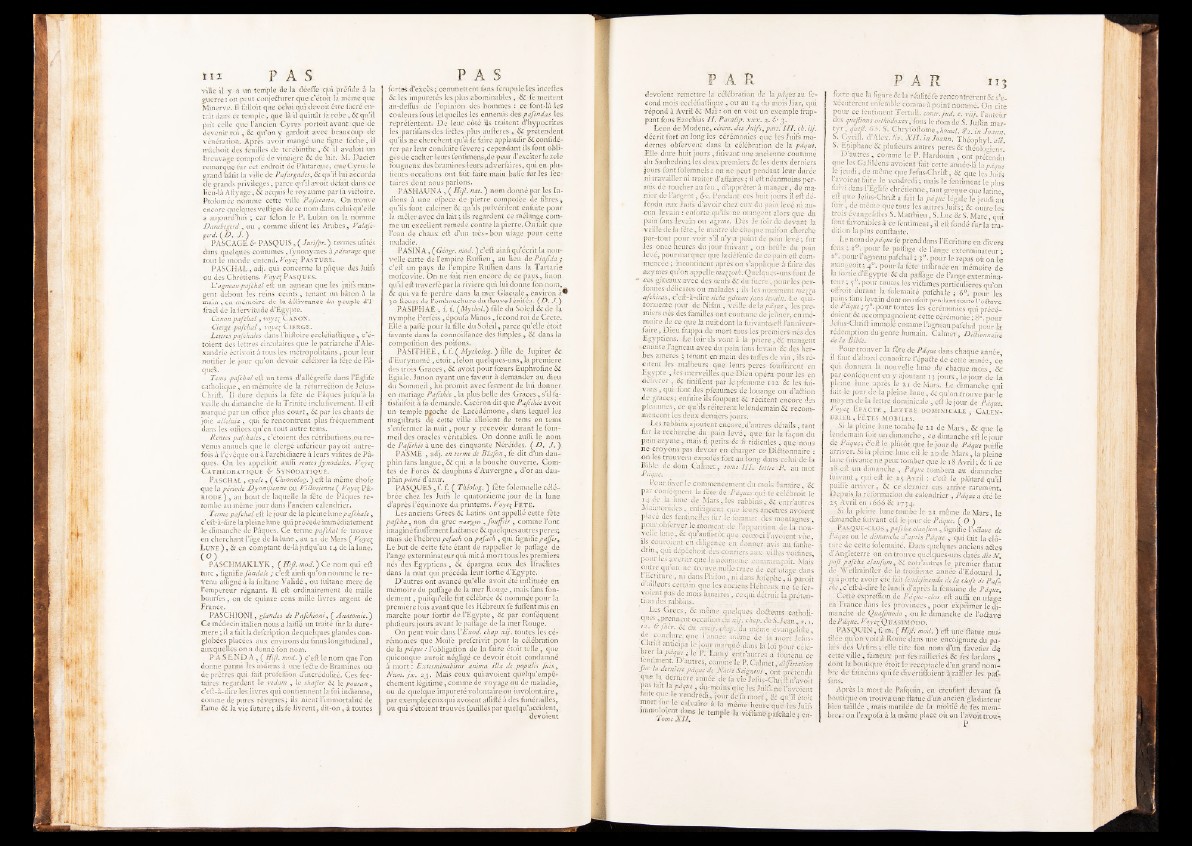
ville il y à un temple de la déeffequi 'préfide à la
guerre : on peut conjedurer que c’ étoit la même que
Minerve. Il falloit que celui qui devoit être facré en-
trât dans ce temple-, que là il quittât l'a robe, 6c qu’il
prît celle que l’ancien Cyrus portoit avant que de
devenir r o i , 6c qu’on y gardoit avec beaucoup de
vénération. Après avoir mangé une figue l'éche, il
mâchoit des feuilles de térébinthe , & il avaloit un
breuvage -compolë de vinaigre 6c de lait-. M. Dacier
remarque fur cet endroit de Plutarque, queCyrus le
grand bâtit la ville de P-afargades, 6c qu’il lui accorda
de grands privilèges, parce qu’il avoit défait dans ce
lieu-là Aliyage, 6c acquis -le royaume par fa victoire.
Ptolomée nomme cette ville Pajâcarta. On trouve
encore quelques veftiges de ce nom dans celui-qu’eüe
a aujourd’hui ; car félon le P. Lubin on la nomme
Darabegerd , ou , comme difent les Arabes, Valafe-
gerd. (D . J. )
P ASC AGE & PASQÜIS, ( Jurifpr. ) termes ufités
dans quelques coutumes , fynonymes à pâturage que
tout le monde entend. V?ye{ Pasture.
PASCHAL, adj. qui concerne la pâque des Juifs
ou des Chrétiens. Voyei Pasques.
L’agneau pafchal eft un agneau que les juifs mangent
debout les reins ceints, tenant un bâton à la
main , en mémoire de la délivrance du peuple d’Israël
de lafervitudé d’Egypte^
Canon pafchal, voye^ CANON.
Cierge pafchal, voye{ ClERGE.
Lettres pafckales dans l’hiftoire eccléliaftique., ‘c’é-
toient des lettres circulaires que le patriarche d’Alè-
xandrie écrivoit à tous les métropolitains, pour leur
notifier le jour qu’on devoir célébrer la fête de Pâ-
quefc.
. Tems pafchal eft un tems d’allégreffe dans l’Eglife
catholique , en mémoire de la rélurreélion de Jefus-
Chrift. Il dure depuis la fête de Pâques jufqu’à la
veille du dimanche de la Trinité inclufivement. Il eft
marqué par un office plus court, 6c par les chants de
joie alléluia , qui fe rencontrent plus fréquemment
dans les offices qu’en tout autre tems.
Rentes pa/châles, c’étoient des rétributions ,ou revenus
annuels que le clergé inférieur payoit autrefois
à l’évêque ou à l’archidiacre à leurs vifites de Pâques,
On les appelloit aufli rentes J'y nodales. Voye£
C athéd rat iq ue & Syn od atiq ue.
Pa sch a l , cycle, ( Chronolog. ) eft la même chofe
que la période Dyohijienne ou Victorienne ( Voye[ PÉRIODE)
, au bout de laquelle la fête de Pâques retombe
au même jour dans l’ancien calendrier.
. Terme pafchal eft le jour de la pleine lunepafchale,
c’ eft-à-ftire la pleine lune qui précédé immédiatement
le dimanche de Pâques. Ce terme pafchal fe trouve
en cherchant l’âge de la lune , au 21 de Mars ( Voyeç
L une ) , & en comptant de-là jufqu’au 14 de la lune*
( O )
PASCHMAKLYK, ( flifl. mod. ) Ce nom qui eft
turc , fignifie fandale ; c’eft ainfi qu’on nomme le revenu
amgné à la fultane Validé, ou fultane mere de
l’empereur régnant. Il eft ordinairement de mille
bourfes, ou de quinze cens mille livres argent de
France.
PASCHIONI, glandes de Pafchioni, {Anatomie J)
Ce médecin italien nous a laiffé un traité fnr la dure-
mere ; il a fait la defcription de quelques glandes con-
globées placées aux environs du finus longitudinal,
auxquelleS:pn a donné fon nom.
P A S E N D A , ( Hiß. mod. ) c’eft le nom que l’on
donne parmi les indiens à une fecle de Bramines ou
de prêtres qui fait profeffion d’incrédulité. Ces fec-
taires regardent le vedam , le shaßer 6c le pour an ,
c’eft-à-dire les livres qui contiennent la foi indienne,
comme de pures rêveries ; ils nient l’immortalité de
Famé 6c la vie future ; ils fe livrent, dit-on, à toutes
fortes.d’excès commettent fans fcrupulelés iilceftes
6c les impuretés les plus abominables , & fe mettent
àu-deffus de l’opinion des hommes : ce font-là les
couleurs fous lefquelles les ennemis des paftndas les
repréfentent-. De leur côté ils traitent d’hypocrites
les partifans des feftes plus aufteres , 6c prétendent
qu’ils ne cherchent qu’à fe faire applaudir 6c confidé-
rer par leur conduite févere ; cependant ils font obligés
de cacher leurs fentimens,de peur d’exciter le zele
fougueux des bramines leurs adverfaires, qui en plu-
fieurs occafions ont fait faire main baffe fur les fec-
taires dont nous parlons.
PASHAUNA, ( Hiß. nat. ) nom donné par les Indiens
à une efpece de pierre compofée de fibres -,
qu’ils font calciner 6c qu’ils pulvérifent enfuite pour
la mêler avec du lait ; ils regardent ce mélange comme
un excellent remede contre la pierre. Onfait que
l’eau de chaux eft d’un très- bon ufage pour cette
maladie.
PASINA, ( Géogr. niod. ) e’eft ainli qu’écrit la noui
l l e carte de l’empire Rufîien, au lieu de Piafida ;
c’eft un pays de l’empire Ruffien dans la Tartarie
mofcovite. On ne fait rien encore de ce pays, finon
qu’il eft traverféparla riviere qui lui donne fon nom,
6c qui va fe perdre dans la mer Glaciale, environ à®
30 lieues de l’embouchure du fleuve Jéniféa* (D . /.)
PASIPH AÉ , f. f. (Mytholf fille du Soleil 6c de la
nymphe Perféïs , époufa Minos, fécond roi de Crete.
Elle a pafle pour la fille du Soleil, parce qu’elle étoit
favante dans la connoiffance des limples , 6c dans la
compofition des poifons.
PASITHÈE , f. f. ( Mythoïog. ) fille de Jupiter 6c
d’Eurynomé , é toit, félon quelques-uns, la première
des trois Grâces, 6c avoit pour foeurs Euphrofine 6c
Egiale. Junon ayant une faveur à demander au dieu
du Sommeil, lui promit avec ferment de lui donner
en mariage Paßthee , la plus belle des Grâces , s’il fa-
tisfaifoit à fa demande. Cicéron dit que Paßthee avoit
un temple proche de Lacédémone, dans lequel les
magiftrats de cette ville alloient de tems en tems
s’enfermer la nuit, pour y recevoir durant le fom-
meil des oracles véritables. On donne aufti le nom
de Paßthee à une des cinquante Néréides. ( D . J. )
PASMÉ , adj. en terme de Blafon, fe dit d’un dauphin
fans langue, 6c qui a la bouche ouverte. Comtes
de Forés 6c dauphins d’Auvergne , d’or au dauphin
pâmé d’azur.
PASQUES, f. f. ( Théolog. ) fête foîemnelle célébrée
chez les Juifs le quatorzième jour de ïa lune
d’après l’équinoxe du printems. Voye[ Fe t e .
Les anciens Grecs 6c Latins ont appelle cette fête
pafcha, non du grec naexuv, fooffrir , comme l’ont
imaginéfauffementLa&ance & quelques autres peres;
mais de l’hébreu pefach on pafach , qui fignifie paffer,
Le but de cette fête étant de rappelîer le paflàge de
l’ange exterminateur qui mit à mort tous les premiers
nés des Egyptiens, 6c épargna ceux des Ifraélites
dans la nuit qui précéda leur fortie d’Egypte.
D ’autres ont avancé qu’elle avoit été inftituée en
mémoire du paffage de la mer Rouge, mais fans fondement
, puifqu’elle fut célébrée 6c nommée pour la
première fois avant que les Hébreux fe fuffent mis en
marche pour fortir de l’Egypte, 6c par conféquent
plufieurs jours avant le paflàge de la mer Rouge.
On peut voir dans YExod. ckap xij. toutes Tes cérémonies
que Moïfe prefcrivit pour la célébration
de la pâque : l’obligation de la faire étoit telle , que
quiconque auroit négligé ce devoir étoit condamné
à mort: Exterminabitur anima ilia de populis fuis ,
Num. jx . 2.3. Mais ceux qui avoient quelqu’empe-*
chement légitime, comme de voyage ou de maladie,
ou de quelque impureté volontaire ou involontaire,
par exemple ceux qui avoient aflifté à des funérailles,
ou qui s’étoient trouvés fouillés par quelqu’accident,
dévoient
dévoient remettre la célébration de la pâque au fécond
mois eçcléfiaftique, ou au 14 du mois Jiar, qui
répond à Avril 6c Mai : on en voit un exemple frappant
fous Ezechias II. Paralip. x xx. 2. & 3 .
Leon de Modene, cérem. des Juifs, part. III. ch. iij.
décrit fort' au long les cérémonies que lés Juifs modernes
obfervent dans la célébration de la pâquè.
Elle dure huit jours , fuivant une ancienne coutume
du Sanhédrin; les deux premiers & les deux derniers
jours font folemnels : on ne peut pendant leur durée
ni travailler ni traiter d’affaires ; il eft néanmoins permis
de toucher au feu , d’apprêter à manger, de manier
de l’argent, &c. Pendant ces huit jours il eft défendu
aux Juifs d’avoir chez eux du pain levé ni au-
-cun levain : en forte .qu’ils ne mangent alors que du
pain fans levain ou açyme. Dès le loir de devant la
veille de la fête, le maître de chaque maifon cherche
par-tout pour voir s’il n’y a point de pain levé ; fur
jes onze heures du jour fiiivant, on brûle du pain
levé, pour hiarquer que la défenfe de ce pain eft commencée
; incontinent après on s’applique à faire des
azymes qu’on appelle .maqpth; Quelques-uns font dé
1 ces gâteaux avec des oeufs & du fucre-, pour les per-
fonnes délicates ou malades ; ils les nomment ma^ça
afckiras, c’eft-à-dire riche gâteau fans levain. Le quatorzième
jour de Nifan, veille de la pâque, les premiers
nés des familles ont coutume de jeûner, en mémoire
de ce que la nuit dont la fuivante»eftl’anniver-
faire, Dieu frappa de mort tous les premiers nés des
Egyptiens. Le loir ils vont à la priere, & mangent
■ enmite l’agneau avec du pain fans levain 6c des herbes
ameres ; tenant en main des taffes de v in , ils récitent
les malheurs que leurs peres fouffrirent en
Egypte , le&imerveilles que Dieu opéra pour les en
délivrer , 6c finiffent par le pfeaume 112 6c les fui-
vans, qui font des pfeaumes de louange ou d’aôion
de grâces ; enfuite ils foupent 6c récitent encore des
pfeaumes , .ee qu’ils réitèrent le lendemain & recommencent
les deux derniers jours.
Les rabbins ajoutent encore,d’autres détails, tant
•fur la recherche du pain le v é , que fur la façon du
pain azyme , mais fi petits-& fx ridicules , que nous
ne croyons pas devoir en charger ce Diâionnaire :
on les trouvera èxpofés-fort au long dans celui de la
P M d® dom Gähnet, tome III. lettre P. au mot
Pour.fixer le commencement du mois lunaire, &
par confequent la fête de Pâques.qui 1e célébroit le
14 .de la lune -de Mars , les rabbins entr’autres
Maxinonides , enfeignent que leurs ancêtres ayoient
place des fentinelles fur le fominet des montagnes ,
pour obferyer le.moment.dje l’apparition de la noii-
veiie lune, 6c qu’auffi-tôt que ceux-ci l’avoient vûe,
1 s couroient en diligence en donner, avis :au. fanhe-
dn n, qui dépêchoit des.couriers aux villes voifines,
pour les avertir que la néomenie commençoit. Mais
outre qu’on ne trouve:nulle trace de cet ufaoe dans
l’Ecrtare , ni dans Pfcilon, ni dans fajgfke , I .parqît
cl ailleurs certain que les anciens Hébreux ne le 1er-
voxent pas de mois lunaires, ce qui détruit la prétention
des rabbins.
Les Grecs, & même quelques do&eurs catholiques
, prennent occafion'du xi/, chap. de S.Jean , v. /.
iz . ’&fuiy. & du xriij. ç/iatf. dii même évangelifte j
y . ^?nc urc- c[Lie 1 :!11née mqnie de iit mort Jeiiis-
Uintt anticipa k jo u r m a rqÄ 'än s la loi Üour célébrer
la piuim; le1 P.‘ 'Idmÿ éntt’atttn«^ à" ftSitténu'^cé ‘
B E P » ! P ’au tfei coiiùBèUç P, I B S , dlfàîàiion ‘
Jur la detmerç paque tli ^Qlrï Saigatar, orit'préténdu
.que la dermere annéë;d'e.fa t o Jeftisifiteft n’avoît
pas tait Is-fdqùe , dtutpmnVglie lési Juirs.nè'ravbient
faite que le vèndrédt, fqitt dèïa mort' 1 qù;it étoit
mort tur le' calvïtirè ä>lä ' même hèiiteÂlé.’îW'Juifs
immtÿiqent dans le temple 1 la viétimé pifchale f en- ome X I I t 1 ■ .
forte que la figure & la réalitéfe rencontrèrent & s’e-
Xccuterént enfenible commeà point nommé. On cite
pour ce fentiment Tertull. contr. jud. c. viij. l’auteur
des queflrons orthodoxes, fous le rtôm de S. Juftin mar-
tyr quefi. 65. S._ Chi-yfoftome, homel. 82. in Joann.
c I S P c,’^Iex- Liv‘ X I I . in Joann. Théophyl. a cl.
i>. Epiphane & plufieurs autres peres 6c théologiens.
D ’autres , comme le P. Hardouin , ont prétendu
que les G.aliléens avoient fait cette année-là h pâque
le jeudi, de même que Jefus-Chrift, & que les Juifs
l’avoient faite lé vendredi ; mais le fentiment le plus
fuivi dans l’Eglife chrétienne, tant greque que latine
eft que Jefus-Chrift a fait la pâque légale le jeudi au
fô ir , de même que tous Tes autres Juifs ; & outre les
trois évangeliftes S. Matthieu, S. Luc 6cS. M arc, qui
font favorables à ce fentiment, il eft fonde fur la tradition
la plus confiante.
Le nom de pâque fe prend dans l’Ecriture en divers
fens , i° . pour le paffage de l’ange exterminateur;
z°. pour l’agneau pafchal ; 3 pour lé repas où on le
mangeoit ; 40. pour la fete inftituée en mémoire de
la fortie d’Egypte & du paffage de l’ange extermina-
teur ; 5 °. pour toutes les viftimes particulières qu’on
offroit durant la folemnité pafchale ; 6°. pour les
pains Fans levain dont on ufoit pendant toute l ’oélave
de Pâque; 7°.pour toutes- les cérémonies qui précé-
doient & accompagnoient cette cérémonie ; 8°. pour
Jefus-Chrift immolé comme l’agneau pafchal pour la
rédemption du genre humain. Calmet, Dictionnaire
de la Bible.
Pour trouver la fête de Pâque dans chaque année
il faut d’abord connoître l’épaéle de cette -année, ce
qui. donnera là 'nouvelle lune de chaque mois ’ &:
par conféquent en y ajoutant 13 jours, le jour de la
pleiqè lune apres le z i de Mars. Le dimanche qui
fuit le jour de la pleine lune, 6c qu’on-trouve parle
moyen de la lettre dominicale , eft le jour de Pâque.
Voye{ Epac te , L ettre dominicale -, Calend
r ie r , Fêtes mobiles.
| Si la pleine lune tombe le z i de Mars, 6c que le
lendemain foit un dimanche, ce dimanche eft le jour
de Pâque; ô’eft le plutôt que le jour de Pâque puiffe
arriver. Si la pleine, lune eft le zo de Mars, la pleine
lune fuivante ne. peut tomber que le 18 Avril ; & fi ce
t S» eft un dimanche , Pâque tombera au dimanche
fuiyaiit, qui eft le 25 Avril : c’eft le plûtard qu’il
puiffe arriver, 6c ce dernier cas arrivé rarement.
Depuis la réformation du calendrier , Pâque a été le
25 Avril en (6(56 6c 173 4.
- Si la pleine lune tombe lé 21 même de Mars le
dimanche fuivarit eft le jour de Pâque. ( O ) ’
.as PASQUE-CLOS,, pafcha claufum, lignifie Y octave de
Pâque ou le dimanche d'après Pâque., qui fait la clôture
de cette folemnité. Dans quelques anciens a des
d’Angleterre on en trouve quelques-uhs datés die KT.
pofl pafcha claufum, 6c entr’autres le premier ftatut
dé 'Weftminfter fte la trqifieme année. d’Edouard I.
qui porte avoir été fait lendejmenda de la clofe de P a f
che , c’eft-à-dire le lundi d’après la femaine .de Pâque.
Cette expreffion de Pâque - clos eft auffi en ufage
en' France dans les provinces, pour exprimer le dimanche
de Quafimodo , ou le dimanche de l’odave
de Pâque. Vyyeç Q Û ASIM QD Q. ; '
PASQUIN, f. m. ( Hiji; mod. ) eft une ftatue mutilée
qu.’on voit à Rome dans une encoignure du palais
des Urfins ; elle tire fon nom d’mi favetier de
cette ville , fameux par les railleries & fesdardons ,
dont la boutique étoir le réceptacle d’un grand nombre
de lainéans qiii le divertiffoient à;railler les paf-
fans. ' '
Après la mort d,e Pafquin, en cretilant- devant fâ
bôutique.on trouva uné ftatue d’un ancien'gladiateur
bien taillée , mais mutilée-de la moitié de fès membres
: on l’expoja à la même place oîi on l’avoit trou-
P