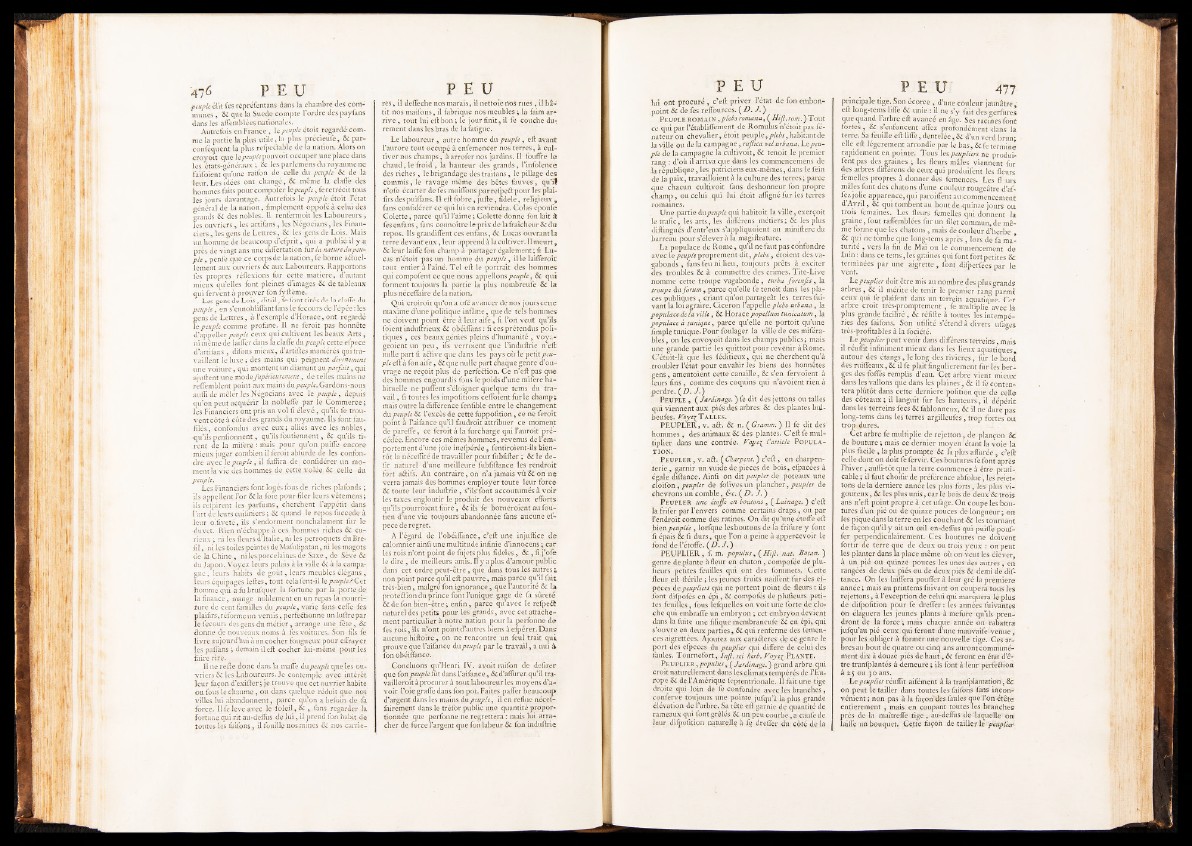
peuple élit fes repréfentans dans la chambre des communes
, & que la Suede compte l’ordre des payfans
dans les affemblées nationales. _ "
Autrefois en France , le peuple étoit regardé comme
la partie la plus utile, la plus precieufe, & par-
conféquent la plus refpedable de la nation. Alors on
croyoit que le peuple pouvoir occuper une place dans
les états-généraux ; & les parlemens du royaume ne
faifoient qu’ime raifon de celle du peuple & de là
leur. Les idées ont changé, & même la clafle des
hommes faits pour compofer 1 e peuple, ferétrécit tous
les jours davantage. Autrefois le peuple étoit l’état
général de la nation, fimplement oppofé à celui des
grands & des nobles. Il renfermoit les Laboureurs ,
les ouvriers, les artifans, les Négocians, les Financiers
, les gens de Lettres, &: les gens de Lois. Mais
un homme de beaucoup d’efprit, qui a publié il y a
près de vingt ans une differtation fur la nature du peuple
, penfe que ce corps de la nation, fe borne actuellement
aux ouvriers & aux Laboureurs. Rapportons
fes propres réflexions fur cette matière, d’autant
mieux qu’elles font pleines d’images & de tableaux
qui fervent à prouver fon fyflème.
Les »ens de Lois, dit-il, le font tirés de la clafle du
peuple, en s’ennobliflant fans le fe cours de l’épée : les
gens de Lettres, à l’exemple d’Horace, ont regardé
le peuple comme profane. Il ne feroit pas honnête
d’ appeller peuple ceux qui cultivent les beaux Arts ,
ni meme de laiffer clans la clafle du peuple cette efpece
d’artifans , difons mieux, d’artiftes maniérés qui travaillent
le luxe ; des mains qui peignent divinement
une voiture, qui montent un diamant ail parfait, qui
ajuftentune mode fupérïeurement, de telles mains ne
reflemblent point aux mains du peuple. Gardons-nous
aufli de mêler les Négocians avec le peuple , depuis
qu’on peut acquérir la nobieffe par le Commerce ;
les Financiers ont pris un vol fi élevé, qu’ils fe trouvent
côte à côte des grands du royaume. Ils font faufilés,
confondus avec eux ; alliés avec les nobles,
qu’ils penfionnent, qu’ils i'outiennent, & qu’ils tirent
de la mifere : mais pour qu’on puiffe encore
mieux juger combien il feroit abfurdede les confondre
ayec le peuple ^ il fuflira de t confidérer un moment
la vie des hommes de cette volée, & , .celle du
peuple.
Les Financiers font logés fous de riches plafonds ;
ils appellent l’or & la foie pour filer leurs vêtemens ;
ils reipirent les parfums, cherchent l’appétit dans
l’art de leurs cuifiniers ; & quand le repos fuccede à
leur o'.fiveté, ils s’endorment nonchalament fur le
-duvet. Rien n’échappe à ces hommes riches & curieux
; ni les fleurs d’Italie, ni les perroquets du Bre-
f il, ni les toiles peintes de Mafulipatan, ni les magots
de la Chine , ni les porcelaines de Saxe, de Sève &
du Japon. V oyez leurs palais à la ville & à la campagne,
leurs habits de goût , leurs meubles élégans,
leurs équipages lefles, tout celafent-il le peuple? Cet
homme qui a fu brufquer la fortune par la porte de
la finance, mange noblement en un repas la nourriture
de cent familles du peuple, varie fans ceiïe-fes,
plaifirs, réforme un vernis, perfectionne unluftrepar
le.fecours des gens du métier, arrange une fête , 8c
donne de nouveaux noms à fes vôitureS; Spn fils fe
livre aujourd’hui à un cocher fougueux pour effrayer
les pa flans; demain il efl cocher lui-même pour les
faire rire.
Il ne refie donc dans la mafle du peuple que les ouvriers
& les Laboureurs. Je contemple avec intérêt
leur façon d’exifter; je trouve que cet ouvrier habite
ou fous le chaume, ou dans quelque réduit que nos
villes lui abandonnent , parce qu’on a befoin de fa
force. Ilfe leve avec le f b le i l ,& , fans regarder la
Fortune qui rit au-deffus de lui, il prend fon habit de
toutes les faifons,, il fouille nos mines 8c nos carrieres,
il deffeche nos marais, il nettoie nos rues , il bâtit
nos maifons, il fabrique nos meubles ; la faim ar*
r iv e , tout lui efl bon ; le jour finit, il fe couche durement
dans les bras de la fatigue.
Le laboureur , autre homme du peuple, efl avant
l’aurore tout occupé à enfemencer nos terres, à Cultiver
nos champs, à arrofer nos jardins. Il fouffre le
chaud, le froid , la hauteur des grands, l’infolence
des riches , le brigandage des traitans, le pillage des
commis, le ravage même des bêtes fauves, qu’il
n’ofe écarter de fes moiflons par refpeél pour les plaifirs
despuiflans. Il efl fobre, ju fle, fidele, religieux ,
fans confidérer ce qui lui en reviendra. Colas époufe
Colette, parce qu’il l’aime ; Colette donne fon lait à
fes enfans, fans connoître le prix de la fraîcheur 8c du
repos. Ils grandiflënt ces enfans, & Lucas ouvrant la
terre devant eux, leur apprend à la cultiver. Il meurt,
& leur laifle fon champ à partager également ; fi Lucas
n’étoit pas un homme du peuple, il le laiflèroit
tout entier à l’aîné. T el efl le portrait des hommes
qui compofent ce que nous appelions peuple, 8c qui
forment toujours la partie la plus nombreufe & la
plus néceflaire de la nation.
Qui croiroit qu’on a ofé avancer de nos jours cette
maxime d’une politique infâme, que de tels hommes
ne doivent point être à leur a ife, fi l’on veut qu’ ils
foient induflrieux 8c obéiflans : fi ces prétendus politiques
, ces beaux génies pleins d’humanité , voya-
geoient un peu, ils verraient que l’induflrie n’efl
nulle part fi aélive que dans les pays oii le petit peuple
efl à fon aife, & que nulle part chaque genre d’ouvrage
ne reçoit plus de perfeftion. Ce n’efl pas que
des hommes engourdis fous le poids d’une mifere habituelle
ne piment s’éloigner quelque tems du travail
, fi toutes les impofitions cefloient furie champ;
mais outre la différence fenfible entre le changement
du peuple 8c l’excès de cette fuppofition, ce ne feroit
point à l’aifance qu’il faudroit attribuer ce moment
de pareffe, ce feroit à la furcharge qui l’auroit précédée.
Encore ces mêmes hommes, revenus de l’emportement
d’une joie inefpérée, fentiroient-ils bientôt
la néceffité de travailler pour fubfifler ; & le de-
fir naturel d’une meilleure fubfiflance les rendroit
fort actifs. Au contraire, on n’a jamais vu 8c on ne
verra jamais des hommes employer toute leur force
8c toute leur induflrie , s’ils'font accoutumés à voir
les taxes engloutir le produit des nouveaux efforts
qu’ils pourroient faire, & ils fé bomeroient au fou-
tien d’une vie toujours abandonnée fans aucune efpece
de regret.
A l’égard de l’obéiflance, c’efl une injufHce de
calomnier ainfi une multitude infinie d’inno,cens : car
les rois n’ont point de fujets plus fideles, & , fi j’ofe
le dire, de meilleurs amis. Ily ap lu s d’amour public
dans cet ordre peut-être, que dans tous les autres;
non point parce qu’il efl pauvre, mais parce qu’il fait
très-bien, maigre fon ignorance, que l’autorité 8c la
protection du prince font Tunique gage de fa sûreté
& de fon bien-être ; enfin, parce qu’avec le refpett
naturel des petits pour les grands, avec cet attachement
particulier à notre natipn pour la perfonne de
fes rois, ils n’ont point d’autres biens à efpérer. Dans
aucune hifloire , on ne rencontre un feul trait qui,
prouve que l’aifance du peuple par le travail, a nui à
l’on obéiflance.
Concluons qu’Henri IV. avoit raifon de defirer
que fon peuple fût dans l’aifance, 8c d’affurer. qu’il tra-
vailleroit à procurer à tout laboureur les moyens d’avoir
l’oie graffe dans fon pot- Faites paffer beaucoup
d’argent dans les mains du peuple, il en reflue nécef-
fairement dans le tréfor public une quantité propor-.
donnée que perfonne ne regrettera : mais lui arracher
de force l’argent que fon labeur 8c fon induflrie
lui ont procuré, c’efl priver l’état de fon embonpoint
8c de fes reffources. (/>.ƒ. ) .
P e u p l e r o m a i n , plebs romana, ( Hiß. rom. ) Tout
ce qui par l’établiflement de Romulus n’étoit pas.fé-
nateurou chevalier, étoit peuple,/»/«As, habitant de
la ville ou de la campagne, ruflica vel urbana. Le peuple
de la campagne la cultivoit, 8c tenoit le premier
rang : d’oîi il arriva que dans les commencemens de
la republique, les patriciens eux-mêmes, dans le fein
de la paix, travailloient à la culture des terres ; parce
que chacun cultivoit fans deshonneur fon propre
champ, ou celui qui lui étoit affigné fur les terres
romaines.
Une partie du peuple qui habitoit la v ille, exerçoit
le trafic, les arts, les différens métiers; & les plus
diflingués d’entr’eux s’appliquoient au miniflere du
barreau pour s’élever à la magiflrature.
La populace de Rome, qu’il ne faut pas confondre
avec le peuple proprement dit, plebs, etoient des vagabonds
, fans feu ni lieu, toujours prêts à exciter
des troubles & à commettre des crimes. Tite-Live
nomme cette troupe vagabonde , turba forenfis, la
troupe du,forum, parce qu’elle fe tenoit dans les places
publiques , criant qu’on partageât les terres fui-
vant la loi agraire. Cicéron l’appelle plebs urbana, la
populace de la ville, 8c Horace popellum tunicatum, la
populace à tunique, parce qu’elle ne portoit qu’une
fimple tunique. Pour foulager la ville de ces miféra-
bles, on les envoyoit dans les champs publics ; mais
une grande partie les quittoit pour revenir à Rome.
Ç’étoit-là que les féditieux, qui ne cherchent qu’à
.troubler l’état pour envahir les biens des honnêtes
.gens, ameutoient cette canaille, 8c s’en fervoient à
leurs fins , comme des coquins qui n’avoient rien à
perdre. ( /> ./ .)
P e u p l e , ( Jardinage. ) fe dit des jettons ou talles
qui viennent aux. piés des arbres 8c des plantes bul-
beufesf V T a l l e s .
PEUPLER, v. aél» 8c n. ( Gramm. ) Il fe dit des'
hommes , des animaux 8c des plantes. C’efl fe multiplier
dans une contrée. Voye^ l'article P o p u l a t
i o n .
P e u p l e r , v. aéh ( Charpent. ) c’e f l , en charpenterie
, garnir un vuide de pièces de bois, efpacées à
égale diflance. Ainfi on dit peupler de poteaux une
cloifon, peupler de folives un plancher, peupler de
chevrons un comble * &c. ( D . J. )
PEUPLER une étoffe en boutons , ( Lainage.. ) c’efl
la frifer par l’envers comme certains draps, où par
l’endroit comme des ratines. On dit qu’une étoffe efl
bien peuplée , lorfque les boutons de la frifure y font
fi épais, & fi durs, que l’on a peine à appercevoir le
fond de l’étoffe. (D . /.,)
PEUPLIER, f. m. popiilus, ( Hiß. nat. Botan. )
genre déniante à fleur en chaton, compofée de plu-
fieurs petites feuilles qui ont des fommets> Cette
fleur efl flérile ; les jeunes fruits naiflent fur des ef-
peces de peupliers qui ne portent point de fleursi ls
font difpofés en ép i, & compofés de plufieurs petites
feuilles, fous lefquelles on voit une forte de cloT
ehe qui embraffe un embryon ; cet embryon devient
dans la fuite une filique membraneufe & en épi, qui
s’ouvre en deux parties, & qui renferme des femen-
ces aigrettées. Ajoutez aux caraéleres de çé genre le
port des efpeces du ptuplier qui différé de celui des
faules. Tournefort, Infi. rei herb. Voye{ P l a n t e .
P e u p l i e r , populus, ( Jardinage. ) grand arbre qui
croît naturellement dans les climats tempérés de l’Europe
& de,l’Amérique feptentrionale. Il fait une tige
droite qui loin de fe confondre avec les branches,
çonferve toujours une pointe jufqu’à la plus grande
élévation de l’arbre. Sa tête efl garnie de quantité de
rameaux qui font grêlés & un;peu courbe, a caufe de
leur difpofition naturelle à fe dreffer du côté de la
principale tige. Son ecorce , d’une couleur jaühâtre »
efl long-tems liffe & unie : il ne s’y fait des gerfures
que quand 1 arbre efl avance en âge. Ses racines font
fortes, & s’enfoncent affez profondément dans la
terre. Sa feuille efl liffe, dentelée, & d’un verd brun;
elle efl légèrement arrondie par le bas, & fe termine
rapidement en pointe. Tous les peupliers né produi-
fent pas des graines ; les fleurs mâles viennent fur
des arbres différens de ceux qui produifent les fleurs
femelles propres à donner des lèmeiices. Les fhurs
mâles font des chatons d’une couleur rougeâtre d’af*
fez jolie apparence, qui paroiffent au commencement
d’A v r il, & qui tombent au bout de -quinze jours ou
trois femaines. Les fleurs femelles qui donnent la
graine, font raffemblées fur un filet commun, de même
forme que les chatons, mais de couleur d’herbe
& qui ne tombe que loiig-tems après , lors de fa maturité
, vers la fin de Mai ou le commencement de
Juin : dans ce tems, les graines qui font fort petites &
terminées par une aigrette, font difperfées par le
vent.
Lc peuplier doit être mis au nombre des plus grands
arbres , & il mérité de tenir le premier rang parmi
ceux qui fe plaifent dans un terrei'n aquatique. Cet
arbre croît très-promptement , fe multiplie ,avec la
plus grande faciliré, & réfifle à toutes les intempéries
des faifons. Son utilité s’étend à divers ufages
très-profitables à la fociété.
Le ptuplier peut venir dans différens terreins, mais
il réuffit infiniment mieux dans les lieux aquatiques,
autour des étangs, le long des rivières, fur ie bord
des ruiffeaux, & il fe plaît fingulierement fur les berges
des foffés remplis d’eau. Cet arbre vient mieux
dans les vallons que dans les plaines, & il fe contentera
plutôt dans cette derniere pofition qüe de celle
des coteaux ; il languit fur les hauteurs, il dépérit
dans les terreins fecs & fablOnneux, & il ne dure pas
long-tems dans les terres argilleufes, trop fortes oit
trop-dures.
Cet arbre fe multiplie de rejetton, de plaftçon &
de bouture ; mais ce dernier moyen étant la voie la
plus facile , la plus prompte & la plus affinée, c’efl:
celle dont on doit fe fervir. Ces boutures fefont après
l’hiver , auffi-tôt que la terre commence à être praticable
; il faut choifir de préférence abfolue , les rejet-
tons de la derniere annee les plus forts, les plus v igoureux,
& les plus unis, car le bois de deux & trois
ans n’efl: point propre à cet ufage. On Coupe les boutures
d’un pié ou de quinze pouces de longueur ; oii
les pique dans la terre en les couchant & les tournant
de façon qu’il y ait un oeil en-deffus qui puifTe pouffer
perpendiculairement. Ces. boutures ne doivent
fortir de terre que de deux ou trois yeux : on peut
les planter dans la place même où on Veut les élever,
à un pié ou quinze pouces les unes des autres , en
rangées de deux piés ou de deux piés & demi de dif-
tance. On les laifferà pouffer à leur gré la première
année ; mais au printems fuivant on coupera tous les
rejettons,.à l’exception de celui qui marquera lè plus
de difpofition pour fe dreffer : les années''fuivantes
On élaguera les jeunes plants à mefiite qu’ils prendront
de la force ; mais chaque année on rabattra
jufqu’au pié ceux qui ferontid’une maüVaife^venue,
pour les.obliger à former urie nouvelle tige. Ces arbres
au bout ae quatre ou cinq ans auront communément
dix à douze piés de haut,, & feront en état d’être
tranfplantés à demeure ; ils font à-leur perfection
à 25 ou 30 ans.
Le peuplier réuffit aifément à la tranfplantation, 8c
on peut le tailler dans toutes des faifons fans inconvénient;
non pas à la façortdes failles'que l ’on etête
entièrement , mais, en coupant toutes les branches
près de la maîtreffe tige ; ;au:deffiis de laquelle on
laifle un bouquet. Cette façon de tailler ie peuplier