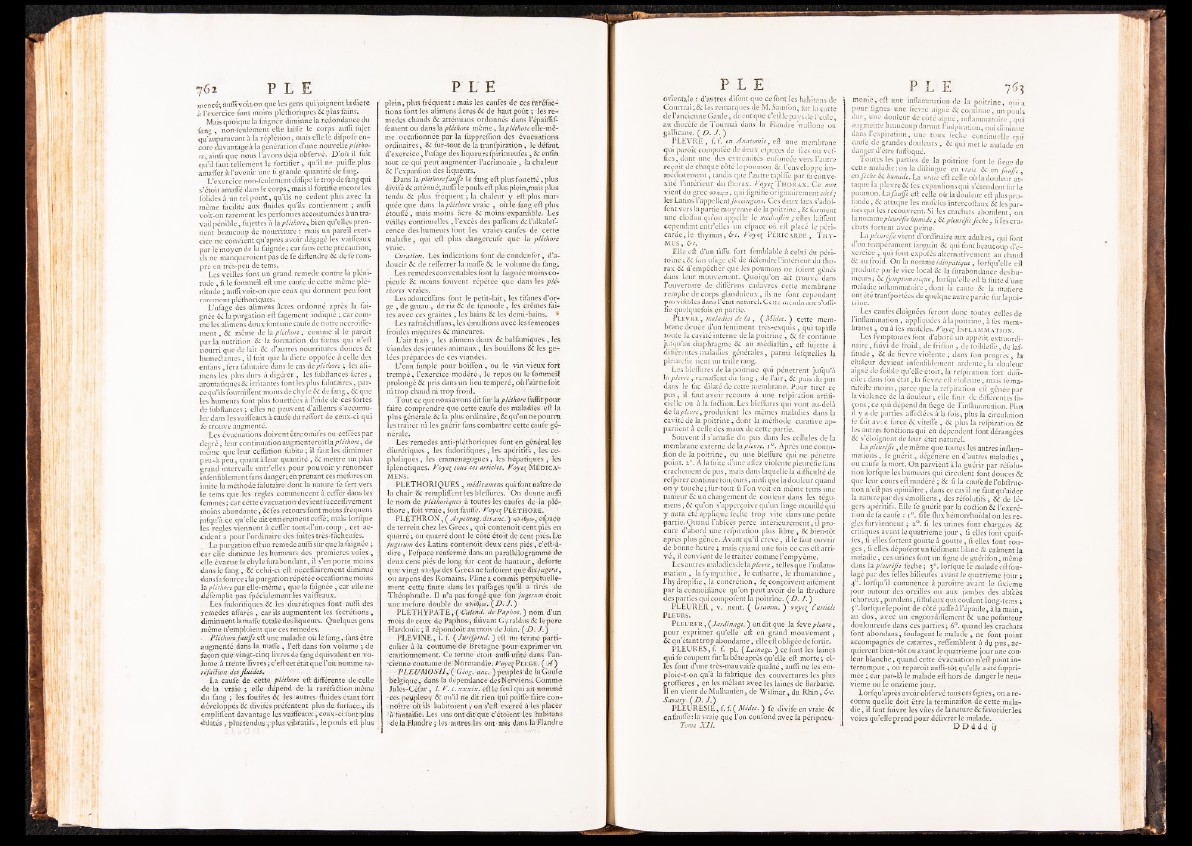
mène«; àuflivoit-on que les gens qui joignent ladiete
à l’exercice font moins pléthoriques 6c plus filins.
Mais quoique la faignée diminue la redondance du
fang , non-feulement elle laiffé le corps aufli fujet
qu’auparavant à la réplctïon, mais elle lè difpole encore
davantage à la génération d’une nouvelle pléthore^
ainli que nous l’avons déjà ôbferve. D ou il fuit
qu’il fout tellement le fortifier, qu’il ne puiffeplus
amaffér à l’avenir une fi grande quantité de fang. . .
L’exercice non-feulement difîipe le trop de fang qui
s’étoit àniaffé dans le corps, mais il fortifie encore les
folides à ün tel point, qu’ils ne cedent plus avec la
même facilité aux fluides qu’ils contiennent ; aufli
voit-on rarement les perfonnes accoutumées à un travail
pénible, fujettes klaplêthore, bien qu’elles prennent
beaucoup de nourriture : mais un pareil exercice
ne convient qu’après avoir dégagé les vaifleaux
par lè'mdyen de la faignée ; car fans cette précaution,
ils ne mànqueroientpas de fe diftendre 6c deferom-
pre en trèis-peu de tems. .
Les veilles font un grand remede contre 1-a plénitude
, fi le fommeil eft une caufe de cette même plénitude
; aufli voit-on que ceux qui dorment peu font
rarement pléthoriques.
L’ufage des alimens âcres ordonné après la faignée
6c la purgation efl fagement indique ; car comme
les alimens douxfontune caufe de notre accroifié-
ment, 6c même de la pléthore, comme il le paroît
pa rla nutrition & la formation du foetus qui n’eft
nourri que de lait & d’autres nourritures douces &
hiimeftantes, il fuit queladiete oppofée à celle des
enfans, fera falutaire dans le cas de pléthore ; les alimens
les plus durs à digérer , les fubftances âcres ,
aromatiques & irritantes font lès plus falutaires, parce
qu’ils fourniffent moins de chyle 6c de fang, 6c que
les humeurs font-plus fouettées à l’aide de ces fortes
de fubftances ; elles ne. peuvent d’ailleurs s’accumuler
dans les vaifleaux à caufe. dur effort de ceux-ci qui
fe trouve augmente.
Les évacuations doivent être omifes ou’cefféespar
degré, leur continuation augnleriteroit la pléthore y de
même que leur déflation fùbite ; il faut les diminuer
peu-à-peu, quant à leur quantité , 6c mettre un plus
grand intervalle entr’elles pour pouvoir y renoncer
infenfiblement fans dangér;.ën:prenant ces mefures on
imite la méthode falutaire dont la nature fe fert vers
le tems quelles réglés commencent à cèffér dàns les
femmes ;ccar. cëtte évacuation devient fuccefiivëment
moins abondante, &fes retoursfont moins fréquens
jufqu’àice,,qu’elle ait entièrement ceflé; mais .'lorfque
les réglés vïennent à.cëïfértOirt-d’ün-coup , cet:accident
a pour l’ordinaire des :fuitestrès-fâcheufes.
La purgation eftunremede.aufli sûr quelafaignëe ;
car elle diminue les humeurs des premières .voies,,
elle évacue leichyle furàbomdaht, il s’en porte moins
dans le fang;, 6c celui-ci ■ efl nécefîairem ent diminué
dansfafoitrçe ;:la purgation répétée occafionne moins
la pléthore par elle-meme ;, que la faignée, car elle ne
défemplit pas fpécialementdes vaiffeaux.
Les fudorifiques ' & : les diurétiques font aufli des
remèdes affurés ,j car ils augmentent les fecrétions :,
diminuent la maffe totale desli'queurs. Quelques gens
même h’emploient que ces remedes.
- Pléthorefaujfe efl une maladie où le fang , Tans être
augmenté, dans la maffe-, l’eft dans fon volume ; de
façon qiievingt-einq‘ livres de fang é quivaient en ■ volume
à trénte* livres ;c ’-eft cetqtàt que l’oiu homme raréfaction'de$
fluides.
La caufe 4« cette pléthore eft différente de icelle
■ de la vràie ; elle.dépend dé la raréfaction même
du fang ; ; les:fbufr’es<& des imitres--fluides étant fort
développés, & divifésîpréféntent plus de, furface^ûls
empliflènt davantage les vaifleaux y ceu x -ci'foht plus
dilatés p plus téndus pplus vififatifs-; lé> pouls-elitiplus
plein , plus fréqiient : mais les caufès de ces Raréfactions
font les alimens âcres 6c de haut goût ; les remedes
chauds 6c atténiians ordonnés dans l’épaiflif-
fement ou dans la pléthore même, la pléthore elle-même
occafionnée par la fupprefliori des évac-uàtions
ordinaires , 6c fur-tout de la tranfpiration-, le défaut
d’exercice, l’ufage des liqueurs fpiritueufes, & enfin
tout ce qui-peut augmenter; l’acrimonie , la1 chaleur
6c l’expanfion des liqueurs.
Dans la pléthore faitjfe le fang eft plus fouetté, plus
div-ifé 6c atténué; aufli le pouls eft plus plein,mais plus
tendu 6c plus fréquent ; la chaleur y eft plus marquée
(pie dans la pléthore vraie , où le fang eft plus
étouffé , mais moins âcre 6c moins expanfible. Les
veilles continuelles , l’excès des paflions 6c l’aikaléf-
eence des humeurs font -les vraies -caufes de cette
maladie, qui eft plus dangereufe què la pléthore
vraie.
Curation, Les indications font de condenfêr , d’adoucir
6c de refferrer la maffe 6c le volume thi fang.
Les remedesconvenables font la faignéémoins co-
pieufe & moins fouvent répétée que dans lés 'pléthores
vraies.
Les adouciffans font le petit-lait, les tifanes d’or-»
ge , de gruau, de riz 6c de femonle , leis crêmes'fai-
tes avec ces graines , les bains 6c les demi-bains. *
Les rafraîchiffans, les émulfions avec les fetnences
froides majeures 6c mineures.
L’air frais , les alimens doux 6c balfamiqifës , les
viandes des jeunes animaux, les bouillons & les gelées
préparées de ces viandes.
L’eau Ample pour boiffon, ou le vin vieux fort
trempé, l’exercice modéré*, le repos ou lefbrhmeîl
prolongé & pris dans un lieu temperé, où l’air néfoit
ni trop chaud ni trop froid.
T ©ut ce que nous avons dit fur la pléthore {\{iRtfpour
faire Comprendre que cette caufe des maladies -eft la
plus générale 6c la plus ordinaire, & qu’on ne pourra
les traiter ni les guérir fans combattre cettecaufe générale.
•
Les remedes anti-pléthoriques font en géilefal les
diurétiques, les fiadorifiques, les apéritifs , des céphaliques,
les emmenagogues, les hépatiques j -lés
fplenétiques. V o y e { tous ces articles. ¥ o y t { MÉ-DICA-
MENS. ~
PLETHORIQUES ,• médicamens quifontoaître dfe
la chair'&;rempliffent'les bleffures. On donrie aufli
•le' liom de à'toutes les câtifes de 4 a- plé-.
th ç re , foit vraie, foit fauffe. j Voyt{ Plé th o r e . '
PLÉTHRON, ( Arpentag. des-anc. f^xéôpo^ Ofpacè
de terrein chez les G recs, qui contenoit ;céntpies en
quarré; ou quarrédont le côté'étoit deeentpiés; Le
jugérum des Latins contenoit deux cèns piés; ’c’éfLà-
dir-e, l’efpace renfermé dans un parâUéldgtamm'è- de
deux cens piés de long fur cent de 'hauteur , defôrfe
•que vingt irXtOjioidés Grecs n'efaifoieiit que’di%j-ugerd,
ou arpëhs des Romains. Pline a commis' péf pefüëllë-
ment c'ettè faute dans les 'paffdgës 'qtdil a- ’tlrés :de
Théôphrafte. Il n’a pas fongé^;quie^ ' foh fotgerum>étoit
une mefure doublé du TrXtBpov. ^D. J. ) - :
PLÉTHYPATE jQCiilVàd. de 'Püphos. ); nom d’un
mois de ceux de Pâphos^ fiiivant G yraldus& le pe^e
Hardouin;il répondoit âu’iîiois de-jiiin. ^'Z). J . f ■,>
■ PLEVINE, i. ïs fJürifpfUd. ) eft -un téfrine païti-
cuîier >à' la coutume de Brétagne ’pôur'exprinier fin
caiitiortnement.' Ce terme étoit- 'âtt-fli üfité'dans d’ah-
-cienhe> Coùïume^dè'7 Nôtrhandie.*¥oÿeç PleOE-.' ( A )
- PLEUMOS'Il, f'Géôg.1 ianc.r ) peuples 'dé la'Gàule
biëlgiqü.e-,! dans la dépei^ance^esNer^iènsi-GOfiime
Jules-Céfar, /. ¥. c. xxxix. eft le feul qui ait-nommé
-Sé'speÙples»^ & qu’il ®ê dit riën qüi ptrfffëfairè con-
* nOître ' oîP ils - habitoiént y on^s-’eft exercé âfle'S'placer
’ à^fantaifie. Les uns ontditf'qUe c ’étoieht^ les Iha'bitahs
iJdé laTlùndre ; lës^aiitresdës oht'-ïhisjdans-là^Flandfe
orientale : d’ailtres difent que ce font les habitans de
Courtrai; 6c les remarques de M. Samfon, fur la carte
de l’ancienne Gaule, diient que c’eftle pays de Peule,
au diocèfe de Tournai dans la Flandre wallone ou
gallicane. ( D. /. )
PLEVRE, f. f. en A natomie, eft une membrane
qui paroît compofée de deux elpeces de facs ou vef-
fies,dont une des extrémités enfoncée vers l’autre
reçoit de chaque côté le poumon/ & l’enveloppe immédiatement
, tandis que l’autre tapiffe par fa convexité
l’intérieur du thorax. ¥oye^ T h o r a x . Ce mot
vient du grec trXtupx, qui fignifie originairement côté;
les Latins l’appellent fuccingens. Ces deux facs s’adof-
fent vers la partie moyenne de la poitrine, 6c forment
une cloifon qu’on appelle le médiaflin ; elles lailfent
cependant entr’ elles un efpace ou eft placé le péricarde,
le thymus, &c. Voye^ Péricarde , T h y m
u s , &c.
Elle eft d’un tiffu fort femblable à celui du péritoine
; 6c fon ufage eft de défendre l’intérieur du thorax
6c d’empêcher que les poumons ne foient gênés
dans leur mouvement. Quoiqu’on ait trouvé aans
l’ouverture de différens cadavres cette membrane
remplie de corps glanduleux, ils ne font cependant
pas vifibles dans l’état naturel. Cette membrane s’offi-
fie quelquefois en partie.
Ple v r e , maladies de la , ( Médec. ) cette membrane
douée d’un fentiment très-exquis , qui tapiffe
toute la cavité interne de la poitrine , 6c fe continue
jufqu’au diaphragme 6c au médiaftin, eft fiijette à
différentes maladies générales, parmi lefquelles la
pleuréfie tient un trifte rang.
Les bleffures de la poitrine qui pénètrent jufqu’à
la plevre , ramaffent du fang , de l’air, 6c puis du pus
dans le fac dilaté de cette membrane. Pour tirer ce
pus , il faut avoir recours à une refpiration artifi-
ciellë ou à la fuélion. Les bleffures qui vont au-delà
de laplevre, produifent les mêmes maladies dans la
cavité de la poitrine, doht la méthode curative appartient
à celle des maux de cette partie.
Souvent il s’amaflè du pus dans les cellules de la
membrane externe de la plevre. 1 °. Après une contu-
fion de la poitrine, ou une bleffure qui ne pénétré
point, z". A la fuite d’une affez violente pleurefie fans
crachement de pus, mais dans laquelle la difficulté de
refpirer continue toujours, ainli que la douleur quand
on y touche ; fur-tout fi l’on voit en même tems une
tumeur 6c un changement de couleur dans les tégu-
mens, 6c qu’on s’apperçoive qu’un linge mouillé qui
y aura été appliqué feche trop vîte dans une petite
partie. Quand l’abfcès perce intérieurement, il procure
d’abord une refpiration plus libre , 6c bien-tôt
après, plus gênée. Avant qu’il c reve, il le faut ouvrir
de bonne heure ; mais quand une fois ce cas eft arri-
.vé, il convient de le traiter comme l’empyème.
Les autres maladies de la plevre, telles que l’inflammation
, la fympathie, le catharre, le rnumatifine,
l’hydropifie, la concrétion, fe<conçoiventaifément
par la connoiflànce qu’on peut avoir de la ftruriure
des parties qui compofent la poitrine. ( D. J. )
PLEURER, v. neut. ( Gramm. ) voyeç P article
Pl e u r s .
P leu re r , ( Jardinage: ) on dit que la feve pleure,
pour exprimer qu’elle eft en grand mouvement ,
6c qu’étant trop abondante, elle eft obligée de fortir.
PLEURES, f. f. pl. ( Lainage. ) ce font les laines
qui fe coupent fur la bête après qu’elle eft morte; elles
font d’une très-mauvaife qualité, aufli ne les emploie
t-on qu’à la fabrique des couvertures les plus
groflîeres , en les mêlant avec les laines de Barbarie.
Il en vient de Mulhaufen, de Wifmar, du Rhin, &c.
Savary. ( D . J. )
PLEURÉSIE, !, f. ( Médec. fe divife en vraie 6c
en fauffe : la vraie que l’on confond avec la péripneu-
Tcrne X I I ,
morne, eft ùnfe inflammation de la poitrine, qui a
pour figftes une fievre aiguë & continue, un pouls
dur, une douleur de côté aiguë, inflammatoire, qui
augmente beaucoup durant l’infpiration, qui diminue
dans l’expiration, une toux feche continuelle qui
caufe de grandes douleurs , 6c qui met le malade en
danger d’être fuffoqué.
I outes les parties de la poitrine font le fiege de
cette maladie : on la diftingue en vraie 6c en fauffe ,
en feche 6c humide. La vraie eft celle où la douleur at-
taque la plevre & fes expanfions qui s’étendent fur le
poumon. La fauffe eft celle oit la douleur eft plus profonde
, 6c attaque les mufcles intercoftaux 6c les parties
qui les recouvrent. Si les crachats abondent, on
la nommepleurefie humide ; 6c pleuréfie feche, fi les crachats
fbrtent avec peine.
5 La pleuréfie vient d’ordinaire aux adultes, qui font
d’un tempérament fanguin 6c qui font beaucoup d’exercice
, qui font expofés alternativement au chaud
6c au froid. On la nomme idiopatique, lorfqu’elle eft
produite par le vice local & la furabondance des humeurs;
6cfymptomatique, loifqu’elleeftlafuite d’une
maladie inflammatoire, dont la caufe 6c la matière
ontete tranfportées d,e quelque autre partie furlapoi-
trine.
Les caufes éloignées feront donc toutes celles de
l’inflammation, appliquées à la poitrine, à fes membranes
, ou à fes mufcles. ¥oye[ Inflammation.
Les fymptoines font d’abord un appétit extraordinaire
, luivi de froid, de frifl'on , de foiblefle, de laf-
fitude, 6c de fievre violente ; dans fon progrès , la
chaleur devient infenfiblement ardente, la douleur
aiguë de foibie qu’elle étoit, la relpiration fort difficile
; dans fon état, la fievre eft violente, mais fe ma-*
nifefte moins, parce que la refpiration eft gênée par
la violence de la douleur; elle finit de différentes façons
, ce qui dépend du fiege de l’inflammation. Plus
il y a de parties affe&ées à la fois, plus la circulation
fe fait avec force 6c vîteffe , 6c plus la refpiration &
les autres fondions qui en dépendent font dérangées
& s’éloignent de leur état naturel.
La pleuréfie, de même que toutes les autres inflammations
, fe guérit, dégénéré en d’autres maladies ,
ou caufe la mort. On parvient à la guérir par réfolu*
tion lorfque les humeurs qui circulent font douces 6c
que leur cours eft modéré ; 6c fi la caufe de l’obftruc»
tion n’eftpas opiniâtre, dans ce cas il ne faut qu’aider
la nature par des émolliens, des réfolutifs , & de légers
apéritifs. Elle fe guérit par la codion & l’excrétion
de fa caufe : i°. file fluxhémorrhoïdal ou les réglés
furviennent ; 20. fi les urines font chargées 6c
critiques avant le quatrième jou r , fi elles font épaif-
fes, fi elles fortent goutte à goutte, fi elles font rouges,
fi elles dépofent un fédiment blanc & calment la
maladie, ces urines font un figne de guérifon, même
dans la pleuréfie feche ; 30. lorfque le malade eft foulage
par des felles bilieufes avant le quatrième jour ;
40. lorfqu’il commence à paroître avant le fixieme
jour autour des oreilles ou aux jambes des abfcès
ichoreux,purulens,fiftuleuxqui coulent long-teins ;
50. lorfque le point de côté pafle à l’épaule, à la main ;
au dos, avec un engourdiffement 6c une pefanteur
douloureufe dans ces parties ; 6°. quand les crachats
font abondans, foulagent le malade , ne font point
accompagnés de catarres, reffemblent à du pus, acquièrent
bien-tôt ou avant le quatrième jour une couleur
blanche, quand cette évacuation n’eft point interrompue
, ou reparoît aufli-tôt qu’elle a été fuppri-
mée ; car par-là le malade eft hors de danger le neuvième
ou le onzième jour.
Lorfqu’après avoir obfervé tous ces lignes, on a reconnu
quelle doit être la terminaifon de cette maladie
, il faut fuivre les vues de la nature 6c favorifer les
voies qu’elle prend pour délivrer le malade. .
D D d d d i f