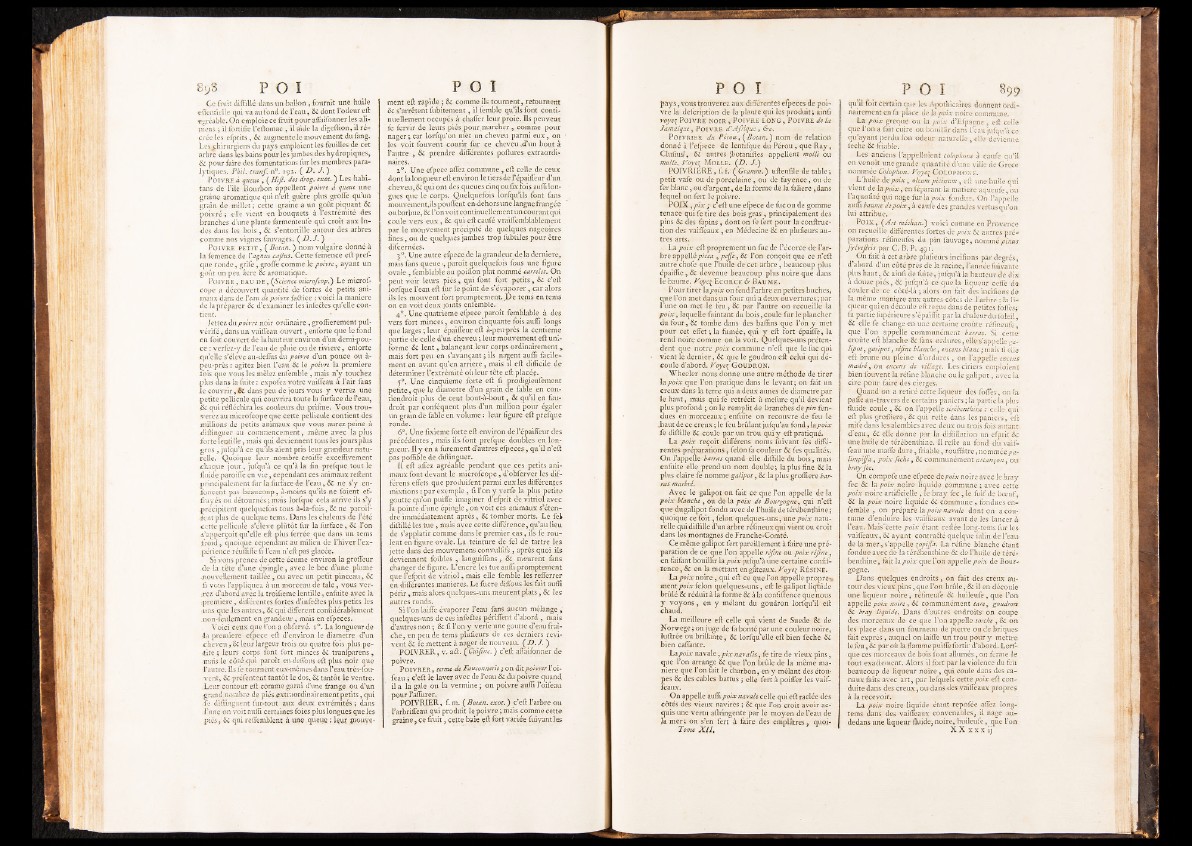
Ce fruit diftillé dans un ballon, fournit une huile
effentielle qui va au fond de l’eau, 8c dont l’odeur eft
e^réable. On emploie ce fruit pour affaifonner les ali-
inens ; il fortifie l’eftomac , il aide la digeftion, il récrée
les efprits , 8c augmente le mouvement du fang.
Les ^chirurgiens du pays emploient les feuilles de cet
arbre dans les bains pour les jambes des hydropiques,
& pour faire des fomentations fur les membres paralytiques.
Phil.tranf n°. 191. ( D . J . )
P o iv r e à queue , ( Hiß. des drog. exot. ) Les habi-
tans de l’île Bourbon appellent poivre d queue une
graine aromatique qui n’eft guère plus große qu’un
grain de millet ; cette graine a un goût piquant 8c
•poivré ; elle vient en bouquets à l’extrémité des
branches d’une plante farmenteufe qui croît aux In-
■ des dans les bois , 8c s’entortille autour des. arbres
com m e nos vignes fauvages. ( D . J. )
P o iv r e p e t it , ( Boum. ) nom vulgaire donné à
la femence.de Yagnus caßus. Cette lemence eft prel-
que ronde, grife, greffe comme le poivre, ayant un
g o û t un peu âcre 8c aromatique.
Po iv r e , e a u d e , (’Science microfcop.) Le microfcope
a découvert quantité de fortes de petits animaux
dans de Y eau de poivre faCtice : voici la maniéré
de la préparer 8c d’examiner les infeCtes qu’elle contient.
Jettez du poivre noir ordinaire , groffierement pul-
vérifé, dans un vaiffeau ouvert, enforte que le fond
en foit couvert de la hauteur environ d’un demi-pouce
: verfez-y de l’eau de pluie ou de riviere, enforte
.qu’elle s’élève au-deffus du poivre d’un pouce ou à-
peu-près : agitez bien l’eau 8c le poivre la première
i'ois mie vous les mêlez enfemble , mais n’y touchez
plus dans la fuite : expofez votre vaiffeau à l’air fans
le couvrir, & dans peu de jours vous y verrez une
petite pellicule qui couvrira toute la furface de l’eau,
<k. qui réfléchira les couleurs du prifme. Vous trouverez
au microfcope que cette pellicule contient des
millions de petits animaux que vous aurez peine à
diûinguer au commencement, même avec la plus
if'orte lentille, mais qui deviennent tous les jours plus
gros , jufqu’à ce qu’ils aient pris leur grandeur naturelle.
Quoique leur nombre croiffe exceffivement
chaque jou r, jufqu’à ce qu’à la fin prefque tout le
iluide paroiffe en v ie , cependant ces animaux relient
principalement fur la furface de l’eau, 8c ne s’y enfoncent
pas beaucoup, à-moins qu’ils ne foient effrayés
ou détournés ; mais lorfque cela arrive ils s’y
précipitent quelquefois tous à-la-fois, 8c ne paroif-
,fent plus de quelque tems. Dans les chaleurs de l’été
cette pellicule s’eleve plutôt fur la furface, 8c l’on
-s’apperçoit qu’elle eft plus ferrée que dans un tems
froid, quoique cependant au milieu de l’hiver l’ex-
.périence réuffiffe fi l’eau n’eft pas glacée.
Si vous prenez de cette écume environ la groffeur
.de la tête d’une épingle, avec le bec d’une plume
.nouvellement taillée, ou avec un petit pinceau , 8c
fi vous l’appliquez à un morceau de talc, vous verre
z d’abord avec la troifieme lentille, enfuite avec la
p r e m i è r e , différentes fortes d’infeCtes plus petits les
uns que les autres, & qui different coniîdérablement
.non-leulement en grandeur, mais en efpeces.
Voici ceux que l’on a obfervé. 1 °. La longueur de
:1a première - efpece eft d’environ le diamètre d’un
.cheveu, 8c leur largeur trois ou quatre fois plus petite
; leurs corps font fort minces & tranlparens,
•mais le côté qui paroît en-deffous eft plus noir que
l’autre. Ils fe tournent eux-mêmes dans l’eau très-fou-
vent, 8c préfentent tantôt le dos, 8c tantôt le ventre.
Leur contour eft comme garni d’une frange ou d’un
grand nombre de piés extraordinairement petits, qui
fe diftinguent fur-tout aux deux extrémités ; dans
l’une on voit auffi certaines foies plus longues quç les
piés, 8c qui reffemblent à une queije. : lçuç piouvement
eft rapide ; & comme ils tournent, retournent
8c s’arrêtent fubitement, il femble qu’ils font continuellement
occupés à chaffer leur proie. Ils peuvent
fe fervir de. leurs piés pour.marcher , comme pour
nager ; car lorfqu’on met un cheveu parmi eu x, on
les voit fouvent courir fur ce cheveu .d’un bout à
l’autre , 8c prendre differentes poftures extraordinaires.
z°. Une efpece affez commune, eft celle de ceux
dont la longueur eft environ le tiers de l’épaiffeur d’un
cheveu,& qui ont des queues cinqoufixfois auffilon-
gues que le corps. Quelquefois lorfqu’ils font fans
mouvement,ils pouffent en-dehors une langue frangée
ou barbue, 8c l’on voit continuellement un courant qui
coule vers eu x, 8c qui eft caufé vraiffemblablement
par le mouvement précipité de quelques nageoires
fines, ou de quelques jambes trop fubtiles pour être
difeernées.
3°. Une autre efpece de la grandeur.dela derniere,
mais fans queue -, paroît quelquefois fous une figure
ovale , femblable au poiflon plat nommé carrelet. On
peut voir leurs piés , qui font fort petits, 8c c’eft
lorfque l’eau eft fur le point de s’évaporer, car alors
ils les mouvent fort promptement. .De tems en tems
on en voit deux joints enfemble. •
40. Une quatrième efpece paroît femblable à des
vers fort minces, environ cinquante fois auffi longs
que larges ; leur épaiffeur eft à-peu-près la centième
partie de celle d’un cheveu ; leur mouvement eft uniforme
8c len t, balançant leur corps ordinairement,
mais fort peu en s’avançant ; ils nagent auffi facilement
en avant qu’en arriéré, mais il eft difficile de
déterminer l’extrémité oii leur tête eft placée-
50. Une cinquième forte eft fi prodigieufement
petite, que le diamètre d’un grain de fable en con-
tiendroit plus de cent bout-à-bout, & qu’il en fau-
droit par conféquent plus d’un million pour égaler
un grain dé fable en volume : leur figure eft prefque
ronde.
6°. Une fixieme forte eft environ de l’épaiffeur des
précédentes , mais ils. font prefque doubles en longueur.
Il y en a furement d’autres efpeces, qu’il n’eft
pas poffible de diftinguer.
Il eft affez agréable pendant que ces petits animaux
font devant le microfcope, d’obferver les dif-
férens effets que produifent parmi eux les différentes
mixtions : par exemple, fi l’on y verfe la plus petite
goutte qu’on puiffe imaginer d’efprit de vitriol avec
la pointe d'une épingle, on voit ces animaux s’étendre
immédiatement après, 8c tomber morts. Le fei
diftillé les tu e , mais avec cette différence, qu’au lieu
de s’applatir comme dans le premier cas, ils fe roulent
en figure ovale. La teinture de fel de tartre les
jette dans des mouvemens convulfifs, après quoi ils
deviennent foibles , languifl'ans, 8c meurent fans
changer de figure. L’encre les tue auffi promptement
que l’efprit de vitriol, mais elle femble les refferrer
en différentes maniérés. Le fucre diffous les fait auffi
périr, mais alors quelques-uns meurent plats, & les
autres ronds.
Si l’on laiffe évaporer l’ eau fans aucun mélange
quelques-uns de ces infeCtes périffent d’abord , mais
d’autres non ; 8c fi l’on y verfe une goutte d’eau fraîche,
en peu de tems plufieurs de ces derniers revivent
8c fe mettent à nager de nouveau. ( D . J. )
POIVRER, v . aél. ( Cuijîne. ) c’eft affaifonner de
poivre.
P o i v r e r , terme de Fauconnerie ; on dit poivrer l’oi-
feau ; ç’eft le laver avec de l’eau 8c du poivre quand,
il a la gale ou la vermine ; on poivre auffi l’oifeau
pour l’affurer.
POIVRIER, f. m. ( Botan. exot.) c’ eft l’arbre ou
l’arbriffeau qui produit le poivre ; mais comme cette
graine, ce fruit, cette baie eft fort variée fuivantles
P O I
pays, vous trouverez aux différentes efpeces de poivre
la defeription de la plante qui les produit ; ainfi
voye{ Po iv r e n o ir , Po iv r e l o n g , Po iv r e de la
Jamaïque , PoiVRE d'Afrique , &c.
P o iv r ie R du Pérou, (Botan.) nom de relation
donné à l’efpece de lentifque du Pérou , que Ray,
Clufiusj, 8c autres [botaniftes appellent molli ou
molle., Voye{ Mo l l e . (D. J.)
POIVRIERE, f. f. ( Gramm. ) uftenfile de table ;
petit vafe ou de porcelaine, ou de fayence, ou de
fer blanc, ou d’argent, de la. forme de la faliere ,dans
lequel on lert le poivre.
POIX ,p ix ; c’eft une efpece de fucou de gomme
tenace qui fe tire des bois, gras , principalement des
pins 8c des fapins , dont on fe fert pour la conftruc-
tion des vaiffeaux, en Médecine, & en plufieurs autres
arts..
. La poix eft proprement un fuc de l’écorce de l’arbre
appellépicea , pejfe, 8c l’on conçoit que ce n’eft
autre chofe que l’huile de cet arbre , beaucoup plus
épaiffie , & devenue beaucoup plus noire que dans
le baume. Voye^ E c o r c e & Ba u m e .
Pour tirer la poix on fend l’arbre en petites huches,
que l’on met dans un four qui a deux ouvertures; par
l ’une on met le feu, 8c par l’autre on recueille la
p oix, laquelle fiiintant du bois, coule fur le plancher
du four, & tombe dans des baffins que l’on y met
pour cet effet ; la fumée, qui y eft fort épaiffe, la
rend noire comme on la voit. Quelques-uns prétendent
que notre poix commune n’eft que le fuc qui
vient le dernier, & que le goudron eft celui qui découle
d’abord. Voyeç G o u d r o n .
'Wheeler nous donne une autre méthode de tirer
la poix que l’on pratique dans le levant; on fait un
creux dans la terre qui a deux aunes de diamètre par
le haut, mais qui fe rétrécit à mefure qu’il devient
plus profond ; on le remplit de branches de pin fendues
en morceaux ; enfuite on recouvre de feu le
Jhaut de ce creux ; le feu brûlant jufqu’au fond , 1apoix
fe diftillé 8c coule par un trou qui y .eft pratiqué.
La poix reçoit différens noms lùivaiit fes différentes
préparations, félon fa couleur 8c fes qualités.
On l’appelle barras quand elle diftillé du bois, mais
enfuite elle prend un nom double ; la plus fine 8c la
plus claire fe nomme galipot, 8c la plus groffiere barras
marbré.
Avec le galipot on fait ce que l’on appelle de la
poix blanche , ou de la poix de Bourgogne, qui n’eft
que du galipot fondu avec de l’huile de térébenthine;
quoique ce fo i t , félon quelques-uns, une poix naturelle
qui diftillé d’un arbre refineux qui vient ou Croît
dans les montagnes de Franche-Comté.
Ce même galipot fert pareillement à faire une préparation
de ce que l’on appelle réfine ou poix réjine,
en faifant bouillir la /w x jufqu’à une certaine confif-
tence, 8c en la mettant en gâteaux. Voye^ R é s in e .
La poix noire, qui eft ce que l’on appelle propre-»
ment poix félon quelques-uns, eft le galipot licftiide
brûlé & réduit à la forme & à la confiftence que nous
y voyon s , en y mêlant du goudron lorfqu’il eft
chaud.
La meilleure eft celle qui vient de Suede 8c de
Norvège ; on juge de fa bonté par une couleur noire,
luftrée ou brillante, 8c lorfqu’elle eft bien feche 8c
bien caffante.
La poix navale ,p ix navalis, fe tire de vieux pins,
que l’on arrange 8c que l’on brûle de la même maniéré
que l’on fait le charbon, en y mêlant des étou-
pes 8c des cables battus ; elle fert à poiffer les vaiffeaux.
On appelle auffi poix navale celle qui eft raclée des
côtés des vieux navires ; 8c que l’on croit avoir acquis
une vertu aftringente par le moyen de l’eau de
la mer; on s’en fert à faire des emplâtres, quoi-
Torne X I I ,
P O I 899
qu'il fôit certain que les Apothicaires nairement en fa place de la donftêftt ôrdi* poix noire commune,
La poix greque ou la poix d’Efpagrte , eft cellè
que l’on a frit cuire ou bouillir dans l’eau jufqu’à ce
qu’ayant perdu fon odeur naturelle , elle devienne
feche & friable.
Les anciens l’appelloïent côlophoné à càufe qu’il
en venoit une grande quantité d’ime ville de Grece
nommée Colophon. Voye^ C olophone.
L huile de poix, oleum picinum, eft une huile qui
vient de la poix, en féparant la matière aqueufe, ou
1 aquofité qui nage fur la poix fondue. On l’appelle
auffi baume de poix, à caufe des grandes vertus qu’on
lui attribue* •
PoïX , (Art médian.) voici comme en Provence
on recueille différentes fortes de poix 8c autres pré-»
paradons réfineufes du pin fauvage, nommé pinus
fylvejlris par C. B. P. 491.
On fait à cet arbre plufieurs incifions par degrés,
d’abord d’un côté près de la racine, l ’année fui vante
plus haut, 8c ainfi de fuite, jufqu’à la hauteur de dix
à douze piés, 8c jufqu’à ce que la liqueur ceffe de
Couler de ce côté-là ; alors on fait des incifions de
la même maniéré aux autres côtés de l ’arbre ; la liqueur
qui en découle eft reçue dans de petites foffes;
fa partie fitpérieure s’épaiffit par la chaleur du foleil,
8c elle fe change en une certaine croûte réfineufe,
que l’on appelle communément barras. Si cette
croûte eft blanche 8c fans ordures, elle s’appelle ga^
Hpot, garipot, réjïne blanche , encens blanc ; mais fl elle
eft brune ou pleine d’ordures , on l’appelle encens
madré,.ou eucens de village. Les ciriers emploient
bien fouvent la réfine blanche ou le galipot, avec la
cire pour faire des cierges.
Quand on a retiré cette liquelir des foffes, on la
paffe au-travers de certains paniers ; la partie la plus
fluide coule , 8c on l’appelle térébenthine : celle qui
eft plus groffiere, 8c qui relie dans les paniers, eft
mife dans les alembics avec deux ou trois fois autant
d’eau, 8c elle donne par la diftillation un efprit 8c
une huilé de térébenthine. Il refte au fond du vaiffeau
une maffe dure, friable, rouffâtre,nomméepa-
limpiffa, poix feche, 8c communément arcançon, ou
brayfec, ■ ; ••
On compofe une efpece de poix noire avec le bray
fe c 8c la. poix noire liquide commune ; avec cette
poix noire artificielle , le bray fe c , le fuif de boeuf,
8c la poix noire liquide &• commune, fondues enfemble
, on prépare la poix navale dont on a coutume
d’enduire les 'vaiffeaux avant de les lancer à
l’eau. Mais'cette poix étant reliée long-tems fur les
vaiffeaux, 8c ayant contra&é quelque falin de l’eau
de la mer, s’appelle \opiÿa. La réfine blanche étant
fondue avec de la térébenthine 8c de l’huile de térébenthine
, fait la poix que l’on appelle poix de Bourgogne.
Dans quelques endroits, on fait des creux autour
des vieux pins, que l’on brûle, & il en découle
une liqueur noire, refineufe 8c huileufe , que l’on
appelle poix noire, 8c communément tare, goudron
8c bray liquide. Dans d’autres endroits'on coupe
des morceaux de ce que l ’on appelle torche , 8c on
les place dans un fourneau de pierre ou de briques
fait exprès , auquel on laiffe un trou pour y mettre
le feu, 8c par où la flamme puiffe fortir d’abord. Lorf-
que cès morceaux de bois font allumés, on ferme le
tout exactement. Alors il fort par la violence du feu
beaucoup de liqueur noire , qui coule dans des canaux
faits avec art, par lefquels cette poix eft conduite
dans des creux, on dans des vaiffeaux propres
à la recevoir.f
La poix noire- liquide étant repofée affez long-
tems dans des vaiffeaux convenables, il nage au-
dedans une liqueur fluide, noire, huileufe, que l’on
X X x x x ij