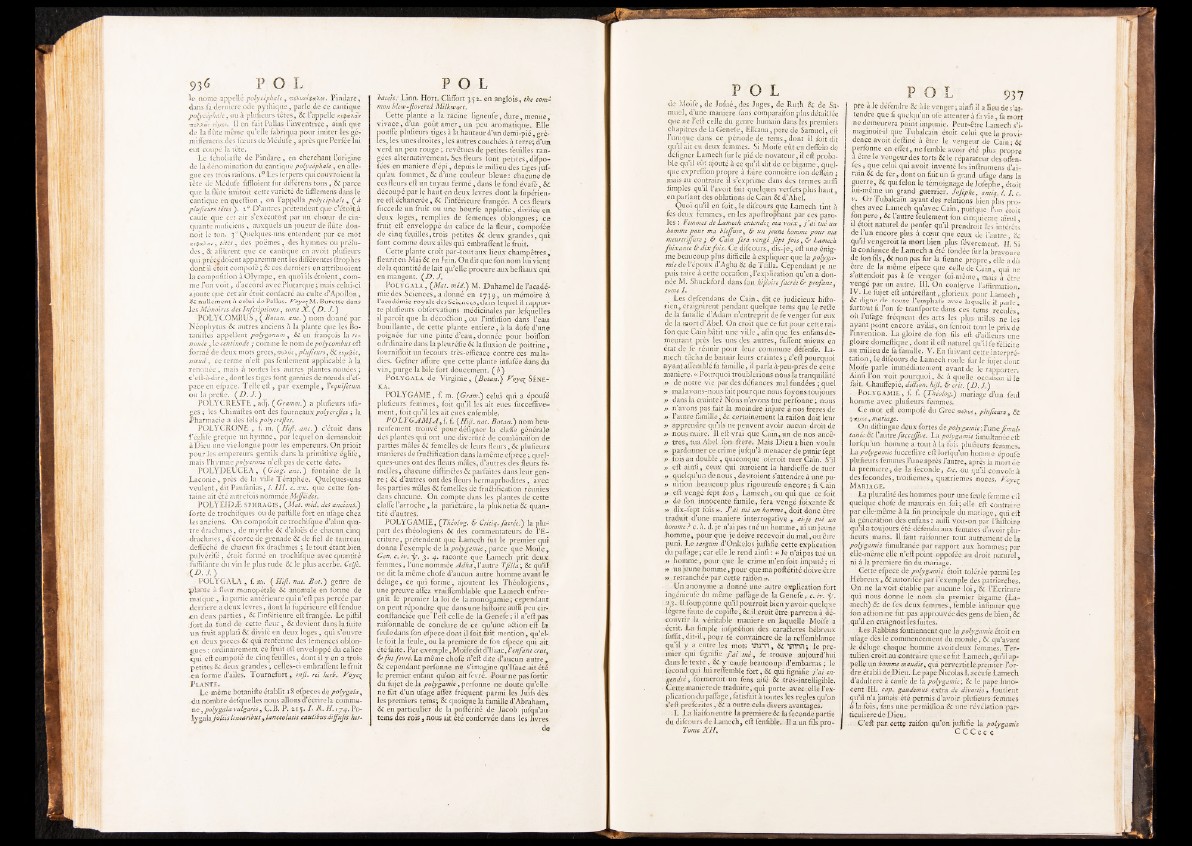
le nome appelle pofycéphale, iroxvztQa.\ov. Pïndare ,'
dans fa derniere ode pythique, parle de ce cantique
pofycéphale , ou à plufieurs têtes , Sc l’appelle zapaXav
ttoXXuv vo/j,cv. Il en fait Pallas l’inventrice, ainfi. que
de la flûte même qu’elle fabriqua pour imiter les gé-
miflemens des foeurs deMéduie, après quePerfée lui
eut coupé la tête.
Le fcholiafte de Pindare , en cherchant l’origine
de la dénomination du cantique pofycéphale, en allégué
ces trois raifons. i° Les ferpens qui couvroient la
tête de Médufe fiffloient fur différens tons , Sc parce
que la flûte imitoit cette variété de lifflemens dans le
cantique en queftion , on l’appella pofycéphale , ( à
plufieurs têtes ). 2° D’autres prétendent que c’étoit,à
caufe que cet air s’exécutoit par un choeur de cinquante
muficiens , auxquels un joueur de flûte don-
noit le ton. 30 Quelques-uns entendent par ce mot
KnpaXcti, têtes, des poëmes , des hymnes Ou préludes,
& aflïirent que ce cantique en avoit plufieurs
qui.précédoient apparemment les différentes ftrophes
dont il «oit compofé ; Sc ces derniers en attribuoient
la compofition à Olympe, en quoi ils étoient, comme
l’on v o it , d’accord avec Plutarque ; mais celui-ci
ajoute que cet air étoit confacré au culte d’Apollon,
& nullement à celui de Pallas. Voye^ M. Burette dans
les Mémoires des Infcripdons- ^ tome X . { D . J. )
POLYCOMBUS , ( Botan. anc. ) nom donné par
Néophytus Sc autres anciens à la plante que les Bo-
taniftes appellent polygonu/n, Sc en françois la renouée
, le centinode ; comme le nom depolycombus eft
formé de deux mots grecs,ttuxJç, plufieurs, Sc xvy.ßoc,
noeud, ce terme n’eft pas feulement applicable à la
renouée , mais à toutes les autres plantes nouées
c’eft-à-dire, dont les tiges font garnies de noeuds d’ef-
pace en efpace. Telle e ft, par exemple, l'equifetum
ou la prefle. (D . ƒ .)
POLYCRESTE , adj. ( Gramm.') a plufieurs ufa-
ges ; les Chimiftes ont des fourneaux polycrefies ; la
Pharmacie a des leis polycreßes.
POLYCRONE , f. m. ( Hifi. anc. ) c’étoit dans
i ’églife greque un hymne, par lequel on demandoit
àDieu une viedongue pour les empereurs. Onprioit
pour les empereurs gentils dans la primitive eglife,
mais l’hymne polycrone n’eft pas de cette date.
POLYDEUCEA, ( Géog. anc.') fontaine de la
Laconie, près de la ville Téraphée. Quelques-uns
veulent, dit Paufanias, l. III. c .x x . que cette fontaine
ait été autrefois nommée Mcjféïdes.
POLYEIDÆ SPHRAGIS, {Mat. méd. des anciens?)
forte de trochifques ou de paftille fort en ufage chez
les anciens. On compofoit ce trochifque d’alun quatre
drachmes, de myrrhe & d’aloës de chacun cinq
drachmes, d’écorce de grenade Sc de fiel de taureau
-defféché de chacun fix drachmes ; le tout étant bien
pulvérifé , étoit formé en trochifque avec quantité
luflïfante du vin le plus rude Sc le plus acerbe. Celfe.
POLYGALA ., £, m. ( Hifi. nat. Bot?) genre de
plante à fleur monopétale & anomale en forme de
mafque , la partie antérieure qui n’eft pas percée par
derrière a deux levres, dont la fupérieure eft fendue
£n deux parties , & l’inférieure eft frangée. Le piftil
: fort du fond de cette fleur, & -de vient dans-la fuite
un fruit applati divifé en deux loges , qui s’ouvre
en deux pièces & qui renferme des femences oblon-
eues : ordinairement cé fruit eft enveloppé du calice
qui eft compofé de cinq feuilles, dont il y en a trois
petites 6c deux grandes ; celles-ci embralfent le fruit
-en forme d’ailes. Tournefort, inß. rei herb. Voye^
P l a n t e .
Le même botanifte établit 18 efpeces de polygala,
. du nombre defquelles nous allons d’écrire la commune,
polygala vulgaris, C.B. P. 2 15 .1. R. H. 174. Po-
ïygpXdfioliis linearibus ? Lanceolatis caulibus dijfufis her•
"baceis: Linn. Hort. Cliffort 3 52. en anglois, the com«
mon blew-flovered MilkwQrt.
Cette plante a la racine ligneufe, dure, menue,'
v ivace, d’un goût amer, un peu aromatique. Elle
pouffe plufieurs tiges à la hauteur d’un demi-pi é , grêles,
les unes droites, les autres couchées à terre; d’un
verd un peu rouge ; revêtues de petites feuilles rangées
alternativement. Ses fleurs font petites, difpo-
lëes en maniéré d’epi, depuis le milieu des tiges juf-
qu’au fommet, & d’une couleur bleue: chacune de
ces fleurs eft un tuyau fermé, dans le fond évafé, &:
découpé par le haut en deux levres dont la fupérieure
eft echancrée, & l’inférieure frangée. A ces fleurs
fuccede un fruit ou une bourfe applatie, divifée en
deux loges, remplies de femences oblongues; ce
fruit eft enveloppé du calice de la fleur, compofée
de cinq feuilles,trois petites & deux grandes, qui
font comme deux ailes qui embralfent le fruit.
Cette plante croît par-tout aux lieux champêtres ,
fleurit en Mai Sc en Juin. On dit que fon nom lui vient
delà quantité de lait qu’elle procure auxbeftiaux qui
en mangent. (D . J.
Po l y g a l a , {Mat. méd?) M. Duhamel de l’académie
des Sciences, a donné en 1739, un mémoire à
l’académie royale des Sciences, dans lequel il rapporte
plufieurs obfervations médicinales par lefquelles
il paroît que la décoction, ou l’infufion dans l’eau
bouillante, de cette plante entière, à la dofed’une
poignée fur une pinte d’eau, donnée pour boiffon
odrdinaire dans la pleuréfie & la fluxion de poitrine,
fourniffoit un fecours très-efficace contre ces maladies.
Gefner affure que cette plante infufée dans du
vin, purge la bile fort doucement. ( b )
P o l y g a l a de Virginie, {Botan?) Foye^Sf.ne -
k a .
POLYGAME, f. m. {Gram?) celui qui a époufé
plufieurs femmes, foit qu’il les ait eues fueceflive-
ment, foit qu’il les ait eues enfemble.
P O LYG AM I A fi. f. {Hiß. nat. Botan?) nom heu-
reufement trouvé pour défigner la claffé générale'
des plantes qui ont une diverfité de combinaifon de
parties mâles Sc femelles de leurs fleurs, & plufieurs'
maniérés de fru&ification dans la même efpece ; quelques
unes ont des fleurs mâles, d’autres des fleurs femelles,
chacune diftinûes & parfaites dans leur genre
; & d’autres ont des fleurs hermaprhodites , avec
les parties mâles Sc femelles de fru&ification réunies
dans chacune. On compte dans les plantes de cette
claffel’arroche , la pariétaire, la pluknetia &c quantité
d’autres.
POLYGAMIE, {Théolog. 6* Critiq. facrée?) la plu-'
part des théologiens & des commentateurs de l’Ecriture
, prétendent que Lamech fut le premier qui
donna l’exemple de la polygamie, parce que Moile ,
G en. c. iy. f i . 3. 4. raconte que Lamech prit deux
femmes, l’une nommée Adha, l’autre T filial Sc qu’il
ne dit la même chofe d’aucun autre homme àvant le
déluge, ce qui forme, ajoutent les Théologiens,
une preuve affez vraiffemblable que Lamech enfreignit
le premier la loi de la monogamie; cependant
on peut répondre que dans une hiftoire aufli peu cir-
conftanciée que’ l’ eft celle de la Genefe; il n’eft.pas
raifonnable de conclure de ce qu’une a dion eft la
feule dans fon efpece dont il foit fait mention, qu’elle
foit la feule, ou la première de fon efpece qui ait
été faite. Par exemple, Moïfe dit d’Ifaac, l'enfant crut,
G fut fevré. La même chofe h’eft dite d’aucun autre,
Sc cependant perfonne ne s’imagine qu’Ifaac ait été
le premier enfant qu’on ait fevre. Pour ne pas fortir
du fujet de-la polygamie, perfonne ne doute qu’elle
ne fut d’un ufage affez frequent parmi les Juifs dès
les premiers tems; & quoique la famille d’Abraham,
Sc en particulier de la poftérité de Jacob jufqu’au
tems des rois , nous ait été confervée dans les livres
do
de Moïfe, de Jofué,des Juges, de Ruth Sc de Samuel,
d’une maniéré fans comparaifon plus détaillée
que ne l’eft celle du genre humain dans les premiers
chapitres de la Genefe, Elkana, pere de Samuel, eft
l’unique dans ce période de tems, dont il foit dit
qu’il ait eu deux femmes. Si Moïfe eût eu deffein de
défigner Lamech fur le pié de novateur, il eft probable
qu’il eût ajouté à ce qu’il dit de ce bigame, quelque
expreffion propre à faire connoître ion de flein ;
mais au contraire il s’exprime dans des termes aufli
fimples qu’il l’avoit fait quelques verfets plus haut,
en parlant des oblations de Caïn Sc d’Abel.
Quoi qu’il en foit, le difeours que Lamech tint à
fes deux femmes, en les apoftropnant par ces paroles
: Femmes de Lamech entende£ ma voix, j'a i tué un
homme pour ma bleffure, & un jeune homme pour ni(t
meurtrijfure ; & Caïn fera vengé fept fo is , & Lamech
foixante & dix fois. Ce difeours, dis-je, eft une énigme
beaucoup plus difficile à expliquer que la polygamie
de l’époux d’Agha & de Tfilla. Cependant je ne
puis taire à cette oçcafion, l’explication qu’en a donnée
M. Shuckford dans fon hifloire facrée & profane.
tome I.
Les defeendans de Caïn, dit ce judicieux hifto-
rien, craignirent pendant quelque tems que le refte
delà famille d’Adam n’entreprît de fe venger fur eux
de la mort d’Abel. On croit que ce fut pour .cette rai-
fon que Caïn bâtit une v ille , afin que fes enfans demeurant
près les uns des autres, fuffent mieux en
état de fe réunir pour leur commune défenfe. La-
mech tâcha de bannir leurs craintes ; c’eft pourquoi
ayant affemblé fa famille, il parla à-peu-près de cette
maniéré. « Pourquoi troublerions- nous la tranquillité
» de notre vie par des défiances mal fondées ; quel
»> mal avons-nous fait pour que nous foyons touj ours
» dans la crainte? Nous n’avons tué perfonne; nous
» n’avons pas fait la moindre injure à nos freres de
» l’autre famille, & certainement la raifon doit leur
» apprendre qu’ils ne peuvent avoir aucun droit de
» nous nuire. Il eft vrai que Caïn, un de nos ancê-
» très., tua Abel fon frere, Mais Dieu a bien voulu
» pardonner ce crime j.ufqu’à menacer de punir fept
» fois au double , quiconque oferoit tuer Caïn. S’il
» eft ainfi , ceux qui auroient la hardieffe de tuer
».. quelqu’un de nous, çfeyroient s’attendre à une pu-
» nition beaucoup plus ri^oureufe encore ; fi Caïn
» eft yengé fept fois , Lamech , ou qui que ce foit
» de fon innocente famile , fera vengé foixante &
» dix-fept fois ». J'ai tué un homme, doit donc être
traduit d’une maniéré interrogative , ai-je „tué un \
homme ? c. à. d. je n’ai pas tuéun nomme, ni.im jeune j
homme, .pour que je doive recevoir du mal, oii être !
puni. L e targum d’Onkelos juftifie çett.e explication I
du paffage; car elle le rend ainfi : « Je n’aipas tué un
» homme, pour que le crime m’en foit imputé ; ni
» un jeune homme ,pour que ma poftérité doive être ;
». retranchée par cette raifon ».
■ _ Un .anonyme .a donné une autre explication fort j
ingénieufe du même paffage de la Genefe, c.ïv. fi. !
• U foupçonne qu’il.poufrbit bien yjavoir quelque
- légère faute de copifte, SCj L croit être, parvenu à dé- j
couvrir la véritable maniéré en laquelle Moïfe a j
écrit. La ftmple infp.e&ion des cara&eres hébreux |
. fuffit, dit-il, pour Te cqnyaincre.de la reffemblance
qu’il y a entre les mots HlAin, & vmn ; le pre- ,
mier qui fignifie fa t itté., fe trouve aujourd’hui !
dans le texte, & .y caufe beaucoup d’embarras ; le j
, fécond qui luireffemble fort , .& qui fignifie j'a i en- j
gendre, jformeroit un fens a,ifé & très-intelligible. <
■ Cette .maniéré de traduire, .qui porte, avecx.elie d’ex- i
plication du paffage, fatisfait à toutes les réglés.qu’on I
s’eft preïcrites a outre.cela divers avantages.
■ I. La liaifon entre la première & la fécondé partie
du difeours de Lamech, eft fenfible.. Il a un fils pro- !
Tome X I I ,
pre à le défendre Sc à le venger ; ainfi il a lieu de s’attendre
que fi quelqu’un ofe attenter à fa v ie , fa mort
ne demeurera point impunie. Peut-être Lamech s’i-
maginoit-il que Tubalcaïn étoit celui que la providence
avoit deftioé à être le vengeur de Caïn; St
perfonne en effet, nefemble avoir été plus propre
à être le vengeur des torts & le réparateur des offen-
fes , que celui qui avoit inventé les inftrumens d’ai-
rain Sc de fer , dont on fait un fi grand ufage dans la
guerre, Sc qui félon le témoignage de Jofèphe, étoit
lui-même un grand guerrier. Jofephe, antiq. I. /. c,
y. Or Tubalcaïn ayant des relations bien plus proches
avec Lamech qu’avec C aïn, puifque l’un etoit
fon pere, Sc l’autre feulement fon cinquième aïeul
il étoit naturel de penfer qu’il prendroit les intérêts
de Pun encore.plus à coeur que ceux de l’autre, Sc
qu’il vengeroit fa mort bien plus féyerement. II. Si
la confiance de Lamech a été fondée fur la bravoure
de fon fils, & non pas fur la fienne propre, elle a dû
être de la même efpece que celle de Caïn, qui ne
s’attendoit pas à fe venger foi-même, mais à être
vengé par un autre. III. On conferve l’affirmation,
IV. Le fujet qft.intéreflànt, glorieux pour Lamech,
Sc digne de toute l’emphafe avec laquelle il parle ;
furtout fi l’on fe tranfporte dans ces tems reculés *
oii l’ufage fréquent des arts les plus utiles ne les
ayant point encore avilis, on fentoit tout le prix de
l’invention. La gloire de fon fils eft d’ailleurs une
gloire domeftique, dont il eft naturel qu’il fe félicite
au milieu de fa famille. V. En fuivant cette interprétation,
le. difeours de Lamech roule fur le fujet dont
Moïfe parle immédiatement avant de le rapporter.
Ainfi l’on voit pourquoi, Sc à quelle o.ccafion il lé
fait. Ghauffepie, diction, hifi, & crit. {U. J.)
Po l y g a m ie , f. f. {Théolog.) mariage d’un feul
homme av ec plufieurs femmes,.
•Ce mot eft compofé du Grec tto^vç , plufieurs, Sc
ytt/Acc, mariage.
. On diftingue deux fortes de polygamie fiunefimul-
tanee Sc 1 autre fuccefiîve. La polygamie fimultariée eft
lorfqu’un homme a tout à la fois plufieurs femmes.
La polygamie fucceffive eft lorfqu’un homme époufe
plufieurs femmes l’une après l’autre, après la mort de
la première, de la fécondé, &c. ou qu’il convole à
des .fécondes, troifiemes, quatrièmes noces. Foyer
Ma r ia g e .
La pluralité des hommes pour line feule femme eft
quelque chofe de mauvais en foi ; elle eft contraire
par elle-même à la fin principale du mariage, qui eft
la génération des enfans : aufli voit-on par Phiftoire
.qu il a toujours.été .défendu aux femmes d’avoir plufieurs
maris. Il faut raifonner tout autrement de la
polygamie fimultanée par rapport aux hommes; par
.elle-même elle .n’eft point oppofée. au droit naturel,
ni à la première fin du mariage.
•Cette efpece, de polygamie étoit tolérée parmi les
Hébreux, Sc autorifée par l’exemple des patriarches.
On ne la voit établie par:aucune lo i, & l’Ecriture
qui nous donne le . nom du premier bigame (La-
-medi) Sc de fes. deux femmes ,.femble infinuer que
•fon aâion ne fi.it pas approuvée des gens de bien, &
, qu’il en craignoit les fuites.
Les>Rabbins fo.utiennent.que la polygamie étoit en
.ufage dèsrle commencement du monde, Sc qu’avant
•le. déluge chaque homme avoit deux femmes. Ter-
tulien croit.au.contraire quecefiit Lamech, qu’il appelle
un homme maudit, qui pervertit leprèmier l’ordre
établi .de Dieu. Le pàpe Nïcolas I. acCufe Lamech
d’adultere à caufe de fa polygamie; Sc le pape Innocent
IH. cap. gaudemus .extra de divortio , foutient
qu’il n’a jamais été per,mis d’avoir plufieurs femmes
-à la.-fois, fans une perniiflïon & une révélation particulière
de Dieu.
. .C’eft par. cette raifon qu’on juftifie la polygamie
C C C e c c