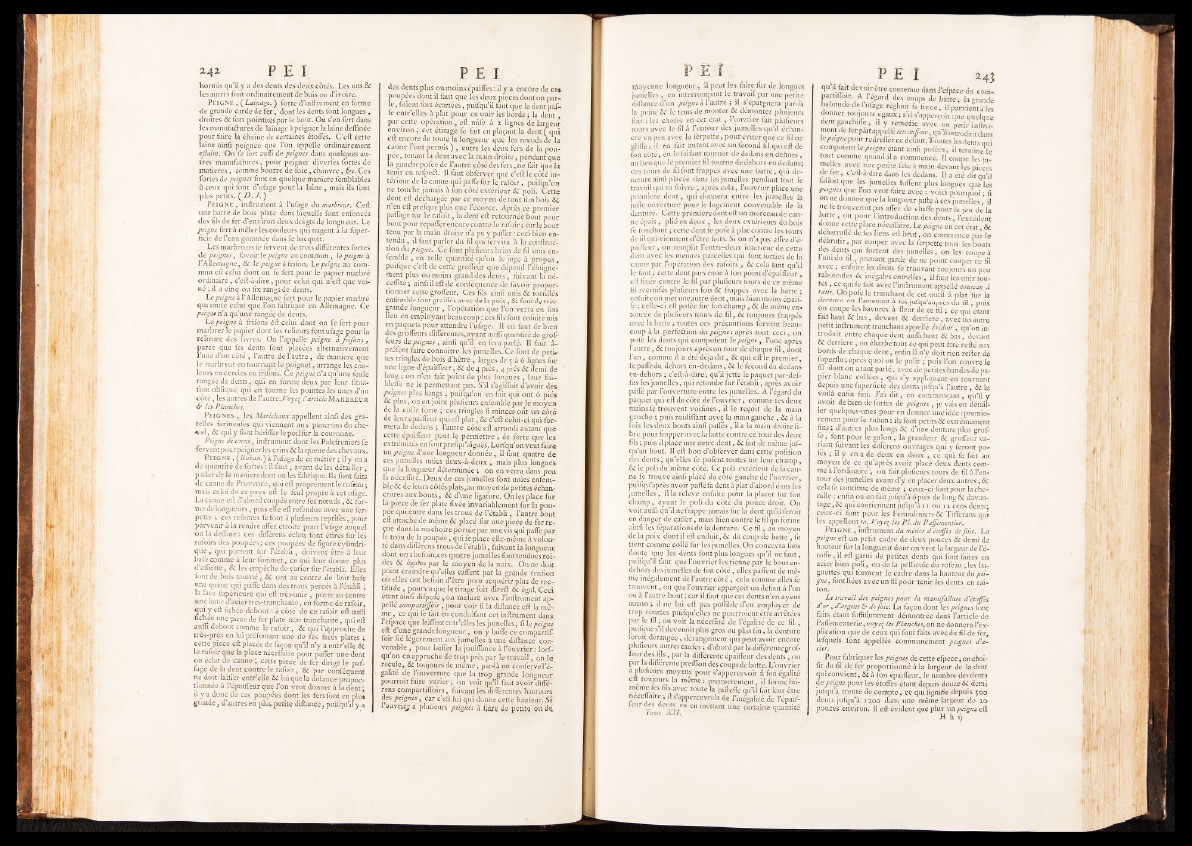
hormis qu’il y a des dents des deux côtés. Les uns &
les autres font ordinairement de buis ou d’ivoire.
Peigne , ( Lainage. ) forte d’infiniment en forme
de grande carde de fer, ' dont les dents font longues ,
droites 6c fort pointues par le bout. On s’en fert dans
les manufaûures de lainage àpeigner la laine deftinée
pour faire la chaîne-de certaines étoffes. C ’eft cette
laine ainfi peigriée que l’on appelle ordinairement
■ ejlaini. On fe fert auffi de peignes dans quelques autres
manufadures, pour peigner diverfes fortes de
matières , comme bourre de foie , chanvre, &c. Ces
fortes de peignes font en quelque maniéré femblables
â ceux qui font d’ufage pour la laine , mais ils font
plus petits. ( D . J. )
Pe ig n e , infiniment à l’ufage du marbreur. Cefl
une barre de, bois plate dans laquelle font enfoncés
des fils de fer d’environ deux doigts de longueur. Le
peigne fert à mêler les couleurs qui nagent à la fuper-
ficie de l’eau gommée dans le bacqiiet.
Les marbreurs fe fervent de trois différentes fortes
de peignes, favoir le peigne au commun , le peigne à
l’Allemagne, & le peigne à frifon. Le peigne au commun
efl celui dont on fe fert pour le papier marbré
ordinaire , c’efl-à-dire, pour celui qui n’efl que vein
é ; il a cinq ou fix rangs de dents.
Le peigne à l’Allemagne fert pour le papier marbré
qui imite celui que l’on fabrique en Allemagne. Ce
peigne n’a qu’une rangée de dents.
Le peigne à frifons éfl celui dont on fe fert pour
marbrer le papier dont les relieurs fontufage pour la
relieure des livres. On l’appelle peigne a frifons ,
parce que fes dents font placées alternativement
l ’une d’un côté , l’autre de l’autre, de maniéré que
le marbreur en tournait le poignet, arrange les couleurs
en cercles ou frifons. Ce peigne n’a qu’une feule
rangée de dents, qui en forme deux par leur fitua-
tion oblique qui en tourne les pointes les unes d’un
cô té , les autres de l’autre. Voye^ L'article Marbreur
d* les Planches.
Peignes , les Maréchaux appellent ainfi des gra-
telles farineufes qui viennent aux panerons du chenal
, 6c qui y font hériffer le poilTur la couronne.
Peigne de corne, infiniment dont les Palefreniers fe
fervent pour peigner les crins 6c la queue des chevaux.
Peigne , {Ruban.') à l’ufage de ce métier ; il y en a
de quantité de fortes : il faut, avant de les détailler,
parler de la maniéré dont on les fabrique. Ils font faits
de canne de Provence, quiefl proprement le rofeau;
mais celui de ce pays eft le feul propre à cetufage.
La canne efl d’abord coupée entre fes noeuds ,& forme
de longueurs, puis elle efl refendue avec une fer-
pette ; ces refentes fe font à plufieurs reprifes, pour
parvenir à la rendre affez étroite pour l’ufage auquel
on la defline : ces différens éclats font étirés fur les
raloirs des poupées; ces poupées de figure cylindrique
, qui portent fur l’établi , doivent; être à leur
bafe comme à leur fommet, ce qui leur donne plus
d’affiette, 6c les empêche de varier fur l’établi. Elles
font de bois tourné, 6c ont au centre de leur bafe
une queue qui paffe dans des trous percés à l’établi ;
la face fuperieure qui efl très-unie , porte au centre
une lame d’àeier très-tranchante, en forme de rafoir,
qui y efl fichée debout ■: à côté de ce rafoir efl auffi
nchee une piece de fer plate non tranchante, qui efl
auffi debout comme le rafoir, 6c qui l’approche de
très-près en lui présentant une de fes faces plates ;
cette piece efl placée de façon qu’il n’y a entr’elle 6c
le rafoir que la place neceflaire pour palier une dent
ou éclat de canne ; cette piece de fer dirige le paf-
fage de la dent contre le rafoir, 6c par conféquent
ne doit laifler entr’elle 6c lui que la diflance proportionnée
à l’épaiffeur que l’on veut donner à la dent ;
il y a donc de ces poupées dont les fers font en plu*
grande, d’autres en plus petite diflançe, puifqu’il y a
des dents plus ou moins épaiffes : il y a encore de ce*
poupées dont il faut que les deux pièces dont on parle
, foient fort écartées, puifqu’il faut que la dent paffe
entr’elles à plat pour en unir les bords ; la dent ,
par cette opération, efl mife à 2 lignes de largeur
environ ; cet étirage fe fait en plaçant la dent ( qui
efl encore de toute la longueur crue les noeuds de la
canne l’ont permis ) , entre les deux fers de la poupée,
tenant la dent avec la main droite, pendant que
la gauche pofée de l’autre côté des fers, ne fait que la
tenir en refpeél. Il faut obferver que c’efl le côté intérieur
de la canne qui paffe fur le rafoir, puifqu’on
ne touche jamais à fon côté extérieur & poli. Cette
dent efl déchargée par ce moyen de tout fon bois 6c
n’en ef£ prefque plus que l’écorce. Après ce premier
pa!Tage fur le rafoir, la dent efl retournée bout pour
bout pour repaffer encore'contre le rafoir ; car le bout
tenu par la main droite n’a pu y paffer : ceci bien entendu
, il faut parler du fil qui fervira à la conflruc-
tion du peigne. Ce font plufieurs brins de fil unis enfemble
, en telle quantité qu’on le juge à propos,
puifque c’efl de cette groffeur que dépend l’éloignement
plus ou moins grand des dents, fuivant la né-
ceffite ; ainfi il efl de conféquence de favoir proportionner
cette groffeur. Ces fils ainfi unis 6c tortillés
enfemble font graiffés avec de la poix, 6c font de très-
g'rande longueur , l’opération que l’on verra en fon
lieu en employant beaucoup : ces fils font enfuitemis
en paquets pour attendre l’ufage. Il en faut de bien
des groffeurs différentes, ayant auffi quantité de grof-
feurs de peignes , ainfi qu’il en fera parlé. Il faut à-
préfent faire connoître les jumelles. Ce font de petir
tes tringles de bois d’hêtre, larges de 5 à 6 lignes fiir
une ligne d’épaiffeur, 66 de 4 piés, 4 piés & demi de '
long ; on n’en fait point de plus longues , leur foi-
bleffe ne le permettant pas. S’il s’agiffoit d’avoir des
peignes plus longs , puifqu’on en fait qui ont 6 piés
& plus, on en joint plufieurs enfemble par le moyen
de la colle forte ; cës tringles fi minces ont un côté
de leur épaiffeur quiefl plat, & c’efl celui-ci qui formera
le dedans ; l’autre côté efl arrondi autant que
cette epaiffeur peut le permettre , de forte que les
extrémités en fontprefqu’aiguës. Lorfqu’on veut faire
un peigne d’une longueur donnée, il faut quatre de
ces jumelles unies deux-à-deux , mais plus longues
que la longueur déterminée ; on enverra dans peu.
la neceffite. Deux de ces jumelles font unies enfemble
6c de leurs côtés plats,au moyen de petites échancrures
aux bouts, 6c d’une ligature. On les place fur
la piece de fer plate fixée invariablement fur la poupée
qui entre dans les trous de l’établi, l’autre bout
efl attache de même 6c placé fur une piece de fer reçue
dans la mâchoire portée par une vis qui paffe par
le trou de la poupée, qui fe place elle-même à volonté
dans differens trous de l’établi, fuivant la longueur
dont onabefoin;ces quatre jumelles fonttendups roi--
des 6c égalés par le moyen de ia noix. On ne doit
point craindre qu’elles caffent pat la grande tenfion
ou elles ont befoin d’être pour acquérir plus de rectitude
, pourvu que le tirage foit direél 6c égal. Ceci
étant ainfi difpolé, ôn mefure avec l’inflrument ap-
pellé companijfoir, peur voir fi la diflance eft la même
, ce qui fe fait en conduifant cet infiniment dans
l’efpace que laiffent entr’elles les jumelles; fi le peigne
efl d’une grande longueur, on y laiffe ce compartif-
foir lie legerement aux jumelles à une diflance convenable
, pour laiffer la jouiffance à l’ouvrier : lorfqu’on
en approche de trop près par le travail, on le
recule, & toujours de meme ; par-là on cônfervel’égalité
de l’ouverture que la trop grande .longueur
pourroit faire varier ; on voit qü’il faut aÿoir différens
compartiffoirs, fuivant les différentés hauteurs
des peignes, car c’efl lui qui donne cette hauteur. Si
l’ouYriej a plufieurs peignés à fiùrç de petits ou de;
P E ï
iflôÿënrie longueur, il pè,ut les faire fur de longues
jumelles , en interrompant le travail par une petite
diflance d’un peigne à l’autre ; il s’épargnera par-là
la peine & le tems de monter & démonter plufieurs
fois : les chofes en cet état , l’ouvrier fait plufieurs
tours avec le fil à l’entour des jumelles qu’il éehan-
cre un peu avec la ferpette, pour éviter que ce fil ne
gliffe ; il en fait autant avec un fécond fil qui efl de
fon côté, ën le faifant tourner de dedans en dehors ,
au lieu que le premier fil tourne de dehors en dedans;
oes tours de fil font frappés avec une batte, qui demeure
ainfi placée dans les jumelles pendant tout le
travail qui va fuivre.; après cela, l’ouvrier place une
première dent * qui donnera entre les jumelles la
jufle ouverture pour le logement convenable de la
denture» Cette première dent eft un morceau de canne
épais , plié en deux , les deux extérieurs du bois
fe touchant ; cette dent fe pofe à plat contre les tours
de fil qufviennent d’être faits» Si on n’a pas affez d’é-
paiffeui1, on remplit l’ entre-deux intérieur de cette
dent avec les menues parcelles qui font forties de la
canne par l’opération des rafoirs , & cela tant qu’il
le faut; cette dent parvenue à fon point d’épaiffeur
efl fixée contre le fil par plufieurs tours de ce même
fil recroifés plufieurs fois 6c frappés avec la batte ;
enfuite on met une autre dent, mais bien moins épaif-
fe ; celle-ci eft pofée fur fon champ, 6c de même en*
tourée de plufieurs tours de fil, & toujours frappés j
avec la batte ; toutes ces précautions fervent beau*- i
coup à la perfection du peigne : après tout ce c i, on
pofe les dents qui compofent le peigne, l’une après
l’autre, 6c toujours après un tour de chaque fil, dont
l’un, comme il a été déjà dit, & qui efl le premier
fe paffe du dehors en-dedans, 6c le fécond du dedans
en-dehors ; c’efl-à-dire, qu’il jette le paquet par-def-
fus les jumelles, qui retombe fur l’établi, apres avoir
paffé par l’ouverture entre les jumelles. A l’égard du
paquet qui eft du côté de l’ouvrier, comme fes deux
mains fe trouvent voifines , il le reçoit de la main
gauche ; puis roidiffant avec la main gauche , 6c à la
fois les deux bouts ainfi paffés , il a la main droite libre
pour frapper avec la batte contre ce tour des deux
fils ; puis il place une autre dent, 6c fait de même juf-
qu’au bout. Il eft bon d’obferver dans cette pofition
des dents, qu’ elles fe pofenLtoutes fur leur champ,
& le poli dit même côté. Ce poli extérieur de la canne
fe trouve ainfi placé du côté gauche de l’ouvrier,
puifqu’après avoir paffé fa dent à plat d’abord dans les
jumelles , il la releve enfuite pour la placer fur fon
champ, ayant le poli du côté du pouce droit. On
voit aiiffi qu’il ne frappe jamais fur la dent qu’il feroit
en danger de caffer, mais bien contre le fil qui forme
ainfi les féparations de la denture. Ce f il, au moyen
de la poix dont il eft enduit, 6c du coup de batte , fe
tient comme collé fur les jumelles. On concevra fans
doute que les dents font plus longues qu’il ne fout,
puifqu’il faut qiie l’ouvrier les tienne par le bout en-»
dehors des jumelles de fon cô té, elles paffent de même
inégalement de l’autre côté , cela comme elles fe
trouvent, ou que l’ouvrier apperçoit un défaut à l’un
ou à l’autre bout ; car il faut que ces dents n’en ayent
aucun ; il ne lui eft pas poffible d’en employer de
trop courtes puifqu’elles ne pourroient être arrêtées
par le fil ; on voit la néceffite de l’égalité de ce fil ,
puifque s’il devenoit plus gros ou plus fin, la denture
feroit dérangée, dérangement qui peut avoir encore
plufieurs autres caufes ; d’abord par la différente groffeur
des fils, par la différente épaiffeur des dents, ou
par la differente preffion des coups de batte» L’ouvrier
a plufieurs moyens pour s’appercevoir fi fon égalité
e a touj ours k même : premièrement, il forme lui-
meme fes fils avec toute la jufteffe qu’il fait leur être
neceflaire ; il s’appercevroit de l’inégalité de l’épaif-
ieur clés dents en en mettant une certaine quantité
Tome X I I , x
PE I
je vo irê tre contenue dans fefpace du com-
pamffoir. A l.egard K M éoups <le batte 1 la grande
habitude de 1 ufagfe réglant la force, il parvient à les
donner toujours égaux ; s’il s’apperooit que qdclque
dent gauehiffe| il y «medje, avec un petirinftm,
menç deierplatappelle rarmfoir, qu’ilmtrodnitdans
tepagnemoe redreffereedé&ut.Tbutes lesdents crut
epmpoient lé.peigne étant ainfi poféeap ibterniiifofo
tout comme quand ,il a commencé. Il coupe les. jumelles,
avee.unepetite foie à main deyantles pièces
dgret* c eù-à-dire dans les dedans. U a été dit cm’il
îalfoit que les jumelles liiflént plus longues que les
e t ‘gms <{ue l’on veut foire avec : voici tpoiitquoi ; fi
on ne donnoit que la longueur jufle à ces jumelles il
ne le trouveroit pas affez de ehaffe pour le jeu de la
batte , ou pour l’introduâion des dents, l’excédent
donne cette place néceffaire. Le peigne en cet état, &
debarraffe de fes liens eft brut, on commence par lé
debrutir, par couper., avec la ferpette tous les bouts
des dents qui fortent des jumelles, on les coupe à
1 uni; du f i l , prenant garde de ne point couper ce fil
avec ; enfuite les dents fe trouvant toujours un peu
raboteüfes 6c inégales entrelles , il fout les unirtou-
tes , ce quife foit avec l’inftruinent appelle couteau à
ratir. On pofe le tranchant de cet outil à plat fur la
denture en l’amenant à foi jufqu’auprès du f il, puis
on coupe les bavures à fleur de ce fil ; ce qui étant
fait haut 6c bas, devant 6c derrière, avec un autre
petit infiniment tranchant appellé évidoir, qu’on introduit
entre chaque dent auffi haut 6c bas, devant
6c derrière, on ébarbe tout ce qui peut être refté aux
bords de chaque dent, enfin il n’y doit rien refter de
fuperflu ; après quoi ori le polit ; puis l’on couvre le
fil dont on a tant parlé, avec de petites bandes de pa*
pier blanc collées, qui s’y appliquent .en tournant
depuis une fuperfiçie des dents jufqu’à l’autre , 6c le
voilà enfin fini. J’ai dit, en commençant, qu’il y
avoit de bien de fortes de peignes , je vais en défait
1er quelques-unes pour en donner üneidée : premièrement
pour le ruban ; ils font petits 6c extrêmement
fins ; d’autres plus longs 6c d’une denture plus grof-
f e , font pour le galon , là grandeur & groffeur va-
rï,ant foivant les différens ouvrages qui y feront po-
fés ; il y en a de deux en deux , ce qui fe foit au
moyen de ce qu’après avoir placé deux dents comme
à l’ordinaire , on fait plufieurs tours de fil à l’entour
des jumelles avant d’y en placer deux autres, 6c
celafe continue de même ; ceux-ci fontpour lâche-
nille : enfin on en foit jufqu’à 6 piés de long 6c davanta
g e ,^ qui contiennent/ufqu’à 11 ou n cens dents;
ceux-ci font pour les Feràndiniers 6c Tifferans qui
les appellentyo. Voye^ iès PI. du Pajfenientier.
Peigne , Infiniment du métier d'étoffes de foie. Le
peigne efl un petit cadre de deux pouces & demi dé
hauteur fur la longueur dont on veut la largeur de l’étoffe
, il efl garni de petites dents qui font faites en
acier bien poli, ou de la pellicule du rofeau ; les baguettes
qui forment le cadre dans la hauteur du peigne,
fontliées avec un fil pour tenir lés dents en rai-
fon.
Le travail des peignes pour là tiianufacluré T’étoffes
d’o r, T argent & de foie. La façon dont les peignes font
faits étant fuffifamment démontrée dans l’article de
Paffementerie ,• voyty les Planches, on ne donnera l’explication
que de ceux qui font faits avec du fil de fer,
lefqugjs font appellés communément peignes d'acier,
Pour fabriquer les peignes de cette efpéce, on choi-
fit du fil de fer proportionné à la largeur de la dent
qui convient, 6c à fon épaiffeur, le nombre des dents
de peigne pour les étoffes étant depuis douze & demi
jufqu’à trente de compte, ce quifigriifie depuis. 500
dents jufqirà 1200 dans une même largeur de 20
pouces environ» Il efl évident que plus un peigne eft
H h ij