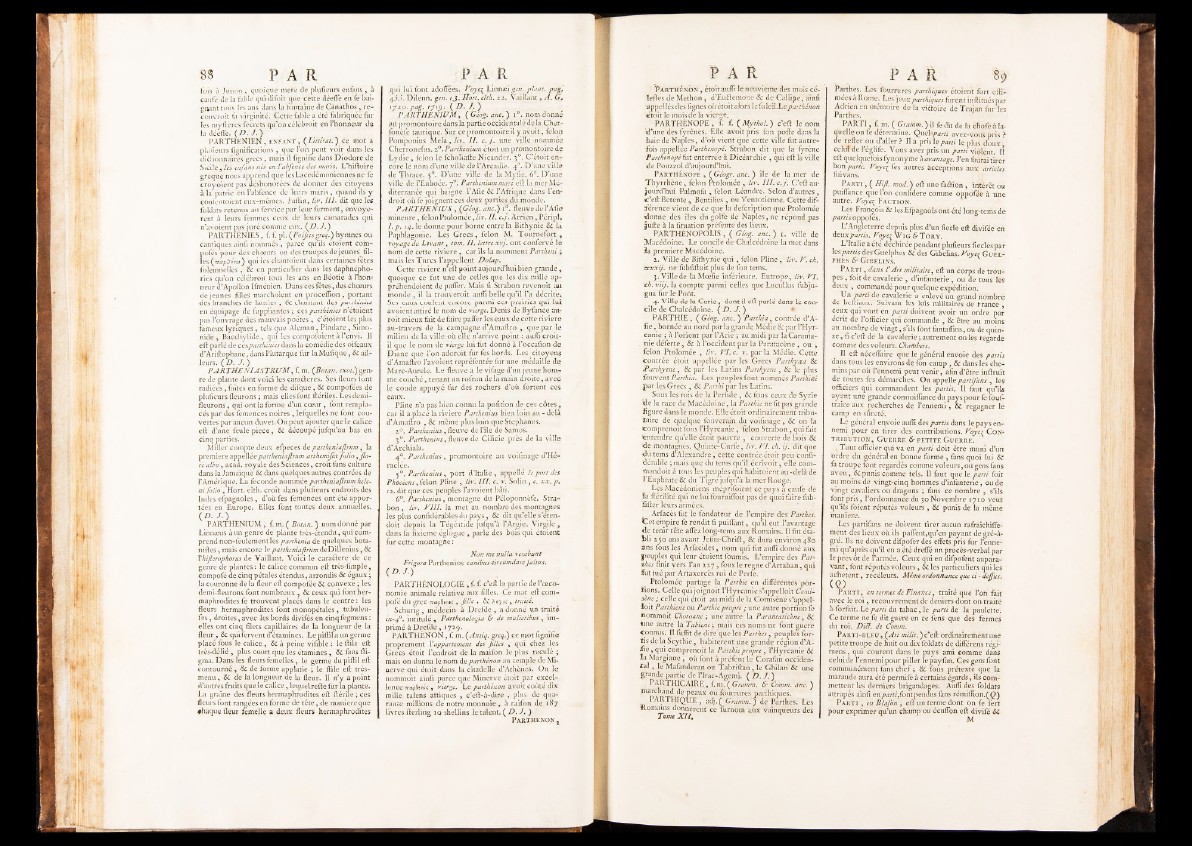
8 8 P A R
lois à Junon , quoique mefe de plufieurs enfajls , à
caufe de la fable qui difoit que cette déeffe en fe baignant
tous les ans dans la fontaine de Çanathos, re-
couvroit fa virginité. Cette fable a été fabriquée fur
les myfteres fecrets qu’on célébroit en l’honneur de
la déeffe; (D . J .)
PARTHÉNIÈN, eNf a n t , ( Littlrat. ) ce mpt à
plu fieurs fignifications , que l’on peut voir dans les
dictionnaires grecs, mais il lignifie dans Diodqre de
Sicile, les enfqns nés en l'abfence des maris. L’hjftoire
greque nous apprend que les Lacedémoniennesnp fe
croyoient pas déshonorées de donner des citoyens
à la patrie en l’abfence de leurs maris, quand ils y
conl'entoient eux-mêmes. Juftm, liv, III. dit que les
foldats retenus au fervice par leur ferment, envoyèrent
à leurs femmes ceux de leurs camarades qui
n’avoient pas juré comme eux. (D .J .)
PARTHÉNIES, f. f. pl. (Poéfies greq.) hymnes où
Cantiques ainli nommés , parce qu’ils etoient com-
pofés pour des choeurs ou des troupes de jeunes filles
( ttapd-îvoi ) qui les chantoient dans certaines fêtes
folemnelles , & en particulier dans les daphnépho-
ries qu’on célébroit tous les ans en Béotie à l’honneur
d’Apollon Ifménien. Dans ces fêtes, des choeurs
de jeunes filles marchoient en proceflion, portant
des branches de laurier , &C chantant des parthénies
en équipage de fuppliantes ; ces parthénies ri’étoient
pas l’ouvrage des mauvais poètes , c’etoient les plus
fameux lyriques , tels que Alcman, Pindare , Sitno-
nide , Bacchylide, qui les compofoient à l’envi. Il
eft parlé de ces parthénies dans la comédie des oifeaux
d’Ariftophane, dans Plutarque fur laMufique, & ailleurs.
(D . J.')
PAR TH EN IA STRUM , f . m. (Botan. exot.')genre
de plante dont voici les caractères. Ses fleurs f ont
radiées , faites en forme de difque , & compofées de
plufieurs fleurons ; mais elles font flériles. Les demi-
fleurons , qui ont la forme d’un coeur, font remplacés
par des femences noires , lefquelles ne font couvertes
par aucun duvet. On peut ajouter que le calice
eft d’une feule piece, & découpé jufqu’au bas en
cinq parties.
Miller compte deux efpeCes de partheniajlrüm, la
première appellée partheniajlrüm arthemijice folio, flore
albo, acad. royale des Sciences, croît fans culture
dans la Jamaïque & dans quelques autres contrées de
l’Amérique. La fécondé nommée partheniaflrum hele-
ni folio , Hort. elth. croît dans plufieurs endroits des
Indes espagnoles , d’où fes femences ont été apportées
en Europe. Elles font toutes deux annuelles.
{ D . J . )
PARTHENIUM , f. m. ( Boum. ) nom donne par
Linnæus à un genre de plante très-étendu, qui comprend
non-feulement les parthenia de quelques bota-
niftes, mais encore le partheniaflrum deDillenius, &
l’hijlerophorus de Vaillant. Voici le caractère de ce
genre de plantes : le calice commun eft très-fimple,
compofé de cinq pétales étendus, arrondis & égaux ;
la couronne de la fleur eft compofée & convexe ; les
demi-fleurons font nombreux , & ceux qui font hermaphrodites
fe trouvent placés dans le centre : les
fleurs hermaphrodites font monopétales , tubuleu-
fe s , droites, avec les bords divifés en cinq fegmens :
elles ont cinq filets capillaires de la longueur de la
fleu r, & qui fervent d’étamines. Le piftila un germe
placé fous le calice , & à peine vifible : le ftile eft
très-délié, plus court que les étamines , & fans fti-
gma. Dans les fleurs femelles, le germe dupiftil eft
contourné , & de forme applatie ; le ftile eft très-
menu , & de la longueur de la fleur. Il n’y a point
d’autres fruits que le calice, lequeLrefte fur la plante.
La graine des fleurs hermaphrodites eft ftériîe ; ces
fleurs font rangées en forme de tête, de maniéré que
♦ haque fleur femelle a deux fleurs hermaphrodites
f A R
rqui lui, font adoflees. Liniiæi gen, plant. pagi
466. Dilenn. geru i j . Hort. elth. 22. Vaillant, A. G,
ty.20. pag. ;■ ( Z?. J. )
P A R T HE N lDM , ( Géog. a'tic. ) i° . nom donné
ail promontoire dans la partie occidentale de la Cher-
fonèfe taurique. Sur ce promontoire il y avoit, félon
Pomponius Mêla, liv. II. c . j . une ville .■ nommée
Cherronefus. 20. Partheniuni étoit un promontoire de
Lydie , félon le fcho.liafte Nicander. 30. C’étoit en-r
core le nom d’une ville de l’Arcadie. 40. D'une ville
de Tbmce. 50. D ’une ville de la Myfie. 6°. D ’une
ville de l’Êuboée. 70. Partheniiim mare eft la mer Méditerranée
qui baigne l’Afie & l’Afrique dans l’endroit
oh fe joignent ces deiix parties, du monde.-,
PARTHENIUS , (Géog. anc.) 1°. fleuve del’Afié
mineure, félon Ptolomée, liv. II. c.j. Arrien, PéripL
I. p. 14. le donne pour borne entre la Bithynie & la
Paphlagonie. Les • Grecs , félon M. Toujrnefort ,
voyage du Levant, tom. IL lettre xvj. ont conferve le
nom dé cette riviere , car ils la nomment Partheni 5
mais les Turcs l’appellent Dolap.
Cette riviere n’eft point aujourd’hui bien grande ,
quoique ce fut une de celles que les dix mille ap-
préhendoient de pafler. Mais fi Strabon revenoit au
monde , il la trouveroit aufli belle qü’il l’a décrite.
Ses eaux coulent encore parmi ces prairies qui lui
âvoient attiré le nom de vierge. Denis de Byfance au-
roit mieux fait de fàire pafler les eaux de cette riviere
au-trav,ers de la campagne d’Amaftro , que par le
milieu de la ville oh elle n’arrive point : aufli croit-
il que le nom de vierge lui fut donné à l’occafion de
Diane que l’on adofoit fur fes bords. Les citoyens
d’Amaftro l’avoient repréfentée fur une médaille de
Marc-Aurele. Le fleuve a le vifage d’un jeune homme
couché, tenant un rofeau de la main droite, avec:
le coude appuyé fur des rochers cl’ou fortent ces
eaux.
Pline n’a pas bien connu la pofition de çe's cotes ,
car il a place la riviere Parthenius bien loin au - delà
d’Amaftro , & même plus loin que Stephanus.
20. Parthenius, fleuve del’îie de Samos.
30. Parthenius9 fleuve de Cilicie près de la ville
d’Archiala,
40. Parthenius, promontoire au yoifinage d’Hé-
raclée. , . .. . , _•
c Parthenius, port d’Italie, appellé le port des
Phocéens, félon Pline , liv. III. c. y. Solin $ c. x x . p.
12. dit que ces peuples l’avoient bâti.
6°. Parthenius, montagne du Péloponnèfe.- Strabon
, liv. FUI. la met au nombre des montagnes
les plus confidérablesdu pays, dit qu’elle s’eten-
doit depuis la Tégéaüde jufqu’à l’Argie. Virgile ,
dans fa fixieme églogue , parle des bois qui étoient
fur cette montagne:
Non me nulla vetabunt
Frigora Parîhenios cdnibus circümdare Jaltus.
( D . J . )
PARTHÉNOLOGIE , f. f. c’eft la partie de l’oeco-
nomie animale relative aux filles. .Ce mot eft compofé
du grec wa/iô«*?, fille > & hoyoç, traite.
Schung , médecin à Drefde , a donné un traité
in-40. intitulé , Pdrthenologia & de mulieribus , imprimé
à D refde, 172.9.
PARTHÉNON , f. m. (Antiq. greq.) ce mot lignifie
proprement l’appartement des filles , qui chez les
Grecs étoit l’endroit de la maifon le plus reculé ;
mais on donna le nom de parthénon au temple de Minerve
qui étoit dans la citadelle d’Athènes. On le
nommoit ainfi parce que Minerve étoit par excellence
wapfltvéç , vierge. Le parthénon avoit coûté dix
mille talens attiques , c’eft-à-dire , plus de quarante
millions de notre monnoie , à raifon de 187
livres fterling iq shellins le talent. ( D . J . )
Parthénonj
P A R
Parthénon , é to i t au fli le neuvième des mois cé-
ïeftes de Methon, d’Euftemone & de C a l l ip e , ainfi
appellés cles 'fignes oh étoit alors le foleil.Leparthénon
étoit le mois de la v ie r g e .
PARTHÉNOPE, f. f. ( Mythol. ) c’eft le nom
•d’une des fyrènes. Elle avoit pris fon pofte dans la
baie de Naples, d’oh vient que cette ville fut autrefois
appellee Parthenopé. Strabon dit que la fyrène
Partkenopé fut enterrée à Dicéàfchie , qui ëft la Ville
de Pouzzol d’aujourd’hui.
Pa rthÉnope , ( Gèogr. anc. ) île de la mer de
Thyrrhène, félon Ptolomée , liv. III. c .j. C ’eft au-
jourd’hui Palmofa , félon Léandre. Selon d’autres,
nc’eft Betente , Bentilies , ou Ventotienne. Cette différence
vient de ce que la defeription que Ptolomée
donne des îles du golfe de Naples, ne répond pas
jjufte à la fituation préfente des lieux.
PARTHÉNOPOLIS, ( Géog. anc. ) i . ville de
Macédoine. Le concile de Chalcédoine la met dans
la première Macédoine.
2. Ville de Bithynie qui , félon Pline , liv. F. ch.
vcxxij. ne fubliftoit plus de fon tems.
3. Ville de laMoefie inférieure. Eutrope, liv\ FI.
ch. viij. la compte parmi celles que Lucullus fubju-
gua ftir le Pont.
4. Ville de la Ca rie, dont il eft parlé dans le concile
de Chalcédoine. ( D . J . )
PARTHJ.E , ( Géog. anc. ) Parthia, contrée d’A-
f ie , bornée au nord par la grande Médie & par l’Hyr-
canie ; à l’orient par l’Arie ; au midi par la Carama--
nie déferte, & à l ’occident par la Paratacène , ou ,
félon Ptolomée , liv. FI. c. v. par la Médie. Cette
contrée étoit appellée par les Grecs Parthyaa &
Farthyene, & par les Latins Parthyene , & le plus
Touvent Parthia. Les peuples font nommés Parthiai
par les Grecs , & Parthi par les Latins.
Sous les rois de la Perfide , & fous ceux de Syrie
tle la race de Macédoine, la Parthie ne fit pas grande
figure dans le monde. Elle étoit ordinairement tributaire
de quelque fouverain du voifinage, & on la
comprenoit fous l’Hyrcanie, félon Strabon, qui fait
^entendre qu’elle étoit pauvre , couverte de bois &
<le montagnes. Quinte-Curfe, liv. FI. ch. ij. dit que
dutems d’Alexandre , cette contrée étoit peu’confi-
dérable ; mais que du tems qu’il éerivoit, elle com-
mandoit à tous les peuples qui habitoient au - delà de
l ’Euphrate & du Tigre jufqu’à la mer Rouge;
Les Macédoniens mépnfoient ce pays à caufe de
la ftérilité qui ne lui fournifloit pas de quoi faire fub-
lifter leurs armées^
Arfacès fut le fondateur de l’empire des Parthes.
Cet empire fe tendit fi puiflant, qu’il eut l’avantage
de tenir tête aflez long-teins aux Romains. Il fi.it établi
250 ans avant Jefus-Chrift, & dura environ 480
ians fous les Arfacides, nom qui fut aufli donné aux
peuples qui leur étoient fournis. L’empire des P arrhes
finit vers l’an 227, fous le régné d’Artàban, qui
fut tué par Artaxercès roi de Perle;
Ptolomée partage la Parthie en différentes portions.
Celle qui joignoit l’Hyrcanie s’appelloit Comi-
sène ; celle qui etôit au midi de la Comisèné s’appel-
loit Parthiene ou Parthie propre ; une autre portion fe
nommoit Choroane ; une autre la Parantaticène, &
lme autre la Tabiené ; mais ces noms ne font guere
Connus. Il fuffit de dire que les Parthes, peuples for-
tis de la Scythie, habitèrent une grande région d’A-
f ie , qui eomprenoit la Parthie propre , l’Hyrcanie & 3a Margiane , oh font à prefént le Corafan occidenta
l , le Mafanderan ou Tabriftan j 1e Ghilan & une
grande partie de l’Ifac-Àgemi; ( D . J . )
PARTHICAIRE, f. m. ( Gramm. & Corn/n. àné. )
marchand de peaux ou fourrures parthiques.
PARTHIQUE, ad;. ( Gramm.) de Parthes. Les
Romains donnèrent ce furnom aux vainqueurs des
Tonte X IL
P A R Sÿ
Parthes. Les fourrures parthiques étoient fort eftï-
meesà Rome. Les jeux parthiques furent inftituéspar
Adrien en memoire de la viftoire de Trajan ftir les
Parthes.' : , . A . , v.
P A R T I , f. m. ( Gramm. ) il fe dit de la chofe à laquelle
on fe détermine. QnéUparci avez-vous pris >
e refter ou d’aller ? Il a pris le parti le plus doux ■
celui de l’églife. Vous avez pris un parti violent. Il
eft quelquefois fynonyme à avantage. J’en faufai tirer
bon parti. Foye^ Ies autres acceptions àux articles
fuivanS.
Partir ( Hifl. tnod.) eft une faftion, intérêt où
puiffance que l’on confidete comme oppdfée à une
‘ autre. Foye^ Fa ct ion .
Les François & lesEfpagnôls ont été long-tems dè
partis Oppofés.
L’Angleterre depuis plus d’un fiecle eft dîvifée en
deux.partis. Foye^NIIG & T orŸ.
L’Italie a été dechiréè pendant plufieurs fieClespàr 1 es partis des Guelphes & des Gibelins. Foyer Guel-
phes & Gibelins.
Pa r t i , dans l'Art militaire, èft un corps de troupes
j foit de cavalerie , d’infanterie , ou de tous lés
deux , commandé pour quelque expédition.
Ün parti de cavalerie a enlevé iin grand nombrè
de beftiaux. Suivant les lpis militaires de France ,
çeiix qui vont en parti doivent avoir un ordre par
écrit de l’officier qui Commande , & être au moins
au nombre de vingt, s’ils font fantaflins, ou de quinz
e , fi c’eft de la cavalerie ; autrement on les regarde
comme des voleurs. Chambers.
. Il eft néceflaire que le général envoie des partis
dans tous les environs de fon camp, & dans les che-
minspar oh l’ennemi peut venir, afin d’être inftruit
de toutes fes démarches. On appelle partifans , les
officiers qui commandent lés partis. Il faut qu’ils
ayent une grande connoiffance du pays pour fe fouf-
traire aux recherches de l’ennemi, & regagner le
camp en sûreté.
Le général envoie aufli des partis dans le pays ennemi
pour en tirer des contributions. Foye%_ C ontr
ibu t io n , Guerre & petite Guerre.
. Tout officier qui va eh parti doit être muni d’uii
ordre du général en bonne forme -, fans quoi lui &
fa troupe font regardés comme voleurs, ou gens fans
aveu , & punis comme tels. Il faut que le parti foit
au moins de vingt-cinq hommes d’infanterie, ou de
vingt cavaliers ou dragons ; fans ce nombre , s’ils
font pris, l’ordonnance du 3o Novembre 1710 veut
qu’ils foient réputés voleurs, & punis de la même
manière.
Lés partifâns ne doivent tirer aucun rafraîchiffe-
ment des lieux oh ils paffent,qu’en payant de gré-à-
gré. Ils ne doivent difpofer des effets pris fur l’ennemi
qu’après qu’il en a été drefle un procès-verbal par
le prévôt de l’armée. Ceux qui en difpofent auparavant,
font réputés voleurs, & les particuliers qui les
achètent, recéleurs. Même ordonnance que ci ■ deffusi
H . . WË WËËË .
Pa r t i , en termes de Finance, traité que l’on fait
avec le r o i , recouvrement de deniers dont on traité
a-forfait. Le parti du tabac, le parti de la paulette.
Ce terme ne fe dit guere en ce fens que des fermes
du roi. Dicl. de Comm.
Parti-bI eu , (Art milit. ) C’eft ordinairement une
petite troupe de nuit ou dix foldats de différens régi^
mens, qui courent dans le pays ami comme dans
celui de l’ennemi pour piller lepayfan. Ces gens font
communément fans chef ; & fous prétexte que la
maraude aura été permife à certains égards, ils commettent
les derniers brigandages: Aufli des foldats
attrapés ainfi enparti, font pendus fans rémiflion.(Q)
Pa rti , en Blafon, eft un terme dont on fe fert
pour exprimer qü’un champ ou écuflon eft divifé &£