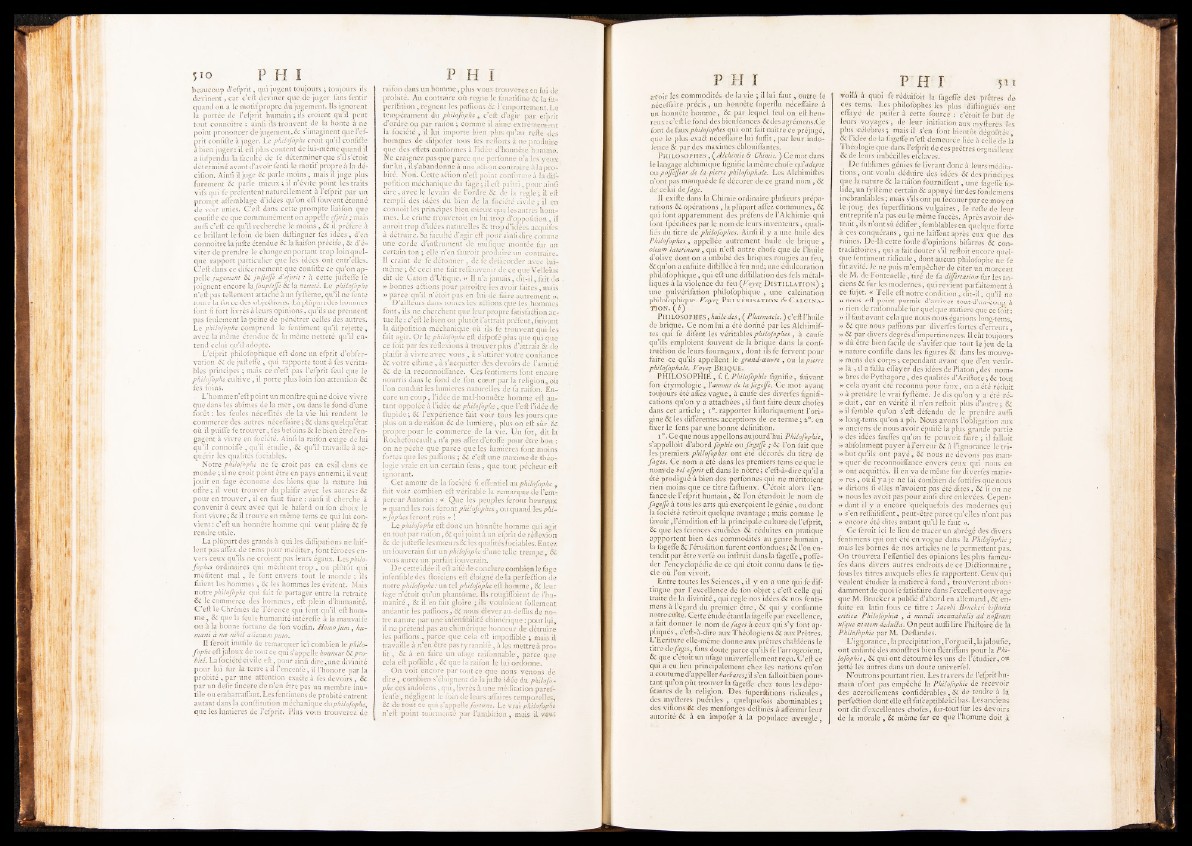
beaucoup d’efprit, qui jugent toujours ; toujours ils
devinent, car c’ eft deviner que de juger fans fentir
quand on a le motif propre du jugement. Ils ignorent
la portée de l’ efprit humain ; ils croient qu’il peut
tout connoître : ainfi ils trouvent de la honte à ne
point prononcer de jugement, 6c s’imaginent que l’ef-
prit confifte à juger. Le philofophe croit qu’il confifte
à bien juger : il eft plus content de lui-meme quand il
afufpendu la faculté de fe déterminer que s’il s’étoit
déterminé avant d’avoir fenti le motif propre à la dé-
cifxon. Ainft il juge & parle moins , mais il juge plus
furement & parle mieux ; il n’évite point les traits
vifs qui fe prefentent naturellement à l’efprit par un
prompt affemblage d’idées qu’on eft fouvent étonné
de voir unies. C’eft dans cette prompte liaifon que
confifte ce que communément on appelle efprit; mais
aufti c’eft ce qu’il recherche le moins , 6c il préféré à
ce brillant le foin de bien diftinguer fes idees, d’en
connoître la jufte étendue 6c la liaifon p récife, & d’éviter
de prendre le change en portant trop loin quelque
rapport particulier que les idées ont entr’elles.
C ’eft dans ce difcernement que confifte ce qu’on appelle
jugement 6c juflejfe d'efprit : à cette jufteffe fe
joignent encore la fouplejfe 6c la netteté. Le phiLofophe
n’eft pas tellement attaché à un fyftème, qu’il ne fente
toute la force des objections. La plupart des hommes
font fi fort livrés à leurs opinions, qu’ils ne prennent
pas feulement la peine de pénétrer celles des autres.
Le phiLofophe comprend le fentiment qu’il rejette,
avec la même étendue 6c la même netteté qu’il entend
celui qu’il adopte.
L ’efprit philofophique eft donc un efprit d’obfer-
vation 6c de jufteffe , qui rapporte tout à fes véritables
principes ; mais ce n’eft pas l’efprit feul que le
phiLofophe cultive, il porte plus loin fon attention 6c
fes foins.
L’homme n’eft point un monftre qui ne doive vivre
que dans les abîmes de la mer, ou dans le fond d’une
forêt : les feules néceflités de la vie lui rendent le
commerce des autres néceffaire ; 6c dans quelqu’état
oh il puiffe fe trouver, fes befoins & lesbien être l’engagent
à vivre en fociété. Ainft la raifon exige de lui
qu’il connoiffe , qu’il étudie, & qu’il travaille à acquérir
les qualités fociables.
Notre phiLofophe ne fe croit pas en exil dans ce
monde ; il ne croit point être en pays ennemi; il veut
jouir en fage économe des biens que la nature lui
offre ; il veut trouver du plaifir avec les autres : &
pour en trouver, il en faut faire : ainft il cherche à
convenir à ceux avec qui le hafard ou fon choix le
font v ivre; & il trouve en même tems ce qui lui convient
: c’eft un honnête homme qui veut plaire 6c fe
rendre utile.
La plupart des grands à qui les difïipations ne Iaif-
lent pas affez de tems pour méditer, font féroces envers
ceux qu’ils ne croient pas leurs égaux. Les philo-
fopkes ordinaires qui méditent trop , ou plutôt qui
méditent mal , le font envers tout le monde ; ils
fuient les hommes , 6c les hommes les évitent. Mais
notre phiLofophe qui fait fe partager entre la retraite
6c le commerce des hommes, eft pléin d’humanité.
C ’eft le Chrémès de Térence qui fent qu’il eft homme
, 6c que la feule humanité intéreffe à la mauvaife
ou à la bonne fortune de fon voifin. Homo fum, humant
a me nihil alienumputo.
Il feroit inutile de remarquer ici combien le phiLofophe
eft jaloux de tout ce qui s’appelle honneur 6c probité.
Lafociétecivile eft, pour ainft dire,une divinité
pour lui fur la terre ; il l’encenfe, il l’honore par la
probité , par une attention exaCte à fes devoifs , 6c
par un deftr fincere de n’en être pas un membre inutile
ou embarraffant. Les fentimens de probité entrent
autant dans la conftitution méchanique du phiLofophe
que les lumières de l’efprit. Plus vous trouverez de
raifon dans un homme, plus vous trouverez en lui de
probité. Au contraire où régné le fanatifme 6c la fu-
perftition , régnent les pallions 6c l ’emportement.Le
tempérament du philofophe , c’eft d’agir par efprit
d’ordre ou par raifon; comme il aime extrêmement
la fociété , il lui importe bien plus qu’au refte des
homipes de difpofer tous fes refforts à ne produire
que des effets conformes à l’idée d’honnête homme.
Ne craignez pas que parce que perfonne n’a les yeux
fur lui, il S’abandonne à une aftion contraire à la pro-
bité. Non. Cette action n’eft point conforme à ladif-
pofttion méchanique du fage ; il eft paîtri, pour ainft
dire, avec le levain de l’ordre &c de la réglé ; il eft
rempli des idées du bien de la fociété civile ; il en
connoît les principes bien mieux que les autres hommes.
Le crime trouveroit en lui .trop d’oppofttion, il
auroit trop d’idées naturelles 6c trop d’idées acquifes
à détruire. Sa faculté d’agir eft pour ainft dire comme
une corde d’inftrument de muftque montée fur un
certain ton ; elle n’en fauroit produire un contraire.
Il craint de fe détonner , dé le défacorder avec lui-
même ; &: ceci me fait reffouvenir de ce que Velleius
dit de Caton d’Utique. « Il n’a jamais, dit-il, fait do
» bonnes actions pour paroître les avoir faites , mais
» parce qu’il n’étoit pas en lui de faire autrement ».
D ’ailleurs dans toutes les allions que les hommes
font, iis ne cherchent que leur propre fatisfaftion actuelle
: c’eft le bien ou plutôt l’attrait préfent, fuivant
la difpofition méchanique où ils fe trouvent qui les
fait agir. Or le phiLofophe eft difpofé plus que qui que
ce foit par fes réflexions à trouver plus d’attrait & de
plaifir à v ivre avec vous , à s’attirer votre confiance
6c votre eftime , à s’acquitter des devoirs de l’amitié
6c de la reconnoiffance. Ces fentimens font encore
nourris dans le fond de fon coeur par la religion, où
l’on conduit les lumières naturelles de fa railon. Encore
un coup, l’idée de mal-honnêtè homme eft autant
oppofée à l’idée de phiLofophe, que l’eft l’idée de
ftupide ; 6c l’expérience fait voir tous les jours que
plus on a de raifon 6c de lumière, plus on eft sûr 6c
propre pour le commerce de la vie. Un fot, dit la
Rochefoucault, n’a pas affez d’étoffe pour être bon :
on ne pèche que parce que les lumières font moins
fortes que les pallions ; 6c c’eft une maxime de théologie
vraie en un certain fens, que tout pécheur eft
ignorant.
Cet amour de la fociété fi effentiel au phiLofophe ,
fait voir combien eft véritable la remarque de l’empereur
Antonin : « Que les peuples feront heureux
» quand les rois feront philofophes, ou quand les phi-
» fophes feront rois » !
Le phiLofophe eft donc un honnête homme qui agit
en tout par raifon, 6c qui joint à un efprit de réflexion
6c de jufteffe les moeurs & les qualités fociables. Entez
un fouverain fur un phiLofophe d’une telle tremoe, 6c
vous aurez un parfait fouverain.
De cette idée il eft aifé de conclure combien le fage
infenfible des ftoïciens eft éloigné de la perfeftion de
notre phiLofophe: un tel phiLofophe eft homme, 6c leur
fage n’étoit qu’un phantôme. Ils rougiffoie.nt de l’humanité
, & il en fait gloire : ils vouloient follement
anéantir les pallions , & nous élever au-deffus de notre
nature par une infenfibîlité chimérique : pour lui,
il ne prétend pas au chimérique honneur de détruire
les pallions , parce que cela eft impoflible ; mais il
travaille à n’en être pas tyrannifé, à les mettre à pro?
fit , & à en faire un ulage raifonnable, parce que
cela eft poflible, & que la raifon le lui ordonne.
On voit encore par tout ce que nous venons dé
dire , combien s’éloignent de la jufte idée du philofo*
phe ces indolens, qui, livrés à une méditation paref-
feufe, négligent le foin de leurs affaires temporelles,
6c de tout ce qui s’appelle fortune. Le vrai phiLofophe
n’ eft point tourmenté par l’ambitionmais il veut
avoir les commodités de la vie ; il lui faut, outre le
nécefl'aire précis, un honnête fuperflu néceffaire à
un honnête homme, 6c par lequel feul on eft heureux
: c’eft le fond des bienféances &des agrémens.Ce
font de fauxphilofophes qui ont fait naître ce préjugé,
que le plus exaCt néceflaire lui fuffit, par leur indolence
& par des maximes éblouiffantes.
P h i l o s o p h e s , (Alchimie & Chimie. ) C e mot dans
le langage alchimique lignifie lamêmechofe qu’adepte
ou poffejfeur de la pierre philofophale. Les Alchimiftes
n’ont pas manqué de fe décorer de ce grand nom, 6c
dé celui de fige.
Il exifte dans la Chimie ordinaire plufieurs préparations
6c opérations , la plupart affez communes, 6c
qui font apparemment des préfens de l’Alchimie qui
font fpécifiées par le nom de leurs inventeurs, qualifiés
du titre de philofophes. Ainft il y a une huile des
Philofophes, appellée autrement huile de brique ,
oLeurn lâterinum, qui n’eft autre chofe que de l’huile
d’olive dont on a imbibé des briques rougies au feu,
6c qu’on a enfuite diftillée à feu nud; une édulcoration
philofophique, qui eft une diftillation des fels métalliques
à la violence du feu (Voye^ D i s t i l l a t i o n ) ;
une pulvérifation philofophique , une calcination
philofophique. Voye^ P u l v é r i s a t i o n & C a l c i n a t
i o n . ( ^ )
PHILOSOPHES, huile des, ( Pharmacie. ) c’eft l’huile
de brique. Ce nom lui a été donné par les Alchimiftes
qui fe difent les véritables philofophes, à caufe
qu’ils emploient fouvent de la brique dans la conf-
tru&ion de leurs fourneaux, dont ils fe fervent pour
faire ce qu’ils appellent le grand-oeuvre , ou la pierre
philofophale. Voye{ BRIQUE.
PHILOSOPHIE , f. f. Philofophie lignifie, fuivant
fon étymologie, l’amour de LaJagejfe. Ce mot ayant
toujours été affez vague, à caufe des diverfes lignifications
qu’on y a attachées, il faut faire deux chofès
dans cet article ; i° . rapporter hiftoriquement l’origine
6c les différentes acceptions de ce terme ; i° . en
fixer le fens par une bonne définition.
i° . Ce que nous appelions aujourd’hui Philofophie,
s’appelloit d’abord fophie ou fageffe ; 6c l ’on fait que
les premiers philofophes ont été décorés du titre de
fages. Ce nom a été dans les premiers tems ce que le
nomade bel efprit eft dans le nôtre ; c’eft-à-dire qu’il a
été prodigué à bien des perfonnes qui ne méritoient
rien moins que ce titre faftueux. C ’étoit alors l’enfance
de l’efprit humain, 6c l’on étendoit le nom de
fageffe à tous les arts qui exerçoient le génie, ou dont
la fociété retiroit quelque avantage ; mais comme le
favoir, l’érudition eft la principale culture de l’efprit,
6c que les fciences étudiées 6c réduites en pratique
appportent bien des commodités au genre humain,
la fageffe 6c l’érudition furent confondues ; 6c l’on entendit
par être verfé ou inftruit dans la fageffe, poffé-
der l’encyclopédie de ce qui étoit connu dans le fie-
cle où l’on vivoit.
Entre toutes les Sciences, il y en a une qui fie dif-
îingue par l’excellence de fon objet ; c’eft celle qui
traite de la divinité, qui réglé nos idées 6c nos fentimens
à l’égard du premier être, & qui y conforme
notre culte. Cette étude étant la fageffe par excellence,
a fait donner le nom de fages à»ceux qui s’y font appliques
, c’eft-à-dire aux Théologiens & aux Prêtres.
L’Ecriture elle-même donne aux prêtres chaldéens le
titre de fages, fans doute parce qu’ils fe l’arrogeoient,
6c que c’etoit un ufage univerfellement reçu. C ’eft ce
qui a eu lieu principalement chez les nations qu’on
a coutume d’appeller barbares fû s’en falloitbien pourtant
qu’on pût trouver la fageffe chez tous les dépo-
fitaires de la religion. Des fuperftitions ridicules,
des myfteres puériles , quelquefois abominables ;
des vifions & des menfonges aeftinés à affermir leur
autorité 6c à en impofer à la populace aveugle,
voilà à quoi fe reduifoit la fageffe dés prêtfes de
ces tems. Les philofophes les plus diftingüés1 ont
effayé de puifer à cette fource : c’étoit le but de
leurs voyages -, de leur initiation aux myfteres les
plus célébrés ; mais il s’en font bientôt dégoûtés,
6c l’idée de la fageffe n’eft demeurée liée à cellé de la
Théologie que dans l’ efprit de ces prêtres orgueilleux
6c de leurs imbécilles efclaves. ■
De fublimes génies fe livrant donc à leurs méditations
, ont voulu déduire des idées 6c des principes
que la nature 6c la raifon fôurniffent, une fageffe fo-
lide, un fyftème certain 6c appuyé fur des fondemens
inébranlables ; mais s’ils ont pu fecouer par ce môyeil
le joug des fuperftitions vulgaires, le refte de leur
entreprife n a pas eu le même fuccès. Après avoir détruit
, ils n’ont sû édifier, femblables en quelque forte
à ces conquérans , qui ne laiffent après eux que des
ruines. De-là cette foule d’opinions bifarres 6c contradictoires
, qui a fait douter s’il reftoit encore quelque
fentiment ridicule, dont aucun philofophe ne fé
futavifé. Je ne puis m’empêcher de citer un morceau
de M. de Fontenelle, tire de fa differtation fur les anciens
& fur les modernes, qui revient parfaitement à
ce fiijet. « Telle eft notre Condition, dit-il, qu’il ne
» nous eft point permis d’arriver tout-d’un-coug à
» rien de raifonnable fur quelque matière que ce foit:
» il faut avant cela que nous nous égarions long-tems
» 6c que nous pallions par diverfes fortes d’erreurs,
» 6c par divers degrés d’impertinences. Il eût toujours
» dû être bien facile de s’avifer que tout le jeu de la
» nature confifte dans les figures 6c dans les mouve-
» mens des corps ; cependant avant que d’en venir-
» là , il a fallu effayer des idées de Platon, dès nom-
» bres de Pythagore, des qualités d’Ariftofe ; 6c tout
» cela ayant été reconnu pour faux, on a été réduit
» à prendre le vrai fyftème. Je dis qu’on y a été ré-
» duit, car en vérité il n’en reftoit plus d’autre ; 6c
» il femble qu’on s’eft défendu de le prendre aufti
» long-tems qu’on a pu. Nous avons l’obligation aux
» anciens de nous avoir épuifé la plus grande partie
» des idées fauffes qu’on fe pouvoit faire ; il falloit
» abfolumept payer à l’erreur 6c à l’ignorance le tri-
» but qu’ils ont payé, 6c nous rte devons pas man-
» quer de reconnoiffance envers ceux qui nous en
» ont acquittés. Il en va de même fur diverfes matie-
» res , où il y a je ne fai combien de fottifes que nous
» dirions fi elles n’avoiënt pas été dites, 6c fi on ne
» nous les avoit pas pour ainft dire enlevées. Cepen-
» dant il y a encore quelquefois des modernes qui
>» s’en reffaififfent, peut-être parce qu’elles n’ont pas
» encore été dites autant qu’il le faut ».
• Ce feroit ici le lieu de tracer un abrégé des divers
fentimens qui Ont été en vogue dans la Philofophie ;
mais les bornes de nos articles ne le permettent pas.
On trouvera l’effentiel des opinions les plus fameu-
fes dans divers autres endroits de ce Di&ionnaire,
fous les titres auxquels elles fe rapportent. Ceux qui
veulent étudier la matière à fond, trouveront abondamment
de quoi fe fatisfaire dans l’excellent ouvrage
que M. Brucker a publié d’abord en allemand, 6c en-
mite en latin fous ce titre J Jacobi Bruckiri hifloria
critica Philofophice , à mundi incunabulis ad nofram
ufque oetatem deducla. On peut aufti lire l’hiftoire de la
Philofophie par M. Deflandes.
L’ignorance, la précipitation, l’orgueil,la jaloufîe,
ont enfanté des monftres bien flétriflans pour la Philofophie
, 6c qui ont détourné les uns de l’étudier, ou
jetté les autres dans un doute univerfel.
' N’outrons pourtant rien. Les travers de l’eijjrit humain
n’ont pas empêché la Philofophie de recevoir
des accroiffemens confidérables, 6c de tendre à la
perfeftion dont elle eft fufceptibleicibas. Les anciens
ont dit d’excellentes chofes, fur-tout fur les devoirs
de la morale , 6c même fur ce que l’homme doit à