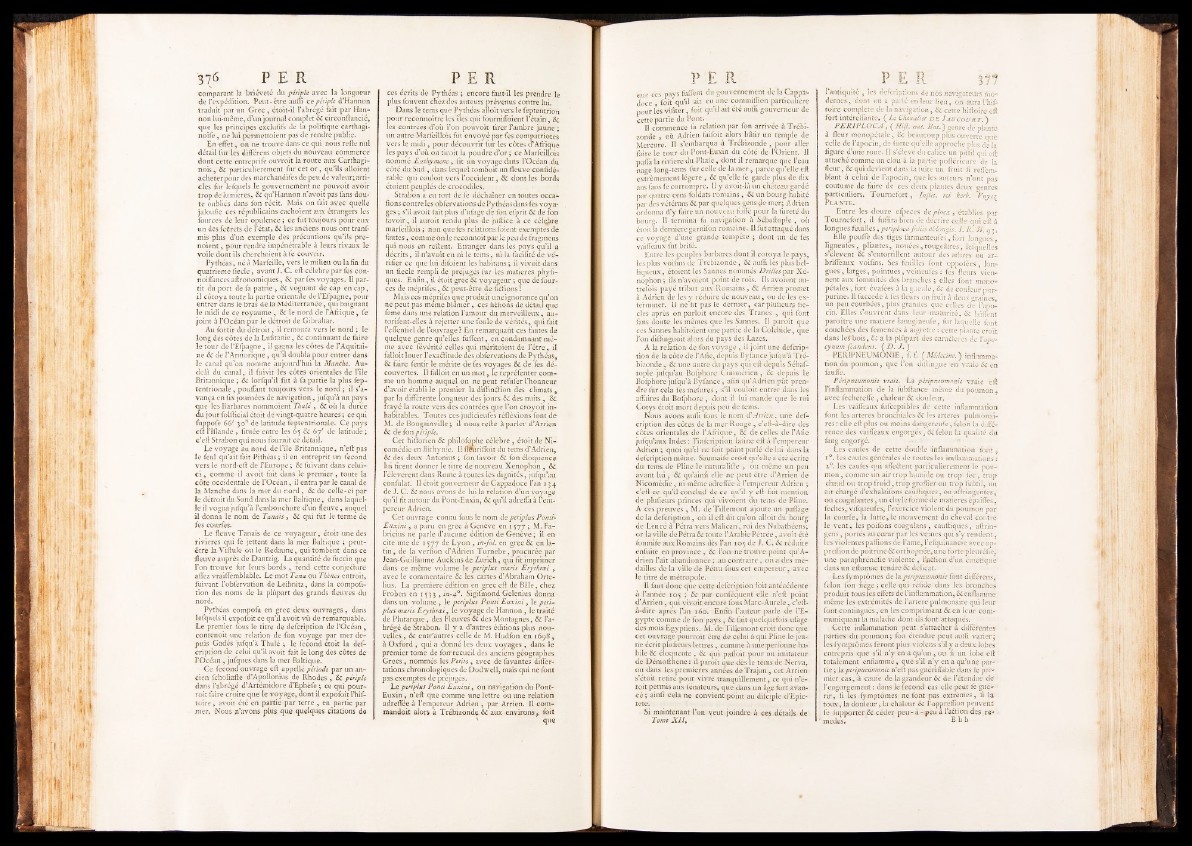
comparant la brièveté du périple avec la longueur
de l'expédition. Peut-être auffi et périple d’Hannon
traduit par un Grec , étoit-il l’abrégé fait par Han-
non lui-même, d’un journal complet 6c circonftancié,
que les principes exclufifs de la politique carthagi-
noife, ne lui permettoient pas de rendre public.
En effet, on nè trouve dans ce qui nous refie nul
détail fur les différens objets du nouveau commerce
dont cette entreprife ouvroit la route aux Carthaginois
, 6c particulièrement fur cet o r , qu’ils alloient
acheterpoùr des marchandifes de peu de valeur; articles
fur lefquels le gouvernement ne pouvoit avoir
trop de lumières, 6c qu’Hannon n’avoit pas fans doute
oubliés dans l'on récit. Mais on fait avec quelle
jaloufie ces républicains cachoient aux étrangers les
fources de leur opulence; ce fut toujours pour eux
ùn des fetrets de l’état, 6c les anciens nous ont tranl-
mis plus d’un exemple des précautions qu’ils pre-
noient, pour rendre impénétrable à leurs rivaux le
voile dont ils cherchoient à fe couvrir.
Pythéas, né à Marfeille, vers le milieu ou la fin du
quatrième fiecle, avant J. C. eft célébré par fes con-
noiffances allronomiques, 6c par fes voyages. Il partit
du port de fa patrie, 6c voguant de cap en cap,
il côtoya toute la partie orientale de l’Efpagne, pour
entrer dans le bras de la Méditerranée, qui baignant
le midi de ce royaume ", 6c le nord de l’Afrique , fe
joint à l’Océan par le détroit de Gibraltar.
Au fortir du détroit, il remonta vers le nord ; le
long des côtes de la Lufitanie, & continuant de faire
le tour de l’Efpagne, il gagna les côtes de l’Aquitaine
& de l’Armorique, qu’il doubla pour entrer dans
le canal qu’on nomme aujourd’hui la Manôhe. Au-
delà du canal, il fui v it les côtes orientales de File
Britannique ; 6c lorfqu’il fut à fa partie la plus fep-
tentrionale, pouffant toujours vers le nord ; il s’avança
en fix journées de navigation, jufqu’à un pays
que les Barbares nommoient Thulé , 6c où la durée
du jour folfticial étoit dé vingt-quatre heures ; ce qui
fuppofe 66' 30" de latitude feptentrionale. Ce pays
eft ÎTflande, fituée entre les 6 5 6c 67' de latitude ;
c’eft Strabon qui nous fournit ce détail.
Le voyage au nord de File Britannique, n’eft pas
le feul qu’ait fait Pithéas ; il en entreprit un fécond
vers le nord-eft de l’Europe ; 6c fuivant dans celui-
ci , comme il avoit fait dans le premier , toute la
côte occidentale de l’Océan, il entra par le canal de
la Manche dans la mer du nord, 6c de celle-ci par
le détroit du Sond dans la mer Baltique, dans laquelle
il vogua jufqu’à l’embouchure d’un fleuve, auquel
il donna le nom de Tandis , 6c qui fiit le terme de
fes courfes.
Le fleuve Tanaïs de ce voyageur, étoit une des
rivières qui fe jettent dans la mer Baltique ; peut-
être la Viftule ou le Redaune, qui tombent dans ce
fleuve auprès de Dantzig. La quantité de fuccin que
l’on trouve fur leurs bords , rend cette conje&ure
allez vraiffemblable. Le mot Tana ou Thénes entroit,
fuivant l’obfervation de Leibnitz, dans la compofi-
îion des noms de la plupart des grands fleuves du
nord.
Pythéas compofa en grec deux ouvrages, dans
lefquels il expofoit ce qu’il avoit vu de remarquable.
Le premier fous le titre de defeription de l’Océan ,
contenoit une relation de fon voyage par mer depuis
Gadés jufqu’à Thulé ; le fécond etoit la defeription
de celui qu’il avoit fait le long des côtes de
l’Océan, jufques dans la mer Baltique.
Ce fécond ouvrage eft appellé période par un ancien
feholiafte d’Apollonius de Rhodes , & périple
dans l’abrégé d’Artémidore d’Ephèfe ; ce qui pour-
roit faire croire que le voyage, dont il expofoit l’histoire
, avoit été en partie par terre , en partie par
mer. Nous n’avons plus, que quelques citations de
ces écrits de Pythéas ; encore faut-il les prendre le
plus fouvent chez des auteurs prévenus contre lui.
Dans le tems que Pythéas alloit vers le feptentrion
pour reconnoître les îles qui fournifloient l’étain, 6c
les contrées d’où Fon pouvoit tirer l’ambre jaune ;
un-autre Marfeillois fut envoyé par fes compatriotes
vers le midi, pour découvrir fur les côtes d’Afrique
les pays d’où on tiroit la poudre d’or ; ce Marfeillpis
nommé Euihymene, fit un voyage darts l’Océan ,du
côté du Sud, dans lequel tomboit un fleuve confidé-
rable qui couloit vers l’occident, 6c dont les bords
étoient peuplés de crocodiles.
Strabon a-eu tort défe déchaîner en toutes occa-
fions contrôles obfervations de Pythéas dans fes voyages
; s’il avoit fait plus d’ufage de fon efprit 6c de ion
favoir, il auroit rendu plus de juftice. à ce cél^re
marfeillois ; non que les relations foient exemptes de
fautes, comme ôn le reconnoît par le peu de fragmens
qui nous en reftent. Etranger dans les pays qu’il a
décrits, il n’avoit eu ni le tems, ni la facilité de vérifier
ce que lui difoient les habitans ; il v ivoit dans
un fiecle rempli de préjugés fur les matières phyfi-
quès. Enfin, il étoit grec 6c voyageur ; que de four-
çes de méprifes, 6c peut-être de hélions !
Mais ces méprifes cjue produit une ignorance qu’on
ne peut pas même blâmer, ces fiftions de détail que
feme dans une relation l’amour du merveilleux, au-
torifent-elles à rejetter une foule de vérités, qui fait
I’effentiel de l’ouvrage ? En remarquant ces fautes de
quelque genre qu’elles fuffent, en condamnant même
avec févérité celles qui méritoient de l’être, il
falloit louer l’exaélitude des obfervations de Pythéas,
6c foire fentir le mérite de fes voyages 6c de fes découvertes.
Il falloit en un mot, le repréfenter comme
un homme auquel on ne peut refufer l’honneur,
d’avoir établi le premier la diftinftion des climats ,
par la différente longueur des jours 6c des nuits , 6c
frayé la route vers des contrées que Fon croyôit inhabitables.
Toutes ces judicieufes réfléxions font de
M. de Bougainville ; il nous refte à parler d’Arrien
6c de fon périple.
Cet hiftorien 6c philofophe célébré , étoit de Ni-
comédie en Bithynie. Il fl'&.iriffoit du tems d'Adrien,
6c des deux Antonius ; fon favoir 6c fon éloquence
lui firent donner le titre de nouveau Xenophon , 6c
l’élevérent dans Rome à toutes les dignités, jufqu’au
confulat. Il étoit gouverneur de Cappacjoce Fan 134
de J. C. 6c nous avons de lui la relation d’un voyage
qu’il fit autour du Pont-Euxin, & qu’il adreffa à l’empereur
Adrien.
Cet ouvrage connu fous le nom de periplus Pond-
Eu x in i, a paru en grec à Genève en 1577 ; M. Fa-
bricius ne parle d’aucune édition de Genève ; il en
cite une de 1577 de Lyon , in-fol.en grec 6c en latin,
de la verfion d’Adrien Turnebe, procurée par
Jean-Guillaume Auckius de Zurich, qui fit imprimer
dans ce même volume le periplus maris Erythrcei ,
avec le commentaire 6c les cartes d’Abraham Orte-
lius. La première édition en grec eft de Bâle, che?
Froben en 1533 , i/z-40. Sigifmond Gelenius donna
dans un volume , le periplus Pond Euxini, le periplus
maris Erythrcei, le voyage de Hannon, le traité
de Plutarque, des Fleuves & des Montagnes, 6c l’abrégé
de Strabon. Il y a d’autres éditions plus nouvelles,
6c entr’autres celle de M. Hudfon en 1698,
à Oxford , qui a donné les deux voyages , dans lé
premier tome de foiïrecueil des anciens géographes
Grecs, nommés les Petits, avec de favantes differ-
tations chronologiques de Dodwell, mais qui ne font
pas exemptes de préjugés.
Le periplus Pond Euxini, ou navigation du Pont-
Euxin , n’eft que comme une lettre ou une relation
adreflee à l’empereur Adrien , par Arrien. Il com-
mandoit alors à Trébizonde. 6c aux environs ; foit
' • Rue
P E R
eue ces pays fufl'enl du gouvernement de la Càppâ^
doce , foit qu’il ait eu une commiffion particulière
pour les vifiter, foit qu’il ait été auffi gouverneur de
cette partie du Pont.
Il commence fa relation par fon arrivée à Trébi-
zonde , où Adrien faifoit alors bâtir un temple de
Mercure. Il s’embarqua à Trébizonde, pour aller
faire le tour du Pont-Euxin du côté de l’Orient. Il
pafia la riviere du Phafe, dont il remarque que l’eau
nage long-tems fur celle de la m er, parce qu’elle eft
extrêmement légère , 6c qu’elle fe garde plus de dix
ans fans fe corrompre. Il y avoit-là un château gardé
par quatre cens foldats romains , 6c un bourg habité
par des vétérans 6c par quelques gens de mer; Adrien
ordonna d’y faire un nouveau foffé pour la fureté du
bourg. Il termina fa navigation à-Sébaftople , où
étoit la derniere garnifon romaine. Il fut attaqué dans
ce voyage d’une grande tempête ; dont un de. fes
vaiffeaux fut brifé.
Entre les peuples barbares dont il cotoya le pays,
les plus voifins de Trébizonde, 6c auffi les plus belliqueux,
étoient les Sannes nommés Drilles par Xé-
nophon ; ils n’avoient point de rois. Ils avoient autrefois
payé tribut aux Romains, 6c Arrien promet
à Adrien de les y réduire de nouveau, ou de les exterminer.
Il ne fît pas le dernier, carplufieurs fie-
cles après on parloit encore des Tranes , qui font
fans doute les mêmes que les Sannes. Il paroît que
ces Sannes habitoient une partie de la Colchide, que
Fon diftinguoit alors du pays des Lazes.
A la relation de fon voyage , il joint une defeription
de la côte de l’Afie, depuis Byi'ance jufqu’à Trébizonde
, 6c une autre du pays qui eft depuis Sébaf-
tople jufqu’au Bofphore Cimmérien, 6c depuis le
Bofphore jufqu’à Byfance, afin qu’Adrien put prendre
fur cela fes melùres , s’il vouloit entrer dans les
affaires du Bofphore , dont il lui mande que le roi
Cotys étoit mort depuis peu de tems.
Nous avons auffi fous le nom d'Arrien, une defeription
des côtes de la mer Rouge, c’eft-à-dire des
côtés orientales de l’Afrique, 6c de celles de l’Afie
jufqu’aux Indes : l’infcription latine eft à l’empereur
Adrien; quoiqu’il ne foit point parlé de lui dans la
defeription même. Saumaife croit qu’elle a été écrite
du tems de Pline le naturalifte , ou même un peu
avant lu i, 6c qu’ainfi elle ne peut être d’Arrien de
Nicomédie, ni même adreflee à l’empereur Adrien ;
c’eft ce qu’il conclud de ce qu’il y eft foit mention
de plufieurs princes qui vivoient du tems de Pline.
A ces preuves , M. de Tillemont ajoute un pafl'age
de la defeription, où il eft dit qu’on alloit du bourg
de Lencé à Pétra vers Malican, roi des Nabathéens;
or la ville de Pétra & toute l’Arabie Pétrée, avoit été
foumife aux Romains dès Fan 105 de J. C. 6c réduite
enfuite en province , &c l’on ne trouve point qu’Adrien
l’ait abandonnée ;. au contraire , on a des médailles
de la ville de Pétra fous cet empereur, avec
le titre de métropole.
Il faut donc que cette defeription foit antécédente
à l’anhée 105 ; 6c par conféquent elle n’eft point
d’Arrien, qui vivoit encore fous Marc-Aurele, c’eft-
à-dire après Fan 160. Enfin Fauteur parle de l’Egypte
comme de fon pays , 6c fait quelquefois ufoge
des mois Egyptiens. M. de Tillemont croit donc que
cet ouvrage pourroit être de celui à qui Pline le jeu--:
ne écrit plufieurs lettres, comme à uneiperfonne habile
6c éloquente , 6c qui paffoit pour un imitateur
de Démofthène : il paroît que dès le téms de Nerva,
ou dans les premières années de Trajan, cet Arrien
s’étoit retire pour vivre tranquillement, ce qui n’é-
toit permis aux fénateurs, que dans un âge fort avancé
; ainfi cela ne convient point au difciple d’Epic-
tete.
Si maintenant l’on veut joindre à ces .détails, de:
Tome XII»
rantiquite , les deferiptions de nos navigateurs iftô»
dernes, dont on a parle en leur lieu, on aura Fhift
toire complété de la navigation, 6c cette hiftoire eft
fort intéreffantej ( Le Chevalier d e Ja v c o u r t . )
P E R IP LO C A , ( Hiß. nat. Bot.) genre de planté
à fleur monopétale, 6c beaucoup plus ouverte qué
celle de l’âpocin, de forte qu’elle approche plus de la
figure d’une roue. Il s’élève du calice un piftil qui eft
attaché comme un clou à la partie poftérieure de la
fleur, 6c qui devient dans la fuite un fruit fi reffem-
blant à celui de l’apocin, que les auteurs n’ont pas
coutume de faire de ces deux plantes deux genres
particuliers. Tournefort, Injlit. rei herb. Voyez
Plante.
Entre les douze efpeces de plôca * établies par
Tournefort, il fuffira bien de décrire celle qui eft à
longues feuilles, periploca foliis oblongis. I. R. H. 03 ;
Elle pouffe des tiges formenteufes, fort longues »
ligneufes , pliantes, nouées, rougeâtres, lefquelles
s’élèvent 6c s’entortillent autour des arbres ou ar-
briffeaux voifins. Ses feuilles font oppofées , longues,
larges, poihtues, veineufes i fes fleurs viennent
aux lommités des branches ; elles font mono*
pétales , fort évafées à la gueule, 6c de couleur purpurine.
Il fuccede à fes fleurs un fruit à deux graines*
un peu courbées, plus grandes que celles de l’apo-
cin. Elles s’ouvrent dans leur maturité 6c laiffent
paroître une matière lanugineufe, fur laquelle font
couchées des femences à aigrette : cette plante croît
dans 1 elbois, 6c a la plupart des caraéteres de Vapo*
cynum feandens. ( D. J. )
PERIPNEUMONIE, f. f. ( Médecine. ) inflammation
du poumon, que l’on diftingue en vraie 6c en
fauffe.
Peripneumonie vraie. Là peripneumonie vraie eft
l’inflammation de la fubftance même du poumon j
avec fechereffe , chaleur 6c douleur.
Les vaiffeaux fufceptibles de cette inflammation
font les arteres bronchiales 6c les arteres pulmonaires
: elle eft plus ou moins daftgeréufe, félon la différence
des vaiffeaux engorgés, 6c félon la qualité du
fang engorgé.
Les cailles de cette double inflammation font *
i° . les caufes générales de toutes les imflammations :
20. les caufes qui affeétent particulièrement le poumon
, comme un air trop humide ou- trop fe c , trop
chaud ou trop froid, trop groffierou trop fubtil, un
air chargé d’exhalaifons cauftiques, ou aftringentes *
ou coagulantes, un chyle formé de matières épaiffes *
feches, vifqueufes, l’exercice violent du poumon par
la courfe, la lutte, le mouvement du cheval contre
le vent, les poifons coagulans , cauftiques, aftrin-
gens, portés au coeur par les veines qui s’y rendent,
les violentes pallions de l’ame, Pefquinancie avec op-
preffion de poitrine 6c orthopnée, une forte pleuréfie/
une paraphrénéfie violente , lfeftion d’un émétique
dans un eftomac tendre& délicat.
Les fymptômes de la peripneumonie font diffèrens*
félon fon fiége ; celle qui réfide dans les bronches
produit tous les effets de l’inflammation, 6c enflamme
même les extrémités de Fartere pulmonaire qui leur
font continguës, en les comprimant 6c en leur communiquant
la maladie dont ils font' attaqués.
Cette inflammation peut s’attacher a différentes
parties du poumon;' fon étendue peut auffi varier;
les fymptômes feront plus violens s’il y a deux.lobes
entrepris que s’ilrn’y en a qu’u n , ou fi un lobe eft
totalement enflammé, que s’il n’y en a qu’une par- •
tie ; la peripneumonie n’eft pas guériffable dans le premier
cas, à caufe de la grandeur 6c de l’étendue de
l’engorgement ; dans le lecond cas: elle peut fe guérir
, fi les fymptômes ne font pas extrêmes, fi la
toux, la douleur ; la chaleur 6c Foppreffion peuvent
fe lupp.orter 6c céder peu - à -peu à l’aétion des re- .
medes« B b b