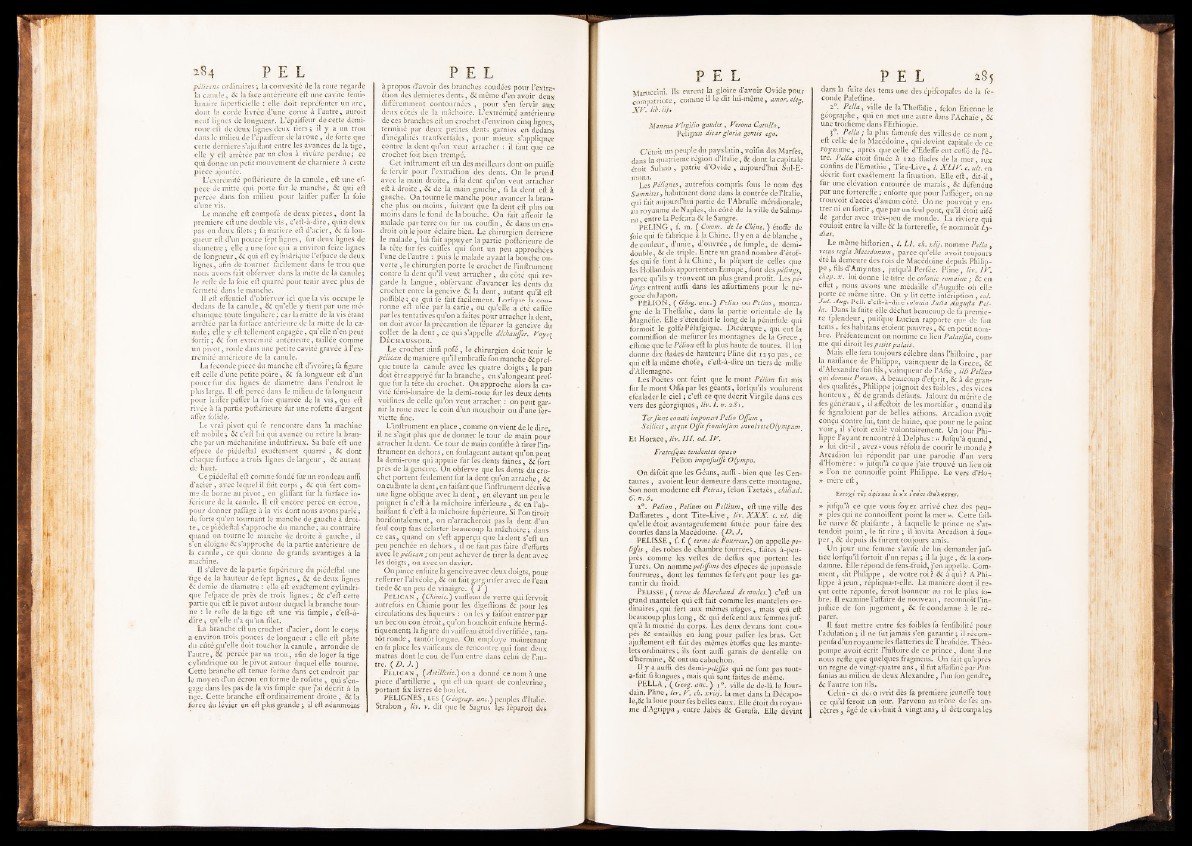
pélicans ordinaires ; la convexité de la roue regarde
ia canule, 6c la face antérieure eft une cavité l'emi-
îunaire fiiperficielle : elle doit repréfenter un arc,
dont la corde livrée d’une corne à l’autre, auroit
neuf lignes de longueur. L’épaiffeur de cette demi-
roue elt de deux lignes deux tiers ; il y a un trou
dans le milieu de l’epaiffeur de la roue , de forte que
cette derniere s’ajuftant entre les avances.de la tige,
elle y eft arrêtée par un clou à rivûre perdue ; ce
qui donne un petit mouvement de charnière à cette
piece ajoutée.
L’extrémité poftérieure 3e la canule, eft une ef-
pecfe demitte qui porte fur le manche, & qui eft
percée dans fon milieu pour laiffer paffer la foie
d’une vis.
Le manche eft compofé de deux pièces , dont la
première eft une double v is , c’eft-à-dire, quia deux
pas ou deux filets ; fa matière eft d’acier, & fa longueur
eft d’un pouce fept lignes, fur deux lignes de
diamètre ; elle a une foie qui a environ feize lignes
de longueur, & qui eft cylindrique l’efpace de deux
lignes, afin de tourner facilement dans le trou que
nous avons fait obferver dans la mitte de la canule;
le refte de la foie eft quarré pour tenir avec plus de
fermeté dans le manche.
Il eft effentiel d’obferver ici que la vis occupe le
dedans de la canule, 6c qu’elle y tient par une mé-
chanique toute finguliere ; car la mitte de la vis étant
arrêtée par la fiirface antérieure de la mitte de la canule;
elle y eft tellement engagée, qu’elle n’en peut
■ fortir; 6c fon extrémité antérieure, taillée comme
un p ivot, roule dans une petite cavité gravée à l’extrémité
antérieure de la canule.
La fécondé piece du manche eft d’ivoire ; fa figure
eft celle d’une petite poire, 6c fa longueur eft a’un
pouce fur dix lignes de diamètre dans l’endroit le
plus large. Il eft percé dans le milieu de fa longueur
pour laiffer paffer la foie quarrée de la v is , qui eft
rivée à fa partie poftérieure fur une rofette d’argent
affez fohde.
Le vrai pivot qui fe rencontre dans la machine
eft mobile ; 6c c’en: lui qui avance ou retire la branche
par un méchanifme induftrieux. Sa bafe eft une
efpece de piédeftal exactement quarré , 6c dont
chaque furface a trois lignes de largeur , 6c autant
de haut.
Ce piédeftal eft comme foudé fur un rondeau aulîi
d’acier, avec lequel il fait corps , 6c qui fert comme
de borne au p ivot, en gliffant fur la furface inférieure
de la canule. Il eft encore percé en écrou,
pour donner paffage à la vis dont nous avons parlé ;
de forte qu’en tournant le manche de gauche à droite
, ce piede'ftal s’approche du manche ; au contraire
quand on tourne" le manche de droite à gauche, il j
s’en éloigne & s’approche de la partie anterieure de .
la canule, ce qui donne de grands avantages à la
machine.
Il s’élève de la partie fupérieure du piédeftal une
tige de la hauteur de fept lignes , 6c de deux lignes
6c demie de diamètre : elle eft exactement cylindrique
l’efpace de près de trois lignes ; & c’eft cette
partie qui eft le pivot autour duquel la branche tourne
: le refte de la tige eft une vis fimple, c’eft-à-
dire ; qu’elle n’a qu’un filet.
La branche eft un crochet d’acier, dont le corps
a environ trois pouces de longueur : elle eft plate
du côté qu’elle doit toucher la canule, arrondie de
l’autre, 6c percée par un trou, afin de loger la tige
cylindrique ou le pivot autour duquel elle tourne.
Cette branche eft tenue ferme dans cet endroit par
le moyen dîun écrou en forme de rofette , qui s’engage
dans les pas de la vis fimple que j’ai décrit à la
tige. Cette branche eft ordinairement droite , 6c la
force du levier en eft plus grande ; il eft néanmoins
à propos d’avoir des branches coudées pour l’extra«
ftion des dernieres dents, & même d’en avoir deux
différemment contournées , pour s’en fervir aux
deux côtés de la mâchoire. L’extrémité antérieure
de ccs branches eft un crochet d’environ cinq lignes,
terminé par deux petites dents garnies en dedans
d’inegalites tranfverfales, pour mieux s’appliquer
contre la dent qu’on veut arracher : il faut que ce
crochet foit bien trempé.
Cet infiniment eft un des meilleurs dont on puiffe
fe fervir pour l’extraâion des dents. On le prend
avec la main droite, fi la dent qu’on veut arracher
eft à droite , & de la main gauche, fi la dent eft à
gauche. On tourne le manche pour avancer la branche
plus ou moins, fuivant que la dent eft plus ou
moins dans le fond de la bouche. On fait affeoir le
malade par terre ou fur un couffin, & dans un endroit
où le jour éclaire bien. Le chirurgien derrière
le malade, lui fait appuyer la partie poftérieure de
la tête fur fes cuiffes qui font un peu approchées
l’une de l’autre : puis le malade ayant la bouche ouverte
, le chirurgien porte le crochet de l’inftrument
contre la dent qu’il veut arracher , du côté qui regarde
la langue, obfervant d’avancer les dents du
crochet entre la gencive & la dent, autant qu’il eft
poffible ; ce qui fe fait facilement. Lorfque la couronne
eft ufee par la carie, ou qu’elle a été çaffée
par les tentatives qu’on a faites pour arracher la dent,
on doit avoir la précaution de féparer la gencive du
collet de la dent, ce qui s’appelle déchaujfer. Voye{
D é c h a u s so ir .
Le crochet ainfi pofé, le chirurgien doit tenir le
pélican de maniéré qu’il embrafle fon manche 6c pref-
que toute la canule avec les quatre doigts ; le pan
doit être appuyé fur la branche, en s’alongeant pref-
que fur la tête du crochet. On approche alors la cavité
fémi-lunaire de la demi-roue fur les deux dents
voifines de celle qu’on veut arracher : on peut garnir
la roue avec le coin d’un mouchoir ou d’une fer-
viette fine.
L’inftrument en place, comme on vient de le dire
il ne s’agit plus que de donner le tour de main pour
arracher la dent. Ce tour de main confifte à tirer l’in-
ftrument en dehors, en foulageant autant qu’on peut
la demi-roue qui appuie fur les dents faines, 6c fort
près de la gencive. On obferve que les dents du crochet
portent feulement fur la dent qu’on arrache, &
on culbute la dent, en faifant que l’inftrument décrive
une ligne oblique avec la dent, en élevant un peu le
poignet fi c’eft à la mâchoire inférieure, & en l’ab-
baiffant fi c’eft à la mâchoire fupérieure. Si l’on droit
horifontalement, on n’arracheroit pas la dent d’un
feul coup fans éclarter beaucoup la mâchoire ; dans
ce cas, quand on s’eft apperçu que la dent s’eft un
peu penchée en dehors , il ne faut pas faire d’efforts
avec le pélican ; on peut achever de tirer la dent avec
les doigts, ou avec un davier.
On pince enfuite la gencive avec deux doigts, pour •
refferrer l’alvéole, & on fait gargarifer avec de l’eau
tiede 6c un peu de vinaigre. ( Y )
P é l ic a n , (Chimie.) vaiffeau de verre qui fervoit
autrefois en Chimie pour les digeftions 6c pour les
circulations des liqueurs : on les y faifoit entrer par
un bec ou cou étroit, qu’on bouchoit enfuite hermétiquement;
la figure du vaiffeau étoit diverfifiée, tantôt
ronde, tantôt longue. On employé maintenant
en fa place les vaiffeaux de rencontre qui font deux
matras dont le cou de l’un entre dans celui de l’autre.
( D. J. )
PÉLICAN, Artillerie.') on a donné ce nom à une
piece d’artillerie , qui eft un quart de coulevrine,
portant fix livres de boulet.
PÉLIGNES, les ( Géograp. anc.) peuples d’Italie.
Strabon ^ liv. v. dit que le Sagrus les féparojt des
Maruccxm. Ils eurent la gloire d’avoir Ovide pour
compatriote, comme il le dit lui-même, amor. eleg,
X V . lib.iij.
Mantua Virgïlio gaudet, Vtrôna Catullo 9
Pelignæ dicar gloria gentis ego.
C ’étoit un peuple du pays latin, voifin des Marfes,
dans la quatrième région d’Italie, & dont la capitale
étoit Sulrno, patrie d’Ovide , aujourd’hui Sul-E-
mona.
Les Pélignes, autrefois compris fous le nom des
Samnites, habitaient donc dans la contrée de l’Italie,
qui fait aujourd’hui partie de l’Abruffe méridionale,
au royaume de Naples, du côté de la ville deSalmo-
na, entre la Pefcara & le Sangre.
PÉLING , f. m. ( Comm. de la Chine, ) étoffe de
foie qui fe fabrique à la Chine. Il y en a de blanche,
de couleur, d’unie, d’ouvrée, de fimple, de demi-
double, & de triple. Entre un grand nombre d’étoffes
qui fe font à la Chine , la plupart de celles que
les Hollandois apportent en Europe, font des pélings,
parce qu’ils y trouvent un plus grand profit. Les pélings
entrent aufli dans les affortimens pour le négoce
du Japon.
PÉLION, ( Géog. anc.) Ptlius ou Pelios, montagne
de la Theffalie, dans la partie orientale de la
Magnéfie. Elle s’étendoit le long de la péninfule qui
formoit le golfe Pélafgique. Dicéarque, qui eut la
commiflion de mefurer les montagnes de la Grece ,
eftime que le Pélion eft la plus haute de toutes. Il lui
donne dix ftades de hauteur; Pline dit IZ50 pas, ce
qui eft la même chofe, c’eft-à-dire un tiers de mille
d’Allemagne.
Les Poètes ont feint que le mont Pélion fut mis
fur le mont Offa par les géants, lorfqu’ils voulurent
efcalader le ciel ; c’eft ce que décrit Virgile dans ces
vers des géorgiques, liv. 1. v. 2.81.
Ter funt conaii imponere Pelio Offarn ,
Scilicet, atque OJfce frondofuni involvereOlympum%
Et Horace, liv. III. od. IV.
Fratrefque tendeiites opaco
Pélion impojuijfe Olympo.
On difoit que les Géans, aufli - bien que les Centaures
, avoient leur demeure dans cette montagne.
Son nom moderne eft Petras, félon Tzetzès, chiliad.
6. n.6 .
20. Pélion, Peliurn ou Pellium, eft une ville des
Daffaretes , dont T ite-L iv e, liv. X X X . c. xl. dit
qu’elle étoit avantageufement fituée pour faire des
eourfes dans la Macédoine. (D . J.
PELISSE, f. f. ( terme de Fourreur,) on appelle petites
, des robes de chambre fourrées, faites à-peu-
près comme les veftes de deffus que portent les
Turcs. On nommepelijfons des efpeces de jupons de
fourrures,- dont les femmes fe fervent pour les garantir
du froid.
PELISSE, ( terme de Marchand démodés.) c’eft un
grand mantelet qui eft fait comme les mantelets or-b
dinaires, qui fert aux mêmes ufages , mais qui eft
beaucoup plus long, 6c qui defcend aux femmes juf-
qu’à la moitié du corps. Les deux devans font coupés
6c entaillés en long pour paffer les bras. Cet
ajuftement eft fait des mêmes étoffes ,que les mante-
léts ordinaires ; ils font aufli garnis de dentelle ou
d’hermine, 6c ont un cabochon.
Il y a aufli des demi-pelijfes qui ne font pas tout-
a-fait fi longues, mais qui lont faites de même.
PELLA, ( Geog. anc. ) i° . ville de de-là le Jourdain.
Pline, liv. V. ch. xviij, la met dans laDécapo-
le,& la loue pour fes belles eaux. Elle étoit du royaume
d’Agrippa, entre Jabçs 6c Gerafa. Elle devint
dans la fuite des tems une des épifcopalcs de la fécondé
Paleftine.
; 2°. Pella, ville de la Theffalie , félon Etienne le
géographe, qui en met une autre dans l’Achaïe, 6c
une troifieme dans l’Ethiopie.
30. Pella j la plus fameufe des villes de ce nom,
eft celle de la Macédoine, qui devint capitale de ce
royaume, après que celle d’Edeffe eut ceffé de l’être.
Pella étoit fituée à 120 ftades de la mer, aux
confins de l’Emathie, Tite-Live, l. XLIV. t. ùlt. en
décrit fort exaftement la fituation. Elle e ft , dit-il,
fur une élévation entourée de marais, & défendue
par une forterefle ; enforte que pour l’alfiéger, on ne
trouvoit d’accès d’aucun côté. On ne pouvoit y entrer
ni en fortir, que par un feul pont, qu’il étoit aifé
de garder avec tres-peu de monde. La riviere qui
couloit entre la ville 6c la forterefle, fe nommoit Ly-
dias.
Le meme hiftorien, /. L l. ch. xlij. nomme Pella,
vêtus regia Macedonum, parce qu’elle avoit toujours
ete la demeure des rois de Macédoine depuis Philippe
, fils d’Amyntas, jufqu’à Perfée. Pline, liv. IV .
chap. x . lui donne le titre de colonie romaine ; 6c en
effet, nous avons une médaille d’Augufte où elle
porte ce meme titre. On y lit cette infeription , col.
Jul. Aug. Pell. c’eft-à-dire colonia Julia Augufia Pella.
Dans la fuite elle déchut beaucoup de fa première
fplendeur, puifque Lucien rapporte que de fon
tems, fes habitans étaient pauvres, & en petit nombre.
Présentement on nomme ce lieu Palatifia, comme
qui diroit les petits palais.
Mais elle fera toujours célébré dans l’hiftoire, par
la naiffance de Philippe, vainqueur de la Grece, &
d’Alexandre fon fils, vainqueur de l’Afie, illi Pelloeo
qui domuit Porum. A beaucoup d’efprit, & à de Grandes
qualités, Philippe joignoit des toibles, des vices
honteux, 6c de grands defauts. Jaloux du mérite de
fes généraux, il affectoit de les mortifier, quand ils
fe fîgnaloient par de belles attions. Arcadion avoit
conçu contre lui, tant de haine, que pouf ne le point
v o ir , il s’étoit exilé volontairement. Un jour Philippe
l’ayant rencontré à Delphes : « Jufqu’à quand,
» lui dit-il, avez -vous réfolu de courir le monde ?
Arcadion lui répondit par une parodie d’un vers
d’Homère: » julqu’à ce que j’aie trouvé un lieu où
» l’on ne connoiffe point Philippe. Le vers d’Ho-
» mère eft,
Eico%t Tttç utyiKHcti oi mi 1 cet m t&a Xxctray.
» jufqu’à ce que vous foyez arrivé chez des peu-
» pies qui ne connoiffent point la mer ». Cette faillie
naïve & plaifante, à laquelle le prince ne s’at-
tendoit point, le fit rire ; il invita Arcadion à fou-
p e r , & depuis ils furent toujours amis.
Un jour unè femme s’avife de lui demander juf*
tice lorfqu’il fortoit d’un repas ; il la juge, & la condamne.
Elle répond de fens-froid, j’en appelle. Comment
, dit Philippe , de votre roi ? & à qui ? A Philippe
à jeun, repliqua-t-elle. La maniéré dont il reçut
cette réponfe, feroit honneur au roi le plus fo-
bre. Il examine l’affaire de nouveau, reconnoît l’in-
juftice de fon jugement, 6c fe condamne à le réparer.
Il faut mettre entre fes foibles fa fenfibilité pour
l’adulation; il ne fut jamais s’en garantir; ilrécom-
penfa d’un royaume les flatteries de Thrafidée. Théopompe
avoit écrit l’hiftoire de ce princé, dont il ne
nous refte que quelques fragmens. On fait qu’après
lin régné de vingt-quatre ans, il fut affafliné par Pau-
fanias au milieu de deux Alexandre, l’un fon gendre,
& l’autre fon fils.
C e lu i-c i déco ivrit dès fa première jeuneffe tout
ce qu’il feroit un jour. Parvenu au trône de fes ancêtres
, âgé de ciix-huità vingt ans, il détrompa les