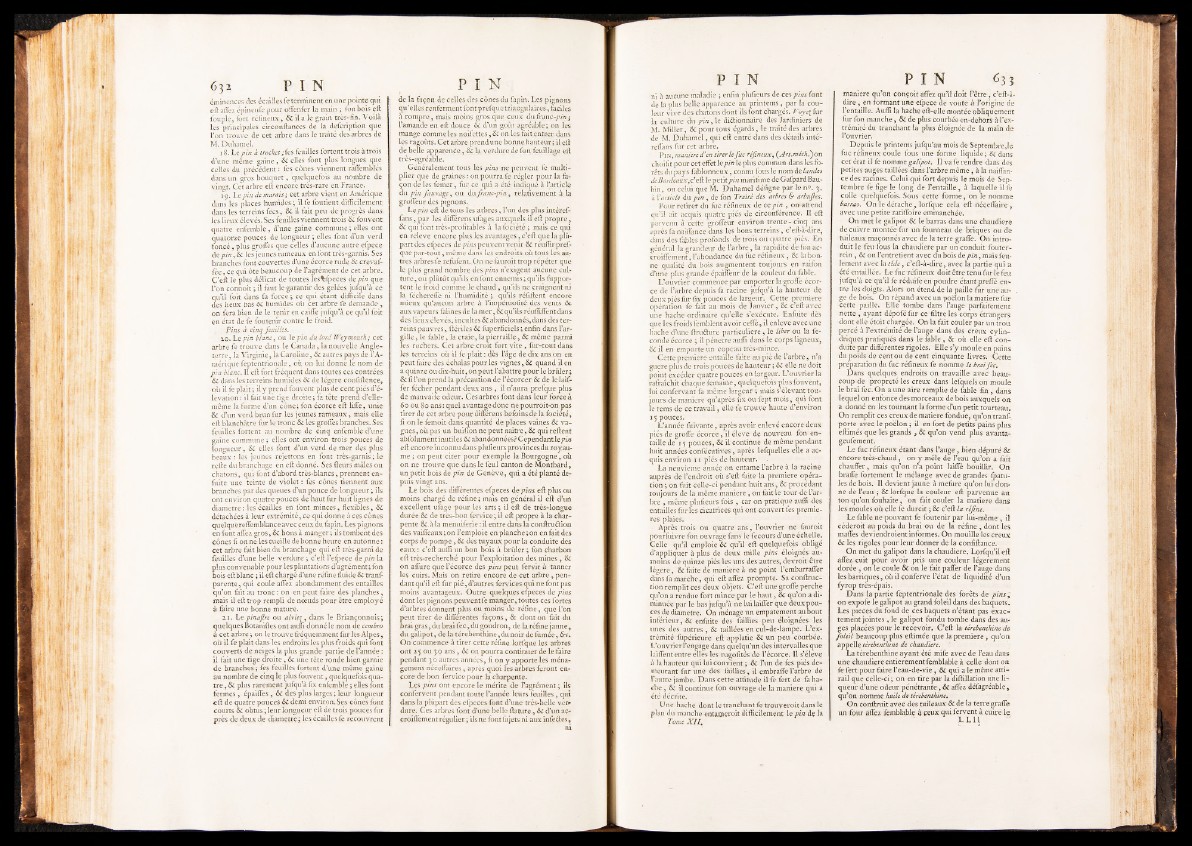
éminences des écaillesfe terminent en une pointe qm
eft affez épineufe pour offenfer la main ; fon hois eft
fouple, fort réfineux , & il a le grain très-fin. Voilà
les principales circonftances de la defcription que
l’on trouve de cet arbre dans le traité des arbres de
M. Duhamel.
' 18. Le pin à trochetjtes feuilles fortent trois à trois
d’une même gaine, & elles font plus longues que
celles du précédent: fes cônes viennent raffemblés
dans un gros bouquet, quelquefois au nombre de
vingt. Cet arbre eft encore très-rare en France.
10. Le pin de marais ; cet arbre vient en Amérique
dans les places humides ; il fe foutient difficilement
dans les terreins fées, & il fait peu de progrès dans,
les lieux élevés. Ses feuilles viennent trois 6c fouvent
quatre enfemble, d’une gaine commune ; elles ont
quatorze pouces de longueur ; elles font d’un verd
foncé, plus groffes que celles d’aucune autre efpece
de pin, & les jeunes rameaux en font très-garnis. Ses
branches font couvertes d’une écorce rude & crevaf-
fée, ce qui ôte beaucoup de l’agrément de cet arbre.
C ’eft le plus délicat de toutes les%fpeces de pin que
l’on connoît ; il faut le garantir des gelées jufqu’à ce
qu’il foit dans fa force ; ce qui étant difficile dans
des lieux bas & humides 011 cet arbre fe demande ,
on fera bien de le tenir en caifife jufqu’à ce qu’il foit
en état de fe foutenir contre le froid.
Pins à cinq feuilles.
20. Le pin blanc, ou le pin du lord Weymouth; cet
arbre fe trouve dans le Canada, la nouvelle Angleterre
, la Virginie, la Caroline, ôc autres pays de l’Amérique
feptentrionale, où on lui donne le nom de
pin blanc. Il eft fort fréquent dans toutes ces contrées
& dans les terreins humides & de légère confiftence,
où il fe plait ; il y prend fouvent plus de cent piés d’é-
levation : il fait une tige droite ; fa tête prend d’elle-
même la forme d’un cône; fon écorce eft lifte, unie
& d’un verd brun fur les j eunes rameaux, mais elle
eft blanchâtre fur le tronc & les groffes branches. Ses
feuilles fortent au nombre de cinq enfemble d’une
gaine commune ; elles ont environ trois pouces de
longueur, & elles font d’un verd de mer des plus
beaux: les jeunes rejettons en font très-garnis ; le
refte du branchage en eft donné. Ses fleurs mâles ou
chatons, qui font d’abord très-blancs, prennent en-
fuite une teinte de violet : fes cônes tiennent aux
branches par des queues d’un pouce de longueur ; ils
ont environ quatre pouces de haut fur huit lignes de
diamètre : les écailles en font minces, flexibles, &
détachées à leur extrémité, ce qui donne à ces cônes
quelquereffemblance avec ceux du fapin. Les pignons
en font allez gros, & bons à manger ; ils tombent des
cônes fi on ne les cueille de bonne heure en autonne :
cet arbre fait bien du branchage qui eft très-garni de
feuilles d’une belle verdure ; c’eft l’efpece de pin la
plus convenable pour les plantations d’agrément; fon
bois eft blanc ; il eft chargé d’une réfine fluide & tranf-
parente, qui coule allez abondamment des entailles
qu’on fait au tronc : on en peut faire des planches,
mais il eft trop rempli de noeuds pour être employé
à faire une bonne mature.
21. Le pinaftre ou alvie^, dans le Briançonnois,;
quelques Botaniftes ont auffi donné le nom de cembro
à cet arbre ; on le trouve fréquemment fur lès Alpes,
où il fe plait dans les endroits les plus froids qui font
couverts de neiges la plus grande partie de l’année :
il fait une tige droite, & une tête ronde bien garnie
de branches ; fes feuilles fortent d’une même gaine
au nombre de cinq le plus fouvent, quelquefois quatre
, & plus rarement jufqu’à fix enfemble ; elles font
fermes , épaiffes , & des plus larges ; leur longueur
eft de quatre pouces & demi environ. Ses cônes font
courts bc obtus ; leur longueur eft de trois pouces fur
près de deux de diamètre ; les écailles fe recouvrent
de la façon d.e celles des cônes d,u fapin. Les pignons
qu’elles renferment font prefque triangulaires, faciles
à rompre, mais moins gros que ceux du franc-pin ;
l’amande en eft douce & d’un goût agréable ; on les
mange comme les noifettes, & on les: Fait entrer, dans
les ragoûts. Cet arbre prendune bonne hauteur; il eft
de belle apparence, & la verdure de fon feuillage eft
très-agréable.
Généralement tous lès pins ne peuvent fe multiplier
que de graines : on pourra fe régler pour la façon
de les femer * fur ce qui. a été indique, à l’article
du pin fauvage, ou du franc-pin, relativement, à. la
groffeur des pignons.
Le pin eft de tous les arbres, l’un des plus intéref-
fans, par les différens ufages auxquels il eft propre,
& qui font très-profitables à la fociété ; mais ce qui
en releve encore plus les avantages, c’eft que la plupart
des efpeces de pins peuvent venir & reuffirpref-
que par-tout, même dans les endroits, oit to.us les autres
arbres fe refùfent. On ne fauroit trop répéter que
le plus grand nombre des pins n’exigent aucune culture
, ou plutôt qu’ils en font ennemis ; qu’ils fiippor-
tent le froid comme le chaud, qu’ils ne craignent ni
la féchereffe ni l’humidité ; qu’ils réfiftent encore
mieux qu’aucun arbre à l’impétupfité des vents &
aux vapeurs falines de la mer, & qu’ils réuffiffent dans
des lieux élevés, incultes & abandonnés, dans des terreins
pauvres , ftériles & fuperficiels ;.enfin dans.l’ar-
gille, le fable, la craie, la pierraille, & même parmi
les rochers. Cet arbre croit fort v ite , fur-tout dans
les terreins où il fe plait : dès l’âge de dix ans on en
peut faire des échalas pour les vignes quand il en
a quinze ou dix-huit, on peut l’abattre pour le brûler ;
& fi l’on prend la précaution de Fécorcer & de le laif-
fer fécher pendant deux ans , il n’aura prefque plus
de mauvaile odeur. Ces arbres font dans leur force à
60 ou. 80 ans : quel avantage donc n,e ppurroit-on pas
tirer de cet arbre pour différens befoins de la focieté,
fi on le femoit dans, quantité de places vaines & vagues
, oii pas un buiffon ne peut naître, & qui reftent
abfolument inutiles & abandonnées? Cependant le pin
eft encore inconnu dans plufieurs provinces du royaume
; on peut citer pour exemple la Bourgogne, où
on ne trouve que dans le feul canton de Montbard,
un petit bois de pin de Genève, qui a été planté depuis
vingt ans.
Le bois des différentes efpeces de pins eft; plus ou
moins chargé de réfine ; mais en général il eft d’un
excellent ufage pour les arts ; il eft de très-longue
durée & de très-bon fervice ; il eft propre à la charpente
&.à la menuiferie : il entre dans la conftrufrion
des vaiffeaux; on l’emploie en planche ; on en fait des
corps de pompe, & des tuyaux pour la conduite des
eaux : c’eft auffi un bon bois à brûler ; fon charbon
eft très-recherché pour l’exploitation des. mines, &
on affure que l’écorce des pins peut fervir à tanner
les cuirs. Mais on retire encore de cet arbre , pendant
qu’il eft fur pié, d’autres fervices. qui ne font pas
moins avantageux. Outre quelques elpeces de pins
dont les pignons.peuventfe manger, toutes ces fortes
d’arbres donnent plus ou moins, de réfine, que l’on
peut tirer de differentes façons., & dont on fait du
brai gras, du brai fec, du goudron, de la réfine jaune ,
du galipot, de la térébenthine, du noir de fumée, &c.
On commence à tirer cette réfine lorfque les arbres
ont 25 ou 30 ans, & on pourra continuer de le faire
pendant 30 autres années, fi on y apporte les ména-
gemens néceffaires, après quoi fes arbres feront encore
de bon fervice pour la charpente.
Les pins ont encore le mérite de l’agrément ; ils
confervent pendant toute l’année leurs feuilles, qui
dans la plûpart des efpeces font d’une très-belle v.ei>
dure. Ces arbres font d’une belle ftature, & d’un acr
croiffement régulier ; ils ne fontfujets ni aux infe&es,
ni
ni à aucune maladie ; enfin plufieurs de ces pins font
de la plus belle apparence au printems, par la couleur
vive des chatons dont ils font chargés. Veye{ fur
la culture du pin, le dictionnaire des Jardiniers de
M. Miller, & pour tous égards, le traité des arbres
de M. Duhamel, qui eft entré dans des détails inté-
reffans fur cet arbre.
Pin, manière d'en tirer le f i e réfineux, (Art.méch.') on
choifit pour cet effet le pin le plus commun dans les forêts
du pays fablonneux, connu fous le nom de landes
de Bordeaux,*? eft le petit pin maritime de GafpardBau-
hin, ou celui que M. Duhamel défigne par le n°. 3.
à l’article du p in , de fon Traité des arbres & arbujles.
Pour retiret du fuc réfineux de ce pin , o»attend
qu’il ait acquis quafre piés de circonférence. II eft
parvemi à cette grofleur environ trente - cinq ans
après fa naiffance dans les bons terreins, c’eft-à-dire,
dans des fables profonds de trois ou quatre piés. En
général la grandeur de l’arbre, la rapidité de fon ac-
croiffement, l’abondance du fuc réfineux, & la bonne
qualité du bois augmentent toujours en raifon
d’une plus grande épaiffeur de la couleur du fable.
L’ouvrier commence par emporter la groffe écorce
de l’arbre depuis fa racine jufqu’à la hauteur de
deux piés fur fix pouces de largeur. Cette première
opération fe fait au mois de Janvier , ôc c’eft avec
une hache ordinaire qu’elle s’exécute. Enfuite dès
que les froids femblent avoir ceffé, il enleve avec une
hache d’une ftruâure particulière , le liber ou la fécondé
écorce ; il pénétré aufli dans le corps ligneux,
ô c il en emporte un copeau très-mince.
Cette première entaille faite au pié de l’arbre, n’a
guere plus de trois pouces de hauteur ; & elle ne doit
point excéder quatre pouces en largeur. L’ouvrier la
rafraîchit chaque femaine, quelquefois plus fouvent,
lui confervant fa même largeur ; mais.s’élevant toujours
de maniéré qu’après fix ou fept mois, qui font
le tems de ce travail, elle fe trouve haute d’environ
15 pouces*
L’année fuivante,-après avoir enlevé encore deux
piés de groffe écorce, il éleve de nouveau fon entaille
de 15 pouces, & il continue de même pendant
huit années confécutives, après lefquelles elle a acquis
environ 11 piés de hauteur.
La neuvième année on entame l’arbre à la racine
auprès de l’endroit où s’eft frite la première opération
; on fuit celle-ci pendant huit ans, & procédant
toujours de la même maniéré , on fait le tour de l’arbre
, même plufieurs fois , car on pratique auffi des
entailles fur les cicatrices qui ont couvert fes premières
plaies.
Après trois ou quatre ans, l’ouvrier ne fauroit
pourfuivre fon ouvrage fans le fecours d’une échelle.
Celle qu’il emploie & qu’il eft quelquefois obligé
d’appliquer à plus de deux mille pins éloignés au-
moins de quinze piés les uns des autres, devroit être
légère, & frite de maniéré à ne point l’embarraffer
dans fa marche, qui eft allez prompte. Sa conftruc-
tion remplit ces deux objets. C’eft une groffe perche
qu’on a rendue fort mince par le haut, & qu’on a diminuée
par le bas jufqu’à ne luilaiffer que deux pouces
de diamètre. On ménage un empâtement aubout
inférieur, & enfuite des faillies peu éloignées les
unes des autres , & taillées en cul-de-lampe. L’extrémité
fupérieure eft applatie & un peu courbée.
L’ouvrier l’engage dans quelqu’un des intervalles que
laiffent entre elles les rugofites de l’écorce. Il s’élève
à la hauteur qui lui convient ; & l’un de fes piés demeurant
fur une des faillies, il embraffe l’arbre de
l’autre jambe. Dans cette attitude il fe fert de fa hache
, & il continue fon ouvrage de la maniéré qui a
été décrite.
Une hache dont le tranchant fe trouveroit dans le
plan du manche entameroit difficilement le pin de la
Tome X I I ,
maniéré qu’on conçoit affez qu’il doit l’être, c’eft-à-
dire , en formant une efpece de voûte à l’origine de
l’entaille. Auffi la hache eft-elle montée obliquement
fur fon manche, & de plus courbée en-dehors à l’extrémité
du tranchant la plus éloignée de la main de
l’ouvrier.
Depuis le printems jufqu’aii mois de Septembre,le
fuc réfineux coule fous une forme liquidé ; & dans
cet état il fe nomme galipot. Il va fe rendre dans des
petites auges taillées dans l’arbre même, à la 'naiffance
des racines. Celui qui fort depuis le mois de Septembre
fe fige le long de l’entaille, à laquelle il fe
colle quelquefois. Sous cette forme, on le nomme
barras. On le détache, lorfque cela eft rtéceffaire,
avec une petite ratiffoire emmanchée.
On met le galipot & le barras dans une chaudière
de cuivre montée fur un fourneau de briques ou de
tuileaux maçonnés avec de la terre graffe. On introduit
le feu fous la chaudière par un conduit fouter-
rein, & on l’entretient avec du bois de pin, mais feulement
avec la téde, c’eft-à-dire, avec la partie qui a
été entaillée. Le fucréfineux doit être tenu fur le feu
jufqu’à ce qu’il fe réduife en poudre étant preffé en*-
tre les doigts.-Alors on étend de la paille fur une auge
de bois. On répand avec un poêlon la matière fur
cette paille. Elle tombe dans l’auge parfaitement
nette , ayant dépofé fur ce filtre les corps étrangers
dont elle étoit chargée. On la fait couler par un trou
percé à l’extrémité de l’auge dans des creux Cylindriques
pratiqués dans le labié, & où elle eft conduite
par differentes rigoles. Elle s’y moule en pains
du poids de cent ou de cent cinquante livres. Cette
préparation du foc réfineux fe nomme le brai fec.
Dans quelques endroits on travaille avec beaucoup
de propreté les creux dans lefquels on moule
le brai fec. On a une aire remplie de fable fin , dans
lequel on enfonce des morceaux de bois auxquels on
a donné en les tournant la forme d’un petit tourteau.
On remplit ces creux de matière fondue, qu’on tranf-,
porte avec le poêlon ; il en fort de petits pains plus
eftimés que les grands , & qu’on vend plus avanta-
geufement.
Le fuc réfineux étant dans l’auge, bien dépuré &
encore très-chaud, on y mêle de l’eau qu’on a fait
chauffer, mais qu’on n’a point laiffé bouillir. On
braffe fortement le mélange avec de grandes fpatu-
les de bois. Il devient jaune à mefiirè qu’on lui donne
de l’eau ; & lorfque la couleur eft parvenue au
ton qu’on fouhaite, on frit couler la matière dans
les moules où elle fe durcit ; & c’eft la réjîne.
Le fable ne pouvant fe foutenir par lui-même , il
céderoit au poids du brai; ou de la réfine , dont les
maffes deviendroient informes. On mouille les creux
bc les rigoles pour leur donner de la confiftance.
On met du galipot dans la chaudière. Lorfqu’il eft
affez cuit pour avoir pris une couleur légèrement
dorée, on le coule & on le fait paffer de l’auge dans
les barriques, où il conferve l’état de liquidité d’un
fyrop très-épais.
Dans la partie feptentrionale des forêts de pins ÿ
on expofe le galipot au grand foleil dans des baquets.
Les pièces du fond de ces baquets n’étant pas exactement
jointes , le galipot fondu tombe dans des auges
placées pour le recevoir, C’eft la térébenthine de
foleil beaucoup plus eftimée que la première, qu’on
appelle térébenthine de chaudière.
La térébenthine ayant été mife avec de l’eau dans
une chaudière entierementfemblable à celle dont on
fe fert pour faire l’eau-de-vie, & qui a le même attirail
que celle-ci; on en tire par la diftillation une liqueur
d’une odeur pénétrante, & affez défagréable,
qu’on nomme huile de térébenthine.
On conftruit avec des tuileaux & de la terre graffe
un four affez femblable à çeux qui fervent à cuire le
- - L L 11