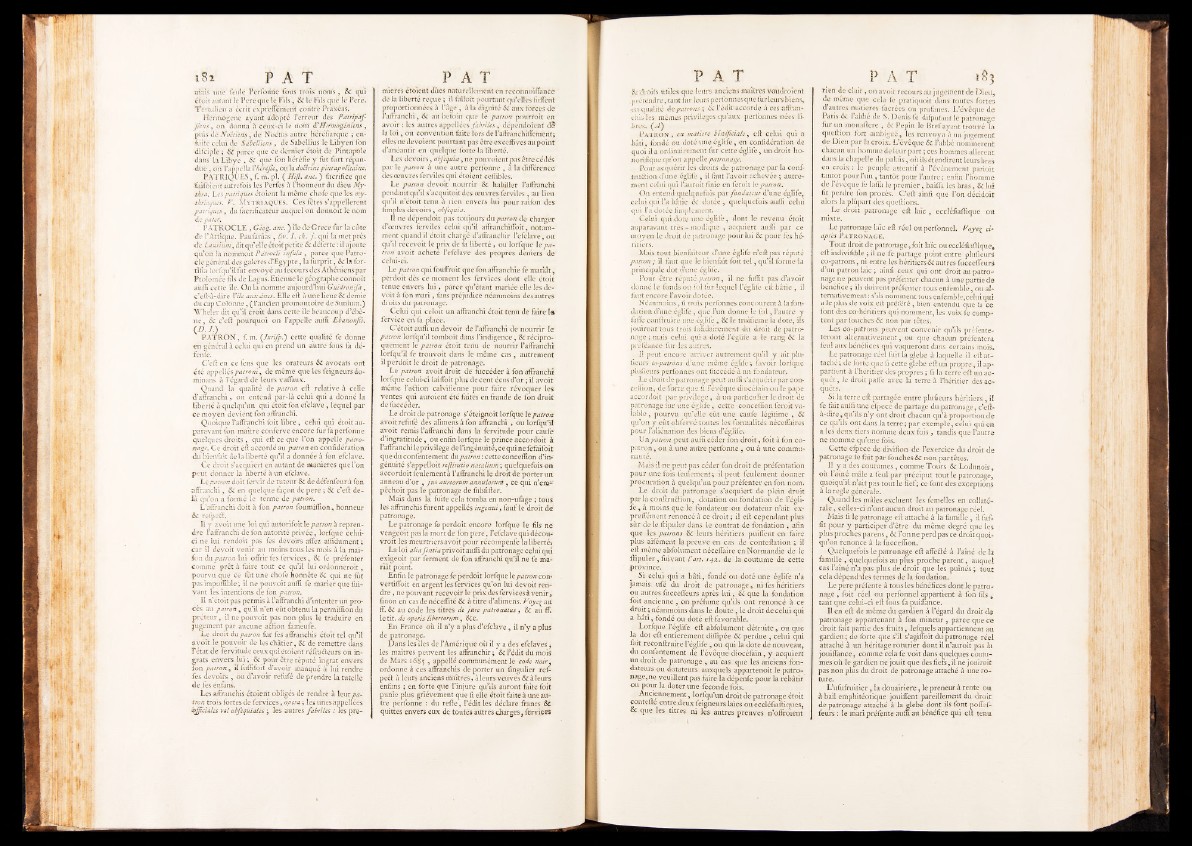
i 8 i P A T
Triais unie feulé Perforine fous trois noms, 6c qui
était autant le Pore que le Fils, 6c le Fils que le Pere;
Tertulien a écrit expreffémenf contre Pra'xéaS.
Heririogene ayant adopté l’erreur' dès Patripàf
Jîèns, on donna à céiix-ci le noiri d' Hefm'oginiens ,
puis de Noétiens, de Noétùs autre heréfiarqUe ; en-
îüite celui de Sàbelliens , de Sabellius le Libyen fön
difciplè ; 6c parce que ce dernier étoit de Pintapole
dans' là Libye , 6c que fori héréfie y fut fort répandue,
on l’appel la Ÿhcrcfit, oii la doctrine pintapolitaine.
PATRIQUES, f. m. pl. ( Hiß. anc. ) facrifice que
•faifoierit autrefois les Perfes à Phonnëur du dieu My-
■ ffiràl Les patriques étoient la môme chofë que les my-
thr'uiquis. V. My triaqu ES. Ces fêtes s’appèllerent
paniques, du facrificatëur auquel ön donnôit le nom
PATROCLE , Géog. anc. ) île de Grece fur la cote
de l’Afrique. Paufähias , Uv. I. ch. j . qui la met près
de Laurium, dit qu’elle étoif petite & défertc : il ajoute
qu’on là riommoit Pdtrocli infula , parce que Patro-
cle général des galeres d’Egypte, la nirprit, 6c là fortifia
lorfqu’iifut envoyé au fecours des Athéniens par
Ptolomée fils de Lagus. Etienne le géographe connoît
aiifli cette île. On la nomme aujourd’hui Guidronifa,
c’ eft-à-dire Y île auxdnes. Elle eft à line lieue & demie
du cap Colonne, ( l’ancien promontoire de Siiriium.)
"Wheler dit qu’il croît dans cette île beaucoup d’ébèn
e , & c’ eft pourquoi on l’appelle aufli Ebanonfii, mm,
PA TRO N , f. m. ( Jttrifp.) cette qualité fe donne
en général à celui qui en prend un autre fous fa dé-
ienfe.
C’eft en ce fens que les orateurs 6c avocats ont
été appellespatrorn, de même que les feigneursdo-
minans à l’égard de leurs vaffaux.
Quand la qualité de patron eft relative à celle
■ d’affranchi, on entend par-là celui qui a donné la
liberté à quelqu’un qui étoit l'on efclave, lequel par
ce moyen devient fon affranchi.
Quoique l’affranchi foit libre , celui qui étoit auparavant
fon maître conferve encore fur fa perfonne
quelques droits , qui efl ce que l’on appelle patronage.
Ce droit êft accordé au patron en confidération
du bienfait de la liberté qu’il a donnée à fon efclave.
Ce droit s’acquiert en autant de maniérés que l’on
peut donner la liberté à un efclave.
Le patron doit fervir de tuteur 6c de défenfeur à fon
affranchi, & en quelque façon de pere ; 6c c’eft delà
qu’on a formé le fermé de patron.
L’affranchi doit à fon patron foumiflion, honneur
6c rel’peâ:.
Il y avoit une loi qui autörifoit le patron à reprendre
l’affranchi de fon autorité privée, lorfque celui-
ci ne lui rendoit pas fes devoirs allez alîidument ;
car il devoit venir au moins tous les mois à la mai-
fon du patron lui offrir fes fervices, & fe préfenter
comme prêt à faire tout ce qu’il lui ordonneroit,
pourvu qué ce fut une chofe honnête 6c qui ne fut
pas impoflible ; il ne pouvoit aufli fe marier que fui-
vant les intentions de fon patron.
Il n’étoit pas permis à l’affranchi d’intenter un procès
au patron , qu’il n’en eût obtenu la permiffion du
préteur, il ne pouvoit pas non plus le traduire en
Jugement par aucune a&ion fameufe.
Le droit du patron fur fes affranchis étoit tel qu’il
avôit le pouvoir de les châtier, 6c de remettre dans
l’état de fervitude ceux qui étoient réfracteurs ou ingrats
envers lui; & pour être réputé ingrat envers
fon patron, il fuffifoit d’avoir manqué à lui rendre
fes devoifs , où d’avoir refiifé de prendre la tutelle
de fes ënfaris.
Les affranchis étoient obligés de rendre à leur patron
trois fortes de fervices, opéra ; les unes appellées
bjficialu vtl obfequiaüs ; les autres fabriles : les pre-
P A T
mierës étoient dues naturellemerit en reconnoiflanëè
de la liberté reçue ; il falloit pourtant qu’ellës fuflent
proportionnées à l’âge , à la dignité 6c aux for'ces de
i’affrànchi, 6c au beïbin que le patron pourroit en
avoir : les autres appellées fabriles, dépertdoiënf d&
la lo i, ou convention faite lors de l’affranchiflefrrent;
elles ne dévoient pourtant pas être exceflî vës au point
d’anéantir en quelque forte la liberté.
Les devoirs, obfequia, ne pouvoient pas être cédés
par le patron à une autre perfonne , à la différence'
des oeuvres ferviles qui étoient ceflibles.
Le patron devoit nourrir 6c habiller l’affranchi
pendant qu’il s’acquitoit des oeuvres ferviles , au lieu
qu’il n’étoit tenu a rien envers lui pour raifon des
fimples devoirs, obfequia.
Il ne dépendoit pas toujours du patron de charger
d’oeuvres ferviles celui qu’il affranchiffoit, notamment
quand il étoit chargé d’affranchir l’efclave, ou
qu’il recevoit le prix de là liberté, ou lorfque le patron
avoit acheté l’efclave des propres deniers de
celui-ci.
Le patron qui fouffroit que fon affranchie fe mariât,
perdoit dès ce moment les fervices dont elle étoit
tenue envers lu i, parce qu’étant mariée elle les devoit
à fon m ari, fans préjudice néanmoins des autres
droits du patronage.
Celui qui celoit un affranchi étoit tenu de faite 1a
fervice en la place.
C’étoit aufli un devoir de l’affranchi de nourrir le
patron lorf qu’il tomboit dans l’indigence, 6c réciproquement
le patron étoit tenu de nourrir l’affranchi
lorfqu’il fe trouvoit dans le même cas , autrement
il perdoit le droit de patronage.
Le patron avoit droit de' firccéder à fon affranchi
lorfque celui-ci lâiffoit plus de cent écus d’or ; il avoit
meme l’aûion calviflenne pour faire révoquer les
ventes qui auroient été faites en fraude de fon droit
de fiiccéder.
Le droit de patronage s’éteignoit lorfque le patron
avoit refiifé des àlimens à fon affranchi , oulorfqu’il
avoit remis l’affranchi dans la fervitude pour caufe'
d’ingratitude, ou enfin lorfque le prince accordoit à
l’affranchi leprivilege de l’ingénuité, ce qui ne fefaifoit
que du confentement du patron : cette conceflïon d’in*
genuité s’appelloit reflitutio natalium ; quelquefois on
accordoit feulement a l’affranchi le droit de porter un
anneau d’or , jus aureorum annulorum , ce qui n’eni-
péchoit pas le patronage de ftibfifter.
Mais dans la fuite cela tomba en non-ufage ; tous
les affranchis furent appellés ingenui, fauf lè droit de
patronage.
Le patronage fe perdoit encore lorfque le fils ne'
vengeoit pas la mort de fon pere, l’efclave qui décou-
vroit les meurtriers avoit pour récompenfe la liberté»
La loi alia fentia privoit aufli du patronage celui qui
exigeoit par ferment de fon affranchi qu’il ne fe mariât
point.
Enfin le patronage fe perdoit lorfque le patron corn
vertiffoit en argent lés fervices qu’on lui devoit rendre
, ne pouvant recevoir le prix des fervices à venir,
finon en cas de néceflité 6c à titre d’alimens. Voye£ au
ff. & au code les titres de juré patronatus , 6c au ff.
le tit. de operis libertorum, &C.
En France oîi il n’y a plus d’efclave, il n’y a plus
de patronage.
Dans les îles de l’Arnérique oïl il y a des efclaves ,
les maîtres peuvent les affranchir ; 6c l’édit du mois
de Mars 1685 , appelle communément le code rioir9
ordonne à ces affranchis de porter un fingulier ref-
pect à leurs anciens maîtres, à leurs veuves & à leurs
ènfans ; en forte que l’injure qu’ils auront faite foit
punie plus grièvement que fi elle étoit faite à Une autre
perfonne : du refte, l’édit les déclare francs 6t
quittes envers eux de toutes autres charges, fervicei
P A T
6c drôits utiles que leurs anciens maîtres Vôudroient
prétendre, tant lur leurs perfonnes que fur leurs biens,
•en qualité de patrons ; 6c l’édit accorde à ces affranchis
les memes privilèges qu’aux perfonnes nées libres.
{ A )
Pa tro n , en matière bénéficiait, eft celui qui a
bâti, fondé ou doté une églife, en confidération de
quoi il a ordinairement fur cette églife, un droit honorifique
qu’on appelle patronage.
Pour acquérir les droits de patronage par la conf-
tru&ion d’une églife , il faut l’avoir achevée ; autrement
celui qui l’auroit finie en feroit le patron.
On entend quelquefois par fondateur d’une églife,
celui qui l’a bâtie oc dotée, quelquefois aufli celui
qu.i l’a dotée Amplement.
Celui qui dote une églife, dont le revenu étoit
auparavant très - modique , acquiert aufli par ce
moyen le droit de patronage pour lui 6c pour fes hé*
ritiers.
Mais tout bienfaiteur d’une églife n’eft pas réputé
patron ; il faut que le bienfait foit t e l , qu’il forme la
principale dot d’une eglife.
Pour être réputé patron, il ne fuffit pas d’avoil*
donné le fonds ou fol fur lequel l’églife eft bâtie , il
faut encore l’avoir dotée.
Néanmoins, fi trois perfonnes concourent à la fon*
dation d’une églife, que l’un donne le f o l , l’autre y
fafl'e conftruire une. églife , 6c le troâfieme la dote, ils
jouiront'tous trois foüdairement du droit de patronage
; mais celui qui a doté i’égiife a le rang 6c la
preféance fur les autres.
Il peut encore arriver autrement qu’il y ait plu*
fseurs co-patrons d’une meme eglife ; lavoir lorfque
plufieurs perfonnes ont fuccédé à un fondateur-.
Le droit de patronage peut aufli s’acquérir par con*
cefïion, de forte que fi l’évêque diocéfàin ouïe pape
accordoit par privilège, à un particulier le droit de
patronage fur une églife, cette conceflion feroit valable
, pourvu qu’elle eût une caufe légitime , 6c
qu’on y eût obfervé toutes les formalités néceffaires
pour l’aliénation des biens d’églife.
Un patron peut aufli céder f on droit, foit à fon co-
patron-, ou à une autre perfonne , ou à une commu*
nauté. \
Mais il ne peut pas céder fon droit de préfentation
pour une fois feulement ; il peut feulement donner
procuration à quelqu’un pour préfenter en fon nom*
Le droit de patronage s’acquiert de plein droit
par la conftruétion, dotation ou fondation de l’églife
, à moins, que le fondateur ou dotateur n’ait ex-
preflement renoncé à ce droit ; il eft cependant plus
sûr de le ftipuler dans le contrat de fondation , afin
que l^s patrons 6c leurs héritiers puiffent en faire
plus jaifément la preuve en cas de conteftation ; il
eft même abfolument néeeffaire en Normandie de le
ftipuler ,-fuivant l ’art. 142. de la coutume de cette
province.
Si celui qui a bâti, fondé ou doté une églife n’a
jamais, ufé du droit de patronage, ni fes héritiers
ou autres fuccefleurs après lu i, 6c que la fondation
foit ancienne, on prémme qu’ils ont renoncé à ce
droit ; néanmoins dans le doute, le droit de celui qui
a bâti, fondé ou doté eft favorable.
Lorfque, l ’églife eft abfolument détruite , ou que
la dot eft entièrement diflîpée 6c perdue , celui qui
fait reconftruire l’églife , ou qui la dote de nouveau,
du confentement de l’évêque diocéfàin, y acquiert
un droit de patronage., au cas que les anciens fondateurs
ou dotateurs auxquels appartenoit le patro-
nage,ne veuillent pas faire la dépenfe pour la rebâtir
ou pour la doter une fécondé fois.
' ^ n^'fnnement , lorfqu’un droit de patronage étoit
contefte entre deux feigneurs laïcs ou eccléfiaftiques,
oc que les titres ni les autres preuves n’offroient
P A T
rien de clair > on avoit recours ali jugement de Dicll*
de meme que cela fe pratiquoit dans toutes fortes
d’autres matières làcrées ou profanes. L ’évêque de
Paris 6c l’abbe de S. Denis fe difputant le patronage
lur un monaftere > 6c Pépin le Bref ayant trouvé la
queftion fort ambiguë, les renvoya à un jugement
de Dieu par la croix. L’évêque 6c l’abbé nommèrent
chacun un homme de leur part ; ces hommes allèrent
dans la chapelle du palais, oû ils étendirent leurs bras
en croix : le peuple attentif à l’événement partait
tantôt pouiT’u n , tantôt pour l’autre; enfin l’hômmû
de l’évêque fe laffa le premier, baiffa les bras, 6c lui
fit perdre fon procès. C ’eft ainfi que l’on décidoit
alors la plûpart des queftions.
^ Le droit patronage eft laïc , eccléfiaftique oit
mixte.
Le patronage laïc eft réel ou perfonnel. Voye^ ci*
apres P a t r o n a g e .
Tout droit de patronage, foit laïc ou eccléfiaftique,
eft indivifible ; il ne fe partage point entre plufieurS
co-patrons, ni entre les héritiers & autres fuccefleurs
d’un patron laïc ; ainfi ceux qui ont droit au ■ patro-j
nage ne peuvent pas préfenter chacun à une partie de
bénéfice ; ils doivent préfenter tous enfemble, ou alternativement
: s’ils nomment tous enfemble,celui qui
a le plus de voix eft préféré , bien entendu que fi ce
font des co-héritiers qui nomment, les voix le comptent
par louches 6c non par têtes.
Les co-patrons peuvent convenir qu’ils préfente-
teront alternativement, ou que chacun préfentera
feul aux bénéfices qui vaqueront dans certains mois.
Le patronage réel fuit la glebe à laquelle il eft attaché
; de forte que fi cette glebe eft un propre * il ap*
partient à l’héritier des propres ; fi la terre eft un acquêt
, le droit paffe avec la terre à l’héritier des acquêts.
Si la terre eft partagée entre plufieurs héritiers , il
fe fait aufli une elpece de partage du patronage, c’eft-
à-dire, qu’ils n’y ont droit chacun qu’à proportion de
ce qu’ils ont dans la terre ; par exemple, celui qui en
a les deux tiers nomme deux fois , tandis que l’autre
ne nomme qu’une fois.-
Cette efpece de divifion de l’exercice du droit dé
patronage lè fait par fouches& non par têtes.
Il y a des coutumes , comme Tours 6c Lodlinois,
oîi l’aine mâle a feul par préciput tout le patronage,
quoiqu'il n’ait pas tout le fief; ce font des exceptions
à la réglé générale.
Quand les mâles excluent les femelles en collatérale
, celles-ci n’ont aucun droit au patronage réel.
Mais fi le patronage eft attaché à la famille , il fuf*
fit pour y participer d’être du même degré que les
plus proches parens, & l’on ne perd pas ce droit quoi*
qu’on irenonce à la fuccefliort.
Quelquefois le patronage eft affeélé à l’aîné de la
famille , quelquefois au plus proche parent, auquel
cas l’aîné n’a pas plus de droit que les puînés ; tout
cela dépendues termes de la fondation.
Le pere préfente à tous les bénéfices dont le patronage
, foit réel ou perfonnel appartient à fon fils ,
tant que celui-ci eft fous fa puiffance.
Il en eft de même du gardien à l’égard du droit de
patronage appartenant à fon mineur , parce que ce
droit fait partie des fruits, lefquels appartiennent au
gardien; de forte que s’il s’agifîoit dii patronage réel
attaché à un héritage roturier dont il n’auroit pas la
jouiffance, comme cela fe voit dans quelques coutumes
oii le gardien ne jouit que des fiefs, il ne jouiroit
pas non plus du droit de patronage attaché à une roture.
L’ufufruitier, la douairière, le preneur à rente ou
à bail emphitéotique jouiffent pareillement du droit
de patronage attaché à la glebe dont ils font pofîef-
feurs : le mari préfente aum au bénéfice qui eft tenu