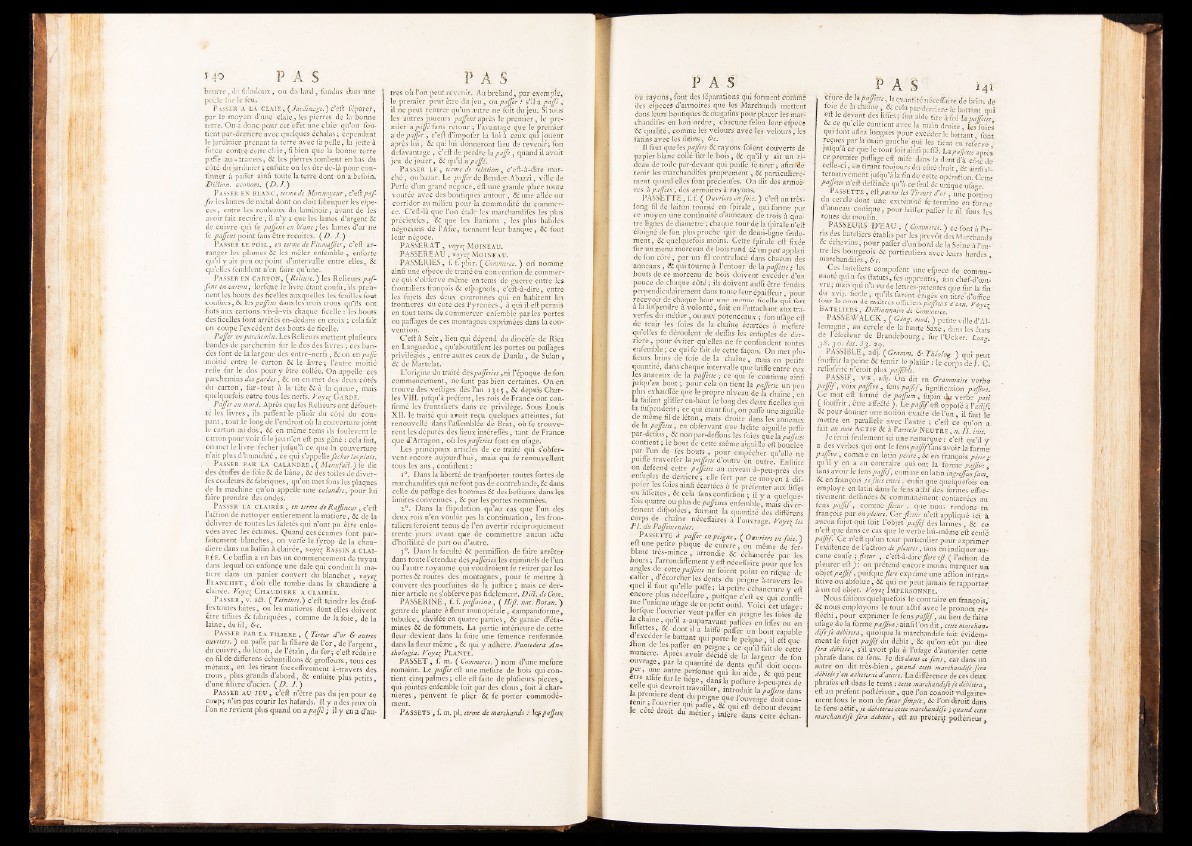
beurre, du {'?.indoux, ou du lard, fondus dans une
poêle fur le feu.
Passer a la c l a ie , ( Jardinage.) c’ eft fcparef,
par le moyen d’une claiep les pierres de la bonne
terre. On a donc pour cet effet ime claie qu’on foiu
tient par-derriere avec quelques échalas ; cependant
le jardinier prenant fa terre avec fa pelle, la jette à
force contre cette claie, fi bien que la bonne terre
paffe au - travers, & les pierres tombent en bas du
côté du jardinier ; enfuite on les ôte de-là pour continuer
à paffer ainfi toute la terre dont on a befoin.
Diction, ccconom. {D .J .)
PASSER EN blan c, terme de Monnoytur, c’effp a f
fer les lames de métal dont on doit fabriquer les elpe-
ces, entré les'rouleaux du laminoir, avant de les
avoir fait recuire ; il n’y a que les lames d’argent &
de cuivre qui fe pafent en blanc ; les lames d’or ne
fe pajfent point fans être recuites. {D . J. )
Passer le poil , en terme de P Initia (f e r , c’eft arranger
les plumes & les mêler enfemble , enforte
qu’il y ait peu ou point d’intervalle entre elles, &
qu’elles femblcnt n’en foire qu’une.
Passer en carton, ( Reliure. ) les Relieurs paf-
fent en carton, lorfque le livre étant coufu , ils prennent
les bouts des ficelles auxquelles les feuilles font
coufues, & lespafent dans les trois trous qu’ils ont
faits aux cartons vis-à-vis chaque ficelle : les bouts
des ficelles font arrêtés en-dedans en croix ; cela fait
on coupe l’excédent des bouts de ficelle.
Pajfer enparchemin. Les Relieurs mettent plufieurs
bandes de parchemin fur le dos des livres ; ces bandes
font de la largeur des entre-nerfs , & on enpajfe
moitié entre le carton & le livre; l’autre moitié
refte fur le dos pour y être collée. On appelle ces
parchemins des gardes, & on en met des deux côtés
du carton, fur-tout à la tâte &c à la queue, mais
quelquefois entre tous les nerfs. Foye^ Garde.
Pajfer en mord. Après que les Relieurs ont défouetté
les livres, ils paffent le plioir du côté du coupant
, tout le long de l’endroit oii la couverture joint
le carton au dos, & en même tems ils foulevent le
carton pour voir fi le jeu n’en efl pas gêné : cela fait,
on met le livre fecher jufqu’à ce que la couverture
n’ait plus d’humidité, ce qui s’appelle fecher les plats.
Passer par la calandre , ( Manufacl. ) fe dit
des étoffes de foie & de laine, &c des toiles de diver-
fes couleurs &c fabriques, qu’on met fous les plaques
de la machine qü’on appelle une calandre, pour lui
foire prendre des ondes.
Passer la c l a ir é e , en terme de Rafntur, c’eft
1’acKon de nettoyer entièrement la matière, & de la
délivrer de toutes les faletés qui n’ont pu être enlevées
avec les écumes. Quand ces écumes font parfaitement
blanches, on verfe le fyrop de la chaudière
dans un baflin à clairée, voye^ Bassin a clairée.
Ce baflin a en bas un commencement de tuyau
dans lequel on enfonce une dale qui conduit la matière
dans un panier couvert du blanchet, voye^
Blanchet , d’où elle tombe dans la chaudière à
clairée. Foye{ CHAUDIERE A clairée.
Passer, V. a£t. {Teinture.) c’eft teindre les étoffes
toutes faites, ou les matières dont elles doivent
être tiflùes & fabriquées, comme de la foie, de la
laine', du fil, &c.
Passer par la filiere , ( Tireur d'or & autres
ouvriers. ) on pafle par la filiere de l’o r , de l’argent,
du cuivre, du léton, de l’étain, du fer; c’eft réduire’
en fil de differens échantillons & grofleurs, tous ces
métaux, en les tirant fucceflivement à-travers des
trous, plus grands d’abord, & enfuite plus petits
d’une filiere d’acier. ( D. J. )
Passer au jeu , c’eft n’être pas du jeu pour ce
coup; n’en pas courir les hafards, Il y a des jeux où
l’on ne revient plus quand on a pafé ; il y en a d’autrès
où l’on peut revenir. Au breland,lé premier peut être du jeu, ou par exemple,-- pajfer ? s’il a pajfé $ ilel sn ea upteruest rjoenuetruerrs qu’un autre ne foit du jeu. Si tous mier a paJJ'ent après le premier, le preà
de p d f élans retour ; l’avantage que le premier- aprèsp alujfie, r, c’eft d’impofer la foi à ceux qui jouent defavantaged e, qcu’ei fltu di ed poenrnderreo lnat lieu de revenir; fort jeu dejouer, & qu’il a pajfe , quand il avoit pajfé.
chéP ,a sosue Bra zlaer., Ltee rme de relation, c’eft-à^dire marPerfe
d’un grand népgaojfcere ,d eef Bt uenned egrr-aAnbdaez pzïl,a cvei'ltloeu dtee vcooûrrtiédeo ra vaeuc m dielsie buo puotiuqru elas caoumtomuro d, idtét udnue caolmléme oeru
pceré. cCie’euffte-lsà, qduee ql’uoen léetsa leB alensi amnsa r,c hlaens dpifleuss lhesa bpilluess lneéugro cniéagnosc ed.e l’Afie, tiennent leur banque, de font PASSER AT, voye{ Moineau. PASSEREAU, voye{ Mo ineau . ainPfiA uSnSe EeRfpIeEcSe, dfe. tf.r apiltuér o. u( Ccoomnvmeenrctieo. n) doen c onmommmeen fcreo nqtuail ise’rosb ffrearnvçeo ims êdme ee fpenag tnemolss , dce’ egftu-eàr-rdei reen, treen tlreés, lferos nftuièjertess ddeus cdôetué xd ecso Puyrorénnnéeess q, uài qeuni hila ebfitt epnert mleiss oenu ptaofulat gteems sd ed ece cso mmomnteargcneer se enxfpemrimbléee ps adra lness lpao crotens
venCt’ieofnt .à Seix, lieu qui dépend du' diocèfe de Riez penri vLialénggiuéesd, oecn,t rqeu a’aubtroeust icfeleunxt dlees Dpoarntelas ,o due p aSfuflaagne s, de Ld’eo rMigairntee ldâut. traité descommencement, ne fontp apjafse rbieies,n ci el’rétapionqeuse. - Oden f oenn lteros uVvIeII d. ejus fvqeuf’àti gpersé fdeènst ,l ’alens r1o3i1s 5d ,e Fder adnecpeu oisn Ct choanrfXirImI.
él el etsr afirtoén qtaulii earvs odita nrse çcue qpureivlqiluèegse .a t-tSeoiunst eLso, ufuist rreennot ulevse dlléép udtaénss dl’easf fleiemubxl éine tédree fBleras,t , taonùtf ed et rForuavnec^e quLe eds’ Aprrrinagciopna,u xo ùa lretisc pleasjf edriee sc feo ntrta eitné uqfaugi es.’obfer- vtoeunst leensc aonres , acuojnofuifrtde’nhtu :i, mais qui fe renouvellent mair°c.h aDnadnifse lsa q luibi enreté f odnet tpraans fdpeo crotenrt rteobuatneds ef,o rtes de celle du paflage des hommes & des beftiaux ddaen dsa lness lim2i0te. s Dcoannvse lnau efsti p, udlea tpioarn leqsu p’aourt ecsa ns oqmume éle’us.n dés tdaeliuexr sr ofeisr oni’eennt vteonuulûs td pea ls’e lna acvoenrttiinru raétciiopnr,o qleuse mfroennt
tdr’ehnotfeti ljiotéu rdse apvaarnt to uq ude’a udter e.commettre aucun aefe dan3s0 .t oDutaen ls’ élate fnadcuuelt éd edse p apjefermrieisf llieosn cdriem fionierles adrer êl’tuenr poour lt’easu tre royaume qui voudroient fe retirer par les couverdt ed reosu pteosu rdfueist ems odnet algan jeusf,t ipceo u; rm faei sm ceet trdee rà
nier article ne s’obferve pas fidèlement. Dicl. de Corn. PASSERINE, f. f. pajfarina, f Hiß. nat. Botan. ) tguebnurelé dee, pdliavnitfeé eà e fnle quur amtroen poaprétiteasl e-, , &ca gmaprnainei fodr’émtae,
fmleinuer sd deev ideen tf odmanms eltas . fuLiate puanrtei ef eimnteénriceeu rree ndfee rcmetétee dans la fleur même , & qui y adhéré. Pontedera A n-
thologia. Voye^ Plante. romPaAinSeS.E LTe, pfa. fmfet. e(f tC oumnme emrceef.u )r en odme bdo’uisn eq umi ecfounre
tqiueni tj ociinntqes p aelnmfeems b; lee lfleo ietf tp faari tdee sd ec lpoluufsi,e fuorist pài èccheasr ,
nmièenret.s , peuvent fe plier & fe porter commode-* PA5SETS , f. m. pl, terme de marchands : 1^ Paf t s .
$'ü ràÿôhs ; îbftt des fépâràtionè qui forihêhf ôômfàê
des elpeces d’armoires que les Marchands mettent
dans leurs boutiques &niagafinSpour placer les marchandifes
en bon ordre, chacune félon leur éfpëce
'& qualité, cortrme les velours âvëc‘les velours ^ les'
Patins avec les fotins -, &c. ;
Il faut que les pajfees & rayons 'foiënt couverts de
papier blanc collé fur le bois * & qu’il y ait Un riu
deau de toile par-devant qui-puifle fë tirer ; afin R etenir
les marchandifes proprement, de particulière^
ment quand elles font précieufes. On dit des armoic
res à paffets , des armoires à rayons-.
PASSETTE, f. f. ( Ouvriers en foie. ) c’eft un très4
long- fil de laiton tourné en fpirale, qui forme par
ce moyen une continuité d’ârtheaux de trois à quatre
lignes de diamètre ; chaque tour de la fpirale n’eft
éloigné de fon plus proche qtié' de demi-ligne feulement,
& quelquefois moins. Cette fpirale eft fixée
fur un menu morceau de bois rond de un peu applati
de fon côté , par un fil contrèlaeé dans chacun des
anneaux, 8c qui tourne à l’entour de la pajfette; les
bouts de cè morceau de bois doivent excéder d’un
pouce de chaque côté ; ils doivent aufli être Pendus
perpendiculairement dans toute leur épaifleur, pour
recevoit de chaque bout une menue ficelle qui fert
à la fufpendre à volonté, foit en l’attachant aux tra-
verfes du métier, ou aux potenceaux ; fon ufâge eft
de tenir les foies de la chaîne écartées à mefiire
qu’elles fe déroulent de defliis les ènfiiples de derrière
3 pour éviter qu’elles ne fe confondent toutes
enfemble; ce quife fait de cette façon. On met plu'-
fieursbrins de foie de la chaîne, mais en petite
quantité, dans chaque intervalle que laifle entre étalés
anneaux de la p a f et te ; ce qui fe continue ainfi
jufqu’au bout ; pour cela on tient la pajfette un peu
plus exhauflee que le propre niveau de la chaîne, en
la faifant gliflèr en-haut le long des deux ficelles qui
la fufpendent ; ce qui étant fait, on pafle une aiguille ;
<je meme fil de leton, mais droite dans les anneaux !
de la pajfette, en obfervant que ladite aiguille pafle
par-defliis, & non par-deflbus les foies que la pajjette
contient ; le bout de cette même aiguille eft'bouclée
par l’un de fes bouts , pour empêcher qu’elle ne
puifle traverfer la pajfette d’outre en outre. Enfuite
on defeend cette pajfette au niveau à-peu-près des
enfuples de derrière ; elle fert par ce moyen à dif-
poler les foies ainfi écartées à fe préfenter aux liftes
ou hflettes, & cela fans confùfion ; il y a quelquefois
quatre ou plus Ae p a f eues enfemble, mais diversement
difpofees, fuivant la quantité des differens
corps de chaîne néceffaires à l’ouvraoe. Foyer les
P l. du Pafemehtier. . 0 y .
PASSETTE à pàjfer>enptignt,\Ouvriers cri foie.)
eftune petite plàqtfe de cuivre même ëe fer-
blanc tres-mmoe, arrondie! Ç& échàncrée par les
bouts ; 1 a rron d ifWn t néceffaite pour que 1&
angles id e e e tte^ / roe ne.foien* point en rifque 'de
ealler d eeorcher les dents du peigne M W
quel il faut qu’elle paffe; la petite écnancrure y cil
encore plus neceffairé puifquè c’ eft Ce qui Confti-
tue laruque ufage de ce petit outil. Voici Cet ufage :
lorlque louvner veut paffer en peigne les foies de
e ’aq j 3'MUparavant Paffées H H en
i H i 40nt U Iai® Paffet un bout capable
wS Ü M i l le ba«ant qui porte le peigne , il eft que-
Aion de .es paffer en peigne; ce qu’il fait-dé cette
■ i Après-avoir décidé de la largeur de fon
8e . Par la quantité de dents qu’il doit occu-
Bl— ■ qui lui M È & qui peut
H H I H H à-peirprès de
introduit la paffehe dans tenir - IflM H t t du peigne.-cue l’ouvriïge -doit coulJee
ccoôttée ddrrooîftf^ dduu 1m11 étier, inféré dands ecbeotutet déeevhaanntiHaSSil
BWBHI dé WÊÊL
to c de la-diaim- & cch, inir-derrii-re le battant qui
eft le devant des hffes; fon aide tire à foi
& ce qu elle contient avècla main droite lesfoieé
qui font allez longues pour éxcéder le batmnt font
reçues parla main gauche qui les tient én refèfve '
JlliqU à ce que le tout fôît ainfi pafle. LapaÏÏeeec après
ce premier puffage eft mile dans la dent d’à côté dé"
célle-ci, en tirant toujours dti côté dfdit, fe àiiifi alu
ternatiy ement jufqu’à la fin de cette opération. Cette
pajeete n elt delbnée qu’à.ce feul & unia:ue'iifàge.
- f A'SSÉTÇE-,. eûfiarfrii les-Tiïairi fo r ‘uhe portion
-üù cercle dont1 une esrlréuiité le termine en -forme
d anneau conique, pour laiffer paffer le fil fous les
roues du moulin.
. i’ -ASSKl-iiï.S i) ‘HAl.‘ i ( CoUrPcrce. ) ce font à Pn-
risto«itéliérS; établis par les prévôt des Marchands
& echeviàa; pour paffer d’uttbôfd de la Seine à l’aù-'
tre lés 'bquï-gèôis &• partieuiièrs aVeé leurs hardes ■
Warchandifés p fe . ;
Ç » r i - ?w ers çompofent line efpecé ’de' commiie-
rtaute qui a fes’ ftatuts, fes appfefitis; fon '.diéf-a’oé'u-!
vre ; mais qm n’a eu de lettres-patentes que fur la fin ’
du XVI). ilecle , -qu’ils furent érigés en titrVd’officé
lOUs le Hdm'de maîtres Officierspceÿeürs d'eau.
Bate-è-iers ; DmérmHré fle éonèniereei - v «-
PASSE WALCK t ( Géog-, moi. ) petite ville d’AlClema^
né, au oercle de lahâute-Sàîie; dahslltSiétafs1 -
- de-’ l’éfeSeur- « e -Brandç|tiûrg-} fu r ‘l’Ucker. Long-.'
f * " n m . • I B
, P^SSi-BEE ; - adp f Greimiti: & Tfeàïog. yeixù peut
i loultrir la peine fe fentir'dé-pMlir: le corps de i. Ci
reffufeité n’étoit plus pciffibte. -
PASSIF, - VE ,-adji ©if dit en Grammaire verbe
poffit. vorxpajjive^ l'cns paflif, lignification paQlve:
Ce mot eft formé de poffum, lupin du verbe" pmli
(Iquffrir etre affefte ). C e / ..# / eft oppoicà l’Æ
Se pour donner une notion exatte de l’un • il fout fo-
mettre en ’paray&?avec’’l’autre ; c’eft'«ë 'ditioTi a,
fait du mot Ac t if & à Y article N EU TRE, n. I I . inii. -
Je ferai feulement ici une remarque : c’eft qu’il y
a des verbes qui ont le lem p a fif tans avoir la forme
paffve , comme en latin perire, & en françois périr;'
qu’il y en a au contraire qui ont la- forme paffve*'
fons avoir \e ien spajff comme en latin ingrefus fum9
& en françois je fuis entré enfin que quelquefois on-
employé en-latin dans le fens actif des formes effec-:
tivement dèftinées & communément conlàcréës àu’
feris p a f i f , comme fietur , que nous rendons en
françois par on pleure. Car feiitr n’eft appliqué ici à
aucun fujet qui foit l’objet 'pa fff des larmes , & ce
n’eft que dans ce cas que le vërbe lui-même eft eenfé
Paf f Ce n eft qu un tour particulier pour exprimer
l’exiftenee de1 l’attion de pleurer, fons en indiquer aucune
caufe fietur , c ’eft-à-dire ƒ ere e f i f l’aaion de
pleurer eft ) : on prétend encore moins marquer un
objet p a f if , pùifque fine exprime une aftion intran-
fitive ou abfolùe, & qui ne peut jamais fe rapporter'
à un tel objet. Foye^ Impersonnel.
Nous foifons quelquefois le contraire en françois '
& nous employons le tour aftif avec le pronom ré*
fléchi, pour exprimer le fens p a f if , au lieu de foire'
ufage de la forme pafve : ainfi l’on dit, cette marckan-
difefe débitera, quoique la marehandife foit évidem-*
ment lefujet p a f f du débit , & qu’on eût pu dire
fera débitée, s’il avoit plu à l’üfage d’autorifer cette
phrafe dans ce fens. Je dûs dans ce fens , car dans un
autre ort dit très-bien, quand cette marehandife fera
débitée j en achèterai d'autre. La différence de ces deux
phrafes eft dans lë tems : cette marehandife fe débitera,
eft au préfent poftérieur, que l’on connoît:vulgaire^
m ent fous le nom de futur Jimple, de l ’on dir oit dans
le fens aéhf, je débiterai cette marehandife ; -quand cette
marehandife fera débitée, eft au prétérit poftérieur ,