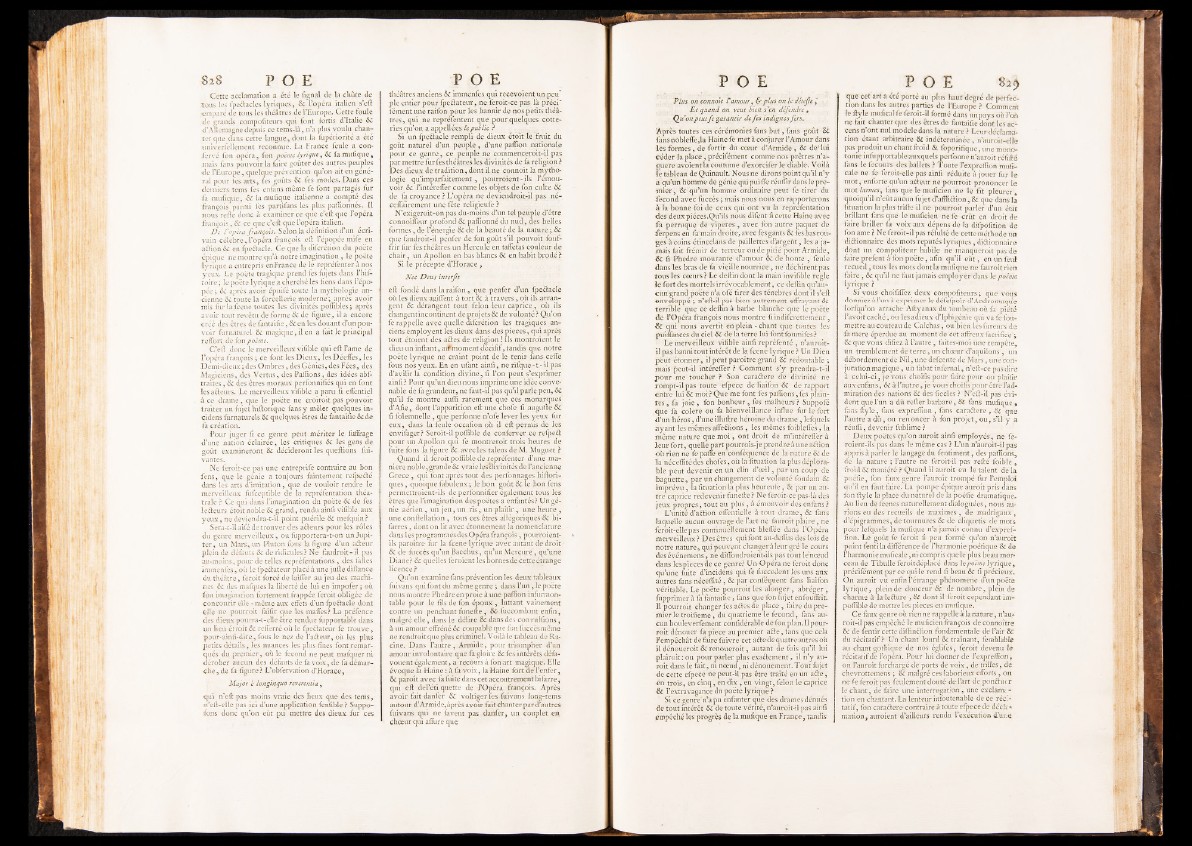
Cette acclamation a été le lignai de la chute de
tous les fpettacles lyriques, 6c l’opéra italien s’eft
•emparé de tous les théâtres de l’Europe. Cette foule
de grands compofiteurs qui font lortis d’Italie 6c
d’Allemagne depuis ce tems-là, n’a plus voulu chanter
que dans cette langue, dont la luperiorite a ete
univerfellement reconnue. La France feule a con-
iervé fon opéra, fon poème, lyrique, & fa mufxque,
mais fans pouvoir la faire goûter des autres peuples
de l’Europe, quelque prévention qu’on ait en general
pour les arts, fes goûts 6c fes modes. Dans ces
derniers tems fes enfans même fe font partages fur
fa mufique, 6c la mufique italienne a compté des
François parmi fes partifans les plus paflionnes. Il
nous relie donc à examiner ce que c?eft que l’opéra
François, 6c ce que c’eft que l’opéra italien.
De l'opéra françois. Selon la définition d’un écrivain
célébré, l’opéra françois eft l’épopée mife en
-attion 6c en fpeûacle. Ce que la diferetion du poëte
épique ne montre qu’à notre imagination , le poëte
lyrique a entrepris enFrance de le repréfenter à nos
yeux. Le poëte tragique prend fes fujets dans l’hif-
toire ; le poëte lyrique a cherché les fiens dans l’épopée
; 6c après avoir épuifé toute la mythologie ancienne
6c toute la forcellerie moderne ; après avoir
mis fur la feene toutes les divinités poflibles; après
avoir tout revêtu de forme 6c de figure, il a encore
•créé des êtres de fantaifie, &: en les douant d’un pouvoir
furnaturel 6c magique, il en a fait le principal
refi'ort de fon poème.
C ’eft donc le merveilleux vifible qui eft l’ame de
l ’opéra françois ; ce font les D ieux, les Déefles, les
Demi-dieux ; des Ombres, des Génies, des Fées, des,
Magiciens, des Vertus, des Pallions, des idées abf-
traites, 6c des êtres moraux perfonnifiés qui en font
les aéteurs. Le merveilleux vifible a paru fi efientiel
à ce drame , que le poëte ne croiroit pas pouvoir
traiter un fujet hiftorique fans y mêler quelques in-
cidens furnaturels 6c quelques etres de fantaifie 6c de
fa création.
Pour juger fi ce genre peut mériter le fuffrage
d’une nation éclairée, les critiques 6c les gens de
goût examineront 6c décideront les queftions fui-
vantes.
Ne feroit-ce pas une entreprife contraire au bon
fens, que le génie a toujours faintement refpe&é
dans les arts d’imitation, que de vouloir rendre le
merveilleux fufceptible de la repréfentation théâtrale
? Ce qui dans l’imagination du poëte & de fes
le&eurs étoit noble & grand, rendu ainfi vifible aux
y e u x , ne deviendra-t-il point puérile 6c mefquin ?
Sera-t-il aifé de trouver des a&eurs pour les rôles
du genre merveilleux, ou fupportera-t-on un Jupiter
, un Mars, un Pluton fous la figure d’un afteur
plein de défauts 6c de ridicules? Ne faudroit-il pas
au-moins, pour de telles repréfentations , des falles
immenfes, où le fpeftateur placé à une jufte diftance
du théâtre, feroit forcé de laiffer au jeu des machines
6c des mafques la liberté de lui en impofer ; où
fon imagination fortement frappée feroit obligée de
concourir elle - même aux effets d’un fpeêtacle dont
elle ne pourroit faifir que les mafies ? La préfence
des dieux pourra-t-elle être rendue fupportable dans
un lieu étroit 6c refferré où le fpeélateur fe trouve,
pour-ainfi-dire, fous le nez de l’aéteur, où les plus
petits détails, les nuances les plus fines font remarqués
du premier, où le fécond ne peut mafquer ni
dérober aucun des défauts de fa voix, de fa démarche
, de fa figure ? L’obfervation d’Horace,
Major è longinquo reverentia,
qui n’ eft pas moins vraie des lieux que des tems,
n’eft-elle pas ici d’une application fenfible ? Suppo-
fons donc qu’on eût pu mettre des dieux fur ces
théâtres anciens 6c immenfes qui recevoient un peu'
pie entier pour fpeûateur, ne feroit-ce pas là préci"
fément une raifon pour les bannir de nos.petits théâtres,
qui ne repréfentent que pour quelques cotte-
ries qu’on a appellées le public ?
Si un fpe&açle rempli de dieux étoit le fruit, du
goût naturel d’un peuple , d’une paflion nationale
pour ce genre , ce peuple ne commenceroit-il pas
par mettre fur fes théâtres les divinités de fa religion?
Des dieux de tradition, dont il ne connoit la mythologie
qu’imparfaitement , pourroient - ils l’emou-
voir 6c l’interefler comme les objets de fon culte &
de fa croyance ? L’opéra ne deviendroit-il pas né-
ceflairement une fête religieufe ?
N’exigeroit-on pas du-moins d’un tel peuple d’être
connoifleur profond 6c paflionné du nud, des belles
formes, de l’énergie 6c de la beauté de la nature ; 6c
que faudroit-il penfer de fon goût s’il pouvoit fouf-
frir fur fes théâtres un Hercule en taffetas couleur de
chair, un Apollon en bas blancs 6c en habit brodé?
Si le précepte d’Horace ,
Nec Deus interjit
eft fondé dans la raifon, que penfer d’un fpeâacle
où les dieux agiffent à tort 6c à travers, où ils arrangent
6c dérangent tout félon leur caprice, où ils
changent incontinent de projets 6c de volonté ? Qu’on
fe rappelle avec quelle diferétion les tragiques anciens
employent les dieux dans des pièces, qui aprè$
tout étoient des aftes de religion ! Ils montroient le
dieu un inftant, aifhnoment décifif, tandis que notre
poëte lyrique ne craint point de le tenir lans celle
fous nos yeux. En en ufant ainfi, ne rifque-t- il pas
d’avilir la condition divine, fi l’on peut s’exprimer
ainfi? Pour qu’un dieu nous imprime une idée convenable
de fa grandeur, ne faut-il pas qu’il parle peu, 6c
qu’il fe montre auffi rarement que ces monarques
d’Afie, dont l’apparition eft une chofe fi augufte 6c
fi folemnelle, que perfonne n’ofe lever les yeux fur
eux, dans la feule occafion où il eft permis de le$
envifager? Seroit-il poflible de conferver ce refpeéfc
pour un Apollon qui fe montreroit trois heures de
fuite fous la figure 6c avec les talens de M. Muguet ?
Quand il feroit poflible de repréfenter d’une maniéré
noble, grande 6c vraie les divinités de l’ancienne
Grece , qui font après tout des perfonnages hiftori-
ques, quoique fabuleux ; le bon goût 6c le bon fens
permettroient-ils de perfonnifier également tous les
êtres que l’imagination des poëtes a enfantés ? Un génie
aérien, un jeu, un.ris, un plaifir, une Heure ,
une conftellation , tous ces êtres allégoriques 6c bi-
farres, dont on lit avec étonnement la nomenclature
dans les programmes des Opéra françois, pourroient-
ils paroître fur la l'cene lyrique avec autant dé droit
6c de fuccès qu’un Bacchus, qu’un Mercure, qu’une
Diane? 6c quelles feroient les bornes de cette étrange
licence ?
Qu’on examine fans prévention les deux tableaux
fuivans qui font du même genre ; dans l’un, le poëte
nous montre Phedre en proie à une paflion infurmon-
table pour le fils de fon époux , luttant vainement
contre un penchant fùnefte , 6c fuccombant enfin,
malgré elle, dans le délire &C dans des convulfions,
à un amour effréné 6c coupable que fon fuccès même
ne rendroitque plus criminel. Voilà le tableau de Racine.
Dans l’autre, Armide, pour triompher d’un
amour involontaire que fa gloire 6c fes intérêts défa-
vouent également, a recours à fon art magique. Elle
évoque la Haine : à fa voix, la Haine fort de l’enfer,
6c paroît avec fa fuite dans cet accoutrement bifarre,
qui eft del’éti quette de l’Opéra françois. Après
avoir fait danfer 6c voltiger fes fuivans long-tems
autour d’Armide, àprès avoir fait chanter par d’autres
fuivans qui ne favent pas danfer, un couplet en
choeur qui aflùre que
Plus on connoit l'amour, & plus on ledétejh
E t quand, on veut bien, s'en défendre y
Qu on peut fe gatantir de fes indignes fers.
'Après toutes ces cérémonies fans but, fans goût 6c
fans uobleflè,la Haine fë met à conjurer l’Amour dans
•les formes, de fortir du coeur d’Armide , 6c de1 lui
céder la placé, précifément comme nos prêtres n’a-
guere avoient la coutume d’exorcifer le diable. Voilà
le tableau deQuinault. Nous ne dirons point qu’il n’y
a qu’un homme de génie qui puifle réuflîr dans le premier,
6c qu’un homme ôfdinaire peut fe tirer du
fécond avec fuccès ; mais nous nous én rapporterons
à la bonne foi de ceux qui ont vu la reprefentation
des deux pièces.Qu’ils nous difent fi cette Haine avec
fâ perruque de vipères, avec fon autre paquet de
ferpens en fa’main droite, avec fes gants 6c fes bas rouges
à coins étincelans de paillettes d’argeftt, lès a jamais
fait frémir de terreur ou de pitié pour Armide,
6c fi Phedre mourante d’amour & de honte , feule
dans les bras de fa vieille nourrice, ne déchirent pas
tous les coeurs ? Le deftin dont la main invifible réglé
le fort des mortels irrévocablement, ce deftin qu’aucun
grand poëte n’a ofé tirer des ténèbres dont il s’eft
enveloppé ; n’eft-il pas bien autrement effrayant 6c
terrible que cè deftin à barbe blanche que le poëte
de l’Opéra françois nous montre fi indiferettemènt,
6c qui nous avertit èn plein - chant que toutes les1
puiflances du ciel 6c de la terre lui fontfoumifes?
; Le merveilleux vifible ainfi repréfenté , n’auroit-
il pas banni tout intérêt de la feene lyrique ? Un Dieu
peut «tonner* il peut paroître grand &: redoutable ;
mais peut-il iritérefler ? Comment s’y prendra-t-il
pour me toucher ? Son caraétere de divinité ne
rompt-il pas toute èfpece deliaifon 6c de rapport
entre lui & moi ? Que me font fes pallions , fes plaintes
, fa joie , fon bonheur , fes malheurs ? Suppofé
que fa colere ou fa bienveillance influe fur le fort
d’un héros, d’une illuftre héroïne du drame, lefquels
ayant les mêmes affections , les mêmes foiblefîes, la
même nature qüë moi", ont droit de m’intéreflèr à
leur fort, quelle part pourrois-je prendre à une aCtion
où rien ne fe pafle en conféquence de la nature & de
la néceflitédes chofës,où la fituatiôn la plusdéplôrà-
ble peut devenir en un clin d’oe il, par un coup de
baguette, par un changement de volonté foudain &
imprévu , la fituatiôn la plus heureufe ,'■ & par un autre
caprice redevenir fùnefte ? Ne feroit-ce pas-là des
jeux propres, tout au plus, à émouvoir des enfans ?
L’unité d’aCtion efîentielle à tout drame, & fans
laquelle aucun ouvrage de l’art rie fauroit plaire, ne
feroit-ellepas epntinuéllement bleflee dans l’Opéra
merveilleux? Des êtres qui font au-deffus des lois de
notre nature, qui peuvent changer à leur gré le cours
dès événemens, ne difloudroient-ils pas tout le'noeud
dans les pièces de ce genre? Un Opéra ne feroit donc
qu’une fuite d’incidens qui fe fuccedent les uns aux
autres fans néceflité , & par conféquent fans liaifon
véritable. Le poëte pourroit les alonger , abréger -,
fupprimer à fa fantaifie, fans que fon lujet enfouffrît.
Il pourroit changer fes a£tes de place , faire du premier
le troifieme, du quatrième le fécond, fans aucun
bouleverfement confidérable de fon plan. Il pourroit
dénouer fa piece au premier aéte, fans que cela
Fempêchât défaire fuivre cet afte de quatre autres où
il dénoueroit & renoueroit, autant de fois qu’il lui
plairoit : ou pour parler plus exactement, il n’y au-
roit dans le fait, ni noeud, ni dénouement. Tout fujet
de cette efpece ne peut-il pas être traité en un aCte,
én trois, en cinq, en d ix , en vingt, félon le caprice
& l’extravagance du poëte lyrique ?
Si ce genre n’a pu enfanter que des drames dénués
de tout intérêt & de toute vérité, n’auroit-il pas ainfi
empêché les progrès de la mufique en France, tandis
que cet art a été porté au plus haut degré de perfec*
tion dans les autres parties de l’Europe ? Comment
•le ftyle mufical fe fëroit-il formé dans un pays où l ’on
ne fait chanter que des êtres de fantaifie dont les ac*
cens n’ont nul modèle dans la nature ? Leur déclama*
tion étant arbitraire & indéterminée , n’auroit-elle
pas produit un chant froid & fôporifique, une monotonie
infupportable auxquels perfonne n’auroit réfiftd
fans le fecours des ballets ? Toute l’expreflion niuft-
cale ne fe feroit-elle pas ainfi réduite à jouer fur le
mot, enforte qu’un aCteur ne pourroit prononcer le
mot larmes, fans que le muficien ne le fit pleurer ,
quoiqu’il n’eût aucun fujet d’affliftion, & que dans la
fituatiôn la plus trifte il ne pourroit parler d’un état
brillant fans que le muficien ne fe crut en droit de
•faire briller fà Voix aux dépens de la difpofition de
fon ame ? Ne feroit-ilpas réfulté de cette méthode un
dictionnaire des mots réputés lyriques , dictionnaire
dont un compofiteur habile ne manqueroit pas de
faire prefent à fon pôëte, afin qu’il eû t, en un feul
recueil, tous les mots dont la mufique ne fauroit rien
faire , 6c qu’il ne faut jamais employer dans le poème
lyrique ?
Si vous choififlez deux compofiteurs ; que vous
donniez à l’un à exprimer le défefpoir d’Andromaque
lorfqu’on arrache Aftyanax du tombeau où fa piété
l’avoit caché, ou les adieux d’Iphigénie qui va fe fou-
mettre au couteau de Calchas, ôù bien les fureurs de
fa mere éperdue au moment de cet affreux facrifice'i
6c que vous difiez à l’autre, faîtes-moi une tempête,
un tremblement de terre, un choeur d’aquilons , un
débordement de Nil, une defeente de Mars, une conjuration
magique, un fabat infernal, n’eft-ce pas dire
à celui-ci, je vous choifis pour faire peur ou plaifir
aux enfans, 6c à l’autre, je vous choifis pour être l’admiration
des nations 6c des fiecles ? N’eft-il pas évident
que l’un a dû refter barbare, & fans mufique ,
fans ftyle, fans exprefîïon, fans caraCtere , 6c que
l’autre a dû, ou renoncer à fon projet, ou, s’il y a
réufli, devenir fublime ?
Deux poëtes qu’on àuroit ainfi employés, ne fé-
roient-ils pas dans le même cas ? L’un n’auroit-il pas
appris à parler lé langage du fentiment, des paflîons,
dê la nature ; l’autre ne feroit-il pas refté foib lé,
froid 6c maniéré ? Quand il auroit eu le talent de la
poéfie, fon faux genre l’auroit trompé fur l’emploi
qu’il en faut faire. La pompe épique auroit pris dans
Ion ftyle laplace du naturel de la poéfie dramatique.
Au lieu defeenes naturellement dialoguées, nous aurions
eu des recueils de maximes, de madrigaux,
d’épigrammes, de tournures 6c de cliquetis de mots
pour lefquels la mufique n’a jamais connu d’exprefi*
fiori. Lé goût fe feroit fi peu formé qu’on n’auroit
point fenti la différence de l’harmonie poétique 6c de
l’harmonie muficale, ni compris que le plus beau morceau
de Tibulle feroit déplacé dans le poème lyrique,
précifément par ce qui le rend fi beau 6c fi précieux.
On auroit vit enfin l’étrange phénomène d’ün poëte
lyrique , plein de douceur 6c de nombre, plein de
charme à la leCture , & dont il feroit cependant im-
poflible de mettre les pièces en mufique.
Ce faux genre où rien ne rappelle à la nature, n’au*
roit-il pas empêché le muficien françois de connoître
6c de fentir cette diftinûion fondamentale de l’air 6c
du récitatif? Un chant'lourd 6c traînant, femblablè
au chant gothique de nos églifes, feroit devenu le
récitatif dé l’opéra. Pour lui donner de l’expreflxon ,
on l’auroit furchargé de ports de vo ix , de trilles, de
chevrottemeos ; 6c malgré ces laborieux efforts , on
ne fe feroit pas feulement douté de l’art de ponéhu r
le chant, de faire une interrogation , une exclam? -
tion en chantant. La lenteur infoutenable de ce récitatif,
fon cara&ere contraire à toute efpece de déclamation,
auroient d’ailleurs rendu l’exécution d’ur.e