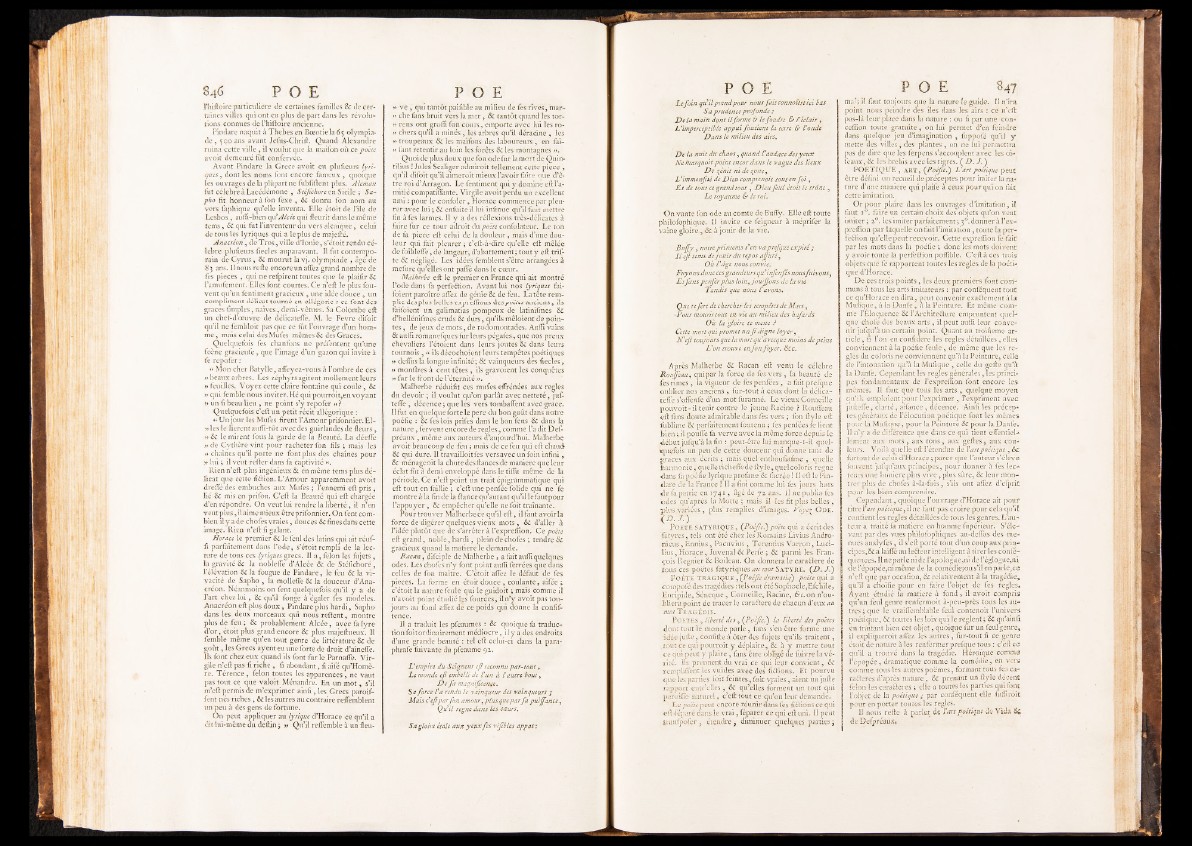
l’hiftoire particulière de certaines familles & de certaines
villes qui ont eu plus de part dans les révolutions
connues de l’hiftoire ancienne.
Pindare naquit à Thebes en Boeotie la 65 olympiade
, 500 ans avant Jefus-Chrift. Quand Alexandre
ruina cette ville , il voulut que la inaifon où ce poète
avoit demeuré fut confervee.
Avant Pindare la Grece avoit eu plufieurs Lyriques
, dont les noms font encore fameux , quoique
les ouvrages de la plûpart ne fubfiftent plus. Alcman
fut célébré à Lacédémone , Stéjichore en Sicile ; Sa-
pho fit honneur à fon fexe , & donna fon nom au
vers faphique qu’elle inventa. Elle étoit de File de
Lesbos , aufli-bien qu'Alcée qui fleurit dans le même
tems, 8c qui fut l’inventeur au vers alcaïque, celui
de tous les lyriques qui a le plus de majefté.
Anacréon, de Tro s, ville d’Ionie, s’étoit rendu célébré
plufieurs fiecles auparavant. Il fut contemporain
de Cyrus, & mourut la vj. olympiade , âgé de
83 ans. Unousrefte encore un affez grand nombre de
fes pièces , qui ne refpirent toutes que le plaifir 8c
l’amufement. Elles font courtes. Ce n’eft le plus fou-
vent qu’un fentiment gracieux , une idée douce , un
compliment délicat tourné en allégorie : ce font des
grâces Amples, naïves, demi-vêtues. Sa Colombe eft
un chef-d’oeuvre de délicateffe. M. le Fevre difoit
qu’il ne fembloit pas que ce fut l’ouvrage d’un homme
, mais celui des Mufes mêmes 8c des Grâces.
Quelquefois fes chanfons ne préfentent qu’une
fcène gracieufe, que l’image d’un gazon qui invite à
fe repofer :
« Mon cher Batylle, affeyez-vous à l’ombre de ces
» beaux arbres. Les zéphyrs agitent mollement leurs
» feuilles. Voyez cette claire fontaine qui coule , 8c
» qui femble nous inviter. Hé qui pourrait,en voyant
» un fi beau lieu , ne point s’y repofer » ?
Quelquefois c’efl un petit récit allégorique :
« Un jour les Mufes firent l’Amour prifonnier.El-
» les le lièrent auflî-tôt avec des guirlandes de fleurs ,
» 8c le mirent fous la garde de la Beauté. La déeffe
» de Cythère vint pour racheter fon fils ; mais les
» chaînes qu’il porte ne font plus des chaînes pour
» lui ; il veut refter dans fa captivité «.
Rien n’eft plus ingénieux & en même tems plus délicat
que cette fiôion. L ’Amour apparemment avoit
dreffé des embûches aux Mufes ; l’ennemi eft pris ,
lié & mis en prifon. C’eft la Beauté qui eft chargée
d’en répondre. On veut lui rendre la liberté, il n’en
veut plus, il aime mieux êtreprifonnier. On fent combien
il y a de chofes vraies, douces & fines dans cette
image. Rien n’eft fi galant.
Horace le premier 8c le feul des latins qui ait réuf-
fi parfaitement dans l’ode, s’étoit rempli de la lecture
de tous ces Lyriques grecs. Il a , félon les fujets,
la gravité & la nobleffe d’Alcée 8c de Stéfichoré,
l’élévation 8c la fougue de Pindare, le feu 8c la vivacité
de Sapho , la molleffe & la douceur d’Anacréon.
Néanmoins on fent quelquefois qu’il y a de
l’art chez lu i, & qu’il fonge à égaler fes modèles.
Anacréon eft plus doux, Pindare plus hardi, Sapho
dans les deux morceaux qui nous relient, montre
plus de feu ; & probablement Alcée, avec fa lyre
d’or, étoit plus grand encore 8c plus majeftueux. IF-
femble même qu’en tout genre de littérature 8c de
goût, les Grecs ayent eu une forte de droit d’aîneffe.
Ils font chez eux quand ils font fur le Parnaffe. Virgile
n’eft pas fi riche , fi abondant, fi aifé qu’Homè-
re. Térence , félon toutes les apparences , ne vaut
pas tout cé que valoit Ménandre. En un mot s’il
m’eft permis de m’exprimer ainfi , les Grecs paroif-
fènt nés riches, & les autres au contraire reffemblent
un peu à des gens de fortune.
On peut appliquer au lyrique d’Horace ce qu’il a
dit lui-même du deftin ; » Qu’il relfemble à un fleu-
» ve , qui tantôt paifible au milieu de fes rives, mar-
» che fans bruit vers la m er, & tantôt quand les tor-
» rens ont grofli fon cours, emporte avec lui les ro-
» chers qu’il a minés , les arbres qu’il déracine , les
»troupeaux & les maifons des laboureurs , en fai-
» fant retentir au loin les forêts 8c les montagnes ».
Quoi de plus doux que fon ode fur la mort de Quin-
tilivis ! Jules Scaliger admirait tellement cette piece ,
qu’il difoit qu’il aimerait mieux l’avoir faite aue d’être
roi d’Arragon. Le fentiment qui y domine eft l’amitié
compatiflante. Virgile avoit perdu un excellent
ami : pour le confoler, Horace commence par pleurer
avec lui ; 8c enfuite il lui infinue qu’il faut mettre
fin à fes larmes. Il y a des réflexions très-délicates à
faire fur ce tour adroit du poète confolateur. Le ton
de fa piece eft celui de la douleur, mais d’une douleur
qui fait pleurer ; c’ eft-à-dire qu’elle eft mêlée
de foibleffe, de langeur, d’abattement; tout y eft trif-
te 8c négligé. Les idées femblent s’être arrangées à
mefure qu’elles ont pafîe dans le coeur.
Malherbe eft le premier en France qui ait montré
l’ode dans fa perfeftion. Avant lui nos lyriques fai-
foient paraître aflez de génie 8c de feu. La tête remplie
des plus belles expreflions des poètes anciens, ils
faifoient un galimatias pompeux de latinifmes 8c
d’heliénifmes cruds 8c durs, qu’ils mêloient de pointes
, de jeux de mots, de rodomontades. Aufli vains
& aufli romanefques fur leurs pégafes, que nos preux
chevaliers I’étoient dans leurs joutes 8c dans leurs
tournois, « ils décochoient leurs tempêtes poétiques
» deffus la longue infinité; 8c vainqueurs des fiecles,
» monftres à cent têtes, ils gravoient les conquêtes
» fur le front de l’éternité ».
Malherbe réduifit ces mufes effrénées aux réglés
du devoir ; il voulut qu’on parlât avec netteté, juf-
teffe , décence ; que les vers tombaient avec grâce.
Il fut en quelque forte le pere du bon goût dans notre
poéfie : 8c fes lois prifes dans le bon fens & dans la
nature, fervent encore de réglés, comme l’a dit Def-
préaux , même aux auteurs d’aujourd’hui. Malherbe
avoit beaucoup de feu ; mais de ce feu qui eft chaud
8c qui dure. Il travailloit fes vers avec un foin infini,
Sc ménageoit la chute des liane es de maniéré que leur
éclat fut à demi enveloppé dans le tiflu même de la
période. Ce n’eft point un trait épigrammatique qui
eft tout en faillie ; c’eft une penlee folide qui ne fe
montre à la fin de la fiance qu’autant qu’il le fautpour
l’appuyer , 8c empêcher qu’elle ne foit traînante.
Pour trouver Malherbe ce qu’il eft, il faut avoir la
force de digérer quelques vieux mots, 8c d’aller à
l’idée plutôt que de s’arrêter à l’expreflion. Ce poète
eft grand, noble, hardi, plein de chofes ; tendre 8c
gracieux quand la matière le demande.
Racan, difciple de Malherbe, a fait aufli quelques
odes. Les chofes n’y font point aufli ferrées que dans
celles de fon maître. C’etoit aflez le défaut de fes
pièces. La forme en étoit douce , coulante,. aifée ;
c’étoit la nature feule qui le guidoit ; mais comme il
n’a voit point étudié les fources, il n’y avoit pas toujours
au fond aflez de ce poids qui donne la confif-
tence.
Il a traduit les pfeaumes : 8c quoique fa traduction
foit ordinairement médiocre, il y a des endroits
d’une grande beauté : tel eft celui-ci dans la para-
phrafe fuivante du pfeaume 92.
Vempire du Seigneur efl reconnu par-tout,
Le monde efl embelli de F un à Vautre bout,
De fa magnificence.
Sa force Va rendu le vainqueur des vainqueurs ;
Mais défi parfon amour, plus que parfa puiffance,
Qu'il régné dans lès coeurs.
Sa gloire étale aux yeux fes vifibles appas :
Lefoin qu'il prend pour nous fait connoitte ici bas
Sa prudence profonde :
De la ma in dont il forme & le foudre <S* Véclair ,
L'imperceptible appui foutient la terre & l'onde
Dans le milieu des airs.
Delà nuit du chaos, quand V audace des y eux
Ne fnarquoit point encor dans le vague des lieux
De finit ni de çone,
L'immtnfitè de Dieu comprenoit tout en f o i ,
E t de tout ce grand tout y Dieu feul étoit Le trône ,
Le royaume & le roi.
On vante fon ode au comte de Bufly. Elle eft toute
phi’lofophique. Il invite ce feigneur à méprifer la
vaine gloire., 8c à jouir de la vie.
Buffy y notre printems s'en va prefque expiré ;
IL efi tems de jouir du repos ajfuréy
Où l'âge nous convie:
Fuyons donc ces grandeurs qu 'infenfés nous fuivonsf
E t fans penfèr plus loiriyjouiffons de la vie
Tandis que nous l'avons.
Que te fert de chercher les tempêtes de Mars f
'■ Pour mourir tout en vie au milieu des hafards
Où la gloire te mene ?
Cette mort qui promet un f i digne loyer,
- N'efi toujours que la mort qu'avecque moins de peine
L'on trouve enfon foyer, ôcc.
Après Malherbe 8c Racan efl: venu le célébré
Rouffeauy qui par la forcé de fes vers , la beauté de
fes rimes , la vigueur de fes penfées, a fait prefque
oublier nos anciens , fur-tout à ceux dont la délica-
iefi'e s’offenfe d’un mot furanné. Le vieux Corneille
pouvoit - il tenir contre le jeune Racine ? Rouffeau
eft fans doute admirable dans fes vers ; fon ftyle eft
fublime 8c parfaitement foutenu ; fes penfées le lient
bien ; il pouffe fa verve avec la même force depuis le
.début jufqu’à la fin : peut-être lui manque-t-il quel-
îquefois un peu de Cette douceur qui donné tant de
grâces aux écrits ; mais quel enthoufiafme , quelle
harmonie, quelle richefi’e de ftyle, quel coloris régné
dans fa poéfie lyrique profane 8c fa crée ! Il eft le Pindare
de la France ! Il a fini comme lui fes jours hors
de fa patrie en 1741, âgé de 72 ans. il ne publia fes
odes qu’après la Motte ; mais il les fit plus belles ,'
plus variées, plus’ remplies d’images. Foye^ Od e.
POETE SATYRIQUE, ( Poéfie.) poète qui a écrit des
fatyres, tels ont été chez les Romains Livius Andro-
nicus, EnniiiS, PaCuviùs, Terentius Varron, Luci-
lius, Horace, Juvenal&Perfe ; & parmi les François
Regnier 8c Boileau. On donnera le caraftere de
tous ces poètes fatyriques au mot S a t y r e . (D . J.)
Po ÉTÉ TRAGIQUE , (.Poéfie dramatiq) poète qui a
compofé des tragédies : tels ont été Sophocle,Efchile,
Euripide, Séneque, Corneille, Racine, &c. on n’oubliera
point de tracer le caraflere de chacun d’eux au
mot T r a g é d i e .
POETES y liberté des, (Poéfie.') la liberté des poètes
dont tout le monde parie, lans s’en être formé une
idée jufte, Confifte à ôter des fujets qu’ils traitent,
.tout ce qui pourrait y déplaire, & à y mettre tout
ce qui peut y plaire , fans être obligé de fuivre lavé-,
rité. Ils prennent du vrai ce qui leur convient, 8c
rempliffent les vuides avec des fiflions. Et pourvu
que les parties foit feintes, foit vraies, aient un jufte
rapport entr’elles , 8c qu’elles forment un tout qui
paroiffe naturel, c’eft tout ce qu’on leur demande.
Le poète peut encore réunir dans fes fixions ce qui
eft-féparé dans le vrai, féparer ce qui eft uni. Il peut
jranfpofer, étendre, diminuer quelques parties ;
ma‘s il faut toujours que la nature le guide. Il n’ira
point nous peindre des îles dans les airs : ce n’eft
pas-là leur place dans la nature : ou fi par une con-
ceflion toute gratuite, on lui permet d’en feindre
dans quelque jeu d’imagination , fuppofé qu’il y
mette des villes, des plantes, on ne lui permettra
pas de dire que les ferpens s’accouplent aveé les oi-
féaux, & les brebis avec les tigres, (£>.ƒ .)
POÉTIQUE , a r t , (Poéfie,) L'art poétique peut
être défini un recueil de préceptes pour imiter la nature
d’une maniéré qui plaife à ceux pour qui on fait
cette imitation.
Or pour plaire dans les ouvrages d’imitation, il
faut i° . faire un certain choix des objets qu’on veut
imiter ; 20. les imiter parfaitement ; 30. donner à l’ex-
preflion par laquelle on fait l’imitation, toute la per-
feélion qu’elle peut receyoir. Cette expreflion fé fait
par les mots dans la poéfie ; donc les mots doivent
y avoir toute la perfection poflible. C’eft à ces trois
objets que fe rapportent toutes les réglés de la poétique
d’Horace*
De ces trois points, les deux premiers font communs
à tous les arts imitateurs : par conféquent tout
ce qu’Horacë en dira,-peut convenir exactement à la
Mufique, à la Danfe, à la Peinture. Et même- corn--
me l’Éloquence 8c l’Architecture empruntent quelque
chofe dés beaux arts , il peut aufli leur convenir
jufqu’à un certain point. Quant au troifieme article
, fi l'on en confidere les réglés détaillées, elles
conviennent à ta poéfie feule, de même que les réglés
du coloris ne conviennent qu’à la Peinture, celle
de l’intonation qu’à la Mufique , celle du gefte qu’à
la Danfe. Cependant les réglés générales, les principes
fondamentaux de l’expreflion font encore les
mêmes. Il faut que tous les arts , quelque moyen,
qu’ils emploient pour l’exprimer , l’expriment avec
jufteffe, clarté, ail'ance , décence. Ainfi les préceptes
généraux de l’élocution poétique font les mêmes
pour la Mufique, pour la Peinture 8c pour la Danfe*.
Il n’y a de différence que dans ce qui tient effentiel-
lemcnt aux mots , aux tons, aux geftes, aux couleurs.
Voilà quelle eft l’étendue de l'artpoétique, 8c
furtotit de celui d’Horace ; parce que l’auteur s’élève
fouvent jufqu’aux principes, pour donner à fes lecteurs
une lumière plus v iv e , plus sûre, 8c leur montrer
plus de chofes à-la-fois, s’ils ont affez d’efprit
pour les bien Comprendre»
Cependant, quoique l’ouvragé d’Horace ait pour
titre l'artpoétique, il ne faut pas croire pour cela qu’il
contient les réglés détaillées de tous les genres. L’auteur
a traité fa matière en homme fupérieur» S’élevant
par des vues philofophiques au-deffus des menues
analyfes, il s’eft porté tout d’un coup aux principes,&
a laifle au leéleur intelligent à tirer les confé-
quences. Il ne parle ni de l’apologue,ni de l’églogue,ni
de l’épopée,ni même de la comédie;ous’il en parle,cô
n’eft que par occafion, 8c relativement à la tragédie,
qu’il a choifie pour en faire l’objet de fes règles*
Ayant étudié fa matière à fond, il avoit compris
qu’un feul genre renfermoit à-peu-près tous les autres
; que le vraiffemblable feul contertoit l’univerâ
poétique, 8c toutes les loix qui le règlent ; 8c qu’ainfi
en traitant bien cet objet, quoique fur un feul genre,
! il expliquerait affez les autres , fur-tout fi ce genre
étoit de nature à les renfermer prefque tous : c’eft ce
! qu’il a trouvé dans la tragédie. Héroïque comme
l’épopée, dramatique comme la comédie, én vers
I comme tous les autres poëmes, formant tous fes Ca-
! rafler es d’après nature, 8c prenant un ftyle décent
! félon les carafteres ; elle a toutes les parties qui font
l’objet de la poétique ; par conféquent elle fufliroit
pour en porter toutes les réglés.
Il nous refte à parler de l'art poétique de Vida &C
de Defpréaux,