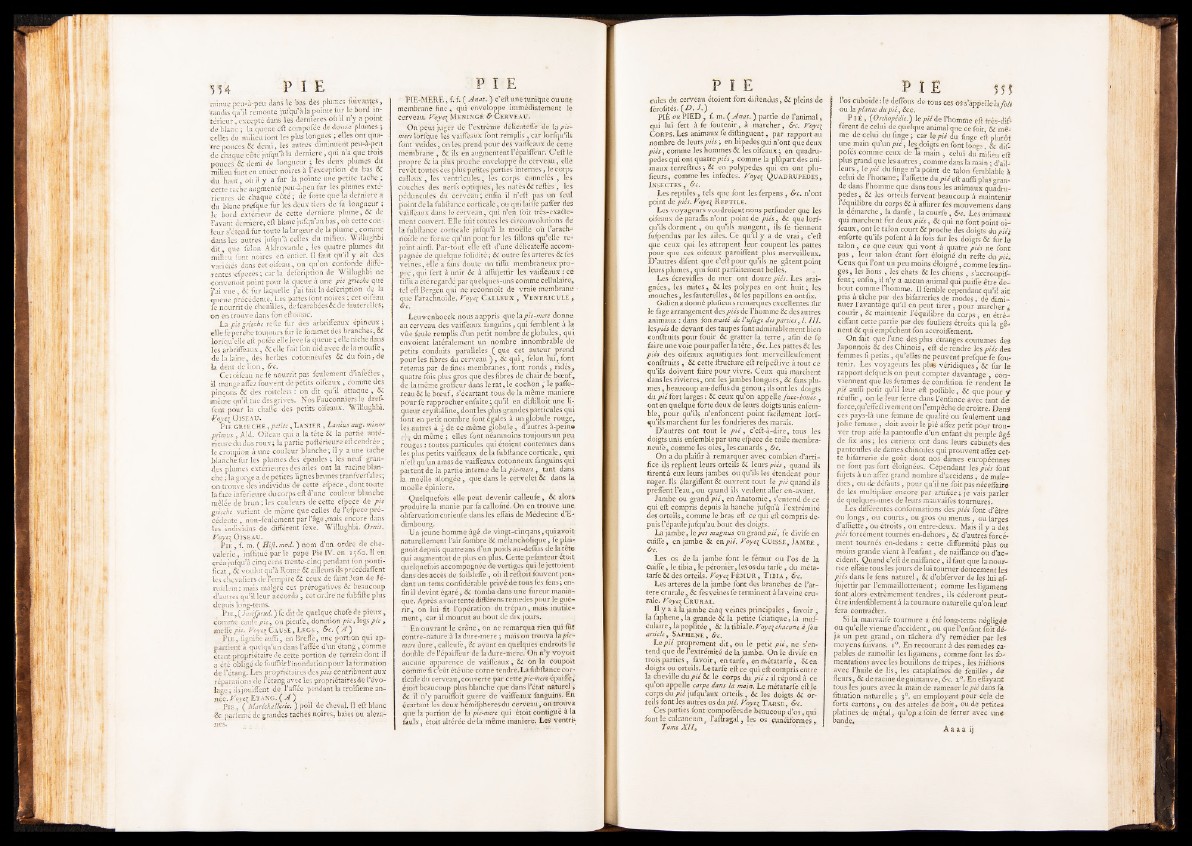
minue péu-à-pèu dafts le bas dès plumes Suivantes,
tandis qu’il remonte jufqù’ à la pointé lut le bord intérieur
, excepté dans les dernier es oii il n’y a point
de blanc ; la queue eft compofée de doute plumes ;
celles du milieu font lès plus longues ; elles ont quatre
pouces & demi, les autres diminuent peu-à-péii
de chaque côté jufqu’à la derniere , qui n a que trois
pouceS & demi de longueur :; l'es deux plumes du
milieu font en entier noires-à l’exception du bas ot
•du haut-, bii il y a fur là pointe une petite tache ;
-cette tache augmente peir-à-pèu fur les plumes extérieures
de chaque côté; de forte que la defniere ä
du blanc prefque fur les deux tiers de fa longueur ;
le bord extérieur de cette derniere plume, & de
Pavant derniere, eft blanc jufqu’att bas, oh cette cou ;
•leur s’étend fur toute la largeur de la plume, comme
dans les autres jùfqù’à celles du milieu. Willughbi
d i t , que félon Aldrovande, lés quatre plumes du
milieu font noires en entier. Il faut qu’il y ait des
variétés dans cet oifeau > ou qu’on confonde différentes'efpeces
; car la description de 'Willughbi ne
<çonvenoit point pour la queue à une pie grieche que
j’ai vu e , &c fur laquelle fa i fait la defcription de la
queue précédente. Les pattes font noires ; cet oiféau
-fe nourrit de chenilles, defcarabées&de lauterelles;
•on en trouve dans foh eftomac.
La pie grieche reffe fur des ârbriffeaux épineux ;
elle fe perche toujours fur le fommetdes branches, &
lorfqu’elle eft pofée ellelevefa queue ; elle niche dans
les arbriffeaux, & elle fait fon nid avec de la moufle,
de la laine, des herbes cotonnéufes & du foin, de
la dent de lion, &c.
Cet oifeau ne fe nourrit pas feulement d’infe&es,
il mange affez fouvent de petits oifeaux , comme des
pinçons &: des roitelets : on dit qu’il attaque , &
même qu’il tue des grives. Nos Fauconniers le drefo
font pour la chaffe dés petits oifeaux. 'Willughbi.
Ÿ oyh O is e a u .
P ie GRIECHE, petite, L an ie r , Làiiiüs aug. minor
primus- , Aid. Oifeau qui a la tete & la partie anterieure
du dos roux ; la partie poftérieure eft cendrée ;
le croupion à une couleur blanche; il y aune tache
blanche fur les plumes des épaulés ; les neuf grandes
plumes extérieures des ailes ont lâ racine blanche
; la gor^e a de petites lignes brunes tranfverfales;
on trouve Ses individus de cette efpece, dont toute
la face inférieure du corps eft d’une couleur blanche
mêlée de brun ; les, couleurs de cette efpece de pie
grieche varient de même qüë celles de l’efpece précédente
, non-feulement par l’âge,mais encore dans
les individus de différent foxè. ‘Willughbi. Omit.
Voye^ O is e a u .
Pie , f. m. ( Hiß. mod. ) nom d’un ordre de chevalerie,
inftitué par le pape Pie IV. en ij6 o . lien
créa jufqu’à cinq cens trente-cinq pendant ton pontificat
, & voulut qu’à Rome & ailleurs ils précédaffent
les chevaliers de l’empire & ceux de foint Jean de Jé-
rufalem : mais maigre ces prérogatives & beaucoup
d’autres qu’il leur accorda, cet ordre rte' ftibfifte plus
depuis long-tems.
. Pie, ( Xurifprud. ) fe dit de quelque chofe dé pieux,
comme caufe p i e , oti pieufe, donatiôfï p i e , leg s pie >
mette pie. Foye^ Causé, L e g s , & c. ( A ) •
T PÏE,Tignifie aufli, en Breffe, une portion qui appartient
à quelqu’un dans l’affée d’urt étang , comme
étant propriétaire de cette portion de terrein dont il
a été obligé de fouffrir l’inondation pour la formation
de l’étang. Les propriétaires des pies contribuent aux
réparations de l’étang avec les propriétaires dé l’évo-
lage ; ils jouiffent de l’affée pendant la tfoifieftie année.
Voye^ Et a n g . ( A )
Pie , ( Marèchallerie. ) poil de cheval. Tl eft blanc
éc parfemé de grandes taches noires, baies ou alezanes.
PIE-MERE, f. f . ( Ariat. ) c’ eft uneturii'que oüuiie
membrane fine, qui enveloppe immédiatement le
cerveau. F o y c { Méningé «S* C erv eau.
On peut juger de l’ extrèïne délicatefte de la pic-
hiere lof (que lès vàiffeaùx font remplis, car lorfqu’ils
font vuides, on les prend pour dès vaiffeaux de cette
mémbrarié , & ils en augmentent l’épaiffeür. C’eft lé
propre & la plus proche enveloppé du cerveau, elle
revet toutes ces plus petites parties internes, le corps
calleux, les ventricules, les corps cannelés , les
couches dés nerfs optiqtfès , les nàtès teftès , leà
péduncules du cerveau | enfin il n’e'ft pas uh feul
point de la fubftancè corticale, où qui laiffe paffer des
vaiffeaux dans lé cerveau, qui n’en foit très-exaéle-
nient couvert. Elle fuit toutes les circonvolutions de
la fubftancè Corticale jufqü’à la moelle où l’arachnoïde
ne forme qü’ün pont fur les filions qu’elle rejoint
àirifi. Par-tôüt elle eft d’ürtë délicâteffe accompagnée
de quelque folidité; & outre fesarteres &feS
veines, elle à fans doute Un tiffu membraneux propre
, qui fort à Unir & à àffujettir les vaiffeaux : ce
tiffu a été regardé par quelques-uns comme cellulaire,
tel eft Bergen qui ne reconnoît de vraie membfané
que l’arachnoide. Foye{ C alleux , V e n t r i c u l e ,
&c.
Leuwenhoeck nous a appris qiie \zpie-merè donne
au cerveau des vaiffeaux fanguins, qui femblent à là
vue feule remplis d’un petit nombre de globules, qui
envoient latéralement un nombre innombrable de
petits conduits parallèles ( que cet auteur prend
pour les fibres du cerveau ) , & q ui, félon lui, font
retenus par de fines membranes, font ronds , ridés,
quatre fois plus gros que des fibres de chair de boeuf,
de la même groffeur dans le rat, le c o c h o n le pafle-
reau& le boeuf, s’écartant tous de la même maniéré
pour fe rapprocher enfuite ; qu’il en diftilloit une liqueur
cry ftalline, dont les plus grandes particules qui
font en petit nombre font égales à un globule rouge,
les autres à £ de ce même globule, d’autres à-peine
du même ; elles font néanmoins toujours un peu
rouges : toutes particules qui étoient contenues dans
les plus petits vaiffeaux de la fubftancè corticale , qui
n’eft qu’un amas de vaiffeaux cotonneux fanguins qui
partent de la partie interne de la pie-mere , tant dans
la moelle alongée, que dans le cervelet & dans la
moelle épiniere.
Quelquefois elle peut devenir calleufe, & alors
produire la manie par fa callofité. On en trouve une.
obforvation curieufe dans les effais de Médecine d’Edimbourg.
Un jeune homme âgé de vingt-cinq ans, qui avoifr
naturellement l’air fombre & melanchoiique, fe plai-
gnoit depuis quatre ans d’un poids au-defïus de la tête
qui augmentoit de plus en plus. Cette pefanteur etoit
quelquefois accompagnée de vertiges qui le jettoient
dans des accès de foibleffe , oh il reftoit fouvent pendant
un tems confidérable privé de tous fes fens ; enfin
il devint égaré, & tomba dans une fureur mania-;
que. Après avoir tenté différens remedes pour le guérir
, on lui fit l’opération du trépan, mais inutilement
, car il mourut au bout de dix jours.
En ouvrant le crâne, on ne remarqua rien qui fut
contre-nature à la dure-mere ; mais on trouva la pie-
mere dure, calleufe, & ayant en qùelqites endroits le
double ‘de l’épaiffeut de la dure-mere. On n’y voyoit
aucune apparence de vaiffeaux, &• on la c'oupoit
comme fi c’eût été une corne tendre. La fubftancè corticale
du cerveau,Couverte par cettepie-there épaiffe,
étoit beaucoup plus blanche que dans l’état naturel,
& il n’y paroiffoit guère de vaiffeaux fanguins. En
écartant les deux hémifpheresdu cerveau, on trouva
que la portion de la pie-mere qui étoit contiguë à la
faulx, étoit altérée de-la même maniéré. Les ventri*
diles du cerveau étoient fort diftendus, & pleins de
férofités. (2>. / .)
PIÉ ou PIED , f. m. ( Anat. ) partie de l’animal,
qui lui fort à fe foutenir, à marcher, &c. Foye{
C o r p s . Les animaux fe diftinguent, par rapport au
nombre de leurs pies ; en bipedesqui n’ont que deux
pies, comme les hommes &: les oifeaux ; en quadrupèdes
qui ont quatre pies, comme la plupart des animaux
terreftres ; & en polypedes qui en ont plu-
fieurs, comme les infedes. Foye^ Q u a d r u p è d e s ,
I n s e c t e s , & c.
Les reptiles, tels que font les ferpens, &c. n’ont
point de pics. Foye[ R e p t i l e .
Les voyageurs voudroient nous perfuader que les
oifeaux de paradis n’ont point de pies, & que lorfqu’ils
dorment , ou qu’ils mangent, ils fe tiennent
fufpendus par les ailes. Ce qu’il y a de vrai, c’eft
que ceux qui les attrapent leur coupent les pattes
pour que ces oifeaux paroiffent plus merveilleux.
D ’autres difent que c’eft pour qu’ils ne gâtent point
leurs plumes, qui font parfaitement belles.
Les écrevifïes de mer ont douze pies. Les araignées,
les mites, & les polypes en oftt huit; les
mouches, lesfauterelles, de les papillons en ontfix.
Galien a donné plufieurs remarques excellentes fur
le fage arrangement des pies de l’homme & des autres
animaux : dans fon traité de l'ufage des parties, L. III.
lespiés de devant des taupes font admirablement bien
conftruits pour fouir & gratter la terre, afin de fe
foire une voie pour paffer la tête, &c. Les pattes & les
piés des oifeaux aquatiques font merveilleufement
conftruits , & cette ftruéture eft refpeftive à tout ce
qu’ils doivent foire pour vivre. Ceux qui marchent
dans les rivières, ont les jambes longues, & fans plumes
, beaucoup au-deffus du genou ; ils ont les doigts
du pié fort larges : & ceux qu’on appelle fuce-bouïs ,
ont en quelque forte deux de leurs doigts unis enfem-
ble, pour qu’ils n’enfoncent point facilement lorfqu’ils
marchent fur les fondrières des marais.
D ’autres ont tout le p ié , c’eft-à-dire, tous les
doigts unis enfemblepar une efpece de toile membra-
neufe, comme les oies, les canards , &c.
On a du plaifir à remarquer avec combien d’artifice
ils replient leurs orteils & leurs piés, quand ils
tirent à eux leurs jambes ou qu’ils les étendent pour
nager. Ils élargiffent & ouvrent tout le pié quand ils
preffent l’eau, ou quand ils veulent aller en-avant.
Jambe ou grand pié, en Anatomie, s’entend de ce
qui eft compris depuis la hanche jufqu’à l’extrémité
des orteils, comme le bras eft ce qui eft compris depuis
l’épaule jufqu’au bout des doigts.
La jambe, le pes magnus ou grand pié, fe divife en
cuiffe, enjambe & en pié. Foye^ C u i s s e , Ja m b e ,
&c.
Les os 4e fo jambe font le fémur ou l’os de la
cuiffe, le tibia, le péronier, les os du tarfe, du méta-
tarfe & des orteils. Foye^ F é m u r , T i b i a , &c.
Les arteres de la jambe font des branches de l’ar-
tere crurale, & fes veines fe terminent à laveine crurale.
Foye^ C r u r a l .
Il y a à la jambe cinq veines principales , favoir ,
la faphene, la grande & la petite feiatique, la muf-
culaire, la poplitée, & la tibiale. Foye{ chacune à fon
article, SA PH EN E , & c.
Le pié proprement dit, ou le petit pié, ne s’entend
que de l’extrémité delà jambe. On le divife en
trois parties, favoir, en tarfe, en métatarfe, & en
doigts ou orteils. Le tarfe eft ce qui eft compris entre
la cheville du pié & le corps du pié : il répond à ce
qu on appelle carpe dans la main. Le métatarfe eft le
corps du pié jufqu’aux orteils , & les doigts & orteils
font les autres os du pié. Foye%_ T a r s e , & c.
Ces parties font compofées de beaucoup d’o s, qui
font le calcanéum 4 l’aftragal, les os cunéiformes,
Tome X I I»
Pos cuboïde.-Ié deffoïfr de tous ces bt S’âppeïlëlaJoli
ou la plante du pié, & c.
P IÉ ; (Orthopédie.) le pié de l’homme eft très-dif*
ferent de celui de quelque animal que ce foit, & me-
me de celui du linge ; car le pié du linge eft plutôt
une main qu’un pié, lesdoigts en font longs, & dif-
pofés comme ceux de la main , celui du milieu eft
plus grand que les autres, comme dans la main ; d’aiL
leurs, 1 épié dufinge n’a point de talon femblable à
celui de l’homme; l’affiette du pié eft aufli plus gran*
de dans l’homme que dans tous les animaux quadrupèdes
, & les orteils fervent beaucoup à maintenu?
1 équilibré du corps & à affurer fes mouvemens dans
la démarche, la danfe, la courfe, &c. Les animaux
qui marchent fur deux pies, & qui ne font point oi-*
foaux, ont le talon court & proche des doigts du pié J
enforte qu’ils pofent à la fois fur les doigts & fur le
talon, ce que ceux qui vont à quatre piés ne font
pas , leur talon étant fort éloigné du refte du pié*
Ceux qui l’ont un peu moins éloigné, comme les fin-
ges, les lions , les chats & les chiens , s’accroupif-
ient; enfin, il n’y a aucun animal qui puiffe être debout
comme l’homme. Il femble cependant qu’il ait
pris à tâche par des bifarreries de modes, de diminuer
l’avantage qu’il en peut tirer , pour marcher 2
courir, & maintenir l’équilibre du corps , en étré-»
ciffant cette partie par des fouliers étroits qui la gênent
& qui empêchent fon accroiffement.
On fait que l’une des plus étranges coutumes des
Japonnois & des Chinois, eft de rendre les piés des
femmes fi petits, qu’elles ne peuvent prefque fe foutenir.
Les voyageurs les plus véridiques, & fur le
rapport defquels on peut compter davantage , conviennent
que les femmes de condition fe rendent lô
pié aufli petit qu’il leur eft poflible, & que pour y*
réuflïr, on le leur ferre dans l’enfance avec tant de
force,qu’effe&ivement on l’empêche de croître. Danâ
ces pays-là une femme de qualité ou feulement une
jolie femme , doit avoir le pié affez petit pour trouver
trop aifé la pantoufle d’un enfant du peuple âgé
de fix ans ; les curieux ont dans leurs cabinets des
pantoufles de dames chinoifes qui prouvent affez cet*
te bifarrerie de goût dont nos dames européennes
ne font pas fort éloignées. Cependant les piés font
fujets à un affez grand nombre d’accidens, de maladies
, ou de 'défauts, pour qu’il ne foit pas néceffaire
de les multiplier encore par artifice ; je vais parler
de quelques-unes de leurs mauvaifes tournures.
Les différentes conformations des piés font d’êtrè
ou longs, ou courts, ou gros ou menus, ou larges
d’afliette, ou étroits, ou entre-deux. Mais il y a des
piés forcément tournés en-dehors, & d’autres forcément
tournés en-dedans : cette difformité plus ou
moins grande vient à l’enfant, de naiflanc.e ou d’accident.
Quand c’eft de naiffance, il faut que la nourrice
effaie tous les jours de lui tourner doucement les
piés dans le fens naturel, & d’obferver de les lui af-
fujettir par l’emmaillottement ; comme les ligamens
font alors extrêmement tendres, ils céderont peut-
être infenfiblement à la tournure naturelle qu’on leur
fera contrarier.
Si la mauvaife tournure a été long-tems négligée
ou qu’elle vienne d’accident, ou que l’enfant foit déjà
un peu grand, on tâchera d’y remédier par les
moyens fuivans. i° . En recourant à des remedes capables
de ramollir les ligamens, comme font les fomentations
avec les bouillons de tripes, les friéfions
avec l’huile de lis, les cataplafmes de feuilles, de
fleurs, & de racine de guimauve, &c. z°. En efiàyant
tous les jours avec la main de ramener le pié dans fa
fituation naturelle ; y°. en employant pour cela de
forts cartons, ou desatteles de bois, on de petites
platines de métal, qu’op a foin de ferrer avec une
bande,
A a a a i j
Vi