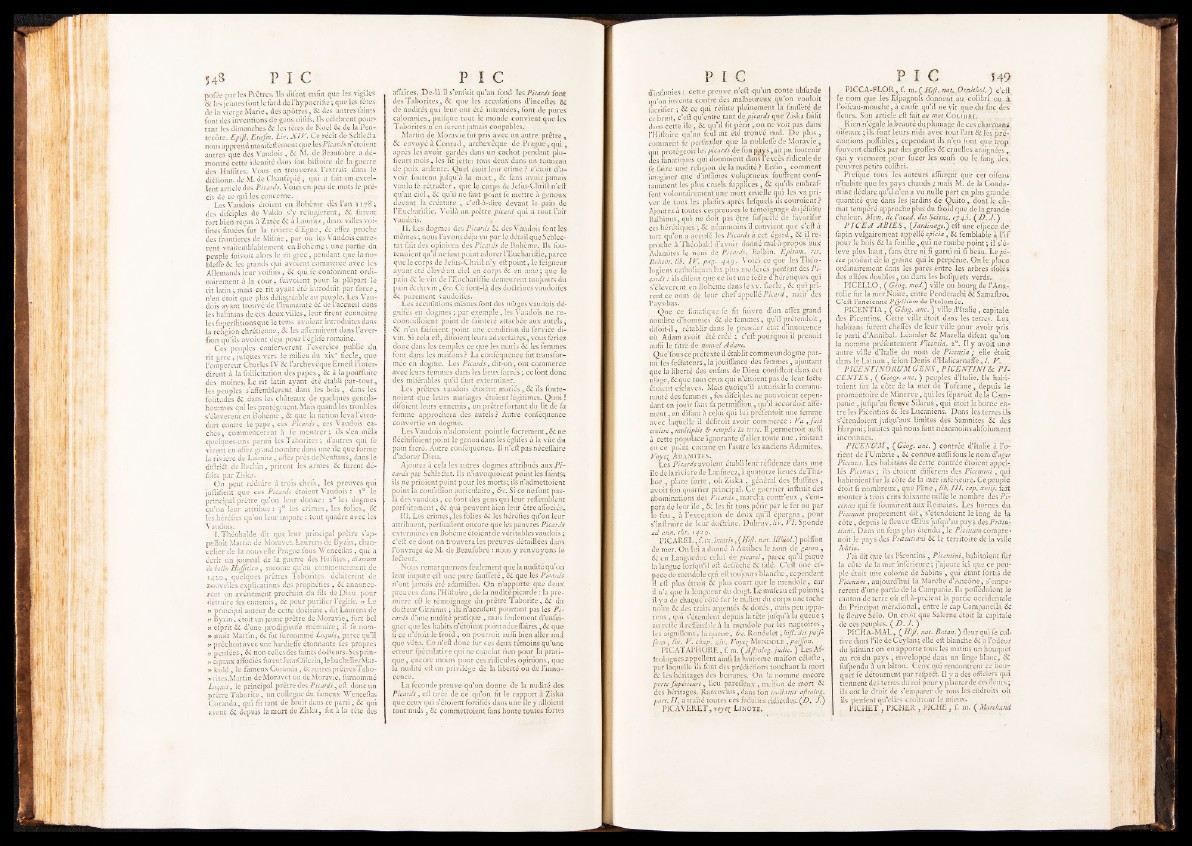
pofée parles Prêtres. Ils difent enfin que les-, vigiles
& les jeûnes font le fard del’hypocrifie ; que les fêtes
de la vierge Marie, des apôtres, 8c des autres faints
font de.s inventions de gens oififs. Ils célèbrent pourtant
les dimanches 8c les fêtes de Noël & de la Pentecôte.
Epifi. Erafm. Liv. X I F . Ce récit de Schlefla
nous apprend manifeftement que,les Picards n’etoient
autres que des Vaudois., 8c M. deSeaufobre a démontré
cette identité dans fon hiftoire de la guerre
des Huffites. Vous en trouverez l’extrait dans le
di&ionn. de M. de Chaufépié , qui a fait un excellent
article des Picards. Voici en peu de mots le précis
de ce qiii les concerne.
Les Vaudois étoient en Bohème dès l’an 1178 ;
des difciples de Valdo s’y réfugièrent, 8c furent’
fort bien reçus à Zatée 8c à Launitz, deux villes voisines
fituées .fur la riviere d’Egne, 8c aflez proche,
des frontières de Mifnie, par où les Vaudois entrèrent
vraifemblablement en Bohème ; une partie du
peuple fuivoit alors le rit grec, pendant que la no-
blefl'e 8c les grands qui avoient commerce avec lés
Allemands leur voifins , 8c qui fe conforment ordinairement
à la cour, Envoient pour la plupart le
rit latin ; mais ce rit ayant été introduit par force,
n’en étoit que plus défagréable au peuple. Les Vaudois
ayant trouvé de l’humanité 8c de l’accueil dans
les habitans de ces deux viiles, leur firent connoître
les fuperftitionsque le tems avoient introduites dans
la religion chrétienne, 8c les affermirent dans l’aver-
fion qu’ils avoient déjà pour l’églife romaine.
Ces peuples conferverent l’exercice public du
rit grec, jufques vers le milieu du xive fiecle, que
l’empereur Charles IV 8c l’archevêque Ernefi: l’interdirent
à la follicitation des papes , 8c à la pouffuite
des moines. Le rit latin ayant été établi par-tout,
les peuples s’affemblerent dans les bois, dans les
folitudes 8c dans les châteaux de quelques gentilshommes
qui les protégoient. Mais quand les troubles
s’élevèrent en Bohème , & que la nation leva l’éten-
dart contre le pape, ces Picards, ces Vaudois cachés
, commencèrent à fe montrer ; ils s’en mêla
quelques-uns parmi les Taborites ; d’autres qui fe
virent en aflez grand nombre dans une île que forme
la riviere de Launitz, afi'ez près deNeuhaus, dans le
diftritt de Bechin, prirent les armes 8c forent défaits
par Ziska.
On peut réduire à trois chefs, les preuves qui
iuftifient que ces Picards étoient Vaudois, : i° le
principal prêtre qu’on leur donne : 20 les dogmes
qu’on leur attribue: 30 les crimes, les folies, 8c
les héréfies qu’on leur impute : tout quadre avec les
Vaudois.
I. Théobalde dit que leur principal prêtre s’ap-
pelloit Martin de Moravet. Laurens de Byzin, chancelier
de la nouvelle Prague fous \Venceflas , qui a
écrit un journal de la guerre des Huflites, diarium
dt bdlo HuJJhico , raconte qu’au commencement de
1420, quelques prêtres Taborites débitèrent de
nouvelles explications des prophéties , 8c annoncèrent
un avènement prochain du fils de Dieu pour
détruire fes ennemis, 8c pour purifier l’églife. » Le
» principal auteur de cette doctrine, dit Laurens de
» Byzin, étoit un jeune prêtre de Moravie , fort bel
». efprit 8c d’une prodigieufe mémoire ; il fe nom-
» moit Martin, 8c fut furnommé Loquis, parce qu’il
» prêchoit avec une hardiefle étonnante fes propres
» penfées, 8c non celles des faints docteurs. Ses prin-
» cipaux aflociés furent JeanOilczin, le bachelierMar-
» k old, le fameux Coranda, 8c autres prêtres Tabo-
» rites.Martin de Moravet ou de Moravie, furnommé
Loquis, le principal prêtre des Picards, eft donc un
prêtre Taborite, un collègue du fameux 'Wenceflas
Coranda, qui fit tant de bruit dans ce parti, 8c qui
avant 8c depuis la mort de Ziska, fut à la tête des
affaires. De-là il s’enfuit qu’au fond les Picards font
des Taborites, 8c que les accufations d’inceftes 8c
de nudités qui leur ont été intentées, font de pures
calomnies, piiifque tout le monde convient que les
Taborites n’en furent jamais coupables.
Martin de Moravie fut pris avec un autre prêtre ,
8c envoyé à Conrad, archevêque de Prague, q u i,
après les avoir gardés dans un cachot pendant plu-
fieursmois, les fit jetter tous deux dans un tonneau
de poix ardente. Quel étoit leur crime ? c’étoit d’avoir
foutenu jufqu’à la mort, 8c fans avoir jamais
voulu fe rétra&er, que le corps de Jefus-Chrift n’eft
qu’au c ie l, 8c qu’il ne faut point fe mettre à genoux
devant la créature , c’ eft-à-dire devant le pain de
l’Euchariftie. Voilà un prêtre picard qui a tout l’air
Vaudois., .
II. Les dogmes des Picards 8c des Vaudois font les
mêmes ; nous l’avons déjà vu par le détail que Schlec-
tat fait des opinions des Picards de Bohème. Us fou-
tenoient qu’il ne faut point adorer l’Euchariftie, parce
que le corps de Jefus-Chrilt ri’y eft point, le feigneur
ayant été élevé au ciel en corps 8c en amc ; que le
pain 8c le vin de l’Euchariftie demeurent toujours du
pain Scduv'in,&c. Cefont-là des doûrines vaudoifes
8c purement vaudoifes.
Les accufations mêmes font des ufages vaudois dé-
guifés en dogmes ; par exemple, les Vaudois ne re-
connoifloient point de fainteté attachée aux autels,
8c n’en faifoient point une condition du fervice divin.
Si cela eft, difoient leurs adverfaires, vous feriez
donc dans les temples ce que les maris 8c les femmes
font dans les maifons ? La conféquence fut transformée
en dogme. Les Picards, dit-on, ont commerce
avec leurs femmes dans les lieux facréà.; ce font donc
des miférables qu’il faut exterminer.
Les prêtres vaudois étoient mariés, 8c ils foute-
noient que leurs mariages étoient légitimes. Quoi l
difoient leurs ennemis, un prêtre fortant du lit de fa
femme approchera des autels ? Autre conféquence
convertie en dogme.
Les Vaudois n’adoroient point le facrement, 8c ne
fléchifloient point le genou dans les églifes à la vue du
pain facré. Autre conféquence. Il n’eft pas néceflaire
d’adorer Dieu.
Ajoutez à cela les autres dogmes attribués aux Picards
par Schle&at. Ils n’invoquoient point les faints;
ils ne prioient point pour les morts; ils n’admettoient
point la confefîïon auriculaire, &c. Si ce ne font pas-
là des vaudois, ce font des gens qui leur reflemblent
parfaitement, 8c qui peuvent bien leur être aflociés.
III. Les crimes, les folies 8c les héréfies qu’on leur
attribuent, perfuadent encore que les pauvres Picards
exterminés en Bohème étoient de véritables vaudois ;
c ’eft ce dont on trouvera les preuves détaillées dans
l’ouvrage de M. de Beaufobre : nous y renvoyons le
leéleur.
Nous remarquerons feulement que la nudité qu’on
leur impute eft une pure faufleté, 8c que les Picards
n’ont jamais été adamiftes. On n’apporte que deux
preuves dans l’Hifto>re, de la nudité picarde : la première
eft le témoignage du prêtre Taborite, 8c du
docteur Gitzinus ; ils n’accufent pourtant pas les P icards
d’une nudité pratique , mais feulement d’enfei-
gner que les habits n’étoient point néceflaires, 8c que
fi ce n’étoit le froid , on pourroit aufli bien aller nud
que vêtu. Ce n’eft donc fur ces deux témoins qu’une
erreur fpéculative qui ne conclut rien pour la pratique
, encore moins pour ces ridicules opinions, que
la nudité eft un privilège de la liberté ou de l’innocence.
La fécondé preuve qu’on donne de la nudité des
Picards , eft tirée de ce qu’on fit le rapport à Ziska
que ceux qui s’étoient fortifiés dans une île y alloient
tout nuds, 8c commettoient fans honte toutes fortes
d’infamies : cette preuve n’eft qu’un conte abfurde
qu’on inventa contre des malheureux qu’on vouloit
facrifier ; 8c ce qui réfute pleinement la faufièté de
ce bruit, c’eft qu’entre tant dç picards que Ziska faifit
dans cette î le , 8c qu’il fit périr j-on ne voit pas dans
l’Hiftoire qu’un feul ait été trouvé riud. De plvis ,
comment fe perfùader que la noblefle de Moravie,
qui protégeoit les picards de fon pjiys, ait pu foutenir
des fanatiques qui donnoient dans l’excès ridicule de
fe faire une religion de la nudité? Enfin, comment
imaginer que d’infames voluptueux fouffrent conf-
iamment les plus cruels fupplices , 8c qu’ils embraf-
fent volontairement une mort' cruelle qui les va priver
de tous les plaifirs après lefquels ils couroient ?
Ajoutez à toutes ces preuves le témoignage du jéfuite
Balbinus, qui ne doit pas être fufpetlé de favorifer
ces hérétiques ; 8c néanmoins il convient que c’êft à •
tort qu’on a accufé les Picards à cet egard, 8c il reproche
à Théobald d’avoir donné mal-à-propos aux
Adamites le nom de Picards. Balbin. Epitom. rér,
Bohem.lib. IF . pag. 449. Voici ce que les Théologiens
catholiques les plus modérés pènfent des Picards
: ils difent que ce fut une fe&e d’hérétiques qui
s’élevèrent en Bohème dans le xv. fiecle, 8c qui prirent
ce nom de leur chef appellé Picard, natif des
Pays-bas.
Que ce fanatique, fe fit foivre d’un aflez grand
nombre d’hommes 8c de femmes,' qu’il pretendoit,
difoit-il, rétablir dans le premier état' d’innocence
où Adam avoit été créé ; c’ eft polif quoi il prerioit
aufli le titre de nouvel Adam.
Que'fous ce prétexte il établit comme un dogme parmi
fes fe&ateurs, la jouifîânce des femmes, ajoutant
que la liberté des| enfans de Dieu confiftoit dans cet
ufage, 8c que tous ceux qui n’étoient pas de leur féôe
étoient eiclaves. Mais quoiqu’il autorisât la communauté
des femmes , fes difciples ne pouvoient cependant
en jouir fans fa permilfion, qu’il accordoit aifé-
ment, en difant à celui qui lui prefentoit une femme
avec laquelle il dé.firoit avoir commerce : Va , fais
Croître, multiplie & remplis la terre. 11 permettait aufli
à cette populace ignorante d’aller toute nue, imitant
en ce point comme en l’autre les anciens Adamites.
Foyei A damites.
Les Picards avoient établi leur réfidence dans une
île de la riviere de Lanfnecz, à quatorze lieues deTha-
bor , place forte, où Ziska , général des Huflites ,
avoit Ion quartier principal. Ce guerrier inftruit des
abominations des Picards, marcha contr’eux , s’empara
de leùr île , 8c les fit tous périr par le fer ou par
le feu , à l’exception de deux qu’il épargna, pour
s’inftruire de leur doôrine.' Dubrav. liv. F l. Sponde
ad ann. chr. /420. ..
PICAREL ,f. m. imaris, nat. Iclluol.') poifîorj
de mer. On lui a donné à Antibes le nom de garon ,
8c en Languedoc celui de p i c a r d , parce qu’il pique
la langue lorfqu’il eft defiëché 8c falé. C’eft une efi-
pece de mendole qui eft toujours blanche, cependant
il eft plus étroit 8c plus court que la mendole, car
il n’a que la longueur du doigt. Le mufeau eft pointu ;
il y a de chaque côté fur le milieu du corps une tache
noire 8c des traits argentés 8c dorés, mais peu appa-
rens , qui s’étendent depuis la tête jufqu’à la queue ;
au refte il réflemble à la mendole par les nageoires ,
les aiguillons , la queue, & c . Rondelet, h ijl. d e sp o if-
f o n s , liv . F. chap. x iv . Voye^ MENDOLE ^poiffon.
P1CATAPHORE, f. m. ( Ajlrolog. judic. ) Les Af-
trologues appellent ainfi la huitième maifon céleftc,
par laquelle ils font des prédirions touchant la mort
8c les héritages des hommes. On la nomme encore
porte fupérieure, lieu parefleux , maifon de mort 8c
des héritages. Ranzovius, dans fon iraclatus aflrolog.
part. II. a traité toutes ces fadaifes ridicules. {D, f .)
PICAVERET, voye{ Linote.
PICCA-FLOR , f. m. ( HiJl. nat^Ot,nkhol. ) c’eft
le nom que les Efpagnols donnent au colibri..ou..à.
l’oifeau-mouche, à caufe qu’ il ne vit que du fuç qes
fleurs. Son article eft fait«« jpot, -Colibri.,
Rien n’égale la beauté dupluriiage de ces charmant
oifeaux ; ils font leurs nids avec tout l’art 8c les^pre-
cautions poffibles; cependant ils,n’en font que trop'
fouvent chafles par des grofles 8c cruelles araign.êjes
qui y viennent pour fucer les oevus ou le fâng desÇ
pauvres petits colibri.
’ Prefqüe fous ' lés auteurs âflii’rerit que cet oifeau
n’habite que les pays chauds ; mais M. de la Conda-'
mine déclare qu’il n’en a yû nulle part en plus gran.de.
quantité que dans les jardins de.Quito, dont.le.climat.
tempéré approche plus' du froid que de la grande •
dhaleur. Mem. de l'acad. des Scierie.. 17 4S. (Z?. 7. )
P IC E A A B 1E S , (.Jardinage.) eft une efp.ece de.
fapin vulgairement appellé epicia , 8c femblable à .l’if
pour le bois Si la feuille, qui ne tombe point ; il s’élève
plus haut, fans être ni fi garni ni fi beau. Le pi- ;
cea produit de la graine qui le perpétue. On le place.
ordinairèmënt dans les parcs entre les arbres ifolés
des allées doubles, ou dans les bofquets verds.
PICELLO, ( Géog. rtiod.') ville ou bourg de l’Anatolie
fur la mer Noire, entre Pendërachi 8c Samaftroi
C’eft l’ancienne PfyIlium de Ptolo.mée.
PICENTIA, ( Géog. anc. ) 'ville d’Italie, capitale
des Picentins. Cette' ville étoit dans les terres. Les,
habitans furent chafles de lèiir ville pour avoir pris
le parti d’Annibal. Léander 8c Mazella difent qu’on
la nomme préfentement Ficentia. i° . Il y avoit une
autre ville d’Italie du non! de Picenda ; , elle étoit.
dans le Latium , félon Denis d’Halicarnafle, l. F.
PICENTÎNORUM G EN S , P ICENTINl 8c P I-
CENT E S , ( Géogr. anc. ) peuples d’Italie. Ils habi-
toient fur la côte de la mer de Tofcarie, depuis, le
promontoire de Minerve, qui les féparoit de la Campanie
, jufqu’au fleuve Silarus , qui étoit la borne entre
les Picentins 8c les Lucaniens. Dans les .terres.ils
s’étendoient jufqu’aux limites des Samnites 8c clés
Harpini ; limites qui nous font néanmoins absolument
inConnùgs.^
PICENUM, (Géog. ànc. ) contrée d’Italie à l’orient
de l’Umbrie , 8c connue-aufli fous le nom d’ager
Picenus. Les habitans de cetté Contrée étoient appel-
lés Picentes )J ils étoient différens des Pïcendni, qui
habitoient fur la côte de la mer inférieure. C e peuple
étoit fi nombreux, que Pline, lib. III, cap ', xviij. fait
monter à trois cens foixante mille le nombre des P i centes
qui fe fournirent aux Romains. Les bornes du
Picenum proprement dit, s’étendoiënt le long de la
côte, depuis le fleuve OEfus jufqu’au pays des Prçetu-
tiani. Dans un fens plus étendu, le Picenum compre-
noit le pays des Prcztutiani 8c le territoire de la ville
Adrià. |
J’ai dit que les Picentins , Picendni, habitoient fur
la côte de la mer inférieure ; j’ajoute ici que ce peuple
étoit une colonie de Sabins , qui étant fortis de
Picenum , aujourd’hui là Marche d’Ancône, s’emparèrent
d’une partie de la Campanie. Ils pofledoient le
canton de terre où eft à-préfent la partie’ occidentale
du Principàt méridional, entre le cap Campanella Si
le fleuve Sélo. On croit que Salerne étoit la capitale
de ces peuples. ( D . J. )
PICHA-MAL, ( Hifi. nat. Botan. ) fleur qui fe cultive
dansTîle de Ceylan ; elle eft blanche 8c a l’odèur
du jafmin : on en apporte tous les matins un bouquet
au roi du pays , enveloppé dans un linge blanc, 8c
fufpendu à un bâton. Ceux qui rencontrent ce bouquet
fe détournent par refpeét. Il y a des officiers qui
tiennent des terres du roi pour y planter de ces fleurs ;
ils oiit le droit de s’emparer de tous les endroits où
ils penfent qu’elles croîtront le mieux. •
. . PICHET , PICHER , PICHE, f. m. ( Marchand