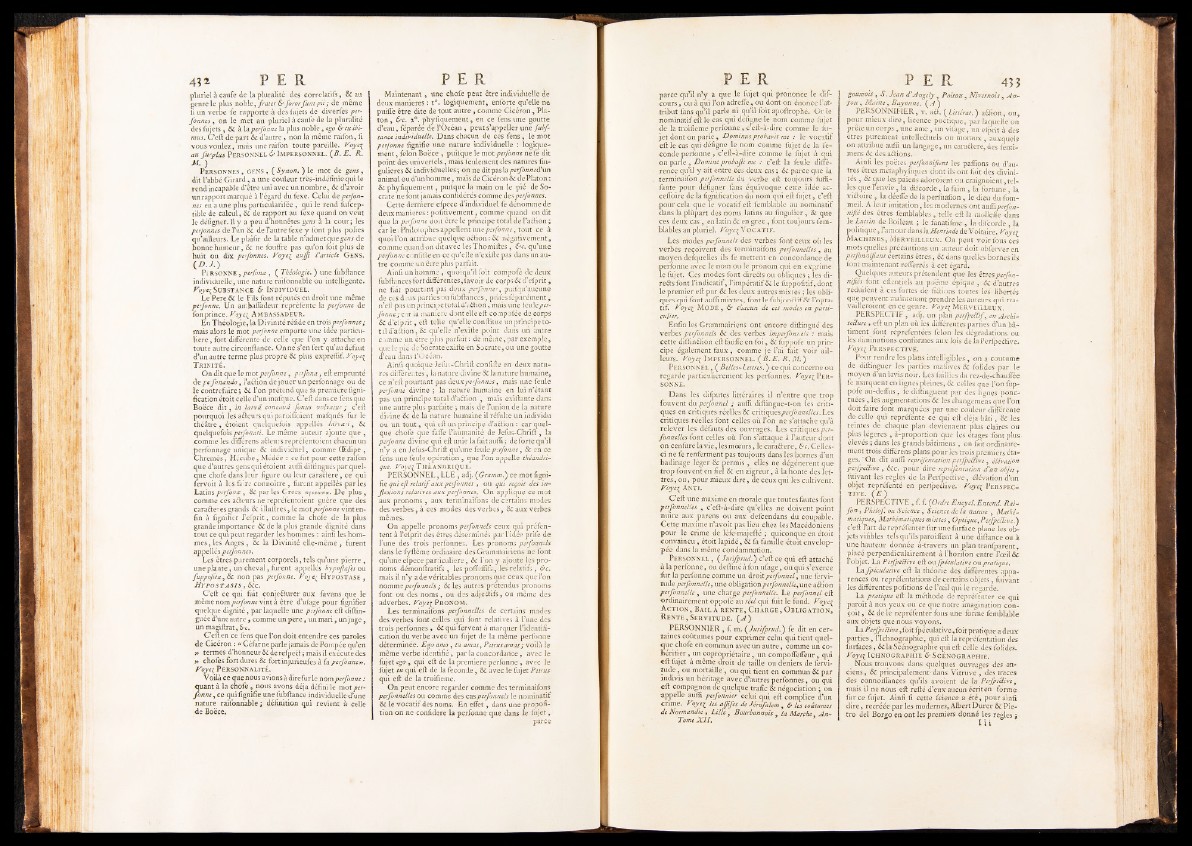
pluriel à caufe de la pluralité des corrélatifs, 6c au
genre le plus noble, ƒrater 6* foror funtpii; de même
li un verbe fe rapporte à des fujets de diverfes per-
Jonnes, on le met au pluriel à caufe de la pluralité
des fujets, & à la perforine la plus noble, ego & tu ibi-
mus. C’eft de part 6c d’autre, non la même raifon, fi
vous voulez, mais une raifon toute pareille. Voye^
au furplus P e r s o n n e l & IMPERSONNEL. ( B. E. R.
M. )
P e r s o n n e s , g e n s , ( Synon. ) le mot de gens,
dit l’abbé G irard, a une couleur très-indéfinie qui le
rend incapable d’être uni avec un nombre, & d’avoir
un rapport marqué à l’égard du l'exe. Celui de perfon-
nes en a une plus particularifée , qui le rend fufcep-
tible de calcul, 6c de rapport au fexe quand on veut
le défigner. Il y a peu d’honnêtes gens a la cour; les
perjonnes de l’un & de l’autre fexe y font plus polies
qu’ailleurs. Le plaifir de la table n’admet que gens de
bonne humeur, 6c ne fouffre pas qu’on foit plus de
huit ou dix pefonnes. Voye£ aufjî L'article G e n s . 1111
P e r s o n n e , perfona , ( Théologie. ) u n e fu b fta n c e
in d iv id u e lle , u n e n a tu r e ra ifo n n a b le o u in te llig e n te .
/ ^ « { S u b s t a n c e 6* In d i v i d u e l .
Le Pere & le Fils font réputés en droit une même
pefonne. Un ambaffadeur repréfente la perfonne de
fon prince. Voyei A m b a s s a d e u r .
En Théologie, la Divinité réfide en troisperfonnes;
mais alors le mot perfonne emporte une idée particulière
, fort différente de celle que l’on y attache en
toute autre circonftance. On ne s’en fert qu’au défaut
d’un autre terme plus propre 6c plus expreflif. Foye^
T r i n i t é .
On dit que le mot perfonne, perfona, eft emprunté
de perfonando, l’a&ion de jouer un perfonnage ou de
le contrefaire ; 6c l’on prétend que fa première figni-
fication étoit celle d’un mafque. C’eft dans ce fens que
Boëce d i t , in larvâ concavâ fonus volvaïur ; c’eft
pourquoi les afteurs qui paroifloient mafqués fur le
théâtre, étoient quelquefois appelles l in a u , &
quelquefois perfonati. Le même auteur ajoute que ,
comme les différens a&eurs repréfentoient chacun un
perfonnage unique 6c individuel, comme (Edipe ,
Chremès, Hécube, Médée : ce fiit pour cette raifon
que d’autres gens qui étoient auffi diltingués par quelque
chofe dans leur figure ou leur caractère, ce qui
fervoit à les faire connoître , furent appelles par les
Latins perfona , 6c par les Grecs nfoeuva. De plus,
comme ces aâeurs ne repréfentoient guère que des
cara&eres grands & illuftres, le mot perfonne vint enfin
à lignifier l’efprit, comme la chofe de la plus
grande importance 6c de la plus grande dignité dans
tout ce qui peut regarder les hommes : ainfi les hommes
, les Anges , 6c la Divinité elle-même , furent
appelles perfonnes.
Les êtres purement corporels, tels qu’une pierre ,
ime plante, un cheval, furent appelles hypoftafes ou
fuppofita, & non pas perfonne. VoytK HYPOSTASE ,
Hy p o s t a s i s &c.
C’eft ce qui fait conjeâurer aux favans que le
même nom perfonne vint à être d’ufage pour fignifier
quelque dignité, par laquelle une perfonne eft diftin-
guée d’une autre , comme un pere, un mari, un juge,
un magiftrat, 6-c.
C’eft en ce fens que l’on doit entendre ces paroles
de Cicéron : «Céfar ne parle jamais de Pompée qu’en
» termes d’honneur 6c de refpeét ; mais il exécute des
» chofes fort dures 6c fortinjurieufes à fa perfonne».
Voyei P e r s o n n a l i t é .
Voilà ce que nous avions à dire fur le nom perfonne :
quant à la cnofe , nous avons déjà défini le mot personne
, ce qui fignifie une fubftance individuelle d’une
nature raifonnable ; définition qui revient à celle
de Boëce.
Maintenant, une chofe peut être individuelle de
deux maniérés : i°. logiquement, enforte qu’elle ne
puifle être dite de tout autre, comme Cicéron, Platon
, &c. i° . phyfiquement, en ce fens une goutte
d’eau, féparée de l’Océan , peut s’appeller une fubftance
individuelle. Dans chacun de ces fens, le mot
perfonne fignifie une nature individuelle : logiquement
, félon Boëce , puilque le mot perfonne ne fe dit
point des univerlels, mais feulement des natures fiu-
gulieres 6c individuelles; on ne dit pas la perfonneà’un
animal ou d’un homme, mais de Cicéron 6c de Platon :
6c phyfiquement, puilque la main ou le pie de Socrate
ne font jamais coniidérés comme des perfonnes.
Cette derniere efpece d’individuel fe dénomme de
deux maniérés : pofitivement, comme quand on dit
que la perfonne doit être le principe total de l’a&ion ;
car le ; Philofophes appellent une perfonne, tout ce à
quoi l’on attribue quelque adrion : 6c négativement,
comme quand on dit avec lesThomift.es , &c. qu’une
perfonne ccnlifte en ce qu’elle n’exifte pas dans un autre
comme un être plus parfait.
Ainfi un homme , quoiqu’il foit compofé de deux
fubftances fort différentes, lavoir de CQrps&d’efprit,
ne fait pourtant pas deux perfonnes, puilqu’aucune
de ces deux parties ou fubftances, prifes féparément,
n’eft pas un principe total d’adrion, mais, une feule perfonne;
car la manière dont elle eft compofée de corps
& d’ef prit, eft telle qu’elle conftilue un principe to-
t il d’a&ion, 6c qu’elle n’exifte point dans un autre
comme un êrre plus parfait : de même, par exemple,
que le pic de Socrate exifte en Socrate, ou une goutte
d’eau dans l’Océan.
Ainfi quoique Jefus-Chrift confifte en deux natures
différentes, la nature divine 6c la nature humaine,
ce n’eft pourtant pas deux perfonnes, mais une feule
pefonne divine ; la nature humaine en lui n’étant
pas un principe total d’adtion , mais exiftante dans
une autre plus parfaite ; mais de l’union de la nature
divine 6c de la nature humaine il réfulte un individu
ou un tou t, qui eft un principe d’adtion : car quelque
chofe que faffe l’humanité de Jefus-Chrift , la
perfonne divine qui eft unie la fait auffi ; de forte qu’il
n’y a en Jefus-Chrift qu’une feule perfonne, & en ce
fens une feule opération, que l’on appelle théandri-
que. Foye{ T HÉ ANDR1QU É.
PERSONNEL, L L E , adj. ( Gramm.) ce mot fignifie
qui ejl relatif aux perfonnes , ou. qui reçoit des inflexions
relatives aux perfonnes. On applique ce mot
aux pronoms , aux terminaifons de certains modes
des verbes, à ces modes des verbes, 6c aux verbes
mêmes.
On appelle pronoms perfonnels ceux qui préfen-
tent à l’efprit des êtres déterminés par l'idée prife de
l’une des trois perfonnes. Les pronoms perfonnels
dans le fyftème ordinaire des Grammairiens ne font
qu’une efpece particulière, 6c Ton y ajoute les pronoms
démonftratifs , les poffeffifs, les relatifs , &c.
mais il n’y a de véritables pronoms que ceux que l’on
nomme perfonnels ; & les autres prétendus pronoms
font ou des noms, ou des adjedtifs, ou même des
adverbes. Voye\ P r o n o m .
Les terminaifons perfonnelles de certains modes
des verbes font celles qui font relatives à l’une des
trois perfonnes , 6c qui fervent à marquer l’identification
du verbe avec un fujet de la meme perfonne
déterminée. Ego amo, tu amas, Petrusamat; voilà le
même verbe identifié, par la concordance, avec le
fujet ego , qui eft de la première perfonne , avec le
fujet tu qui eft de la fécondé, 6c avec le fujet Petrus
qui eft de la troifieme.
On peut encore regarder comme des terminaifons
perfonnelles ou comme des cas perfonnels le nominatif
6c le vocatif des noms. En effet, dans une propofi-
tion on ne confidere la perfonne que dans le fujet,
parce
parce qu’il n’y a que le fujet qui prononce îe discours
, ou à qui l’on adrefl'e, ou dont on énonce l’attribut
fans qu’il parle ni qu’il foit apoftrophé. Or le
nominatif eft le cas qui défigne le nom comme fujet
de la troifieme perfonne, e’eft-à-dife comme le fujet
dont on parle , Dominasprobavit me : le vocatif
eft le cas qui défigne le nom comme fujet de la fécondé
perfonne, c’eft-à-dire comme le fujet à qui
on parle , Domine probafli me : c’eft la feule différence
qu’il y ait entre ces deux cas ; 6c parce que la
terminaifon perfonnelle du verbe eft toujours fuffi-
fante pour défigner fans équivoque cette idée ac-
ceffoire de la lignification du nom qui eft fujet, c’eft
pour cela que le vocatif eft femblable au nominatif
dans la plupart des noms latins au fingulier , & que
ces deux cas , en latin 6c en grec , font toujours fem-
blables au pluriel. FoyefWOCATIF.
Les modes perfonnels des verbes font ceux où les
verbes reçoivent des terminaifons perfonnelles , au
moyen desquelles ils fe mettent'en concordance de
perfonne avec le nom ou le pronom qui en exprime
le fujet. Ces modes font diredfs ou obliques ; les di-
re&s font l’indicatif, l’impératif 6c le fuppofitif, dont
le premier eft pur 6c les deux autres mixtes ; les obliques
qui font auffi mixtes, font le fubjondtif 6c l’optatif.
F?ye\_ M o d e , & chacun de ces modes en parti-
culier.
Enfin les Grammairiens ont encore diftingüé des
Verbes perfonnels 6c des verbes imperfom.els : mais
cette diftindrion eft fauffe en fo i, 6c fuppofe un principe
également faux, comme je l’ai fait voir ailleurs.
V.oye^ Im p e r s o n n e l . ( B .E . R. M. )
P e r s o n n e l , ( Belles-Lettres. ) ce qui concerne ou
regarde particulièrement les perfonnes. Voyeç P e r s
o n n e . .
Dans les difputes littéraires il n’entre que trop
fouvent du perfonnel ; auffi diftingue-t-on les critiques
en critiques réelles 6c critiques perfonnelles. Les
critiques réelles font celles où l’on ne s’attache qu’à
relever les défauts des ouvrages. Les critiques per-
fonnelles font celles où l’on s’attaque à l’auteur dont
on cenfure la v ie , les moeurs, le caraftere, &c. Celles-
c i ne fe renferment pas toujours dans les bornes d’un
badinage . léger 6c permis , ellqs ne dégénèrent que
trop fouvent en fiel 6c en aigreur, à la honte des lettres,
ou, pour mieux d ire, de ceux qui les cultivent.
Voye{ A n t i .
C ’eft une maxime en morale que toutes fautes font
perfonnelles , c’eft-à-dire qu’elles ne doivent point
nuire aux parens ou aux defeendans du coupable.
Cette maxime n’avoit pas lieu chez les Macédoniens
pour le crime de léfe-majefté ; quiconque en étoit
convaincu, étoit lapidé, 6c fa famille étoit enveloppée
dans la même condamnation.
P e r s o n n e l , ( Jurifprud. ) c’eft ce qui eft attaché
à la perfonne, ou deftiné à fon ufage, ou qui s’exerce
fur la perfonne comme un droit perfonnel, une fervi-
tude perfonnelle, une obligation perfonnelle, une adrion
perfonnelle , une charge perfonnelle. Le perfonnel eft
ordinairement oppofé au réel qui fuit le fond. Voye\[
A c t i o n , B a i l a r e n t e , C h a r g e , O b l i g a t i o n ,
R e n t e , S e r v i t u d e , ( a/ )
PERSONNIER, f. m. ( Jurifprud. ) fe dit en certaines
coutumes pour exprimer celui qui tient quelque
chofe en commun avec un autre, comme un coheritier
, un copropriétaire, un compofTeflëur, qui
e ft fujet à meme droit de taille ou deniers de fervi-
tude, ou mortaille', ou qui tient en commun 6c par
indivis un héritage avec d’autres perfonnes, ou qui
eft compagnon de quelque trafic 6c négociation ; on
appelle auffi perfonnier celui qui eft complice d’un
crime. Foye^ les affifes de Jèrufalem, & les coutumes
de Normandie, Lille, Bourbonnois la Marche An-
Tome X I I . V
goumois, S, Jean d’Angely, Poitou, Nivernois, Anjou
, Maine, Bayônne. CA}
PERSONNIFIER, v. a£h ( Littéral. ) â â ion , ou*
pour mieux dire, licence poétique, par laquelle on
prête un corps , une ame , un vifage, un efprit à des
etres puremeni. mtelleéhiels ou moraux, auxquels
on attribue auffi un langage, un caraétere, des fenti-
mens 6c des aérions.
Ainfi les poëtes perfonnifient les paffions oïl d’autres
êtres métaphyliques dont ils ont fait des divinités
, 6c que les païens adoroient ou craignoient, telles
que l’envie , la difeorde, la faim, la fortune , la
victoire , la déeffe de la perfuafion, le dieu du fom-
meil. A leur imitation, les modernes ont auffiperfon-
nijié des êtres femblables , telle eft la molleflë dans
le Lutrin de Boileau ; le fanatifme , la difeorde , la
politique, l’amour dans la Henriade de Voltaire. Voye%_
Machin es, Merveilleux. On peut voir fous ces
mots quelles précautions un auteur doit obferver en
perfonnifiant certains êtres, 6c dans quelles bornes ils
font maintenant refferrés à cet égard.
Quelques auteurs prétendent que les êtresperfon-
nifiés font eflentiels au poëme epiqtie, 6c d’autres
réduifent à ces fortes de fi étions toutes les' libertés
que peuvent maintenant prendre les auteurs qui tra-
vailleroient en ce genre. Voye{ Merveilleux.
PERSPECTIF , adj. un plan perfpeclif, en Architecture
, eft un plan où les différentes parties d’un bâtiment
font reprefentées félon les dégradations ou
les diminutions conformes aux lois de la Perfpeétive.
Foy_e[ P e r s p e c t i v e .
Pour rendre les plans intelligibles , on a Coutume
de diftinguer les parties mafiives 6c folides par le
moyen d’un lavis noir. Les faillies du rez-de-chauffée
fe marquent en lignes pleines, 6c celles que l’on fuppofe
au-defîùs , fe diftinguènt par des lignes ponctuées
,le s augmentations 6c les changemens que l’on
doit faire font marquées par une couleur différente
de celle qui repréfente ce qui eft déjà bâti, 6c les
teintes de chaque plan deviennent plus claires ou
plus légères , à-proportion que les etages font plus
élevés ; dans les grands bâtimens , on fait ordinairement
trois différens plans pour les trois premiers étages.
' On dit auffi repréfentation perfpeciive , élévation
perfpective , & c . pour dire repréfentation d'un objet )
füivant les réglés de la Perfpective, élévation d’un
objet repréfenté en perfpeétive. Voyer P e r s p e c t
i v e . ( E )
PERSPECTIVE, f. f. (Ordre Encycl. Entend. Raifon
, Philof: ou Science , Science de la nature , Mathématiques,
Mathématiques mixtes, Optique,Perfpective.')
c’eft l’art de repréfenter fur une furface plane les objets
vifibles tels qu’ils paroiffent à une diftance ou à
une hauteur donnée à-travers, un plan tranfparent,
placé perpendiculairement à l’horifon entre l’oeil 6c
l’objet. La Perfpective eft ou fpéculative ou pratique.
La fpéculative eft la théorie des différentes apparences
ou repréfentations de certains objets, fuivant
les différentes polirions de l’oeil qui le regarde.
La pratique eft la méthode de repréfenter ce qui
paroît à nos yeux ou ce que notre imagination conçoit
, & de le repréfenter fous une forme femblable
aux objets que nous voyons.
La Perfpective, foit fpéculative, foit pratique a deux
parties , l’Ichnographie, qui eft la repréfentation des
furfaces, 6c la Scénographie qui eft celle des folides.
Vjy e[ Ichnographie & Scénographie.
Nous trouvons dans quelques ouvrages des .anciens
, 6c principalement- dans Vitruve , des traces
des connoiffances qu’ils avoient de la Perfpective,
mais il ne nous eft refté d’eux aucun écrit en forme
fur ce fujet. Ainfi fi cette fcience a été, pour ainfi
dire, recréée par les modernes, Albert Durer & Pie-
tro del Borgo en ont les premiers donné les réglés ;