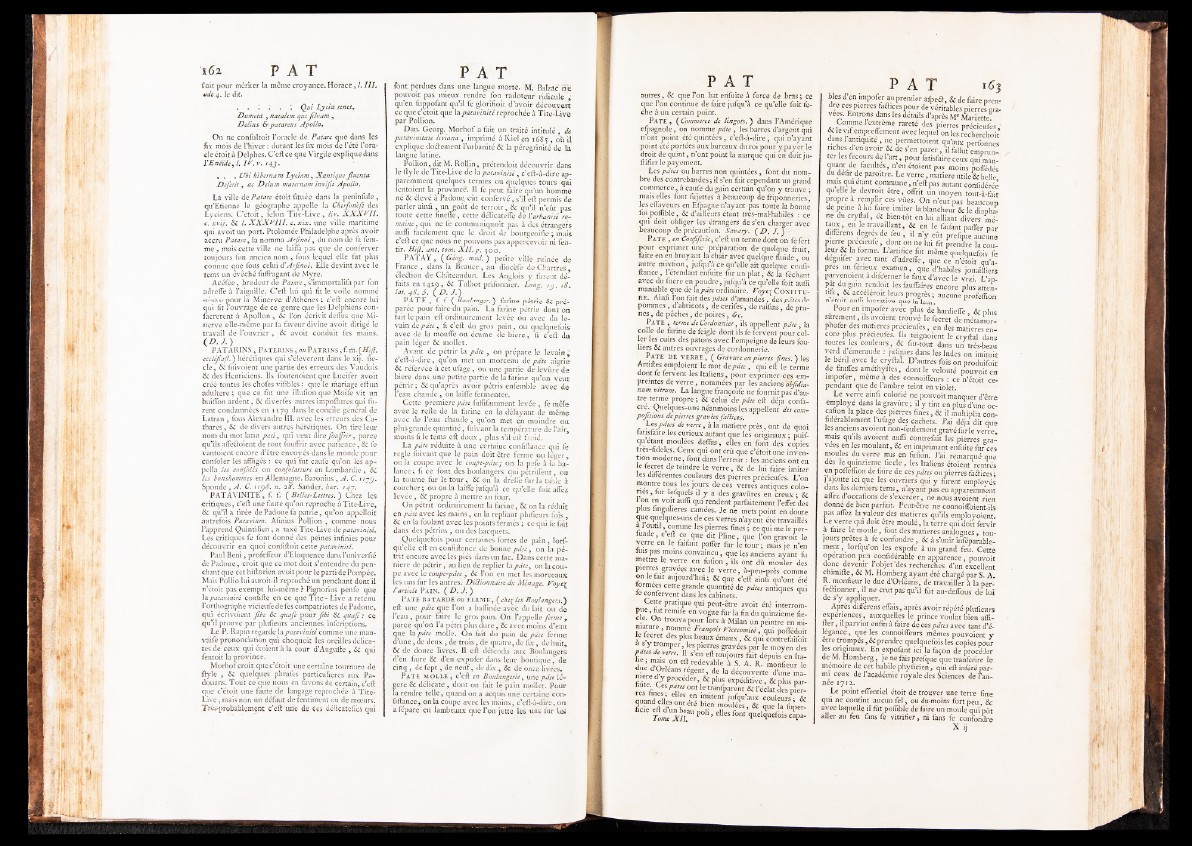
i 6 ï P A T
foit pour mériter la même croyance. Horace, /. III.
edi 4. le dit.
. . Z Z . Z Qui Lycite tcntî.
Dumita y natalcm qui filvam 9
Dclins & patanus Apollo.
On ne confultoit l’oracle de Patare que dans les
fix mois de l’hiver : durant lès fix mois de l’été l’oracle
étoit à Delphes. C’eft ce que Virgile explique dans
Y Enéide y l. IP. v. 143.
. , . Ubi hibernant Lyciam, Xantique jluenta
Deferit, ac Deliim maternant invifit Apollo.
La ville de Patare étoit lituée dans la peninfule ,
qu’Etienne le géographe appelle la Cherfon'efe des
Lyciens. C’étoit, lelon T ite-L iv e, liv. X X X V I I .
c. xvij. & l. X X X V I I I . c. xix. une ville maritime
qui avoit un port. Ptolomée Philadelphe après avoir
accru Patare, la nomma Arjinoé, du nom de fa femme
, mais cette ville ne laifla pas que de confërver
toujours fon ancien nom , fous lequel elle fut plus
connue que fous celui d’Arjinoé. Elle devint avec le
tems un évêché fuffragant de Myre.
Acéfée, brodeur de Patare, s’immortalifa par fon
adreffe à l’aiguille. C’eft lui qui fit le voile nommé
m-nhov pour la Minerve d’Athenes ; c’eft encore lui
qui fit l’ouvrage de ce genre que les Delphiens con-
facrerent à Apollon , & l’on écrivit defliis que Minerve
elle-même par fa faveur divine avoit dirigé le
travail de l’ouvrier , & avoit conduit fes mains.
( D . J . )
PATARINS, Paterins , ou Patrin s , f. m. (H ijl.
eccléjiafl. ) hérétiques qui s’élevèrent dans le xij. fie-
cle, & Envoient une partie des erreurs des Vaudois
& des Hcnriciens. Ils foutenoient que Lucifer avoit
Créé toutes les chofes vifibles ; que le mariage eft un
adultéré ; que ce fut une illufion que Moïfe vit un
buiffon ardent, & diverfes autres impoftures cpii furent
condamnées en 1179 dans le concile général de
Latran , fous Alexandre III. avec les erreurs des Cathares
, & de divers autres hérétiques. O.n tire leur
nom du mot latin pati, qui veut dire fouffrir, parce
qu’ils affe&oient de tout louffrir avec patience, & fe
vantoient encore d’être envoyés dans le monde pour
confoler les affligés : ce qui fut caufe qu’on les ap-
pella les confoles ou confolateurs en Lombardie, &
les bonshommes en Allemagne. Baronius, A. C. 1 iyc).
Sponde, A . C. nc/8. n. 28. Sander. hter. t4y.
PATAVINITÉ, f. f. ( Belles-Lettres. ) Chez les
critiques, c’eft une faute qu’on reproche à Tite-Live,
& qu’il a tirée de Padoue fa patrie, qu’on appelloit
autrefois Patavium. Afinius Pollion , comme nous
l’apprend Quintilien, a taxé Tite-Live de patavinité.
Les critiques fe font donné des peines infinies pour
découvrir en quoi confiftoit cette patavinité.
Paul Béni, profeffeur d’Eloquence dansl’univerfié
de Padoue, croit que ce mot doit s’entendre du penchant
que cet hiftorien avoit pour le parti de Pompée.
Mais Pollio lui auroit-il reproché un penchant dont il
n’étoit pas exempt lui-même ? Pignorius penfe que
la pataviniré confifte en ce que T ite - Live a retenu
l’orthographe vicieufe de fes compatriotes de Padoue,
.qui écrivoient Jibe & quafe pour Jibi & quaji : ce
.qu’il prouve par plufieurs anciennes infcriptions.
Le P. Rapin regarde la patavinité comme une mau-
vaife prononciation qui choquoit les oreilles délicates
de ceux qui étoient à la cour d’Augufte , & qui
fentoit la province.
Morhof croit que c’étoit une certaine tournure de
ftyle , & quelques phrafes particulières aux Pa-
douans. Tout ce que nous en favons de certain, c’eft
que c’étoit une faute de langage reprochée à Tite-
Live , mais non un défaut de lentiment ou de moeursl
.Très-probablemçnt c’ eft une de ces déliçateflès qui
P A T
font perdues dans une langue morte. M. Balzac n e
pouvoit pas mieux rendre fon radoteur ridicule ,
qu’en fuppofant qu’il fe glorifioit d ’avoir découvert
ce que c’étoit que la patavinité reprochée à Tite-Live
par Pollion.
Dan. Georg. Morhof a fait un traité intitulé , de.
patàvinitate liviana , imprimé à Kiel en 1685 , oh il
ëxplique do&ement l’urbanité & la péregrinité de la
langue latine.
Pollion, dit M. Rôllin, prétendoit découvrir dans
le ftyle de Tite-Live de la patavinité, c’eft-à-dire apparemment
quelques termes ou quelques tours qui
fentoient la provincê. Il fe peut faire qu’un homme
né & élevé à Padoue. eut confervé, s’il eft permis de
parler ainfi , un goût de terroir , & qu’il n’eût pas
toute cette fineffe, cette délicateffe de Y urbanité romaine
, qui ne fe, communiquoit pas à des étrangers
aufli facilement que le droit de bourgeoifie mais
c’eft ce que nous ne pouvons pas appercevoir ni fen-
tir. Hiß. anc. tom. X I I .p . 300.
P A T A Y , ( Géog. mod. ) petite ville ruinée de
France , dans la Beauce, au diocèfe de Chartres ,
élection de Châteaudun. Les Anglois y furent défaits
en 1419 , & Talbot prifonnier. Long. 19. 18.
lat. 48. 5. ( D . J .)
P A T E , f. f. ( Boulanger.') farine pétrie & préparée
pour faire du pain. La farine pétrie dont on
fait le pain eft ordinairement levée ou avec du levain
ào.pâte, fi c’eft du gros pain, ou quelquefois
avec de la moufle ou écume de biere, fi c’eft du
pain léger & mollet.
Avant de pétrir la pâte , on prépare le levain 9
c’eft-à-d ire, qu’on met un morceau de pâte aigrie
& réfervée à cet u fage, ou une partie de levûre de
biere dans une petite partie de la farine qu’on veut
pétrir ; & qu’après avoir pétris enfemble avec de
l’eau chaude , on laifle fermenter.
Cette première pâte fuffifamment levée , fe mêle
avec le relie de la farine en la délayant de même
avec de l’eau chaude , qu’on met en moindre ou
plus grande quantité, fuivant la température de Pair
moins fi le tems eft doux, plus s’il eft froid.
La pâte réduite à une certaine confiftance qui fe
regle fuivant que le pain doit être ferme ou leger,
on la coupe avec le coupe-pâte ; on la pefe à la balance
; fi ce font des boulangers qui pétrifient, on
la tourne fiir le tou r, & on la drefle fur la table à
coucher ; ou on la laifle jufqu’à ce qu’elle foit aflez
le v é e , & propre à mettre au four.
On pétrit ordinairement la farine, & on la réduit
en pâte avec les mains, en la repliant plufieurs fois ,
& en la foulant avec les points fermés ; ce qui fe fait
dans des pétrins, ou des bacquets.
Quelquefois pour certaines fortes de pain, lorf-
qu’elle eft en confiftence de bonne pâte, on la pétrit
encore avec les piés dans un fac. Dans cette maniéré
de pétrir, au lieu derepliér la pâte, on la coupe
avec le coupe-pâte , & l’on en met les morceaux
les uns fur les autres. Dictionnaire du Ménage. Voyez
l'article Pa in . ( D. J. ) X
Pa te BATARDE ou ferme, {ehestes Boulangers.)'
eft une pâte que l’on a baflinée avec du lait ou de
l’eau , pour faire le gros pain. On l’appelle ferme ,
parce qu’on l’a pétri plus dure, & avec moins d’eau
que la pâte molle. On fait du pain de pâte ferme
d’une, de deux, de trois, de quatre, de f ix , de huit,
& de douze livres. Il eft détendu aux Boulangers
d’en faire & d’en expofer dans leur, boutique, dè
cinq , de fep t , de neuf, de dix , & de onze livres.
Pa t e mo lle , c’eft en Boulangerie, une pâte légère
& délicate , dont on fait lè pain mollet. Pour
la rendre telle, quand on.a acquis une certaine 'confiftance,
onlà coupe avec les mains, c’eft-à-dire, on
afépare en lambeaux que l’on jette les uns fur les
autres, & que l’on bat erifuite à force de bras ; ce
que l’on continue de faire jufqu’à ce qu’elle foit fe-
Che à un certain point.
Pâ t e , ( Commerce de lingots. ) dans l’Amérique
efpagnole, on nomme pâte , les barres d’argent qui
n’ont point été quintées, c’eft-à-dire, qui n’ayant
point été portées aux bureaux du roi pour y payer le
droit de quint, n’ont point la marque qui en doit ju-
ftifier le payement.
Les pâtes ou barres non quintées, font du nomr
bre des contrebandes ; il s’en fait cependant un grand i
commerce, à caitfë du gain certain qu’on y trouve ;
mais elles font fiijettes à beaucoup de friponneries,
les eflkyeurs en Efpagne n’ayant pas toute la bonne
foi poffible, & d’ailleurs étant tres-’mal-habiles : ce
qui doit obliger les étrangers de s’en charger avec
beaucoup de précaution. Savary. ( Z>. J . )
Pâ te , en Confifericy c ’eft un terme dont on fe fert
pour exprimer une préparation de quelque fruit,
Faite en en broyant la chair avec quelque fluide, ou
autre mixtion, jufqu’à cé qu’elle ait quelque ccnfi-
ftance, l’étendant enfuite fur un plat, & la féchant
avec du fucre en poudre, jufqu’à ce qu’elle foit aufli
maniable que de la pâte ordinaire. Voyej C o n f itu re.
Ainfi l’on fait des pâtes d’amandes , des pâtes de
pommes , d’abricots, decerifes, deraifins, de prunes
, de pêches, de poires, &c.
Pâ te , terme de Cordonnier, ils appellent pâte , la
colle de farine de feigle dont ils fe fervent pour coller
les cuirs des patons avec l’empeigne de leurs fou-
liers & autres ouvrages de cordonnerie.
Pâte DE v e r r e , ( Gravure en pierres fines. ) les
Artiftes emploient le mot de pâte , qui eft le terme
dont fe fervent les Italiens, pour exprimer ces empreintes
de verre, nommées par les anciens obfidia-
num vitrum. La langue françoife ne fournit pas d’autre
terme propre ; & celui de pâte eft déjà confa-
cre. Quelques-uns néanmoins les appellent des com-
pojîtions de pierres gravées factices.
h f sf ^ tes de verre, à la matière près, ont de quoi
iatisfaire les curieux autant que les originaux ; puif-
qu étant moulées defliis, elles en font des copies
trcs-fideles. Ceux qui ont crû que c’étoit une invention
moderne, font dans l’erreur : les anciens ont eu
e fecret cie teindre le verre, & de lui faire imiter
les differentes couleurs des pierres précieufes. L’on
montre tous les jours deces verres antiques colories
, fur lefquels il y a des gravûres en creux ; &
1 on en voit aufli qui rendent parfkitement l’effet des
plus finguheres camées. Je ne mets point en doute
que quelques-uns de ces verres n’ayent été travaillés
à 1 outil, comme les pierres fines ; ce qui me le per-
luade, c eft ce que dit Pline, que l’on gravoit le
verre en le faifant pafler fur le tour ; mais je n’en
uis pas moins convaincu, que les anciens ayant lu
mettre le verre en fiifion, ils ont dû mouler des
pierres gravées avec le v erre, à-peu-près comme
on le tait aujourd’hui; & que c’eli ainfi qu’ont été
ormees cette grande quantité de pâtes antiques qui
le conlervent dans les cabinets.
Cette pratique qui peut-être avoit été interrom-
wffi renfile en vogue fur la fin du quinzième fie-
c e. Un trouva jiour lors à Milan un peintre en miniature
, nomme François Vicecomiti, qui poffédoit
H j§HJ| des Plus beaux émaux, & qui contrefaifoit
à siy tromper les pierres gravées par le moyen des
pâtes de verre. Il s en efi toujours fait dépuis en Ita-
duc évfl,!0" eft/ edevable à S. A. R. moniteur le
n ere d> nS u ge"V de h dé“ «verte d’une ma-
fahe i y P r? ceder’ ,& pl»s expéditive, &plus partes^
fines PT 0M !e b’aniParent & l’éclat des pier-
a n Ues en nmient jufqu’aux couleurs • &
quand elles ont été bien ■ ■ , & que £ fiip e ï
“ ^ UX/i.ai1 P° h ’ eUesfont SP^quefois eapabies
d’en impofer au premier afpeél, & de faire prendre
ces pierres faaices pour de véritables pierres gra-
vees. Entrons dans les details d’après M‘ Mariette
Comme leareme rareté des pierres précieufes,
oc le v if empreffement avec lequel onles recherchoit
dans l antiquité , ne permettoient qu’aux perfonnes
riches d en avoir & de s’en parer, il fallut emprun- ,
ter les fecours de 1 art, pour fatisfaire ceux qui man-
quant de facultés, n’en étoient pas moins pofledés
du defir de paroitre. Le v erre, matière utile & belle
mais qui étant commune, n’eft pas autant confédérée
quelle le devroit être, offrit un moyen tout-à-fait
propre à remplit c es vues. OH n’eut pas beaucoup
de peine à lui faire imiter la blancheur & le diaphane
du c r y& I , & bien-têt en lui alliant divers méj
f f l iM n f f f i f f f W ™ en le faifant paffer par
differens degres de feu , il n’y eût prefqué S i n e
pierre precieufe dont on ne lui fit prendre la cou-
, ,ur a i° rme* C artifice fut même quelquefois fe
deguifer avec tant d’adreffe, que ce n’étoit qu’a-
pres un feneux examen, que d’habiles iouailliers
parvenoient à difderner le feux d’avec le vrai L ’ap-
pat du gain rendoit les feuffaires encore plus atten-
tfts , & acceleroit leurs progrès ; aucune profeflion
n efoit aufli lucrative que la leur.
^ Pour en impofer avec plus dehardieffe & p lu s
sûrement, ils avoient trouvé le fecret de métaïUor-
phofer des matières précieufes, en des matières encore
plus precieüfës. Ils teignoient le cryftal dans
toutes les couleurs, & fur-tout dans un très-beau
verd d’emeraude : jufques dans les Indes on imitoic
le béni avec le cryftal. D ’autres fois oh produifoit
de feuffes amethylles, dont le velouté pouvoit en
impofer, même à des connoilfeurs i ce n’étoit cependant
que de l’ambre teint en violet.
Le verre ainfi colorié ne pouvoit manquer d’être
employé dans la gravû'f j ; il y tint en plus d’une oc-
cafion la place des pierres fines, & il multiplia'con-
liderablement l’ufage des cachets: J’ai déjà dit que
les anciens avoient non-feulement gravé finie verre!
mais qu’ils avoient aufli contrefait les. pierres gravéesen
lès moulant, & en imprimant enfuite fur ces
moules du verre mis en fiifidn. J’ai remarqué que
des le quinzième fiecle., les Italiens étoient rentrés
én poffeflîon de feire de c espaces ou-pierres feftices ;
j ajoute ici que les ouvriers qui y furent employés
dans les derniers tems, tfayant pas eu apparemment
aflez d occafions de s’exercer., ne nous avoient rien
donné de bien parfait. Peut-être ne cônnoilfoient-ils
pas aflez la valeur des matières qu’ils emplbyoient.
Le verre qui doit être mofifi, la terre qui doit fervlr
à feire le moule, fout des matières analogues , toujours
prêtes à fe confondre , & à s’iinir inféparable-
ment, ^ lorfqu’on les expofe à un grand feu. Cette
operation peu confidérable en apparence, pouvoit
donc devenir l’objet "des recherches d’un excellent
chimifte, & M. Homberg ayant été chargé par S. A.
R. monfieur le duc d’Orléans, de travailler ûifeper-
feftionner, il ne crutpasjqu’il fût au-deifous de lui
de s’y appliquer.
Apffis' différais elfeis, jprès avoir répété plufieurs
expériences , auxquelles l e prince voulut bien afli-
fter, il parvint enfin à faire de ces pâtes ayée tant d’é.
légance, que les connoilfeurs mêmes pouvoient y
être trompés, & prendre quelquefois les copies pour
les originaux. En expofant ici la façon de procéder
de M. Homberg, je ne fais prefque que tranferire le
mémoire de cet habile phyficien, qui eft inféré parmi
ceux de 1 academie royale des Sciences de Pan-
née 1712.
Le point effentiel étoit de trouver une terre fine
qui ne contint aucun fe l, ou du-moins fort peu &
avec laquelle il fut poflîble de faire un moule qu^pût
aller au feti fans fe vitrifier, ni fans fe confondre
X i j