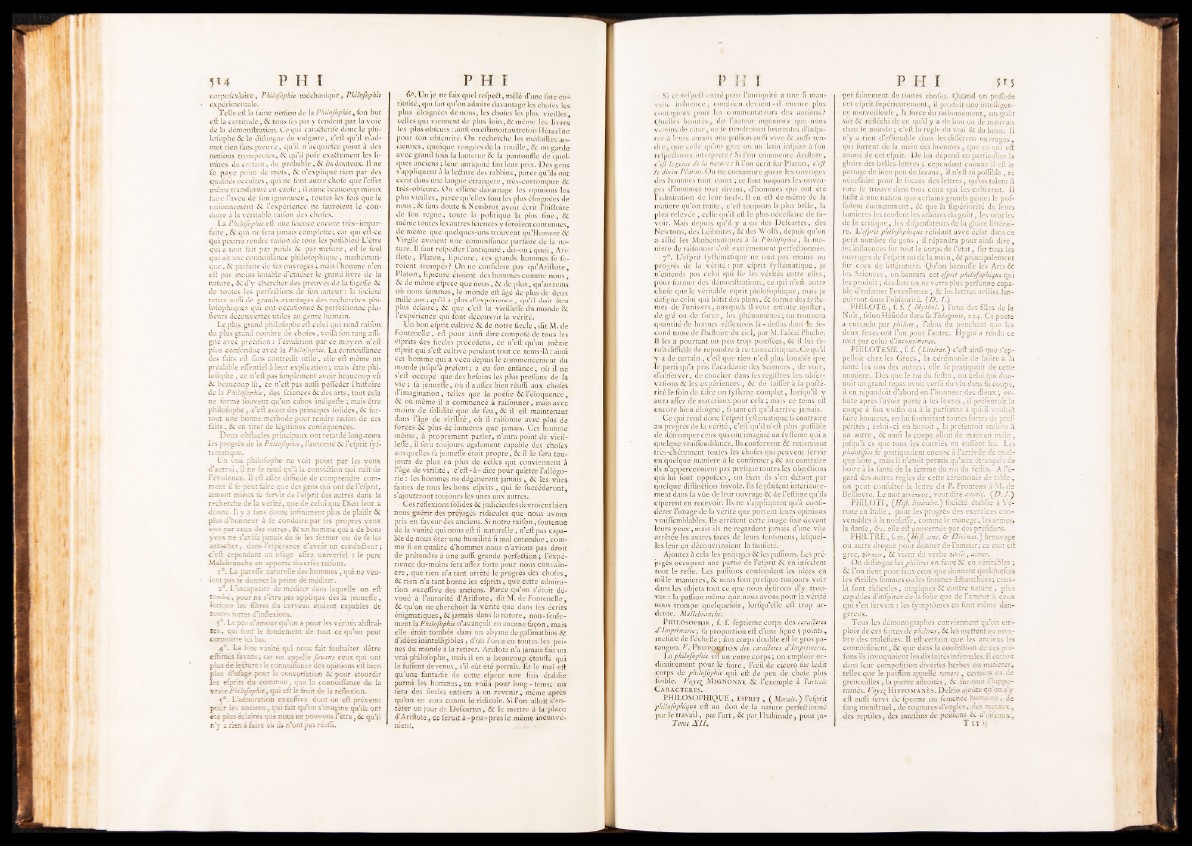
H 4 P H I
eormtfciftaire, Philofophie niéchanique, Pkilofophie
expérimentale»
Telle e(l la laine notion de la Philofophie, l'on but
cil la certitude, ik tous l'es pas y tendent par la voie
de la démonllration. Ce qui caraCtérife donc le philosophe
& le diftingue du vulgaire, c’eft qu’il n’admet
rien Sans preuve, qu’il n’acquielce point à des
notions trompeules, de qu’il pôle exactement les limites
du certain, du probable, de du douteux. Il ne
le pave point de mots, de n’explique rien par des
qualités occultes, qui ne lont autre choie que l’effet
meme transforme en caule ; il aime beaucoup mieux
taire l'aveu de Son ignorance, toutes les fois que le
raiSonnement & l'expérience ne lauroient le conduire
à la véritable rail'on des choies.
La Philofoplùt eft une Science encore très-imparfaite
, îk qui ne Sera jamais complette ; car qui elt-ce
qui pourra rendre railoii de tous les polîibles? L’être
qui a tout tait par poids & par meture, eff le Seul
qui ait une connoiliance philoSophique, mathématique
, de parfaite de les ouvrages ; mais l’homme n’en
elt pas moins louable d’étudier le grand livre de la
nature, de d’y chercher des preuves de la fageffe &
de toutes les perfections de l'on auteur : la Société
retire aulîi de grands avantages des recherches philosophiques
qui ont occaùonné de perfedionné plu-
lieurs découvertes utiles au genre humain.
Le plus grand philolophe elt celui qui rend raiSon
du plus grand nombre de choies, voilà Son rang a ligné
avec précilion : l’érudition par ce moyen n’ eft
plus confondue avec la Phi/ofophie. La connoiffance
des faits eff Sans contredit utile, elle eft même un
préalable effentiel à leur explication ; mais être phi-
lolbphe, ce n’eft pas Simplement avoir beaucoup vû
de beaucoup lù, ce n’eft pas aulîi pofféder l’hiftoire
de la Phi/ofophie, des Sciences de des arts, tout cela
ne forme Souvent qu’un cahos indigefte ; mais être
philolophe, c’eft avoir des principes Solides, 6c Surtout
une bonne méthode pour rendre raiSon de ces
faits , & en tirer de légitimes conséquences.
Deux obftades principaux ont retardé long-tems
les progrès de la Phi/ofophie, l’autorité 6c l'eSprit fyf-
Un vrai philolophe ne voit point par les yeux
d ’autrui, il ne Se rend qu’à la conviction qui naît de
l ’évidence. Il eft allez difficile de comprendre comment
il Se peut faire que des gens qui ont de l’eSprit,
aiment mieux Se Servir de l’elprit des autres dans la
recherche de la vérité, que de celui que Dieu leur a
donné. Il y a Sans doute infiniment plus de plaifir &
plus d’honneur à Se conduire par Ses propres yeux
■ eue par ceux des autres, & un homme qui a de bons
yeux ne s’avisa jamais de Se les fermer ou de Se les
arracher , dans l’efpérance d’avoir un conduCteur ;
c ’eft cependant un ufage allez univerfel : le pere
Malebranche en apporte diverfes raifons.
i° . La parefîe naturelle des hommes, qui ne veulent
pas Se donner la peine de méditer.
2°. L’ incapacité de méditer dans laquelle on eft
tombé, pour ne s’être pas appliqué dès la jeunefle,
lorique les fibres du cerveau étoient capables de
toutes fortes d’inflexions.
3 - Le peu d’amour qu’on a pour les vérités abftrai-
te s , qui Sont le fondement de tout ce qu’on peut
4° . La foîe vanité qui nous fait fouhaiter dêtre
efrimes iavans; car on appelle fayans ceux qui ont
plus de lecture : la connoiliance des opinions eft bien
plus d’ufage pour la converlation & pour étourdir
les efprits du commun, que la connoiffance de la
Vrai e Phi/ofophie, qui eft le fruit de la réflexion.
5°. L’admiration excefîive dont on eft prévenu
pour les anciens, qui fait qu’on s’imagine qu’ils ont
été pins éclairés que nous ne pouvonsTétre, 6c qu’il
c ’y a rien à faire où ils n’ont pas réufli.
P H I
<>0. Un je ne fais quel refpcCt, mêlé d’une Sote cti-
riolité, qui tait qu’on admire davantage les clioSes les
plus éloignées de nous, les choies les plus vieilles-
celles qui viennent de plus loin, 6c même les livres
les plus oblcurs : ainft on eftimoit autrefois Heraclite
pour Son obfcurité. On recherche les médailles anciennes
, quoique rongées de la rouille, 6c on garde
avec grand loin la lanterne 6c la pantouffle de quelques
anciens ; leur antiquité fait leur prix. Des gens
s appliquent à la leCture des rabbins, parce qu’ils ont
écrit dans une langue étrangère, très-corrompue 6c
tres-obfcure. On eftime davantage les opinions les
plus vieilles, parce qu’elles font les plus éloignées de
nous ; ik fans doute hNembrot a voit écrit rhiftoire
de l'on régné, toute la politique la plus fine, 6c
meme toutes les autres Sciences y leroient contenues,
de même que quelques-uns trouvent qu’Hoinere 6c
\irgile avoient une connoiffance parfaite de la nature.
Il faut refpeCter l’antiquité, dit-on ; quoi Ariftote,
Platon, Epicure, ces grands hommes Se fe-
roient trompés ? On ne confidere pas qu’Ariftote,
Platon, Epicure ctoient des hommes comme nous,
èc de meme efjpece que nous, 6c de plus, qu’au tems
ou nous Sommes, le monde eft âgé déplus de deux
mille ans ; qu’il a plus d’expérience, qu’il doit être
plus éclairé ; 6c que c’eft la vieilleffe du monde 6c
l’expérience qui font découvrir la vérité.
Un bon efprit cultivé 6c de notre fiechî, dit M. de
Fontenelle , eft pour ainli dire compolé de tous les
elprits des liecles précédens, ce n’eft qu’un même
efprit qui s’elt cultivé pendant tout ce tems-là : ainft
cet homme qui a vécu depuis le commencement du
monde jufqu’à préSent ; a eu Son enfance, oîi il ne
s’ell occupé que des befbins les plus prelfans de la
vie ; fa jeuneffe, où il a affez bien réufli aux chofes
d’imagination, telles que la poéfie 6c l’éloquence,
6c où même il a commencé à raifonner, mais avec
moins de Solidité que de feu, 6c il eft maintenant
dans l’âge de virilité, où il raifonne avec plus de
forces oc plus de lumières que jamais. Cet homme
même, à proprement parler, n’aura point de vieil-
leffe, il Sera toujours également capable des chofes
auxquelles fa jeunefle étoit propre, 6c il le Sera toujours
de plus en plus de celles qui conviennent à
l’âge de virilité, c’eft-à - dire pour quitter l’allégorie
: les hommes ne dégénèrent jamais, 6c les vues
faines de tous les bons efprits, qui Se Succéderont,
s’ajouteront toujours les unes aux autres.
Ces réflexions Solides & judicieufes devroient bien
nous guérir des préjugés ridicules que nous avons
pris en faveur des anciens. Si notre raiSon, Soutenue
de la vanité qui nous eft Si naturelle , n’eft pas capable
de nous ôter une humilité fi mal entendue, comme
fi en qualité d’hommes nous n’avions pas droit
de prétendre à une aufli grande perfection ; l’expérience
du-moins fera affez forte pour nous convaincre
, que rien n’a tant arrêté le progrès des chofes ,
& rien n’a tant borné les efprits, que cette admiration
excefîive des anciens. Parce qu’on s’étoit dévoué
à l’autorité d’Ariftote, dit M. de Fontenelle ,
& qu’on ne cherchoit la vérité que dans Ses écrits
énigmatiques, 6c jamais dans la nature, non-feulement
laPkilofophit n’avançoit en aucune façon, mais
elle étoit tombée dans un abyme de galimathias 6c
d’idées inintelligibles, d’où l’on a eu toutes les peines
du monde à la retirer. Ariftote n’a jamais fait un
vrai philofophe, mais il en a beaucoup étouffé qui
le fùffent devenus. s’il eût été permis. Et le mal eft
qu’une fantaifie de cette efpece une fois établie
parmi les hommes, en voilà pour long - tems; on
Sera des Siècles entiers à en revenir, même après
qu’on en aura connu le ridicule. Si l’on alloit s’entêter
un jour de Defcartes, 6c le mettre à la place
d’Ariftôte, ce Seroit à -peu-près le même inconvénient.
Si cc refpcdt outré pour l’antiquité a Une fi mau*
vailc influence, combien devient-il encore plus
contagieux pour les commentateurs des anciens ?
Quelles beautés, dit l’auteur ingénieux cjue nous
venons de citer, ne Se tieridroient heureufes d’infpi-
rer à leurs amans une palfion aufli vive 6c aufli tendre,
que celle qu’un grec ou un latin infpire à Son
refpeclueux interprété? Si l’on commente Ariftote,
c'ejl U génie de là nature : fi l’on écrit fur Platon, c'ejt
le divin Platon. On ne commente guere les ouvrages
des hommes tout court ; ce Sont toujours les ouvrages
d’hommes tout divins, d’hommes qui ont été
’admiration de leur fiecle. Il en eft de même de la
matière qu’on traite, c ’eft toujours la plus belle, la
plus relevée, celle qu’il eft le plus néceffaire de Savoir.
Mais depuis qu’il y a eu des Defcartes, des
Newtons, des Léibnitzs, 6c des Wolfs, depuis qu’on
a allié les Mathématiques à la Philofophie, la maniéré
de raifonner s’eft extrêmement perfectionnée.
7°. L’eSprit fyftématique ne nuit pas moins au
progrès de la vérité : par efprit fyftématique, je
n’éntends pas celui qui lie les vérités entre elles,
pour former des démonftrations, ce qui n’eft autre
chofe que le véritable efprit philoSophique, mais je
défigne celui qui bâtit des plans, 6c forme des fyftè-
mes de l’univers, auxquels il veut enfuite ajufter,
de gré ou de force, les phénomènes ; on trouvera
quantité de bonnes réflexions là-deflùs dans le Second
tome de l’hiftoire du ciel, par M. l’abbé Pluche.
Il les a pourtant un peu trop pouflees, 6c il lui Seroit
difficile de repondre à certains critiques. Ce qu’il
■ y a de certain, c’eft que rien n’ eft plus louable que
le parti qu’a pris l’académie des Sciences , de voir,
d’obferver, de coucher dans Ses regiftres les observations
6c les expériences , 6c de laiffer à la pofté-
rité le foin de faire un fyftème complet, lorfqu’il y
aura allez de matériaux pour cela ; mais ce tems eft
encore bien éloigné, fi tant eft qu’il arrive jamais.
Ce qui rend donc l’eSprit fyftématique fi contraire
au progrès de la vérité, c’eft qu’il n’eu plus, poffible
de détromper ceux qui ont imaginé un fyftème qui a
quelque vraiffemblance. Ils confervent 6c retiennent
très-çhérement toutes les chofes qui peuvent Servir
en quelque maniéré à le confirmer; 6c au contraire
ils n’appercevoient pas prefque toutes les objections
qui lui font oppofées', ou bien ils s’en défont par
quelque diltinCtion frivole. Ils Se plaifent intérieurement
dans la vue de leur ouvrage 6c de l’eftime qu’ils
elperent en recevoir. Ils ne s’appliquent qu’à confi-
derer l’image de la vérité que portent leurs opinions
vraiffemblables. Ils arrêtent cette image fixe devant
leurs y eu x, mais ils ne regardent jamais d’une vûe
arrêtée les autres faces de leurs fentimens , lesquelles
leur en découvriroient la fauffeté.
Ajoutez à cela les préjugés 6c les paflions. Les préjugés
occupent une partie de l’eSprit 6c en infeCtent
tout le refte. Les paflions confondent les idées eft
mille maniérés, 6c nous font prefque toujours voir
dans les objets tout ce que nous délirons d’y trouver
: la paflion même que nous avons pour la vérité
nous trompe quelquefois, lorfqu’elle eft trop ardente.
Mallebranche.
Philosophie, f. f. Septième corps des caractères
d'Imprimerie ; fa proportion eft d’une ligne 5 points,
mefure de l’échelle ; Son corps double eft le gros parangon.
V . Proportion des caractères d.'Imprimerie.
La phi/ofophie eu un entre corps ; on emploie ordinairement
pour le faire, l’oeil de cÿcero Sur ledit
corps de philofophie qui eft de peu de chofe plus
■ foible. Voyc{ Mignonne & - l’exemple à Particle
C aractères.
PHILOSOPHIQUE, e s p r it , ( Morale.) l’eSprit
philofophique eft un don de la nature perfedionné
par le travail, par l’art, 6c par l'habitude, pour ju-
Tome X I I ,
P H I 5M ger Sainement de toutes chofes. Quand on poffede
cet efprit Supérieurement, il produit une intelligence
merveilleufe, la force du raisonnement, un goût
sûr 6c réfléchi de ce qu’il y a de bon ou de mauvais
dans le monde ; c’eft la réglé du vrai 6c du beau. 11
n’y a rien d’eftimable dans les différens ouvrages
qui Sortent de la main des hommes, que ce qui eft
animé de cet efprit. De lui dépend en particulier la
gloire des belles-lettres ; cependant comme il eft le
partage de bien peu de Savans, il n’eft ni poflible, ni
néceffaire pour le Succès des lettres, qu’un talent fi
rare Se trouve dans tous ceux qui les cultivent. Il
Suffit à une nation que certains grands génies le pof-
fedent éminemment, 6c que la Supériorité de leurs
lumières les rendent les arbitres du goût, les oracles
de la critique, les difpenfatêurs de la gloire littéraire.
Uefprit philofophique réfidant avec éclat dans ce
petit nombre de gens , fl répandra pour ainfi dire ,
Ses influences fur tout le corps de l’état, fur tous les
ouvrages de l’eSprit ou de la main, 6c principalement
fur ceux de littérature'. Qu’on banniffe les Arts 6c
les Sciences, on bannira cet efprit philofophique qui
les produit ; dès-lors on ne verra plus perfonne capable
d’enfanter l’excellence ; 6c les lettres avilies languiront
dans l’obfcurité. (D . J.')
PHILOTE , S. f. ( Mythol. ) l’une des filles de la
Nuit, Selon Héfiode dans fa Théogonie, 224. Ce poète
a entendu par philote , l’abus du penchant que les
deux Sexes ont l’un pour l’autre. Hygin a rendu ce
mot par celui d’incontinence.
PHILOTÉSIE, f. f. ( Littéral.) c’eft ainfi que s’ap-
pelloit chez les Grecs, la cérémonie de boire à la
Santé les uns des autres ; elle Se pratiquoit de cette
maniéré. Dès que le roi du feftin, ou celui qui don-
noit un grand repas avoit verfé du vin dans fa coupe,
fl en répan doit d’abord en l’honneur des dieux ; en-
fuite après l’avoir porté à Ses levres, fl préfenîoit la
coupe à Son voifin ou à la perfonne à qui il vouloit
faire honneur, en lui Souhaitant toutes fortes de prof
pérités ; celui-ci en buvoit, la préfentoit enfuite à
un autre , 6c ainfi la coupe alloit de main en main,
jufqu’à ce que tous les conviés en euffent bu. Les
philotéjîes Se pratiquoient encore à l’arrivée dé quelque
hôte , mais fl n’étoit permis qu’aux étrangers de
boire à la Santé de la femme du roi du feftin. A l’égard
des autres réglés de cette cérémonie de table ,
on peut confulter la lettre du P. Fronteau à M. de
Bellîevre. Le mot çixothîk , veut dire amitié. (D . /.à
PHILOTI, (H f . littéraire..) Société établie à V érone
en Italie , pour les progrès des exercices convenables
à la nobleffe, comme le manege, les armes,
la danfe, &c. elle eft gouvernée par des préfidens.
PHILTRE, f. m. {Hif. anc. & Divinat.) breuvage
ou autre drogue pour donner de l’amour; ce mot eft
grec, tpîxrpov, 6c vient du verbe çixûr, aimer.
On diftingue les philtres en faujf & en véritables ;
6c l’on tient pour faux ceux que donnent quelquefois
les Vieilles femmes ou les femmes débauchées ; ceux-
là font ridicules, magiques 6c contre nature , plus
capables d’infpirer de la folie que de l’amour à ceux
qui s’en fervent : les Symptômes en font meme dangereux.
Tous les démonographes conviennent qu’on emploie
de ces fortes de philtres > 6c les mettent au nombre
des maléfices. Il eft certain que les anciens les
connoiffoient, 6c que dans la confection de ces poi-
lons ils invoquoient les divinités infernales. Il entrent
dans leur compofition diverfes herbes ou matières,
telles que le poifion appellé remore , certains os de
grenouilles , la pierre altroïtès, & fur-tout i hippô-
manès. Voye^ Hippom anÙS. Delrio ajoute qu'on s’y
eft aulîi Servi de Sperme ou femence humaine, de
fang menltruel, de rognures d’ongles, des métaux ,
des reptiles, des inteftins de poiftons fk d oifeaux. T tt'ij