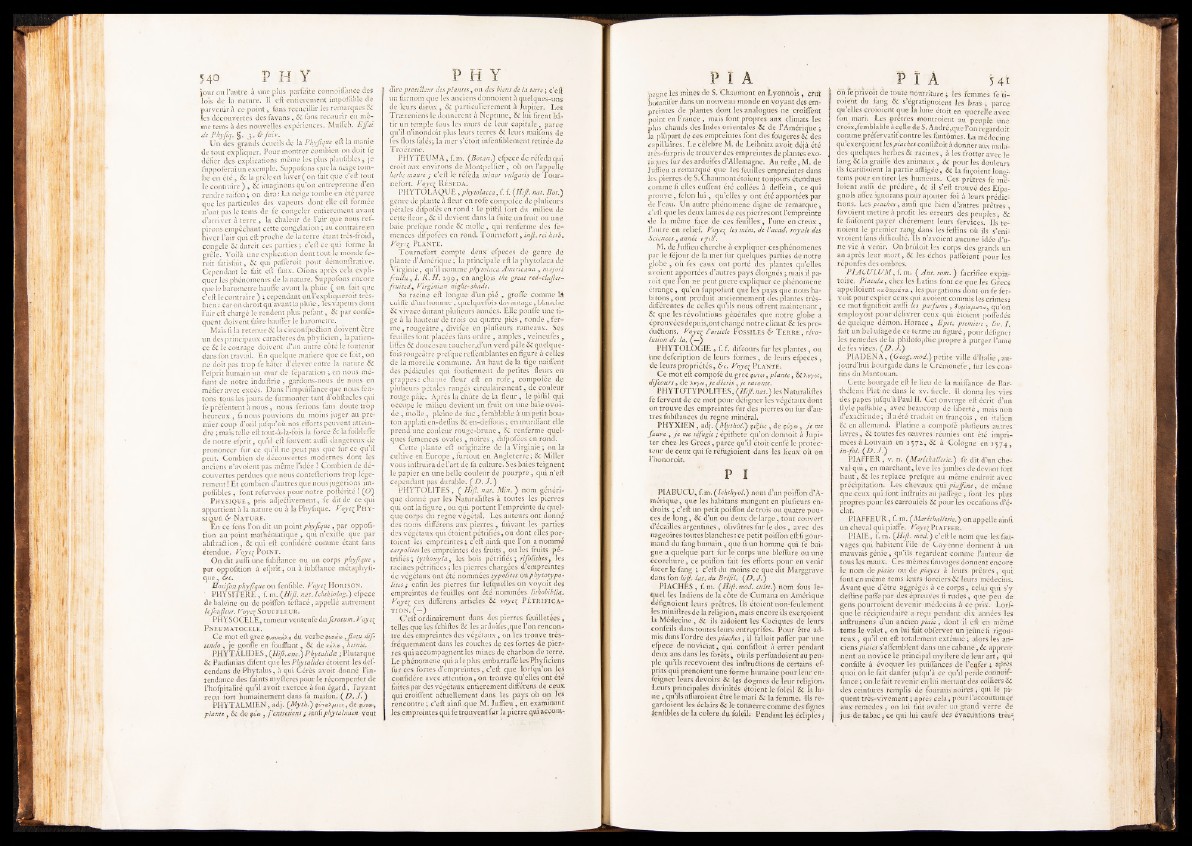
54° P H Y
jour ou l’autre à une plus parfaite connoiffance des
lois de la nature. Il eft entièrement impoffible de
parvenir à ce point, fans recueillir les remarques 8c
les découvertes des favans , 8c fans recourir en meme
tems à des nouvelles expériences. Muffch. Effai
de Phyfiq. § . 3 . &fuiv.
Un des grands écueils de la Phyfique eft la manie
de tout expliquer. Pour montrer combien on doit fe
défier des explications meme les plus plaufiblcs, je
fuppoferai un exemple. Suppofons que la neige tombe
en é té, 8c la grêle en hiver ( on lait que c’eft tout
le contraire ) , 8c imaginons qu’on entreprenne d’en
rendre raifon ; on dira : La neige tombe en été parce
que les particules des vapeurs dont elle eft formée
n’ont pas le tems de fe congeler entièrement avant
d’arriver à terre , la chaleur de l’air que nous refpirons
empêchant cette congélation ia u contraire.en
hiver l’air qui eft proche de la terre étant très-froid,
congele 8c durcit ces parties ; c’eft ce qui forme la
grêle. Voilà une explication dont tout le monde fe-
roit fatisfait, 8c qui pafferoit pour démonftrative.
Cependant le fait eft faux. Ofons après cela expliquer
les phénomènes de la nature. Suppofons encore
que le baromètre häufle avant la pluie ( on fait que
c’ eft le contraire ) ; cependant onl’expliqueroit tres-
bien : car on diroit qu’avant la pluie, les vapeurs dont
l’air eft chargé le rendent plus pefant, 8c par confé-
quent doivent faire haufler le baromètre.
Mais fi la retenue 8c la circonfpeâion doivent être
un des principaux caraûeres du phyficien, la patience
8c le courage doivent d’un autre côté le foütenir
dansfontravail. En quelque matière que ce foit, on
ne doit pas trop fe hâter a élever entre la nature 8c
l’efprit humain un mur de féparation ; en nous méfiant
de notre induftrie , gardons-nous de nous en
méfier avec excès. Dans l’impuiffance que nous fen-
tons tous les jours de furmonter tant d*obftacles qui
fe préfentent à nous , nous ferions fans doute trop
heureux , fi nous pouvions du moins juger au premier
coup d’oeil jufqu’oii nos efforts peuvent atteindre
;-mais telle eft tout-à-la-fois la force 8c lafoibleffe
de notre efprit, qu’il eft fouven: aufîi dangereux de
prononcer fur ce qu’il ne peut pas que fur ce qu’il
peut. Combien de découvertes modernes dont les
anciens n’avoient pas même l’idée ! Combien de de-
couvertes perdues que nous contefterions trop légèrement
! Et combien d’autres que nous jugerions im-
poffibles , font refervées pour notre postérité ! (O)
Phy s iq u e , pris adje&ivement, fe dit de ce qui
appartient à la nature ou à la Phyfique. Voye[ Ph y sique
& Natu re.
En ce fens l’on dit un point phyfique , par oppofi-
tion au point mathématique , qui n’exifte que par
abftraûion, 8c qui eft confidére comme étant lans
étendue. Foye[ Po in t .
On dit auflî une fubftance ou un corps phyfique ,
par oppofition à efprit * ou à fubftance métaphyli-
que, &c.
Morïfonphyfique ou fenfible. V?ye{ HORISON.
PHYSITERE , f. nu {Hfi. nat. IchthioLog.) efpece
de baleine ou de poiflbn teftacé, appellé autrement
lefotifleur. VoyeiSOUFFLEUR.
PHYSOCELE, tumeur venteufe du ferotum. Voyc^
PNEUMATOCELE.
Ce mot eft grec tpv<rvy.tix» du verbe ipwàu yfiatu difi
tendo , je gonfle en fouillant, 8c de xtlh» , hernie,
PHYTALIDES, (Hiß, anc.) Phytalides ; Plutarque
8c Paufànias difent que les Phytalides étoient les def-
cendans de Phytalus, à qui Cérès avoit donné l’intendance
des faints myfterespour le récompenfer de
l’hofpitalité qu’il avoit exercée à fon égard, l’ayant
reçu fort humainement dans fa maifon. {D . J. )
PHYTALMIEN, adj. { M y t h . ) , de ipoTtVj
plante 8c de 91lu , j'entretiens ; ainfiphytalmien veut
P H Y
dire protecteur des plantes, ou des biens de la terre ; c’efl:
un furnom que les anciens donnoient à quelques-uns
de leurs dieux, 8c particulièrement à Jupiter. Les
Træzeniens le donnèrent à Neptune, 8c lui firent bâtir
un temple fous les murs de leur capitale, parce
qu’il n’inondoit plus leurs terres 8c leurs maifons de
fes flots falés; la mer s’etoit infenfiblement retirée de
Troëzeiie.
PHYTÉUMA, f. in. ( Botdn.) efpece de réfeda qui
croît aux environs de Montpellier, oîi on l’appelle
herbe maure ; c’eft le réfeda minor vulgaris de Tour-*
nefort. Voye%_ R éséda.
PHY TOLAQUE, phytolacca, f. f. {Hifi. nat. Bot,)
genre de plante à fleur en rofe compofee de plufieurs
pétales difpofés en rond : le piftil fort du milieu de
cette fleur, 8c il devient dans la fuite un fruit ou une
baie prefque ronde 8c molle , qui renferme des fe-*
mences difpofées en rond; Tournefort, infi, rei herb»
P’oy'i Plante.
Tournefort compte deux efpeces de genre dè
plante d’Amérique ; la principale eft la phytolaca de
Virginie, qu’il nomme phytolaca Americana , majori
fruau y I. R. H. x99, en anglois the great red-clufier-
fruited y Virginian nig/it- shade.
Sa racine eft longue d’un pié , greffe comme lâ
çuiflè d’un homme , quelquefois davantage, blanche
& vivace durant plufieurs années. Elle pouffe une tige
à la hauteur de trois ou quatre piés, ronde , ferme
, rougeâtre , divifée en plufieurs rameaux. Ses
feuilles font placées fans ordre , amples , veineufes 9
lifl'es & douces au toucher,d’un verd pâle 8c quelquefois
rougeâtre prefque refl'emblantes en figure à celles
de la morelle commune. Au haut de la tige naiffent
des pédicules qui foutiennent de petites fleurs en
grappes : chaque fleur eft en rofe, compofée de
plufieurs pétales rangés circulairetnent, de couleur
rouge pâle. Après la chute de la fleur , le piftil qui
occupe le milieu devient un fruit ou une baie ovoïde
, molle , pleine de fuc , femblable à un petit bou-*
ton applati en-deffus 8c en-deffous ; en muriffant elle
prend une couleur rouge-brune , 8c renferme quelques
femences ovales , noires , difpofées en rond.
Cette plante eft originaire de la Virginia ; on la
cultive en Europe , furtout en Angleterre ; 8c Miller
vous inftruira de l’art de fa culture. Ses baies teignent
le papier en une belle couleur de pourpre, qui n’eft
cependant pas durable. ( D. J. )
PHYTOLITES , ( Hiß. nat. Min. ) nom générique
donné par les Naturaliftes à toutes les pierres
qui ont la figure, ou qui portent l’empreinte de quelque
corps du regne végétal. Les auteurs ont donnp
des noms différens aux pierres , fuivant les parties
des végétaux qui étoient pétrifiés, ou dont elles por-
toient les empreintes ; c’eft ainfi que l’on a nomme
carpolites les empreintes des fruits, ou les fruits pétrifiés;
lythoxylay les bois pétrifiés; rifolitheSy les
racines pétrifiées ; les pierres chargées d’empreintes
de végétaux ont été nommées typolites ou phytotypolîtes
; enfin les pierres fur lefquelles on voyoit des
empreintes de feuilles ont été nommées lithobiblia,
Voye^ ces différens articles 8c voye{ PÉTRIFICATION.
(—3
C’eft ordinairement dans des pierres feuilletées ,
telles que les fehiftes 8c les ardoiles,que l’on rencontre
des empreintes des végétaux, on les trouve très-
fréquemment dans les couches de ces fortes de pierres
qui accompagnent les mines de charbon de terre.
Le phénomène qui a le plus embarraffé les Phyficiens
fur ces fortes d’empreintes , c’eft que lorfqu’on les
confidére avec attention, on trouve qu’elles ont été
faites par des végétaux entièrement différens de ceux
qui croiffent attuellement dans les pays oîi on les
rencontre ; c’eft ainfi que M. Juflieu, en examinant
les empreintes qui fe trouvent fur la pierre qui accotn-
P I A
pagne les minés de S. Chaumont en Lyonnoïs, chit
bertanifer dans un nouveau monde en voyant des empreintes
de plantes dont les analogues ne croiffent
point en France , mais font propres aux climats les
plus chauds des Indes orientales 8c de l’Amérique ;
la plupart de ces empreintes font des foUgeres Ôç des
capillaires. Le célébré M. de Leibnitz avoit déjà été
îrès-flirpris de trouver des empreintes de plantes exotiques
fur des ardoifes d’Allemagne. Au refte, M. de
Juflieu a remarqué que les feuilles Empreintes dans
les pierres de S. Chaumont étoient toujours étendues
comme fi elles euffent été collées à deffein, ce qui
prouve, félon lu i , qu’elles y ont été apportées pâr
de l’eau. Un autre phénomène digne de remarque,
c’eft que les deux lames de ces pierres ont l’empreinte
■ de la même face de ces feuilles, l’une en creux,
l’autre en relief. Voyeç les mém, de l'acerd. royale des
Sciences, année iji8 .
M. de Juflieu cherche à expliquer ces phénomènes
par le féjour de la mer fur quelques parties de notre
globe , où fes eaux ont porté des plantes qu’elles
avoient apportées d’autres pays éloignés ; mais il pa-
roît que l’on ne peut guere expliquer ce phénomène
étrange, qu’en liippofant que les pays que nous habitons
, ont produit anciennement des plantes très-
différentes de celles qu’ils nous offrent maintenant,
8c que les révolutions générales que notre globe a
éprouvées depuis,ont changé notre climat 8c les pro-
duûions. Voye{ l'article FOSSILES & T erre, révolution
de la. (—3
PHYTOLOGIE , f. f. difeours fur les plantes, ou
Une defeription de leurs formes , de leurs efpeces ,
de leurs propriétés, &c. Voye^ Plante;
Ce mot eft compofé du grec çutov , plante, 8c Xoyoéy
difeours , de Myoiyje décris , je raconte.
PHYTOTYPOLITES, (.Hifi.nat.) les Naturaliftes
fe fervent de ce mot pour défigner les végétaux dont
on trouve des empreintes fur des pierres Ou fur d’autres
fubftances du regne minéral.
PHYXIEN, adj. (Mythol.) cpi^ioç y de tpûya , je me
fauve y je me réfugie ; épithete qu’on donnoit à Jupiter
chez les Grecs, parce qu’il étoit cenfé le protecteur
de ceux qui fe réfugioient dans les lieux oii on
l’honoroiti
P I
PIABÜCÜ, f in . ( Ichthyol.) noiri d’un poiffon d’A-
imérique, que les habitans mangent en plufieurs endroits
; c’eft un petit poiffon de trois ou quatre pouces
de long, 8c d’un ou deux de large, tout couvert
d’écailles argentines, olivâtres fur le dos, avec des
nageoires toutes blanches : ce petit poifl'on eft fi gourmand
du fang humain , que fi un homme qui fe baigne
a quelque part fur le corps Une bleffure ou une
écorchure, ce poiffon fait fes efforts pour en venir
fucer le fang ; c’eft du moins ce que dit Marggrave
dans fon hifi. lat. du Bréfil. (D . J.)
PIACHES, f. m. (Hiß.mod. culte.) nom fous lequel
les Indiens de la côte de Cumana en Amérique
défignoient leurs prêtres. Ils étoient non-feulement
les miniftres de la religion, mais encore ils exerçoient
la Médecine, 8c ils aidoient les Caciqites de leurs
confeils dans toutes leurs entreprifes; Pour être admis
dans l’ordre des piaches ± il falloit paffer par une
efpece de noviciat, qui confiftoit à errer pendant
deux ans.dans les forêts, où ils perfuadoient aü peuple
qu’ils recevoient des inftruüions de certains ef-
prits qui prenoient une forme humaine pour leur en-
feigner leurs devoirs 8c les dogmes de leur religion;
Leurs principales divinités étoient le fôleil 8c la liï-
11e, qu’ils afluroient être le inari 8c la femme. Ils re-
gardoient les éclairs 8c le tonnerre comme des lignes
fenfibles de la colere du foleil; Pendant les éelipfes )
^ 1 À 541
on fe prîvôit de toûtè nourriture ; les femmes fe ti-
roieht du fang 8c s’égratignoient les bras ; parce
qu’elles croioient cpie la lune étoit en querelle avec
fon mari; Les pretres montroient au peuple Une
croix,femblable à celle de S. André,que l’on re^ardoit
comme préfervatif contre les fantômes. La medecine
qu’exerçoient lès piaches confiftoit à donner aux malades
quelques herbes & racines, à les frotter avec lé
fang 8c la graiffe des animaux , 8c pour les douleurs
ils fearifioient la partie affligée, 8c la fuçoient lone-
tems pour en tirer les humeurs. Ces prêtres fe ml-
loient aufîi de prédire, 8c il s’eft trouvé des Efpa-
gnols affez ignorans pour ajouter foi à leurs prédictions.
Les piaches -, ainfi que bien d’autres prêtres *
favoient mettre à profit les erreurs des peuples ; 8c
fe faifoient payer chèrement leurs fervices. Ils tendent
le premier rang dans les feftins où ils s’eni-
vroient fans difficulté. Ils n’avoient aucune idée d’une
vie à venir. On brCdoit les corps des grands un
an après leur mort, 8c les échos paffoient pour les
réponfes dès ombres.
PIACULUM y f. m; ( Ant. rom. ) facrifice expiatoire.
Piacula, chez les Latins font ce que les Grecs
appelloient KaSuftaTa. , les purgations dont on fe fer-
voit pour expier ceux qui avoient commis les crimes;
ce mot fignifioit aufîi les paifums , S'upiapuTUy qu’on
employoit pour délivrer ceux qui étoient poffedés
de quelque démon. Horace, Epie, première , liv. /.
fait un bel ufage de ce terme au figuré, pour défigner
les remedes de la philofophie propre à purger l’amè
de fes vièeSi (D . J.)
PIADENA, ( Géog-. mod.) petite ville d’Italie, aujourd’hui
bourgade dans le Crémonefe, fur les confins
du Maritouan.
Cette bourgade eft le lieu de la naiffance de Bar-
thélemi Platine dans le xvi fiecle. Il donna les vies
des papes jufqu’à Paul II. Cet ouvrage eft écrit d’un
ftyle paffable, avec beaucoup de liberté, mais non
d’exa&itttde ; il a été traduit en françois , en italien
8c en allemand. Platine a compofé plufieurs autres
livres, 8c toutes fes oeuvres réunies ont été imprimées
à Louvain en 1572, 8c à Cologne en 1S74.,
in-fol. {D. J.)
PIAFFER, v. n. (Maréchàlleriè.) fe dit d’un cheval
q ui, en marchant, leve les jambes de devant fort
haut, 8c les replace prefque au même endroit avec
précipitation; Les chevaux qui piaffent, de même
que ceux qui font inftruits ati paffege ; font les plus
propres pour les earroufels 8c pour les oceafions d’éclat;
PIAFFEUR, f; m. (Maréchallèrie.) on appelle ainfi
un cheval qui piaffe. HmMPiaffer.
PIA1E , f. m. {Hifi. mod.) c’eft le nom que les fau-
vages qui habitent l’île de Cayenne donnent à urt
mauvais génie, qu’ils regardent comme l’auteur dé
tous les maux; Ces mêmes fauvages donnent encore
le nom de piaies ou de piayès à leurs prêtres, qui
font en même tems leurs forciers 8c leurs médecins;
Avant que d’être aggrégés à ce corps, celui qui s’y
deftine paffe par des épreuves fi rudes, que peu dë
gens pourroient devenir médecins à ce prix. Lorf-
que le récipiendaire a reçu pendant dix années les
inftrumens d’un ancien piaie, dont il eft en même
tems le valet, on lui fait obférver lin jeune fi. rigoureux
, qu’il en eft tôtaleriient exténué ; alors les anciens
piaies s’affemblent dans une cabane, 8c apprennent
au novice le principal myftere de leur art,- qui
confifte à évoquer les puiflancés de l’enfer ; ajlrès
quoi on le fait danfer jul'qu’à ce qu’il perde corinoif-
fance ; on le fait revenir en lui mettant des colliers 8c
des ceintures remplis de fourmis noires , qui le piquent
très-vivement ; après cela, pour l’accoutumer
aux remedes ; on lui fait avaler un grand verré dé
jus de tabac $ eè qui lui câtife des évacuations très«