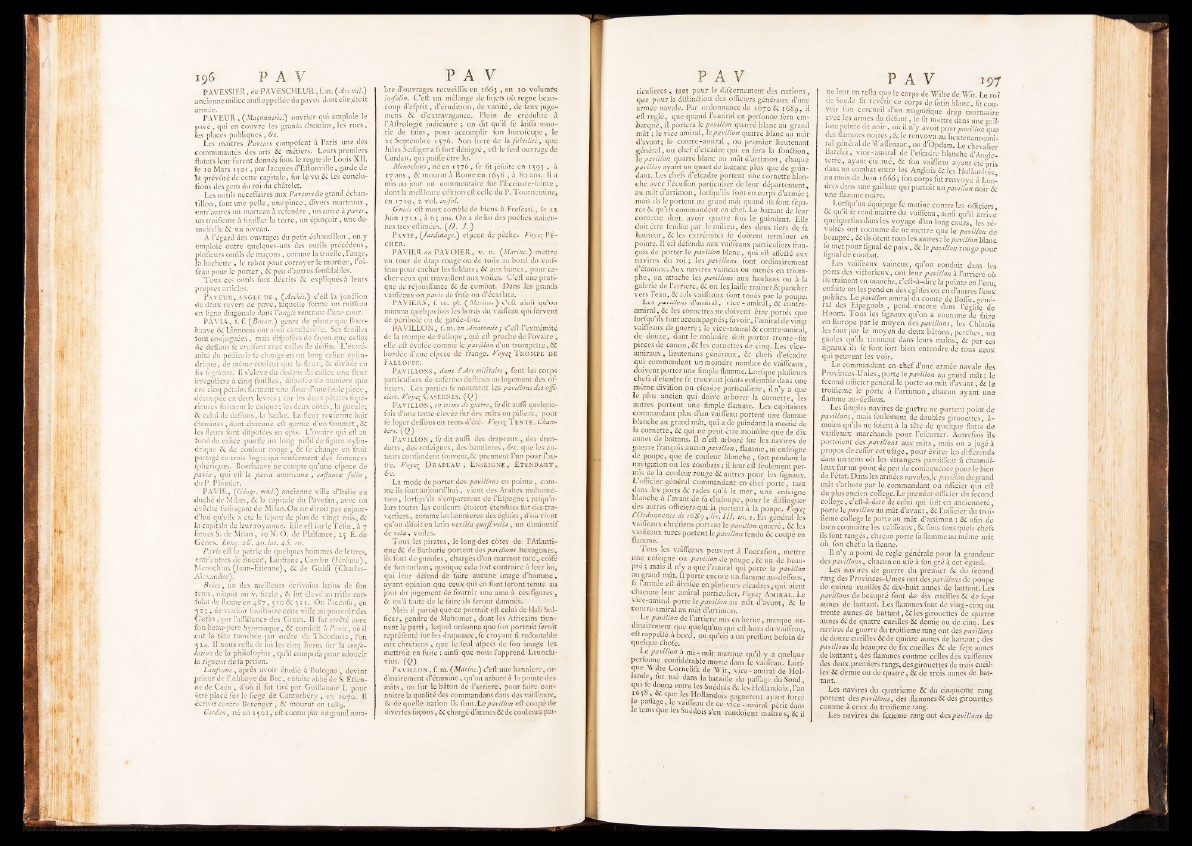
196 P A V
PAVESSIER, ou PAVESCHEUR, f. m. {Art mil.)
ancienne milice ainfi appeilée dupavoi dont elle etoit
armée.
PAVEUR , {Maçonnerie.) ouvrier qui emploie le
pa vé, qui en couvre les grands chemins, les rues ,
les places publiques , &c.
Les maîtres Paveurs compofent à Paris une des
communautés des arts & métiers. Leurs premiers
ftatuts leur furent donnés fous le régné de Louis XII.
le 10 Mars 1501, par Jacques d’Eltonville, garde de
la prévôté de cette capitale, fur le vu & les conduirons
des gens du roi du châtelet.
Les outils néceffaires aux Paveurs de grand échantillon
, font une pelle, une'pince, divers marteaux,
entr’autres un marteau à refendre , un autre à paver,
un troifieme à fouiller la terre, un épinçoir, une de-
moifelle 6c un niveau.
A l’égard des ouvrages du petit échantillon , on y
emploie outre quelques-uns des outils précédens,
plusieurs outils de maçons , comme la truelle, l’auge,
la hachette , le rabot pour corroyer le mortier, l’oi-
feau pour le porter , 6c peu d’autres femblablès.
Tous ces outils font décrits 6c expliqués à leurs
propres articles.
Pa v eu r , angle de , (.Ârckit.) c’eft la jonfrion
de deux revers de pavé, laquelle forme un ruiffeau
èn ligne diagonale dans l’angle rentrant d’une cour.
PÀVIA, f. f. {Botan.) genre de plante que Boer-
haave 6c Linnceus ont ainfi caraûérifée. Ses feuilles
font conjuguées , mais difpofées de façon que celles
de deflous fe croifent avec celles de deffus. L’extrémité
du pédicule fe change en un long calice cylindrique
, de môme couleur que la fleur, 6c divifée en
fix fegmens. Il s’élève du dedans du calice une fleur
irrégulière à cinq feuilles, dilpofée'de maniéré que
ces cinq pétales forment une fleur d’une feule p iece,
découpée en deux levres ; car les deux pétales fupé-
rieures forment le calque ; les deux côtes, la gueule;
& celui de deflous, la barbe. La fleur renferme huit
étamines, dont chacune eft garnie d’un fommet, 6c
les fleurs font difpofées en épis. L’ovaire qui eft ait
fond du calice pouffe un long piftil de figure cylindrique
6c de couleur rouge , 6c fe change en fruit
partagé en trois loges qui renferment des femences
fphériques. Boerhaave ne compte qu’une efpece de
pavia j qui eft la pavia americana , caflanece folio ,
du P. Plum ier.
PAVIE, {Géogr. mod.) ancienne ville d’Italie au
duché de Milan, 6c la capitale du Pavefan, avec un
évêché fuffragantde Milan. On ne diroitpas aujourd’hui
qu’ell'e a été le féjour de plus de vingt rois, 6c
la capitale de leur royaume. Elle eft fur leTéfin, à 7
lieues'Sl de Milan, 10 N. O. de Plaifance, 25 E. de
Gènes..Long. 2C. 40.lat. 46. rô.
Pavie eft la patrie de quelques hommes de lettres,
entr’autres de Boëcd', Lanfranc, Cardan (Jérôme),
Menochius (Jean-Etienne), & de Guidi (Charles-
Alexandre).
Boece, un des meilleurs écrivains latins de fon
tems , naquit au v. fiecle , & fiit élevé au trifte con-
fulat de Rome en 487, 51 o 6c 511. On l’accufa, en
523 , de vouloir fouftraire cette ville au pouvoir des
Goths , par l’afliftance des Grecs. Il fut arrêté avec
fon beàu-pere Symmaque, 6c conduit à Pavie, oiiil
eut la tête tranchée par ordre de Théodoric, l’an
524. Il nous refte de lui les cinq livres fur la confo-
latiofi de la philofophie , qu’il compofa pour adoucir
la rigueur de fa prifon.
Lanfranc, après avoir étudié à Bologne , devint
prieur de l’Abbaye du Bec, enfuite abbé de S. Etienne
de Caen , d’oii il fi.it tiré par Guillaume I. pour
être placé fur le fiege de Cantorbéry , en 1070. Il
écrivit contre Berenger , 6c mourut en 1080.
Cardan, né en 1501, eft connu par tin grand nom-
P A V
bre d’ouvrages recueillis en 1663 , en 10 volumes
in-folio. C’eft un mélange de fujets où régné beaucoup
d’efprit, d’érudition, de vanité, de faux juge-
mens &£ d’extravagance. Plein de crédulité à
l’Aftrologie judiciaire ; on dit qu’il fe laifla mourir
de faim, pour accomplir fon horofeope, le
21 Septembre 1576. Son livre de la fubtilité, que
Jules Scaliger a fi fort dénigré, eft le feul ouvrage de
Cardan, qui puiffe être lu.
Menochius, né en 15 76 , fe fit jéfuite en 1593 , à
17 ans , 6c mourut à Rome en 1656 , à 80 ans. Il a
mis au jour un commentaire fur l’Ecriture-fainte ,
dont la meilleure édition eft celle du P. Tournemine,
en 17 19 , 2 vol. in- fol.
Guidi eft mort comblé de biens à Frefcati, le 12
Juin 1712 , à 63 ans. On a de lui des poéfies italiennes
très-eftimées. {D. J. )
Pa v ie , {Jardinage.) efpece dépêché. Voye^ PÉCHER.
PAVIER ou PAVOIER, v. n. {Marine.) mettre
un tour de drap rouge ou de toile au bord du vaiffeau
pour cacher les loldats ; 6c aux hunes, pour cacher
ceux qui travaillent aux voiles. C’eft une pratique
de réjouiffance & de combat. Dans les grands
vaiffeaux on pavie de frife ou d’écarlate.
PAVIERS, f. m. pl. {Marine. ) c’eft ainfi qu’on
nomma quelquefois les bords du vaiffeau qui fervent
de péribole ou de garde-fou.
PAVILLON, f. m. en Anatomie ; c’eft l’extrémité
de la trompe de Fallope, qui eft proche de l’ovaire,
elle eft évafée pomme le pavillon d’un trompette, &
bordée d’une efpece de frange. Voye{ T rompe de
Fa llop pe.
Pa v il l o n s , dans tArt militaire , font les corps
particuliers de cafernes deftinés au logement des officiers.
Ces parties fe nomment les pavillons des officiers.
Poye^ C asernes. (Q )
Pa v il l o n -, en terme de guerre, fe dit aufli quelquefois
d’une tente élevée fur des mâts ou piliers, pour
fe loger deflous en tems d’été. Voyeç T ente. Cham-
bers. ( (2 ) ':
Pavillon , fe dit aufli des drapeatix, des éten-
darts, des enfeignes, des bannières , &c. que les auteurs
confondent fouvent,& prennent l’un pour l’autre.
Voye^ D r a p e a u , Ense igne, Ét e n d a r t ,
La mode de porter des pavillons en pointe, comme
ils font aujourd’h u i, vient des Arabes mahomé-
tans, lorfqu’ils s’emparèrent de l’Efpagne ; jufqu’a-
lors toutes les couleurs étoient étendues fur des tra-
verfiers, comme les bannières des églifes, d’où vient
qu’on difoit en latin vexilla quajt vella, un diminutif
de vêla, voiles.
Tous les pirates, le long des côtes de l’Atlantique
6c de Barbarie portent des pavillons hexagones ,
ils font de gueules, chargés d’un marmot turc, coifé
de fon turban ; quoique cela foit contraire à leur loi,
qui leur défend de faire aucune image d’homme,
ayant opinion que ceux qui en font feront tenus' aii
jour du jugement de fournir une ame à ces figures,
& qu’à faute de le faire ils feront damnés.
Mais il paroît que ce portrait eft celui de Hali Sul-
ficar, gendre de Mahomet, dont les Africains tiennent
le parti, lequel ordonna que fon portrait feroit
repréfenté lur les drapeaux ,fe croyant fi redoutable
aux chrétiens , que le feul afpeft de fon image les
mettroit en fuite : ainfi que nous l’apprend Leuncla-
vius/ (Q)
Pavillon , f. m. {Marine.) c’eft une bannière, ordinairement
d’étamine, qu’on arbore à la pointe des
mâts, ou fur le bâton de l’arriéré, pour faire con-
noître la qualité des commandaiis dans des vaiffeaux,
& de quelle nation ils font. Le pavillon eft coupé de
diverfes façons ,& chargé d’armes 6c de couleurs par-
P A V
ticulieres-, tant pour le difeernement des nations,
que pour la diftinâion des officiers généraux d’une
armée navale. Par ordonnance de 16 70& 1689, il
eft réglé, que quand l’amiral en perfonne fera embarqué,
il portera le pavillon quarré blanc au grand
mât ; le vice amiral, \epavillon quarré blanc au mât
d’avant; le contre-amiral, ou premier lieutenant
général, ou chef d’efeadre qui en fera la fonftion,
1 e pavillon quarré blanc au mât d’artimon, chaque
pavillon ayant un quart de battant plus que de guin-
dant. Les chefs d’efeadre portent une cornette blanche
avec Péciiffon particulier de leur département
au mât d’artimon, lorfqu’ils font en corps d'armée ;
mais ils le portent au grand mât quand ils font fépa-
rés & qu’ils commandent en chef. Le battant de leur
cornette doit avoir quatre fois le guindant. Elle
doit être fendue par le milieu, des deux tiers de fa
hauteur, 6c les extrémités fe doivent terminer en
pointe. Il eft défendu aux vaiffeaux particuliers fran-
çois de porter le pavillon blanc, qui eft affe&é aux
navires du roi ; les pavillons font ordinairement
d’étamine. Aux navires vaincus ou menés en triomphe,
on attache les pavillons aux haubans ou à la
galerie de l’arriere, 6c 011 les laiffe traîner &pancher
vers l’eau, & tels vaiffeaux font toués par la poupe.
Les pavillons d’amiral, vice-amiral, 6c contre-
amiral, & les cornettes ne doivent être portés que
lorfqu’ils font accompagnés; fa voir, l’amiral de vingt
vaiffeaux de guerre ; le vice-amiral & contre-amiral,
de douze, dont le moindre doit porter trente-fix
pièces de canon, & les cornettes de cinq. Les vice-
amiraux , lieutenans généraux, &: chefs d’efeadre
■ qui commandent un moindre nombre de vaiffeaux,
doivent porter une fimple flamme. Lorfque plufieurs
chefs d’efeadre fe trouvent joints enfemble dans une
même divifion ou efeadre particulière, il n’y a que
le plus ancien qui doive arborer la cornette, les
autres portent une fimple flamme. Les capitaines
commandant plus d’un vaiffeau portent une flamme
blanche au grand mât, qui a de guindant la moitié de
la cornette, 6c qui ne peut être moindre que de dix
aunes de battans. Il n’eft arboré fur les navires de
guerre françois aucun pavillon, flamme, ni enfeigne
de poupe, que de couleur blanche , foit pendant la
navigation ou les combats ; il leur eft feulement permis
de la couleur rouge 6c autres pour les fignaux.
L ’officier général commandant en chef porte, tant
dans les ports 6c rades qu’à la mer, une enfeigne
blanche à l’avant de fa chaloupe,.pour le diftinguer
des autres officiers qui la portent à la poupe. Foye^
VOrdonnance de i€8c, , liv. III. tit. 2. En général les
vaiffeaux chrétiens portent le pavillon quarré, 6c les
vaiffeaux turcs portent le pavillon fendu 6c coupé en
flamme.
Tous les vaiffeaux peuvent .à l’occafion, mettre
une enfeigne ou pavillon de.poupe, 6c un de beaupré
; mais il n’y a que l’amiral qui porte le pavillon
au grand mat. Il porte encore un flamme, au-deffous,
îila rmee eft divifee.en plufieurs efeadres; qui aient
chacune leur amiral particulier. Voye^ Amiral. Le
vice-amiral porte le/^vzV/o/z au mât d’avant, & le
contre-amiral au mât d’artimon.
Le pavillon de l’arriere mis en berne, marque ordinairement
que quelqu’un qui eft hors du‘vaiffeau,
eft rappelle, à bord, ou qu’on a un preflant befoin de
quelque chofe.
Le pavillon a mi - mât marque qu’il y a quelque
perlonne confiderable morte dans le vaiffeau. Lorf-
que Wilte Cornelifz. de W it, vjee-amiral de Hol-
iande, tut tue dans la bataille du paffage duSond,
qui le donna entre les Suédois & les Hollandois, l’an
5 > que les Hollandois-gagnèrent ayant forcé I
le paffage, le vaiffeau de ce vice-amiral périt dans •
le tems que les Suédois s’en rendoient maître s, & il
p a v 197
ne leur en refta que le corps de Wilte de V it . Le roi
deSuede fit revetir ce corps de fatin blanc, fit couvrir
fon cercueil d’un magnifique drap mortuaire
avec les armes du défunt, le fit mettre dans une gail-
lote peinte de noir, où il n’y avoit pour pavillon que
des flammes noires , & le renvoya au lieutenant-amiral
général de Waffenaar, ou d’Opdam. Le chevalier
Barclei, vice-amiral de l’efeadre blanche d’Angleterre,
ayant été tué, & fon .vaiffeau ayant été pris
dans un combat entre les Anglois & les Hollandois
au mois de Juin 1666; fon corps fut renvoyé à Londres
dans une gaillote qui portoit un pavillon noir &
une flamme noire.
Lprfqu’un.équipage fe mutine contre les officiers,
& qu’il fe rend maître du vaiffeau, ainfi qu’il arrive
quelquefois dans les voyage d’un long cours, les révoltés
ont coutume de ne mettre que \ç. -pavillon de
beaupré, & ils ôtent tous les autres : le pavillon blanc
fe met pour fignal de paix, & le pavillon rouge pour
fignal de combat. »
Les vaiffeaux vaincus, qu’on conduit dans les
ports des vi&orieux, ont leur pavillon à l’arriere où
ils traînent en oiiaiche, c’eft-à-dire la pointe en l’eau
enfuite on les pend en des églifes ou en d’autres lieux
publics. ’La. pavillon amiral du comte de Boffu, vénérai
des Efpagnols , pend encore dans l’égiife de
Hoom. Tous les fignaux qu’on a coutume de faire
en Europe par le moyen des pavillons, les Chinois
les font par le moyen de deux bâtons, perches ou
gaules qu’ils tiennent dans leurs mains, & par ces
fignaux ils fe font fort bien entendre de tous ceux
qui peuvent les voir.
Le commandant en chef d’une armée navale des
Provinces-Unies, porte le pavillon au grand mât; le
fécond officier général le porte au mât d’avant ; & le
troifieme le porte à l’artimon, chacun ayant une
flamme au-deffous.
Les fimples navires de guéfre ne partent point de
pavillons, mais feulement de doubles girouettes, à-
moins qu’ils ne foient à la tête de quelque flotte de
vaiffeaux marchands pour l’efeorter. Autrefois ils
portoient des pavillons aux mâts , mais on a jugé à
propos de ceffer cet ufage, pour éviter les différends
dans un tems où les étrangers paroiffent fi chatouilleux
fur un point de peu de conféquence pour le bien
de l’état. Dans les armées navales,le pavillon du grand
mât s’arbore par le commandant ou officier qui eft
du plus ancien college. Le premier officier du fécond
college, c’eft-à-dire de celui qui fuit en ancienneté,
porte le pavillon au mât d’avant, & l’officier du troifieme
college le porte au mât d’artimon : 6c afin de
bien connoitre les vaiffeaux, & fous tous quels chefs
ils font rangés , chacun porte fa flamme au même mât
où fon chef a la fienne.
Il n’y a point de réglé générale pour la grandeur
des pavillons, chacun en .ufe à.fon gré à cet égard.
Les navires de guerre du premier & du fécond
rang des Provinces-Unies ont des pavillons de poupe
de .quinze cueilles & dix-huit aunes de battant. Les
pavillons de beaupré font de dix cueilles & de fept
aunes de . battant. Les flammes font de ving-cinq ou
trente aunes de battant, & les girouettes de quatre
aunes & de quatre cueilles & demie ou de cinq. Les
navires de guerre du troifieme rang ont des pavillons
de douze cueilles & de-quinze aunes de battant ; des
pavillons de beaupré de fix cueilles & de fept aunçs
de battant ; des flammes comme celles des vaiffeaux
des deux premiers rangs, des girouettes de trois cueilles;
& demie ou de quatre, & de trois aunes débattant.
Les navires du quatrième & du cinquième rang
portent des pavillons, des flammes & des girouettes
•OOmjne à. eeu'x du troifieme rang.
. Les navires du fixjeme rang ont des pavillons de