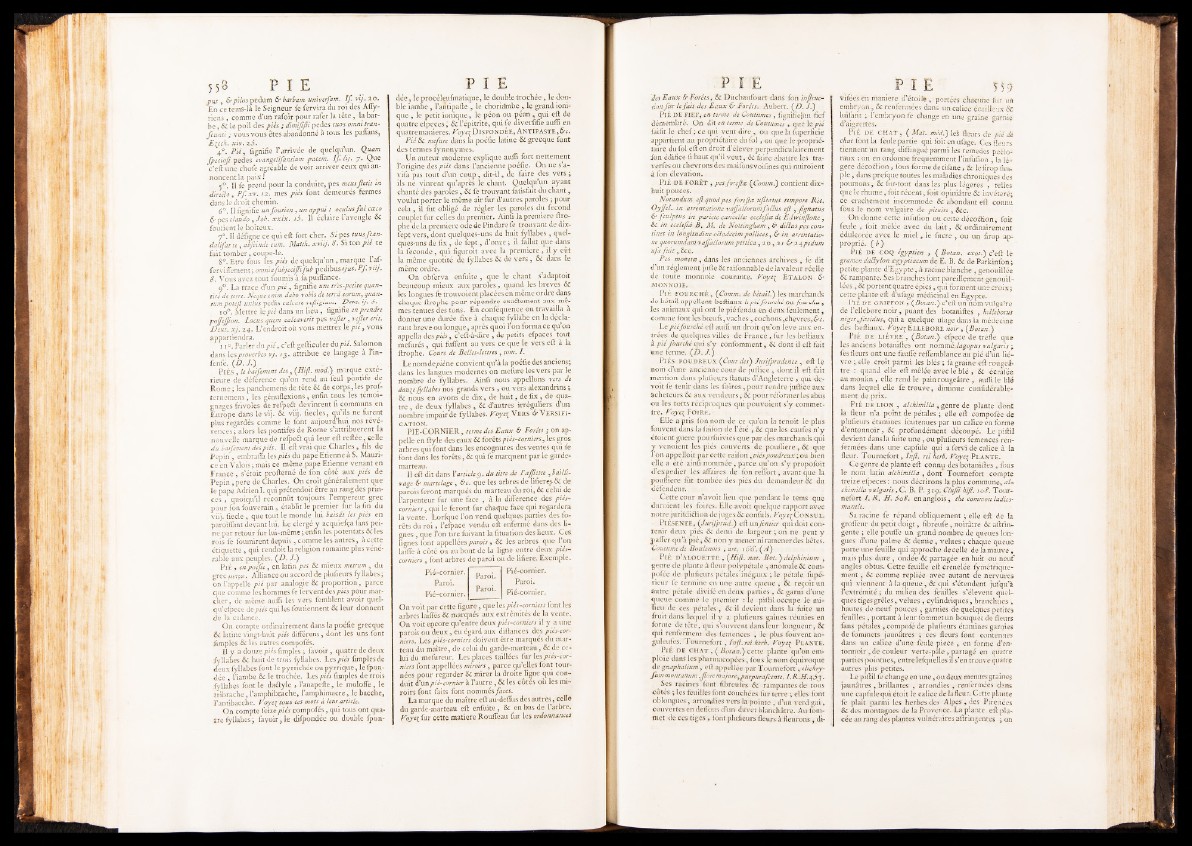
5 58 P I E
pm , & p'dos pedum & barbant univcrfam. If. vij. 20.
En ce tems-là le Seigneur fe fervira du roi des Affy-
riens , comme d’un rafoir pour rafer la tete, la barb
e , & le poil des pies ; dimifljli pedes tuos omni tran-
Jeunti ; vous vous êtes abandonné à tous les paflans,
JEçech. xiv. z 5.
40. P ié, lignifie l’arrivée de quelqu’un. Quant
fpeciofl pedes evangclifantium pacem. IJ. lij. y. Que
c’eft une choie agréable de voir arriver ceux qui annoncent
la paix ! . .
50. Il fe prend pour la conduite, pes meusjletit in
directo, Pf.xv. 12. mes pies font demeurés fermes
dans le droit chemin.
6°. Il fignifie un foutien, un appui : oculusfui coeco
6 pes claudo , Job. xxix. i5. Il éclaire l’aveugle &
foutient le boiteux.
70. Il défigne ce qui eft fort cher. Si pes tuusfcan-
dalifat te , abfcinde eum. Match, xviij. 8. Si ton pie te
fait tomber, coupe-le.
8°. Etre fous les pies de quelqu’u n , marque l’af-
ferviflement ; omniafubjeciflifub pedibus ejus. Pf. viij.
8. Vous avez tout fournis à fa puiflance.
90. La trace d’un pié, lignifie une très-petite quantité
de terre. Neque enim dabo vobis de terra eorum, quantum
potejl unius pedis calcare vefligium. Deut. ij. 5.
io ô. Mettre le pié dans un lieu , fignifie en prendre
pojfejjion. Locus quem calcaverit pes vejler, vejler erit.
Deut. x j. 24. L’endroit oii vous mettrez le pié, vous
appartiendra. | .,
1 1°. Parler du pié, c’eft gefticuler du pie. Salomon
dans les proverbes vj. 13. attribue ce langage à lin-
fenfé. (i0. J . ) . r
PlÉS , Le baifement des, (Hifi. mod.') marque extérieure
de déférence qu’on rend au feul pontife de
Rome ; les panchemens de tête & de corps, les prof-
ternemens, les génuflexions, enfin tous les témoignages
frivoles de refpeû devinrent li communs en
Europe dans le vij. & viij. liecles, qu’ils ne furent
plus regardés comme le font aujourd’hui nos reve-
rences; alors les pontifes de Rome s’attribuèrent la
nouvelle marque de refpeél qui leur eft reliée, celle
du baifement des pies. Il eft vrai que Charles , fils de
Pépin , embrafla les pies du pape Etienne à S. Maurice
en Valois; mais ce même.pape Etienne venant en
France, s’étoit profterne de fon coté aux pies de
Pépin, pere de Charles. On croît généralement que
le pape Adrien I. qui prétendoit être au rang des princes
, quoiqu’il reconnût toujours l’empereur grec
pour fon fouverain, établit le premier fur la fin du
viij. liecle , que tout le monde lui baisât Les piés en
paroifîant devant lui. Le clergé y acquiefça fans peine
par retour fur lui-même ; enfin les potentats & les
rois fe fournirent depuis, comme les autres, à cette
étiquette , qui rendoit la religion romaine plus vénérable
aux peuples. (D. J-)
P l i , enpoejie, en latin pes & mieux metrum , du
grec /AtTpov. Alliance ou accord de plufieurs fyllabes ;
on l’appelle pié par analogie & proportion, parce
que comme les hommes fe fervent des piés pour marcher,
de même aufli les vers femblent avoir quel-
qu’efpece de piés qui les foutiennent & leur donnent
de la cadence.
On compte ordinairement dans la poéfie grecque
ôc latine vingt-huit piés différens, dont les uns font
.fimples & les autres compofés.
Il y a douze piés fimples ; favoir , quatre de deux
fyllabes & huit de trois fyllabes. Les piés fimples de
deux fyllabes font le pyrrichée ou pyrrique, le fpon-
dée l’iambe & le trochée. Les piés fimples de trois
fyllabes font le daûyle ? l’anapefte, le moloffe, le
tribrache, Pamphibrache, l’amphimacre, le bacche,
l’antibacche. Voye[ tous ces mots à Leur article.
On compte feize piés compofés, qui tous ont qua-
2re fyllabes; favoir,le difpondée ou double fpon-
P I E
dée, le procéleiifmatique, le double trochée, le double
iambe, l’antipafte , le choria'mbe , le grand ionique
, le petit ionique, le péon ou péan , qui eft de
quatre efpeces j &. Pépitrite, qui fe diverfifie aufli en
quatre maniérés. r b y e^D lS PO N D É E , A n t i p a s t E j& c.
Pié & mefure dans la poéfie latine & grecque font
des termes fynonymes.
Un auteur moderne explique aufli fort nettement
l’origine des piés dans l’ancienne poéfie. On ne s’a-
vifa pas tout d’un coup, dit-il, de faire des vers ;
ils ne vinrent qu’après le chant. Quelqu’un ayant
chanté des paroles, & fe trouvant fatisfait du chant,
voulut porter le même air fur d’autres paroles ; pour
ce la , il fut obligé de régler les paroles du fécond
couplet fur celles du premier. Ainfi la première ftro-
phe de la première ode de Pindare fe trouvant de dix-
îept vers, dont quelques-uns de huit fyllabes , quelques
uns de fix , de iep t, d’onze ; il fallut que dans
la fécondé, qui figuroit avec la première, il y eut
la même quotité de fyllabes & de vers , & dans le
même ordre.
On obferva enfiiite , que le chant s’adaptoit
beaucoup mieux aux paroles , quand les brèves &
les longues fe trouvoient placées en même ordre dans
chaque ftrophe pour répondre exactement aux memes
tenues des tons. En conféquence on travailla a
donner une durée fixe à chaque fyllabe en la déclarant
breve ou longue, après quoi l’on forma ce qu’on
appella des piés, c’eft-à-dire , de petits efpaces tout
mefurés, qui fufîent au vers ce que le vers eft à la
ftrophe. Cours de Belles-lettres , tom. I.
Le nom de/)« ne convient qu’à la poéfie des anciens;
dans les langues modernes on mefure les vers par le
nombre de fyllabes. Ainfi nous appelions vers de
dou\e fyllabes nos grands vers , ou vers alexandrins ;
& nous en avons de dix, de huit, de fix , de quatre
, de deux fyllabes , & d’autres irréguliers d’un
nombre impair de fyllabes. Voye1 V e r s 6* V e r s i f i c
a t i o n .
PIÊ-CORNIER, terme des Eaux & Forets ; on appelle
en ftyle des eaux & forêts piés-corniers, les gros
arbres qui font dans les encognures des ventes qui fe
font dans les forêts, & qui fe marquent par le garde-
marteau.
Il eft dit dans l’articleg. du titre de Fajjîette , bailli-
vage & martelage , &c. que les arbres de lifieres & de
parois feront marqués au marteau du roi, & celui de
l’arpenteur fur une face , à la différence des piés-
corniers , qui le feront fur chaque face qui regardera
la vente. Lorfque l’on vend quelques parties des forêts
du r o i , l’efpace vendu elt enferme dans des lignes
, que l’on tire fuivant la fituation des lieux. Ces
lignes font appellées parois, & les arbres que l’on
laifle à côté ou au bout de la ligne entre deux pies-
cor nier s , font arbres de paroi ou de lifiere. Exemple.
Pié-cornier.
Paroi.
Pié-cornier.
Paroi.
Paroi.
Pié-cornier.
Paroi.
Pié-cornier.
On voit par cette figure, que les piés-corniers font les
arbres laiffés & marqués aux extrémités de la vente.
On voit epeore qu’entre deux piés-corniers il y a une
parois ou d eux, eu égard aux diftances des piés-corniers.
Les piés-corniers doivent être marqués du marteau
du maître, de celui du garde-marteau, & de celui
du mefureur. Les places taillées fur les piés-corniers
font appellées miroirs, parce qu’elles font tournées
pour regarder & mirer la droite ligne qui conduit
d’un pié-cornier à l’autre, & les côtes ou les miroirs
(ont faits font nommés faces.
La marque du maître eft au-deffus des autres, celte
du garde-marteau eft enfuite, & en bas de 1 arbre»
Voye{ fur cette matière Rouffeau fur les ordonnances
P I E
des Eaux & Forêts, & Duchaufourt dans fon ïnflrut-
tion fur Le fait des Eaux & Forêts-. Aubert. (D . / .)
PlÉ DE FIÈFj en terme de Coutumes , fignifiejun fief
démembré» On dit en terme de Coutumes , que le pié
faifit le chef ;• ce qui veut dire , ou que la fiiperficie
appartient au propriétaire du fo l , ou que le propriétaire
du fol eft en droit d’élever perpendiculairement
fon édifice fi haut qu’il v eu t, & faire abattre les tra-
verfes ou chevrons des maifons voifines qui nuiroient
à fon élévation.
PlÉ DE FORÊT j pesforeflee ( Conirn.) contient dix-
huit pouces.
Notandum efi quodpes foreflee ußtatus tempore Rie.
O y f l . in arrentatione vaffalLorum fichus eß , fignatus
& fculptus in pariete cancelloe eccleßce de Edwinfione,
& in ecclefiâ B. M. de Nottingham , & dictas pes continu
in longitudine octodecim pollices, & in arrentado-
tie quorumdatri vaffalLorumpertica, 20 ,2 1 & 24pedum
ufa fu i t , &c.
P es mohetee , dans le s an c ie n n e s a r c h iv e s , fe d it
çl’u n r é g lem e n t ju f t e tte. r a ifo n n a b le d e la v a le u r r é e l le
d e to u te m o n n o ie co u r a n te . Voye%_ É t a l o n 6*
.MONNOIE.
PlÉ FOURCHÉ, ( Comm. de bétail.') les marchands
de bétail appellent beftiaux à pié fourché ou fourchu,
les animaux qui ont le pié fendu en deux feulement,
comme font les boeufs, vaches, Cochons»chevresj&c.
Le pié fourché eft aufli un droit qu’on leve aux entrées
de quelques villes de France , fur les beftiaux
à pié fourché qui s’y confomment, & dont il eft fait
une ferme. (Z>. J.)
Piés POUDREUX (Cour des) Jurifprudence , eft le
pom d’une ancienne cour de juftice , dont il eft fait
mention dans plufieurs ftatuts d’Angleterre , qui de-
voit fe tenir dans les foires , pour rendre juftice aux
acheteurs & aux vendeurs, & pour réformer les abus
ou les torts réciproques qui pouvoient s’y commettre.
Voye^ Fo ire. ■
Elle a pris fon nom de ce qu’on la tenoit le plus
fouvent dans la faifon de l’été , & que les caufes n’y
étoient guere pourfiiivies que par des marchands qui
y venoient les piés couverts de poufliere , & que
l ’on appelloit par cette raifon rpiéspoudreux ; ou bien
elle a été ainfi nommée, parce qu’on s’y propofoit
d’expedier les affaires de fon reflbrt, avant que la
poufliere fût tombée des piés du demandeur & du
défendeur.
Cette cour n’avoit lieu que pendant le tems que
duroient lès foires. Elle avoit quelque rapport avec
notre jurildiftion de juges & confuls. Voye{ C o n s u l .
P i ÉSENTE, (JuriJ'prud.) e ft \mfentier q u i d o i t c o n t
e n i r d e u x p ié s & d em i d e . la r g e u r ; o n n e p eu t y
p a f le r q u ’à p ié * &: n o n y m e n e r n i r am en e r d es b ê te s.
Coutume de Boulenois , art. iGC. fA )
PlÉ d ’ a l o u e t t e , (Hiß. nat. Bot. ) delphinium i
genre de plante à fleur poiypétale , anomale & corn-
pofée de plufieurs pétales inégaux ; le pétale fupéri
eur fe termine en une autre queue , & reçoit un
autre pétale divilé en deux parties , & garni d’une
queue comme le premier : le piftil occupe le milieu
de ces pétales , & il devient dans la fuite un
fruit dans lequel il y a plufieurs gaînes réunies en
forme de tête, qui s’ouvrent dans leur longueur, &
qui renferment des lèmences § l e plus fouvent an-
guleufes. Tournefort, Inß. rei.htrb. Voye\[ P l a n t e .
Pie d e c h a t , ( Bot an.) cette plante qu’on emploie
dans les pharmacopées, fous le nom équivoque
de gnaphalium, eft appellée parTournefort, elichry-
fum montanum,flore majore,purpurafeente. I. R.H.46g .
, Ses racines font fibreufes & rampantes de tous
cotés ; les feuilles font couchées fur terre ; elles font
oblongues, arrondies vers la pointe , d’un verd gai,
couvertes en deffous d’un dilvet blanchâtre. Au fom-
met de ces tiges, font plufieurs fleurs à fleurons, di-
P I E 559 vifees én maniéré d’etoile , portées chacune fur un
embryon, & renfermées dans un calice écailleux &
luifant ; l’embryon le change en une craine garnie
d’aigrettes.
Pié d e c h a t , ( Mat. méd.) leà fleurs de pié dé
chat font la feule partie qui foit en ufagé. Ces fleurs
tiennent un rang diftingué parmi les reinedes pefto-
raux : on en ordonne fréquemment l’infufion , la legere
déeoftion, fous forme detifane, & leiirop Ample
, dans prefque toutes les maladies chroniques des
poumons, & lur-tout dans les plus légères , telles
que le rhume, foit récent, foit opiniâtre & invétéré;
ce crachement incommode & abondant eft connu
fous le nom vulgaire de pituite, &c.
On donne cette infiifion ou cette décodion, foit
feule , foit mêlée avec du la it , & ordinairement
édulcorée avec le mie l, le fucre , ou un firop approprié.
( b )
PlÉ d e COQ égyptien , ( Botan. exot.) c’eft le
gramen daclylon cegypdacum de E. B. & de Parkinfon;
petite plante d’Egypte, à racine blanche , genouillée
& rampante. Ses branches font pareillement genou il-
lées , & portent quatre épies, qui forment une croix;
cette plante eft d’ufage médicinal en Egypte.
PlÉ DE g r i f f o n , (Botan.) c’ eft un nom vulgaire
de l’ellebore noir, puant des botaniftes , hdleborus
niger,fatidus, qui a quelque ulage dans la médecine
des beftiaux. Voye^ E l l é b o r e noir, (Botan.)
P i é d e l i è v r e , (Botan.) efpece de trèfle que
les anciens botaniftes ont nomméJagopus vulgaris ;
fes fleurs ont une fàuffe reflemblance au pié d’un lièvre
; elle croît parmi les blés ; fa graine eft rougeâtre
: quand elle eft mêlée avec le blé , & écrafée
au moulin, elle rend le pain rougeâtre , aufli le blé
dans lequel elle fe trouve, diminue confidérable-*
ment de prix.
P i é d e l i o n , alchimilla , genre de plante dont
la fleur n’a point de pétales ; elle eft compofée de
plufieurs étamines foutenues par un calice en forme
d’entonnoir, & profondément découpé. Le piftil
devient dans la fuite une, ou plufieurs femences renfermées
dans une capfule qui a lèrvi de calice à la
fleur. Tournefort, Infi, rei herb, Voye^ P l a n t e .
Ce genre de plante eft connu des botaniftes , fous
le nom latin alchimilla , dont Tournefort compte
treize efpeces : nous décrirons la plus commune, alchimilla
vulgaris, C. B. P. 319. Clußi hiß. 108. Tournefort
I. R. H. S 08. en anglois, the common ladies-
mantle.
Sa racine fe répand obliquement ; elle eft de la
grofleur du petit doigt, fibreufe, noirâtre & allrin**
gente ; elle poufle un grand nombre de queues longues
d’une palme & demie , velues ; chaque queue
porte une feuille qui approche de celle de la mauve ,
mais plus dure , ondée & partagée en huit ou neuf
angles obtus. Cette feuille eft crenelée fymétrique-
ment, & comme repliée avec autant de nervures
qui viennent à la queue , & qui s’étendent jufqu’à
l ’extrémité ; du milieu des feuilles s’élèvent quelques
tiges grêles, velues , cylindriques, branchues ,
Hautes de neuf pouces , garnies de quelques petites
feuilles , portant à leur fommetun bouquet de fleurs
fans pétales , compofé de plufieurs étamines garnies
de fommets jaunâtres ; ces fleurs font contenues
dans un calice d’une feule pieCe , en forme d’entonnoir
, de couleur verte-pâle , partagé en quatre
parties pointues, entre lefquelles il s’en trouve quatre
autres plus petites.
Le piftil fe change en une, ou deux menues grain es
jaunâtres , brillantes , arrondies , renfermées dans
une capfule qui étoit le calice delafleur. Cette plante
fe plaît parmi les herbes des Alpes, des Pirenées
& des montagnes de la Provence. La plante eft placée
au rang des plantes vulnéraires aftringentes ; on