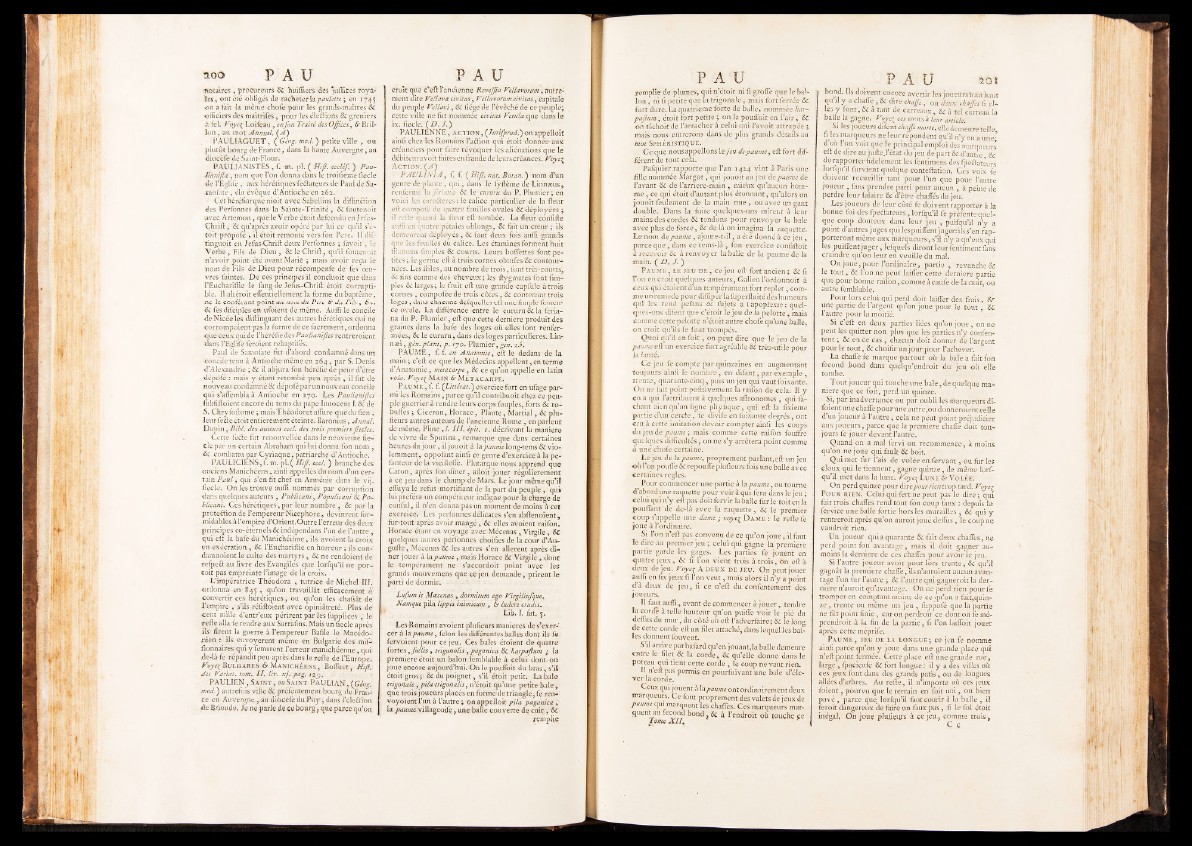
I
||
»IM
UjJtl, I
notaires , procureurs & huiffiers des juftices royale
s , ont été obligés de racheter la paukt te ; en 1745
on a fait là même chofe pour les grands-maîtres &
officiers des maîtrifés-, pour les éleftions fk. greniers
à fel. Voyeç Loifeau , en fon Traite des Offices, & Brillon
, au mot Annuel. (A )
PAULIAGUET, ( Géog. mod. ) petite ville , ou
plutôt- bourg de France, dans la haute Auvergne, au
diocèfe de Saint-Flour.
PAULIANISTES, f. m. pi. ( Hiß. eccléf, ) Pau-
-lîaniflæ, nom que l’on donna dans le troifieme liecle
■ de l’Eglife , aux hérétiques feêlateurs de Paul de Sa-
mofate , élu évêque d’Antioche ein 26a.
■ Cethéréfiarque nioit avec Sabellius, la diftinftion
des Perfonnes dans la Sainte-Trinité , &fioutenoit
avec Artemon, que le V erbe étoit defeendu en J efus-
Chrift, & qu’après avoir opéré par lui ce qu’il s’é-
toit propofe , il étoit remonté vers fon Pere. 11 dif-
tinguoit en Jefus-Çhrift deux Perfonnes ; favoir, le
V e rb e , Fils de Dieu , & le Chrift, qu’il foutenoit
n’avoir point été avant Marie ; mais avoir reçu le
nom de Fils de Dieu pour récompenfe de fes oeuvres
faintes. De ces principes il concluoit que dans
l'Euchariftie - le fang de Jefus-Chrift étoit corruptible.
Il altérait effentiellement la forme du baptême,
ne le conférant point au nom du Pere & du F ils, &c.
& fes difciples en ufoient de même. Auffi le concile
de Nicée les diftinguant des autres hérétiques qui ne
coirompoient pas la forme de ce facrement, ordonna
que ceux qui de l’héréftedes Paulianißes rentrèroient
■ dans l’Eglife feroient rebaptifés.
Paul de Samofate fut d’abord condamné dans un
concile tenu à Antioche même en 264, par S. Denis
d’Alexandrie ; & il abjura don héréfie de peur d’être
dépofé : mais y étant retombé peu après , il fut de
nouveau condamné & dépofé par un nouveau concile
qui s’affembla à Antioche en 270. Les Paulianifles
fubfiftoient encore du tems du pape Innocent I. & de
S. Chryfoftome ; maisThéodoret allure que du lien ,
leur feéte étoit entièrement éteinte. Baromus, Annal.
Dupin, Bibl. des auteurs eccl. des trois premiersßecles.
Cette fecle fut renouvellée dans-le neuvième liecle
par un certain Abraham qui lui donna fon nom ,
& combattu par Cyriaque, patriarche d’Antioche.
PAULICIENS, 1. m. pl. ( Hiß. eccl. ) branche des
anciens Manichéens, ainfi appellés du nom d’un certain
Paul, qui s’en fit chef en Arménie dans le vij.
liecle. On les trouve aulîi nommés par corruption
dans quelques auteurs , Publicani, Populicani & Po-
blicani. Ces hérétiques, par leur nombre , & par la
protection de l’empereur Nicephore, devinrent formidables
à l’empire d’Orient. Outre l’erreur des deux
principes co-éternels &indépendans l’un de l’autre
qui eft la bafe du Manichéilme, ils avoient la croix
en-exécration , & l’Euchariftie en horreur ; ils con-
damnoient le culte des martyrs, & ne rendoient de
refpeét au livre des Evangiles que lorfqu’il ne por-
<toit pas empreinte l’image de la croix.
L’impératrice Théodore , tutrice dé Michel IIï.
ordonna en 845 , qu’on travaillât efficacement à'
convertir ces hérétiques-, ou qu’on les chafsât de-
l ’empire , s’ils-réfiftoient avec opiniâtreté. Plus de’
•cent mille d’entr’eux périrent par les fupp'lices , le
•refte alla fe rendre aux Sarräfins. Mais un liecle après
ils firent la guerre à l’empereur Bafile le Macedo-'
nien : ils envoyèrent même en Bulgarie des mife
iionnaires qui y fernerem l’erreur manichéenne, qui
dé-là- fe répandit peu après-dans le refte de l’Europe.'
Hoye{ Bulgares 6 Manichéens , Boffuet, Hiß.
■ des Variât, tom. II. liv. xj. pâg. izc). Y:
PAULIEN, Saint , ou Sa in t PAULI AN1, (Géog. j
mod.') autrefois ville &c préfentement bourg de FratP
ce en Auvergne,-au diocéfe du P ù y , dans l’éleétion
de Brioude. Je ne parle de ce bourg, que parce qu’oie
Croît que c’eftl’ancienne Reveffio Vdlavorum^ autrement
dite Vellava civitas, Vellavorum civitas, capitale
du peuple Vellavi, & liège de l’évêché de ce peuple;
Cette ville ne fut nommée civitas Vetula que dans le
ixv fiécle. ( D . ƒ .)
PAULIENNE, a c t io n , (Jurifprud.) on appelloit
ainli chez les Romains l’a&ion qui étoit donnée aux
créanciers pour faire révoquer les aliénations que le
‘débiteur avoit faites en fraude de leurs créances. Vcye{
A c t io n ’ .(^)
PAU LIN I A , f. f. ( Hifi. nat. Bot an. ) nom d’un
genre de plante , qui , dans Te fyftème de Linnæus,
renferme la Jériaïia & le cururu du P. Plumier ; en
voici les cara&eres : le calice particulier de la fleur
eft compofé de quatre feuilles ovales & déployées ;
il refte quand la fleur eft tombée. La fleur côrififté
auffi en quatre pétales oblongs, & fait un coeur ; ils
demeurent déployés , & font deux fois auffi gi:ands
que îes feuilles du calice. Les étamines forment huit
filamens fimples & courts. Leurs boffettes font petites
; le germe eft à trois cornes obtufes & contournées.
Les ftiles, au nombre de trois, font très-courts;
& fins comme des cheveux; les ftygmates font fimples
& larges; le fruit eft une grande capfule à trois
cornes , compofée de trois côtes, & contenant trois
loges , dans chacune dèfquelles eft unefimple femen-
ce ovale. La différence entre le cururu & la feria-
na du P. Plumier, eft que cette derniere produit des
graines dans la bafe des loges où elles font renfermées,
& le cururu, dans des loges particulières. -Lin-
næi, gén.plant, p. 170. Plumier, gen. 2S. •
PAUME , f. f. en Anatomie, eft le dedans de la
main ; c’eft ce que les Médecins appellent, en terme
d’Anatomie, métacarpe, & ce qu’on appelle en latin.
vola. Voyé{ MAIN & MÉTACARPE.
Paume , f. f. (Littéral.') exercice fort en ufage parmi
les Romains, parce qu’il contribuoit chez ce peuple
guerrier à rendre leurs corps fouples, forts & ro-
buftes ; Cicéron, Horace, Plaute, Martial, & plu-
fieurs autres auteurs de l’ancienne Rome, en parlent
de même. P l i n e III. épit. 1. décrivant la maniéré
de vivre de Spurina, remarque que dans certaines
heures du jou r, il jouoit à la paume long-tems & violemment
, oppofant ainfi ce genre d’exercice à la pe-
fanteur de la vieilleffe. Plutarque nous apprend que
Caton, après fon dîner, âlloit jouer régulièrement
à ce jeu dans le champ de Mars. Le jour même qu’il
effuya lé refus mortifiant de la part du peuple , qui
lui préféra un compétiteur indigne pour la charge de
conful, il n’en donna pas un moment de moins à'cet
exercice. Les perfonnes'délicates s’en abfténoient,
fur-tout après avoir mangé , & elles avoient raifon.
Horace étant en voyage avec Mécenas , V irgile, &
quelques autres perfonnes choifies de la cour d’Au-
gufte , Mécenas & les autres s’en allèrent après dî-;
ner jouer à la paume , mais Horace & Virgile ', dont
le tempérament ne s’accordoit point avec les
grands mouvemens que ce jeu demande, prirent le
parti dé- dormir. -
. Lufurp it Mctfienas , dormitum ego Virgiliufquc,
Namque pila lippis inimicum , & ludere crudis.
Lib. I. fat. 5.
Les Romains avoient plufieurs maniérés de s’exercer
à la paume, félon les différentes balles dont ils fe
fervoient pour ce jeu. Cés-baies étoient de quatre
fortes ,fo llis , trigonolis, paganica & harpaflum ; la
première étoit un balon femblable à celui dont, on
joue encore aujourd’hui.-On le pouffoit du bras , s’il
étoit gros ; & du poignet, s’il étoit petit, La baie
trigo/lale f pila trigonalis , n’étoit qu’une petite baie ,
que trois joueurs placés en forme de triangle, fe ren-*
voyoieiit- i’ùn à l’autre ; on appelloit pila paganica,
la /JÆ«/«£.villageoife, une balle couverte dç cuir , &
rçmpli,e
.remplie de plumes, qui n’étoit ni fi grôffe que le bah
Ion, ni fi petite que la trigonale, mais fort ferrée &
-fort dure. La quatrième forte de balle, nommée harpaflum
, étoit fort petite ; on la pouffoit en l ’a ir , &
on tâchoit de l’arracher à celui qui l’avoit attrapée ;
mais nous ' entrerons dans de plus grands- détails au
mot Sphéristique.
Ce que nous appelions le jeu de paume, eft fort différent
de tout cela.
Pafquier rapporte que l’an 1424 vint à Paris une
fille nommée Margot, qui jouoit au jeu de paume de
l’avant & de l’arriere-main , mieux qu’aucun homme
, ce qui étoit d’autant plus étonnant, qii’âlors on
jouoit feulement de la main nue, ou avec un gant
double. Dans la fuite quelques-uns mirent à leur
mains des cordes & tendons pour renvoyer la baie
avec plus de force, & ’ de là on imagina la raquette.
Le nom de paume , ajoute-t-il, a été donné à ce je u ,
parce q ue, dans ce tems-là , fon exercice confiftoit
â recevoir & à renvoyer la balle de la paume de la
main. ( D . J. ) s<
Pa u m e , le jeu d e , ce jeu eft fort ancien; & fi
l’on en croit quelques auteurs, Galien l’ordonnoit à
ceux qui étoient d’un tempérament fort replet, comme
un remede pour diffiper la fuperfluité des humeurs
qui les rend pefans & fujets à l’apoplexie : quelques
uns difent que c’étoit le jeu de la pelotte, mais
comme cette pelotte n’étoit autre chofe qu’une balle,
on croit qu’ils fie font trompés.
Quoi qu’il en fo i t , on peut dire que le jeu de la
paume eft un exercice fort agréable & très-utile pour
la fanté.
Ce jeu fe compte par quinzaines en augmentant
toujours ainfi le nombre, en difant, par exemple ,
trente, quarante-cinq, puis un jeu qui vaut foixante.
On ne fait point pofitivement la raifon de cela. Il y
en a qui l’attribuent à quelques aftronomes , qui fa-
chant bien qu’un figne phylique , qui eft la fixieme
partie d’un cercle, fe divife en foixante degrés, ont
cru à cette imitation devoir compter ainfi les coups
du jeu de paume ; mais comme cette raifon fouffre
quelques difficultés * on ne s’y arrêtera point comme
à une chofe certaine.
Le jeu de la paume, proprement parlant,eft un jeu
où l’on pouffe & repouffe plufieurs fois une balle avec
certaines réglés.
Pour commencer une partie à la paume, ou tourne
d’abord une raquette pour voir à qui fera dans le jeu ;
celui qui n’y eft pas doit fervir la balle fur le toit en la
pouffant'de de-là avec la raquette, & le premier
coup s’appelle une dame ; voye{ D am e : le refte fe
joue à l’ordinaire.
Si l’on n’eft pas convenu de ce qu’on joue, Il faut
le dire au premier jeu ; celui qui gagne la première
partie garde les gages. Les parties fe jouent en
quatre jeux, & fi l’on vient trois à trois, On eft à
deux de jeu. Voye{ A deux de jeu. On peut jouer
auffi en fix jeux fi l’on v eu t , mais alors il n’y a point
d’à deux de jeu, fi ce n’eft du confentement des
joueurs.
Il faut auffi, avant de commencer à jouer, tendre
la corde à telle hauteur qu’on puifle voir le pié du
deffus du mur, du côté où eft l’adverfaire ; & le long
de cette corde eft un filet attaché, dans lequel les balles
donnent fouvent.
S’il arrive par hafard qu’en jouant,la balle demeure
entre le filet & la corde, & qu’elle donne dans le
poteau qui tient cette corde , le coup ne vaut rien.
Il n’eft pas permis en pourfuivant une baie d’élever
la corde.
Cettx qui jouent à lupaume ont ordinairement deux
marqueurs. Ce font proprement des valets de jeux de •
paume qui marquent les chaffes. Ces marqueurs mar-
quentau fécond bonda & à l’endroit où touche çe
Tome X I I , ~ ■
bond. Ils doivent encore avertir les joueurs tout haut
qu il y a chaffe -, & dire chafle, ou deux chaffes fi el-
les-y font, & à tant de carreaux, & à tel carreau la
balle la gagne. V ?ye* ces mots à leur article,
Si les joueurs difent chaffe morte, elle demeure telle,
li les marqueurs ne leur repondent qu’il n’y en a une-
d’où l’on voit que le principal emploi des marqueurs
eft de dire au jufte.l’ état du jeu de part & d’autre, Ôc
de rapporter fidèlement les fentimens des fpeétateurs
lorfqu’il furvient quelque conteftation. Ces voix fe
doivent recueillir tant pour l’un que pour l’autre
joueur , fans prendre parti pour aucun , à peine de
perdre leur falaire & d’être chaffés du jefo
Les joueurs de leur côté fe doivent rapporter à la
bonne foi des fpeÛateurs, lorfqu’il fe préfente quelque
coup douteux dans leur jeu , puifqu’il n’y à
point d’autres juges qui les puiffent juger; ils s’en rapporteront
même aux marqueurs', s’il n’y a qu’eux qui
les puiffent juger, lefquels diront leur fentiment fans
craindre qu’on leur en veuille du mal.
On joue, pour l’ordinaire, partie , revanche &
le tout, & l’on ne peut laiffer cette derniere partie
que pour bonne raifon, comme à caufe de la nuit, où
autre femblable.
Pour lors celui qui perd doit laiffer des irais, &c
tine partie de l’argent qu’on joue pour le tou t ,
l’autre pour la moitié.
Si c’eft en deux parties liées qu’on joue, on ne
peut les quitter non plus que les parties n’y confen*
tent ; & en ce cas , chacun doit donner de l’argent
pour le tout, & choifir un jour pour l’ac'hever.
La chaffe fe marque partout où la baie a fait fon
fécond bond dans quelqu’endroit du jeu où elle
tombe.
Tout joueur qui touche une baie, de quelque maniéré
que ce foit, perd un quinze. v
Si, par inadvertance ou par oubli leS marqueurs di-
foientime chaffe pour une autre,ou donneroient celle
d’un joueur à l’autre,' cela ne peut point préjudicier
aux joueurs, parce, que la première chaffe doit toujours
fe jouer devant l’autre.
Quand on a mal fervi on recommence, à moins
qu’on ne joue qui fault & boit.
Qui met fur l’ais de volée en fervant,: ou fur les
dou x qui le tiennent, gagne quinze, de même lorf-
qu’il met dans la lune. Voye{ Lune & V o l é e .
On perd quinze pour dire pour rien trop tard. Voye^
Pour rien. Celui qui fert ne peut pas le dire ; qui
fait trois chaffes rend tout fon coup faux : depuis le
fervice une balle fortie hors les murailles , & qui y
rentreroit après qu’on auroit joué deffus, le coup ne
vaudroit rien.
Un joueur quia quarante & fa it deux chaffes, ne
perd point fon avantage, mais il doit gagner au-
moins la derniere de ces chaffes pour avoir le jeu.
■ Si l’autre joueur avoit pour lors trente, &: qu’il
gagnât la première chafle, ils n’auroient aucun avantage
l’un fiir l’autre ; & l’autre qui gagneroit la derniere
n’auroit qu’avantage. On ne perd rien pour fe
tromper en comptant moins de ce qu’on a fait,quinze
, trente ou même un jeu , fuppofé que la partie
ne fut point finie, car on perdroit ce dont on le mé-
prendroit à la fin de la partie, fi l’on laiffoit jouer
après cette méprife.
Pa u m e , jeu de la Lo n g u e ; ce jeu fe nomme
ainfi parce qu’on y joue dans une grande place qui
n’eft point fermée. Cette place eft une grande rue,
large , fpacieufe & fort longue : il y a des villes où
ces jeux font dans des grands patis, ou de longues
allées d’arbres. Au refte, il n’importe où ces jeux
foient, pourvu que le terrain en foit un i, ou bien
pavé , parce que, lorfqu’il faut courir à la balle , il
feroit dangereux de faire un faux pas, fi le fol étoit ■
inégal, On joue plufieurs à ce jeu., comme trois,