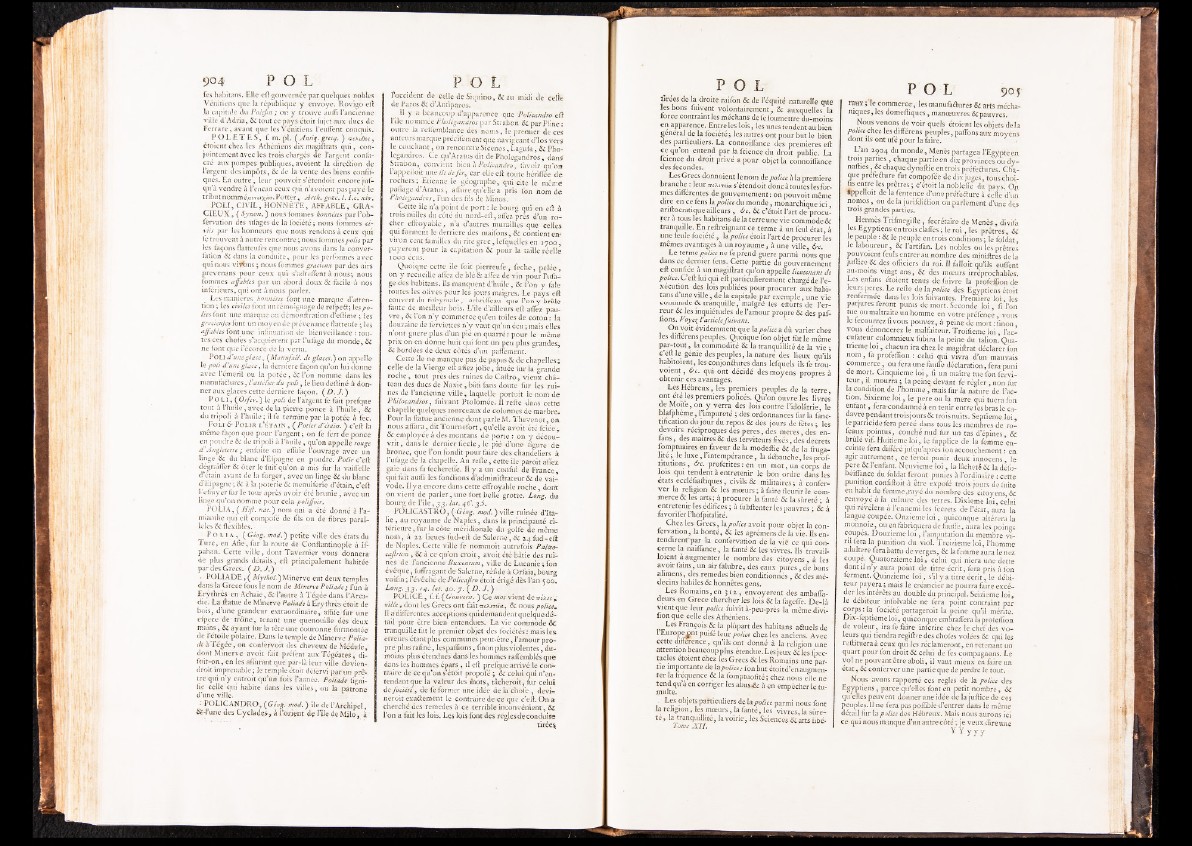
fes habitans. Elle eft gouvernée par quelques nobles
Vénitiens que. la république y envoyé. Rovigo eft
la capitale du Polejin ; on y trouve auffi l’ancienne
ville d’Adria, 6c tout ce pays étoit fujet aux ducs de
Ferrare, avant que les Vénitiens l’euflènt conquis.
P O L E T E S , f. m. pl. ( Antiq. grecq. ) w0A»ôoç,
ctoient chez les Athéniens dix magiftrats qui, conjointement
avec les trois changés de l’argent confa-
cré aux pompes publiques, avoient la direôion de
l’argent des impôts, & de la vente des biens confil-
qués. En outre, leur pouvoir s’étendoit encore juf-
qu’à vendre à l’encan ceux qui n’avoient pas payé le
tribut nommé/utieix'iov. Potter, Arch. gmc. I. l.c. xiv.
POLI, CIVIL, HONNÊTE, AFFABLE, GRACIEUX
, ( Synon. ) nous fommes honnêtes par l’ob-
fervation des ufages de la ibciété ; nous fommes civils
par les honneurs que nous rendons à ceux qui
fe trouvent à notre rencontre ; nous lommespolis par
les façons flatteufes que nous avons dans la conver-
fation 6c dans la conduite, pour les perfonnes avec
qui nous vi^fons ; nous fommes gracieux par dés airs
prevenans pour ceux qui s’adreffent à nous; nous
fommes affables par un abord doux 6c facile à nos
inférieurs, qui ont à nous parler.
Les maniérés honnêtes font une marque d’attention
; les civiles font un témoignage de relpeét; les polies
font une marque ou démonftration d’eftime ; les
gmcieujes font un moyen de prévenance flatteufe ; les
affables font une infinuation de bienveillance : tou-
tesices chofes s’acquierent par l’ulage du monde, 6c
ne font que l’écorce de la vertu.
Poli d une glace, (Manufaci. de glaces.) on appelle
le poli d'une glace, la derniere façon qu’on lui donne
avec Pemeril ou la potée, & l’on nomme dans les
manufàéhires, l'attélier du poli, le lieu deftiné à donner
aux glaces cette derniere façon. ( D. J. )
P o l i , ( Orfev. ) le poli de l’argent fe fait prefque
tout à l’huile, avec de la pierre ponce à l’huile, 6c
du tripoli à l’huile ; il fe termine par la potée à fec.
Poli & Polir l’étain , ( Potier d'étain. ) c’eft la
même façon que pour l’argent; on fe fert de ponce
en poudre 6c de tripoli d l’huile, qu’on appelle rouge
d'Angleterre ; enfuite on efi'üie l’ouvrage avec un
linge & du blanc d’Efpagne en poudre. Polir c’eft
dégraiffer 6c ôter le fuif qu’on a mis fur la vaiffelle
d’étain avant de la forger, avec un linge & du blanc
d Efpagne ; & à la poterie 6c ménuiferie d’étain, c’eft
Tefiuyerfur le tour après avoir'été brunie, avec un
linge qu’on nomme pour cela poliffoir.
POLlA, ( Hiß. nat.) nom qui- a été donné à Pa-
mianthe qui eft compofé de fis ou de fibres paralleles
& flexibles.
P O L i a , ( Géog. mod. ) petite ville des états du
Turc, en Afië, fur la route de Conftantinople à If-
pahan. Cette ville , dont Tavernier vous donnera
de plus grands détails, eft principalement habitée i
par des Grecs.- ( D. J.-)
■ POLIADE, ( Mythol.') Minerve eut deux temples
dans la Grece fous le nom de Minerve Poliâde ; l’un à
Erythrès en Achaïe, & l’autre à T égée dans l’Arcadie.
La ftatue de Minerve Poliade à Erythrès étoit de
bois, d’une grandeur extraordinaire,-aflife)fut line-
efpece de trône, tenant une quenouille dés deux
mains, 6c ayant -fur la tête une couronné furmontée
de i’étoile polaire. Dans le temple de Minerve Poliade
à T égée , on confervoit des cheveux de Médufe,
dont Minerve avoit fait préfent aux Tégéates, di-
foit-on, en les afliirant que par-là leur v ille devien-
droit imprenable ; le temple étoit défervi par un prê-.
tre qui n’y entroit qü’un fois l’ànnée. Poliade- lignifie
celle qui habite dans les villes, ou la pâtrone
d’une ville.
- POLICANDRO, {Géog. mod. ) île de l’Archipel,
& 4’une des Cyclades, à l’orient de I’îlç de Milo, à
1 occident de celle de Siquino, & au midi de celle
de Paros 6c d’Antiparos.
^ Il y a. beaucoup d’apparence que Policandro eft
l’île nommée Pholêgandros par Strabon & par Pline :
outre la reffemblance des noms, le premier de ces
auteurs marque précifement que navigeant d’ïos vers
le couchant, on rencontre Sieenos, Lagufa, 6c Pholegandros.
Ce qu’Aratus dit de Pholegandros, dans
Stiabon, convient bien à Policandro, (avoir qu’on
l’appelfoit une./7e de fer, car elle eft toute hériffee de
rochers; Etienne le géographe, qui cite le même
paflage d’Aratus, affure qu’elle a pris fon nom de
Pholegandros, l’un des fils de Minos.
Cette île n’a point de port : le bourg qui en eft à
trois milles du côté du nord-eft, affez près d’un rocher
effroyable, n’a d’autres murailles que celles
qui forment le derrière des maifons, 6c contient en-»
viron cent familles du rite g rec, lefquelles en 1700,
payèrent pour la capitation 6c pour la taille réelle
io o o écus.
Quoique cette île foit pierreufe, feche, pelée,
on y recueille affez de blé & affez de vin pour l’ufa-
ge des habitans. Ils manquent d’huile, & l’on y fale
toutes les olives pour les jours maigres. Le pays eft
couvert du tithymale, arbriffeau que l’on y brûle
' faute de meilleur bois. L’île d’ailleurs eft affez pauvre
, & l’on n’y commerce qu’en toiles de coton : là
douzaine de ferviêttes n’y vaut qu’un écu ; mais elles
n’ont guere plus d’un pié en quarré : pour le même
prix on en donne huit qui font un peu plus grandes,
& bordées de deux côtés d’un paflèment.
Cette île ne manque pas de papas & de chapelles;
celle de la Vierge eft allez jolie, fituée fur la grande
roche, tout près des ruines de Caftro, vieux château
des ducs de Naxie, bâti fans doute fur les ruines
de l’ancienne ville ÿ laquelle portoit le nom de
Philoeandros, fuivant Ptolomée. Il refte dans cetté
chapelle quelques morceaux de colonnes de marbre*
Pour la ftatue ancienne dont parle M, Thevenot, on
nous affura, dit Tournefort, qu’elle avoit été fciée ;
& employée à des montans de porte : on y découvrit
, dans le dernier fiècle, le pié d’une figure de
bronze, que l’on fondit pour faire des chandeliers à
l’ufage de la chapelle. Au refte, cette île paroit affez
gaie dans fa fechereffe. Ii y a un conful de France,
qui fait auifi les fondions d’adminiftrateur & de vai-
vode. Il y a encore dans cette effroyable roche, dont
on vient de parler, une fort belle grotte. Long, du
bourg de l’île , 33. lat. 4 G. 36.
POLICAS TRO, {-Géog. mod. ) ville ruinée d’Italie
, au royaume de Naples, dans la principauté extérieure,
iiir la côte méridionale du golfe de même
nom j à' 22 lieues fud-eft de Salerne, 6c 24 fud-eft
de Naples. Cette ville fe nommoit autrefois Paloeo-
cafirum , 6 cà ce qu’on croit, avoit été bâtie des ruines
de l’ancienne Buxentum, ville de Lucanie ; fon
évêque, fuffragant de Salerne, réfide à Orlaïa,bourg
voifin ; l’évêché de Policaffro étoit érigé dès l’an 500.
Lonë- 33• ' 4■ IP 40. y . { D . J .)
POLICE, f. f. ( Gouvem. ) Ce mot vient de tfoA/ç,'
ville f dont les Grecs ont fait weAmia, & nous policem
Il a différentes acceptions qui demandent quelque détail
pour être bien entendues. La vie commode &
tranquille fut le premier objet des fociétés: mais les
erreurs étant plus communes peut-être, l’amour propre
plus rafiné, les pallions, finon plus violentes, du-
moins plus étendues dans les hommes raffemblés que
dans les hommes épars , il eft prefque arrivé le contraire
de ce qu’on s?étoit propofé ; & celui qui n’entendant
que la valeur des mots, tâcheron, fur celui
àe fociété, de fe former une idée de la ch ofe, devi-
neroit exaftement le contraire de- ce que e’eft. On a
cherché des remedes à ce terrible inconvénient, &
l’on a fait fos lois. Les lois font des réglés de conduite
tirées
tirées de la droite raifon & de l’équité naturelle qite
les bons fuivent volontairement, & auxquelles la
force contraint les mechans defefoumettre du-moins
en apparence. Entre les lois, les unes tendent au bien
général de la fociété; les autres ont pour but le bien
des particuliers. La connoiffance des premières eft
ce qu’on entend par la fcience du droit public. La
fcience du droit prive a pour objet la connoiffance
des fécondés^ j.:
Les Grecs donnoient le nom de police à la première
branche : leur 7ro\nûa. s’étendoit donc à toutes les formes
différentes de gouvernement : on pouvoit même
dire en ce fens la police du monde, monarchique ici
ariftocratique ailleurs , &c. &c c’étoit l’art de procurer
à tous les habitans de la terre une vie commode &
tranquille. En reftreignant ce terme à un feul état, à
une feule fociété, la police étoit l’art de procurer les
mêmes avantages à un royaume, à une ville &c.
Le terme police ne fe prend guere parmi nous que
dans ce dernier fens. Cette partie du gouvernement
eft confiée à un magiftrat qu’on appelle lieutenant de
police. C’eft lui qui eft particulièrement chargé de l’exécution
des lois publiées pour procurer aux habitans
d’une ville, de la capitale, par exemple, une v ie
commode & tranquille, malgré les efforts de l’erreur
& les inquiétudes de l’amour propre & des paf-
fions. Vvye[ l'article fuivant.
On voit évidemment que la police a dû varier chez
les différens peuples. Quoique fon objet fût le même
par-tout, la commodité & la tranquillité de la vie ;
c’éftle génie des peuples, la nature des lieux qu’ils
habitoient, les conjonctures dans lefquels ils fe trou-
vo ien t, &c. qui ont décidé des moyens propres à
obtenir ces avantages.
Les Hébreux, les premiers peuples de la terre,
ont été les premiers policés. Qu’on ouvre les livres
de Moïfe, on y verra des lois contre l’idolâtrie, le
blafphème, l’impureté ; des ordonnances fur la fanc-
tification du jour du repos & des jours de fêtes ; les
devoirs réciproques des peres, des meres, des en-
fans , des maîtres & des ferviteurs fixés, des decrets
fomptuaires en faveur de la modeftie & de la frugalité
; le luxe, l’intempérance, la débauche, les prof-
titutions, &c. proferites : en un mot, un corps de
lois qui tendent à entretenir le bon ordre dans les
états eccléfiaftiques, civils & militaires ; à confer-
ver la religion & les moeurs ; à faire fleurir le commerce
& les arts ; à procurer la fanté & la sûreté ; à
entretenir les édifices ; à fubftenter les pauvres ; & à
favorifer l’hofpitalité.
Chez les Grecs, la.police avoit pour objet la con-
fervation, la bonté, & les agrémens de la vie. Ils en-
tendirent^par la confervation de la viê ce qui concerne
la naiffance, la fanté 6c les vivres. Ils travail-
loient à augmenter le nombre des citoyens , à les
avoir fains, un air falubre, des eaux pures, de bons
ahmens, des remedes bien conditionnés , & des médecins
habiles 6c honnêtes gens.
Les Romains, en 3 12 , envoyèrent des ambaffa-
deurs en Grece chercher les lois & la fageffe. De-là
vient que leur police fuivit à-peu-près la mêmedivi-
lion que celle des Athéniens.
Les François & la plupart des habitans aftuels de
I Européen! puifé leur police chez les anciens. Avec
cette différence, qu’ilsont donné à la religion une
attention beaucoup plus étendue. Les jeux & lesfpec-
tacles étoientchez les Grecs 6c les Romains une partie
importante de la police; fon but étoit d’en augmenter
la fréquence & la fomptuofité ; chez nous elle ne
tend qu’à en corriger les abus,& à en empêcher le tu- j
tnulte.
Les objets paMciiüers dela/><p/i. parmi nous font
la religion, les moeurs, la fanté, les vivres la sûreté
, la tranquillité, la voirie, les Sciences écarts libé-
Tome XII.
ra«x f ie commerce, les manufactures 6c arts mécha-
niques, les domeftiques, manoeuvres & pauvres.
Nous venons de v o ir quels étoient Iés;objets delà
police chez les différens peuples, paffons aux moyéns
dont ils ont ufé pour la faire.
L’an 2904 du monde, Menés partagea l’Egypte en
trois parties , chaque partie en dix provinces, oii dy-
nafties, 6c chaquedynaftie entrois préfectures. Chaque
prefeCture fut compofee de dix juges, tous choisis
entre les prêtres ; c’etoit la nobleffe du pays! On
appelloit de la fentence d’une préfecture à celle d’un
nomos, ou de la jurifdiCtion ou parlement d’une des
trois grandes parties.
Hermès Trifmegifte, fecrétaire de Menés, divifa
les Egyptiens en trois claffes ; le ro i, les prêtres , 6ç
le peuple : 6c le peuple en trois conditions ; le foldat
le laboureur, 6c l’artifan. Les nobles ou les prêtres
pouvoient feuls entrerait nombre des miniftres de la
juftice 6c des officiers du roi. Il falloit qu’ils euffent
au-moins vingt ans, 6c des moeurs irréprochables.
Les enfans etoient tenus de fuivre la profeffion de
leurs peres. Le refte de la police des Egyptiens étoit
renfermée dans les lois fuivantes. Première lo i, les
parjures feront punis de mort. Seconde lo i, fi l’pn
tue ou maltraite un homme en votre préfence , vous
le fecourrezfivous pouvez, à peine de mort : finon,
vous dénoncerez le malfaiteur. Troifieme lo i, l’ac-
eufateur calomnieux fubira la peine du talion. Quatrième
lo i , chacun ira chez le magiftrat déclarer fon
nom, fa profeffion : celui qui vivra d’un mauvais
commerce, ou fera une fauffe déclaration, fera puni
de mort. Cinquième lo i, fi un maître tue fon fervi-
teur, il mourra ; la peinq devant fe régler j non fur
la condition de l’homme, mais fur la nature de l’action.
Sixième lo i , le pere ou la mere qui tuera fon
enfant, fera*condamne à en tenir entre les bras le cadavre
pendant troisjours 6c trois nuits. Septieme.loi,
le parricide fera percé dans tous les membres de ro-
feaux pointus, couché nud fur un tas d’épines, 6c
bridé vif. Huitième loi, le fupplice de la femme enceinte
fera différé jufqu’après fon accouchement : en
agir autrement, ce feroit punir deux innocens , le
pere 6c l’enfant. Nçuvieme lo i , la lâcheté 6c la defo-
beiffance du foldat feront punies à l’ordinaire : cette
punition confiftoit à être expofé trois, jours de fuite
en habit de femme,rayé du nombre des citoyens, 6c
renvoyé à la culture des terres. Dixième loi , celui
qui révélera à l’ennemi les fëcrets de l’état, aura la
langue coupee. Onzième l o i , quiconque altérera la
monnoie, ou en fabriquera de fauffe, aura les poings
coupés. Douzième lo i, l’amputation du membre viril
fera la punition du viol. Treizième loi, l’homme
adultéré fera battu de verges, 6c la femme aura le nez
coupe. Quatorzième lo i, celui qui niera une dette
dont il n’y aura point de titre écrit, fera pris à fon
ferment. Quinzième lo i , s’il y a titre écrit, le débiteur
payera ; mais le créancier ne pourra faire excéder
les intérêts au double du principal. Seizième lo i,
le débiteur infolvable ne fera point contraint par
corps : la fociété partageroit la peine qu’il mérite.
Dix-feptieme loi, quiconque embraffera la profeffion
de voleur, ira fe faire inferire chez le chef des vo leurs
qui tiendra regiftre des chofes volées 6c qui les
reftitueraà ceux qui les réclameront, en retenant un
quart pour fon droit 6c celui de fes compagnons. Le
vol ne pouvant être aboli, il vaut mieux en faire un
état, 6c conferver une partie que de perdre le tout.
Nous avons rapporté ces réglés de la police des
Egyptiens, parce qu’elles font en petit nombre, &
qu’elles peuvent donner une idée de la juftice de ces
peuples. Il ne fera pas poflible d’entrer dans le même
détail fur la police des Hébreux. Mais nous aurons ici
ce qui nous manque d’un autre côté ; je veux dire une
Y Y y y y