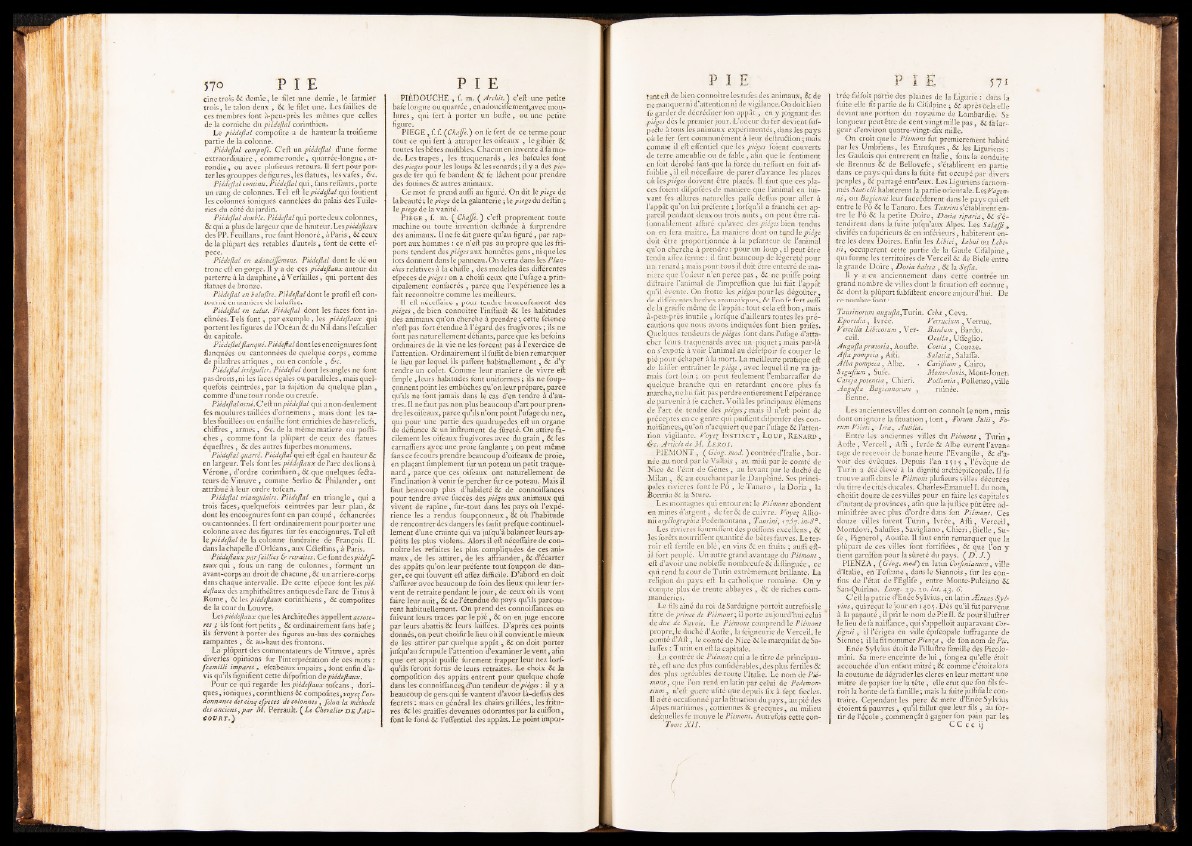
cinetrois6c demie, le filet une demie, le larmier
trois, le talon deux , 6c le filet une. Les faillies de
ces membres font à-peu-près les mêmes que celles
de la corniche du piédejlal corinthien.
Le piédejlal compoute a de hauteur la troifieme
partie de la colonne.
Piédejlal compofé. C’eft un piédejlal d’une forme
extraordinaire , comme ronde, quarrée-longue, arrondie,
ou avec plufieurs retours. Il fert pour porter
les grouppes de figures, les ftatues, lesvafes, &c.
Piédeflal continu. Piédeflal qui, fans reffauts, porte
un rang de colonnes. T el eft le piédejlal qui foutient
les colonnes ioniques cannelées du palais des Tuile-
ries du côté du jardin.
Piédejlal double. Piédejlal qui porte deux Colonnes,
6c qui a plus de largeur que de hauteur. Lespiédejlaux
des PP. Feuillans, rue famt Honoré, à Paris, & ceux
de la plûpart des retables d’autels, font de cette ef-
pece.
Piédeflal en adoucijfement. Piédejlal dont le dé eu
tronc eu en gorge. Il y a de ces piédejlaux autour du
parterre à la dauphine, à Verfailles, qui portent des
ftatues de bronze.
Piédejlal en baluflre. Piédejlal dont le profil eft contourné
en maniéré de baluftre.
Piédejlal en talut. Piédejlal dont les faces font inclinées.
Tels fon t, par exemple, les piédejlaux qui
portent les figures de l’Océan & du Nil dans l’efcalier
du capitole.
Piédeflal flanqué. Piédejlal dont les encoignures font
flanquées ou cantonnées de quelque corps, comme
de pilaftres attiques , ou en confole , &c.
Piédejlal irrégulier. Piédejlal dont les angles ne font
pas droits, ni les faces .égales ou parallèles, mais quelquefois
ceintrées, par la fujétion de quelque plan ,
comme d’une tour ronde ou creufe.
Piédeflal orné. C ’eft un piédejlal qui a non-feulement
fes moulures taillées d’ornemens, mais dont les tables
fouillées ou en faillie font enrichies de bas-reliefs,
chiffres , armés , &c. de la même matière ou pofti-
ch e s , comme'font la plûpart de ceux des ftatues
équeftres, 6c des autres fuperbes monumens.
Piédejlal quarrè. Piédejlal qui eft égal en hauteur 6c
en largeur. Tels font les piédejlaux de l’arc des lions à
Vérone, d’ordre corinthien, & que quelques fefta-
teurs de Vitruve, comme Serlio 6c Philander, ont
attribué à leur ordre tofcan.
Piédejlal triangulaire. Piédejlal en triangle, qui a
trois faces,quelquefois ceintrées par leur p lan ,&
dont les encoignures font en pan coupé, échancrées
ou cantonnées. Il fert ordinairement pour porter une
colonne avec des figures fur fes encoignures. Tel eft
le piédejlal de la colonne funéraire de François II.
dans la chapelle d’Orléans, aux Céleftins, à Paris.
Piédejlaux par faillies & retraites. Ce font des piédef-
taux qui , fous un rang de colonnes, forment un
avant-corps au droit de chacune, 6c un arriere-corps
dans chaque intervalle. De cette efpece font les piédejlaux
des amphithéâtres antiques de l’arc de Titus à
Rome, 6c les piédejlaux corinthiens, & compofites
de la cour du Louvre.
"Les piédejlaux que les Architeôes appellent acrote-
res ; ils font fort petits, & ordinairement fans bafe ;
ils fervent à porter des figures au-bas des corniches
rampantes , 6c au-haut des frontons.
La plûpart des commentateurs de Vitruve, après
diverfes opinions fur l’interprétation de ces mots :
fcamilli impares , efcabeaux impairs , -font enfin d’avis
qu’ils lignifient cette difpofition de piédejlaux.
Pour ce qui regarde les piédejlaux tofcans, doriques
, ioniques, corinthiens & compofites,voye^Cordonnance
des cinq efpeces de colonnes , félon la méthode
des anciens, par M. Perrault. (Le Chevalier DE J AU -
COURT.")
PIEDOUCHE , f. m. ( J relût. ) c’eft une petite
bafe longue ou quarrée, en adouciffement«,avec moulures
, qui fert à porter un bufte, ou une petite
figure.
PIEGE, f. f. ([Chajfe.) on fe fert de ce terme pour
tout ce qui fert à attraper les oifeaux , le gibier &
toutes les bêtes nuifibles. Chacun en invente à fa mode.
Les trapes , les traquenards , les bafcules font
des piégés pour les loups 6c les renards ; il y a des-piégés
de fer qui fe bandent 6c fe lâchent pour prendre
des fouines 6c autres animaux.
Ce mot fe prend auffi au figuré. On dit le piege de
la beauté ; le piege de la galanterie ; le piege du deftin ;
le piege de la vanité.
P i è g e , f. m. ( Chajfe. ) c’eft proprement toute
machine ou toute invention deftinée à furprendre
des animaux. Il ne fe dit guere qu’au figuré, par rapport
aux hommes : ce n’eft pas au propre que les fripons
tendent des pièges aux honnêtes gens, ni que les
lots donnent dans le panneau. On verra dans les Planches
relatives à la chaffe , des modèles des différentes
efpeces de piège : on a choifi ceux que l’ufage a principalement
confacrés , parce que l’expérience les a
fait reconnoître comme les meilleurs.
Il eft néceffaire , pour tendre heureufement des
pièges , de bien connoître l’inftinft 6c les habitudes
des animaux qu’on cherche à prendre ; cette fcience
n’eft pas fort etendue à l’égard des frugivores ; ils ne
font pas naturellement défiants, parce que les befoins
ordinaires de la vie ne les forcent pas a l’exercice de
l’attention. Ordinairement il fuffit de bien remarquer
le lieu par lequel ils paffent habituellement, 6c d’y
tendre un colet. Comme leur maniéré de vivre eft
fimple , leurs habitudes font uniformes ; ils ne foup-
çonnent point les embûches qu’on leur prépare, parce
qu’ils ne font jamais dans le cas d’en tendre à d’autres.
Il ne faut pas non plus beaucoup d’art pour prendre
les oifeaux, parce qu’ils n’ont point l’ufage du nez,
qui pour une partie des quadrupèdes eft un organe
de défiance & un infiniment de fureté. On attire facilement
les oifeaux frugivores avec du grain , 6c les
carnaflîers avec une proie fanglante ; on peut même
fans ce fecours prendre beaucoup d’oifeaux de proie,
en plaçant Amplement fur un poteau un petit traquenard
, parce que ces oifeaux ont naturellement de
l’inclination à venir fe percher fur ce poteau. Mais il
faut beaucoup plus d’habileté 6c de connoiflances
pour tendre avec fuccès des pièges aux animaux qui
vivent de rapine, fur-tout dans les pays où l’expérience
les a rendus foupçonneux, & où. l’habitude
de rencontrer des dangers les faifit prefque continuellement
d’une crainte qui va jufqu’à balancer leurs appétits
les plus violens. Alors il eft néceffaire de connoître
les refuites les plus compliquées de ces animaux
, de les attirer, de les affriander, 6c d’écarter
des appâts qu’on leur préfente tout foupçon de danger,
ce qui fouvent eft affez difficile. D ’abord en doit
s’afîurer avec beaucoup de foin des lieux qui leur fervent
de retraite pendant le jour, de ceux où ils vont
faire leur nuit, 6c de l’étendue de pays qu’ils parcourent
habituellement. On prend des connoiflances en
fuivant leurs traces par le pi’é , & on en juge encore
par leurs abattis 6c leurs laiffées. D’après ces points
donnés, on peut choifir le lieu où il convient le mieux
de les attirer par quelque appât, 6c on doit porter
jufqu’au fcrupule l’attention d’examiner le vent, afin
que cet appât puiffe furement frapper leur nez lorsqu'ils
feront fortis de leurs retraites. Le choix 6c la
compofition des appâts entrent pour quelque chofe
dans les connoiflances d’un tendeur de pièges : il y a
beaucoup de gens qui le vantent d’avoir là-deffus des
fecrets ; mais en général les chairs grillées, les fritures
& les graiffes devenues odorantes par la cuiffon,
font le fond 6c l’effentiel des appâts. Le point important
eft de bien connoître les rufes des'animaux, 6c de
-ne manquerni d’attention ni de vigilance.On doit bien
fe garder de décréditer fon appât > en y joignant des
.pièges dès le premier jour. L ’odeur du fer devient fuf-
peâe à tous les animaux expérimentés, dans les pays
où le fer fert communément à leur deftru&ion ; mais
comme il eft effentiel que les pièges foient couverts
de terre ameublie ou de fable , afin que le fentiment
en foit dérobé fans que la force dureffort en foit af-
foiblie , il eft néceffaire de parer d’avance les places
où 1 es pièges doivent être placés. Il faut que ces places
foient difpofées de maniéré que l’animal en fuivant
fes allures naturelles paffe deffus pour aller à
l’appât qu’on lui préfente ; lorfqu’il a franchi cet appareil
pendant deux ou trois nuits, on peut être raisonnablement
affuré qu’avec des pièges bien tendus
on en fera maître. La maniéré dont on tend le piège
doit être proportionnée à la pefanteur de l’animal
qu’on cherche à prendre : pour un loup, il peut être
tendu affez ferme : il faut beaucoup de légèreté pour
lin renard ; mais pour tous il doit être enterré de maniéré
que l’odeur n’en perce pas, 6c ne puiffe point
diftraire l’animal de l’impreflion que lui fait l’appât
qu’il évente. On frotte les pièges pour les dégoûter,
de différentes herbes aromatiques, & l’onfe fert auffi
de la graiffe même de l’appât: tout cela eft bon, mais
à-peu-près inutile , lorfque d’ailleurs toutes les précautions
que nous avons indiquées font bien prifes.
Quelques tendeurs de pièges font dans l’ufage d’attacher
leurs traquenards avec un-piquet ; mais par-là
on s’expofe à voir l’animal au défefpoir fe couper le
pié pour échaper à la mort. La meilleure pratique eft
.de laiffer entraîner le piège , avec lequel il ne va jamais
fort loin ; on peut feulement l’embarraffer de
.quelque branche qui en retardant encore plus fa
marche, ne lui fait pas perdre entièrement l’efpéranc-e
de parvenir à fe cacher. Voilà les principaux élémens
de l’art de tendre des pièges ; mais il n’eft point de
.préceptes en ce genre qui puiffent difpenfer des con-
noiffances, qu’on n’acquiert que par l’ufage 6c l’attention
vigilante. Voye^ In s t in c t , L o u p ,R en ard ,
•Çs-c. Article de M. L e r o i .
PIEMONT , ( Géog. mod. ) contrée d’Italie, bornée
au nord par le Vallais, au midi par le comté de
Nice 6c l’état de Gènes , au levant par le duché de
Milan , 6c au couchant par le Dauphiné. Ses principales
rivières font le Pô , leTanaro , laDoria , la
Bormia 6c la Sture.
Les montagnes qui entourent le Piémont abondent
en mines d’argent, de fer & de cuivre. Voye^ Allio-
nii oryclographia Pedemontana , Taurini, tySy. in-8°.
Les rivières fourniffent des poiffons excellens , 6c
les forêts nourriffent quantité de bêtes fauves. Le terroir
eft fertile en b lé, en vins 6c en fruits ; auffi eft-
i l fort peuplé. Un autre grand avantage du Piémont,
eft d’avoir une nobleffe nombreufe 6c diflinguée, ce
qui rend la cour de Turin extrêmement brillante. La
religion du pays eft la catholique romaine. On y
compte plus de trente abbayes , 6c de riches com-
jnanderies.
Le fils aîné du roi dé Sardaigne portoit autrefois le
titre de prince de Piémont ; il porte aujourd’hui celui
de duc de Savoie. Le Piémont comprend le Piémont
propre, le duché d’Aofte, la feigneurie de Verceil, le
comté d’Aft , le comté de Nice 6c le marquifat deSa-
lufifes : Turin en eft la capitale.
La contrée de Piémont qui a le titre de principauté
, eft une des plus confidérables, des plus fertiles 6c
des plus agréables de toute l’Italie. Le nom de Piémont
, que l’on rend en latin par celui de Pedemon-
tium, n’eft guere ufité que depuis fix à fept fiecles.
Il a été occafionné par la fituation du pays, au pié des
Alpes maritimes , cottiennes & grecques, au milieu
delquelles fe trouve le Piémont, Autrefois cette con-
Tonn X I I .
trée raifoit partie des plaines de la Ligurie : dans la
fuite elle fit partie de la Cifalpine ; 6c après 'Cela elle
devint une portion du royaume de Lombardie-. Sa
longueur peut être de cent vingt mille pas, 6c là largeur
d’environ quatre-vingt-dix mille.
On croit que le Piémont fut premièrement habité
par les Umbriens, les Etrufques, & les Liguriens I
les Gaulois qui entrèrent en Italie, fous la conduite
de Brennus 6c de Bellovefe, s’établirent en partie
dans ce pays-qui dans la'fuite fut occupé par divers
peuples, & partagé entr’eux. Les Liguriens furnom-
més Statielli habitèrent la partie orientale. LesVdgen-
n i, ou Bagienni leur fuçcederent dans le pays qui elt
entre le Pô 6c le Tanaro. Les Taurini s’établirent entre
le Pô & la petite Doire, Dofia riparia, 6c s’étendirent
dans la fuite jufqu’aux Alpes. Les SalaJJi ,
divifés en fupérieurs 6c en inférieurs, habitèrent en-*-
tre les deux Doires. Enfin les Libici, Lebuiôw Lebe*-
tü, occupèrent cette partie de la Gaule Cifalpine,
qui forme les territoires de Verceil 6c de Biele entre
la grande D o ire, Doria baltea , 6c la Sejia.
Il y a eu anciennement dans cette contrée iin
grand nombre de villes dont la fituation eft connue,
6c dont la plûpart fubfiftent encore aujourd’hui. De
ce nombre font :
Taurinorum augufiafturin. Ceba , Cevà.
Eporedia, Ivrée. Verrucium , Verrue.
Vircellce Libicorum , Ver- Bardum , Bardo.
ceil. Ocella, Uffeglio.
Auguflaproetoria, Aoufte. Cottia, Coazze.
A fia pompeïa , Afti. Salatià, Salaflà.
Alba pompeïa, Albê. • Cariflium , Cairo.
Segujium , Sufe. Mons-Jovis, MontrJouet-.
Carejapotentia, Chieri. Pollentia, Pollenzo, ville
Augufia Bagiennorum , ruinée.
Benne.
Les anciennes villes dont on connoît le nom, mais
dont on ignore la fituation, fon t, Forum JulU, Forum
Vibrii , Iria, Autilia.
Entre les anciennes villes du Piémont, Turin ,
Àofte, Verceil, Afti , Ivrée & Albe eurent l’avantage
de recevoir de bonne heure l’Evangile, 6c d’avoir
des évêques. Depuis l’an 1515 , l’évêque dë
Turin a été élevé à la dignité archiépifcopale-. Il fé
• trouve auffi dans le Piémont plufieurs villes décorées
-du titre de cités ducales. Charles-Emanuel I. du nom,
choifit douze de ces villes pour en faire les capitales
d’autant dë provinces, afin que la juftice pût être ad-
miniftrée avec plus d’ordre dans fon Piémont. Ces
douze villes furent Turin, Ivrée, A fti, Verceil,
Montdovi, Saluffes, SavigFiano, Chieri, Bielle, Sufe
, Pignerol, Aoufte. Il faut enfin remarquer que la
plûpart de ces villes font fortifiées , 6c que l’on y
tient garnifon pour la sûreté du pays. ( D . J. )
PIENZA, (Géog. mod) en latin Corfinianum, Ville
d’Italie, en T ofcane, dans le Siénnois, fur les confins
de l’état de l’Eglife , entre Monte-Pulciano 6c
San-Quirino. Long. 29 . 20 . lai. 43. (y.
C ’eft la patrie d’EnéeSylvius, en latin Æneas Syl-
vius, qui reçût le jour en 1405. Dès qu’il fut parvenu
à la papauté, il prit le nom de Pie II. 6c pour illuftrer
le lieu de fa naiffance, quis’appelloit auparavant Cor-
fign ii, il l’érigea en ville épifcopale fuffragante de
Sienne; il la fit nommer Pien^a, de fonnom deP/e.
Enée Sylvius étoitde l’illuftre famille des Picolo-
mini. Sa mere enceinte de lu i, fongea qu’elle étoit
accouchée d’un enfant mitré ; & comme c’étoitalors
la coutume de dégrader les clercs en leur mettant une
mitre de papier lur la tête , elle crut que fon fils fe-
roit la honte de fa famille ; mais la fuite juftifia le contraire.
Cependant les pere & me te d’Enée SylViiis
étoient fi pauvres , qu’il fallut que leiit fils , au for-
tir de l’école, commençât à gagner fon pain par les