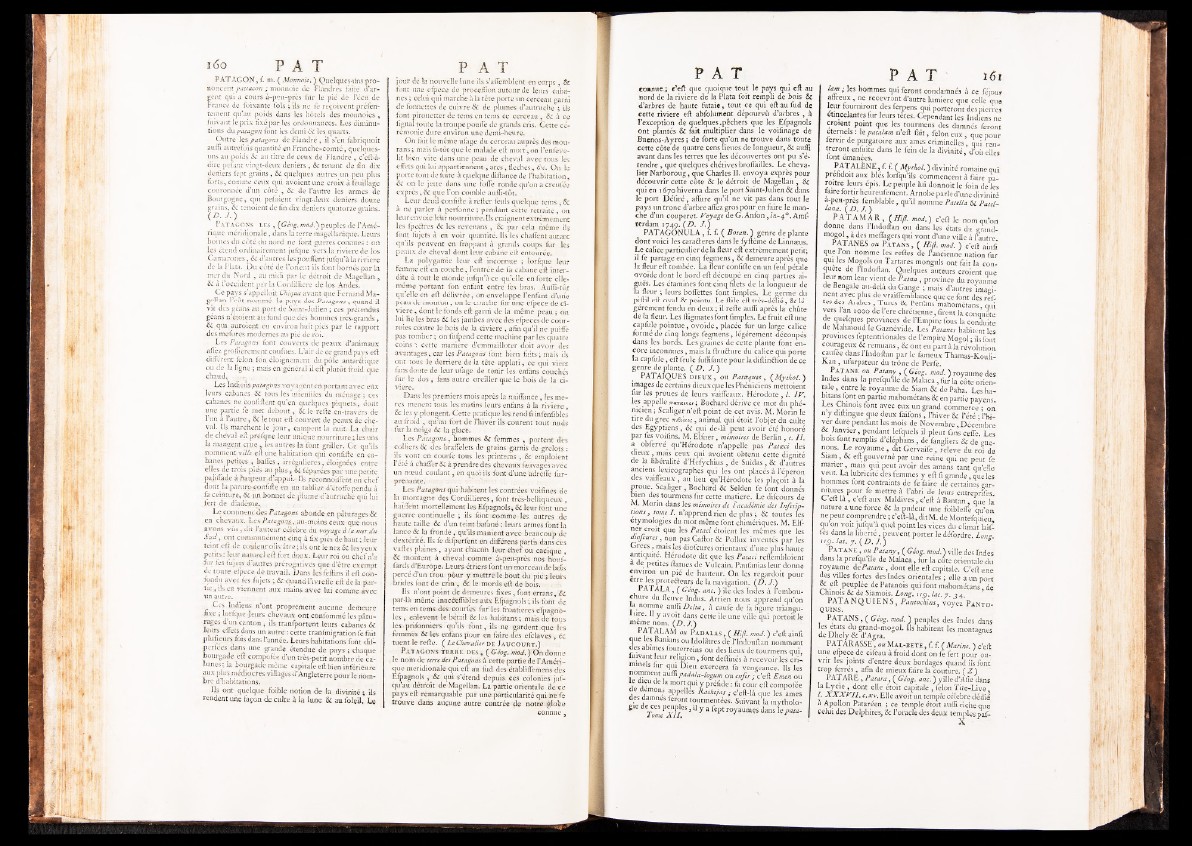
i 6 o P A T
PATAGON, f. m. ( Monnoie. ) Quelqùes-ilns prononcent
pattacon ; monnoie de Flandres faite d’argent
qui a Cours à-peu-près fur le pié dè l’ccu de
France de foixante lois ;ils ne fe reçoivent préfen-
tement qu’au poids dans les hôtels des riionnoies ,
liiivant le prix fixé par les ordonnances. Les diminutions
du patagon font les demi Sc les quarts:
Outre les patagons de Flandre , il s’en fabriquoxt
auffi autrefois quantité en Franche-comté, quelques-
uns au poids & au titre de ceux de Flandre , c’eft-à-
dire pelant vingt-deux denièrs , & tenant de fin dix
deniers fept grains , Sc quelques autres un peu plus
forts, comme ceiix qui avoientune croix à feuillage
couronnée d’un côté , Sc de l’autre les armes de
Bourgogne, qui pefoient vingt-deux deniers douze
grains, Sc tenoient de fin dix deniers quatorze or ai ns.
("•■ /•) - ; \ H |
Patagons les , ( Géog. mod.) peuples de l’Amérique
méridionale, dans la terre niagellanique. Leurs
bornes du côté du nord ne font gueres connues : on
les étend ordinairement jufque vers la riviere de los
Camarones, d’autres les pouffent jufqu’à la riviere
de la Plata. Du côte de l’orient ils font Dornés par la
mer du Nord , au midi par le détroit de Magellan ,
& à l’occident par la Cordiiliere de los Andes.
Ce pays s’appelloit Chiqua avant que Fernand Magellan
Peut nommé le pays des Patagons, quand il
vit des géa“ns au port de Saint-Julien ; ces prétendus
geans n’étoient au. fond que.dés hommes très-grands,
& qui auroient eu environ huit piés par le rapport
des mel'ures modernes au pié de roi.
Les Patagons font couverts de peaux d’animaux
affez groffierement coufues. L’air de ce grand pays eft
Giflèrent félon Ion eloignement du pôle antarctique
ou de la ligne ; mais en général il eft plutôt froid que
chaudv - r-
Les InÛwm patagons voyagent en portant avec eux
_ leurs cabanes Sc tous les ufterililes du ménage ; ces
cabanes ne confiftent qu’en quelques piquets.* dont
une partie fe met debout, Sc le refte en-travers de
l’un à l’autre Sc le tout ëft couvert de peaux de cheval.
Us marchent le jour, campent la nuit. La chair
de cheval eft préfque leur unique nourriture ; les uns
la mangqnt cr,ye* les autres la font griller. Ce qu’ils ■
nomment vi//s,eft une habitation qui confifte en cabanes
petites , paffes* irrégulières ,* éloignées entre
elles de trois piés- au plus léparées par une petite
pajiffade a hauteUr-d’appuivIls jeconnoiflènt un chef
dont la parur&Æonfifte en un tablier d’étoffe pendu à
fa ceinture, Sc\m bomiet de.jMume d'àutrirche qui lui
fert de diadème....
Le continent' dçs Patagons abonde :en pâturages &
en chevaux. Les Patagonie au-moins ceux--que nous
avons vu s , dit-l’auteur cqlebre du voyage à la. mer du
Sud, ont communément-cinq à fix piés de haut; leur
teint eft de couleur olivâtre ; ils ont le nez & les yeux
petits : leur naturel eft fort doux. Leur roi ou- chef n’a ;
dur fes fujets d’aut'res prérogatives-que d’être exempt
de toute efpeCe-de travail. Dans lesfeftins il eft edn-
.fondu avec fes fujets ; & quand Fiv-reflè eftde la par- ,
ti“ ., ils en viennent aux mains avec lui comme avec
un autre. -
. Ces Indiens n’ont proprement aucune demeure
.fixe ; lorfque .leurs chevaux ont confommé les pâturages
d un canton , ils tranfportent leurs cabanes Sc
leurs effets dans un autre : cette transmigration fe. fait
pluneurs fois dans l’année. Leurs habitations font dif- i
perfees dans une grande étendue de pays- ^ chaque .
bourgade eft compofée d’un très-petit nombre de cabanes
; la bourgade même capitale eft bien inférieure
aux plus médiocres vdlages d’Angleterre pour le nombre
d’habitations.
-Ils ont quelque foible notion de la divinité; ils
rendent une façon de culte à la lune Sc au foleil. Le
P A T
jour de la nouvelle lune ils s’affemblent en corps , &C
font une efpece de proccffion autour de leurs cabanes
; celui qui marche à la tête porte un cerceau garni
de fonnettes de cuivre & de plumes d’autruche ; ils
font pirouetter de tems en te ms ce cerceau * & à ce
fïgnal toute la troupe pouffe de grands cris. Cette ceremonie
dure environ uhe demi-heure.
On fait le même ufage du cerceau auprès des mou-
rans ; mais fi-tôt que le malade eft mort * on l ’enfeve-
lit bien vite dans une peau de cheval avec tous les
effets qui lui appartiennent, a rcs, fléchés,, 6>c. On le
porte tout de fuite à quelque diftance de l’habitation,
Sc on le jette dans une foffe ronde qu’on a creulée
exprès, Sc que l’on comble aufli-tôt.
Leur deuil confifte à refter feuls quelque tems , Sc
à ne parler à perfonne ; pendant cette retraite, on
leur envoie leur nourriture. Ils craignent extrêmement
les fpeftres Sc les revenans , Sc par cela même ils
font fujets à en voir quantité. Us les chaffent autant
qu’ils peuvent en frappant à grands coups fur les
peaux de cheval dont leur cabane eft entourée.
La polygamie leur eft inconnue ; lorfque leur
femme eft en couche, l’entrée de fa cabane eft interdite
à tout le monde jufqu’à ce qu’elle en forte elle-
même portant fon enfant entre fes bras. Aufli-tô/
qu’elle en eft délivrée, on enveloppe l’enfant d’une
peau de mouton, on le couche fur une efpece de civière
, dont le fonds eft garni de la même peau ; on
lui lie les bras Sc les jambes avec des efpeces de courroies
contre le bois de la civiere , afin qu’il ne puiffe
pas tomber ; on fufpend cette machine par les quatre
coins ' cette maniéré d’emmailloter doit avoir des
avantages * car les Patagons font bien faits ; mais ils
ont tous le derrière de la tête applati, ce qui vient
fans doute de leur ufage de tenir les enfans couchés
fur le dos * fans autre oreiller que le bois de la civière.
Dans les premiers mois après la naiffance, les mères
mènent tous les matins leurs enfans à la riviere,
&c les y plongent. Cette pratique les rend fi infenfibles
au froid , qu’au fort de l’hiver ils courent tout nuds
fur la neige & la glace.
Les Patagons * hommes Sc femmes , .portent dès
colliers Sc des braffelets de grains garnis de grelots :
ils vont en courfe tous les printems , Sc' emploient
l’été à chafter & à prendre des chevaux faùvages avec
un noeud coulant, en quoi ils font d’tine adréffe fur-
prenante.. •
Les Patagons qui habitent les contrées voifines de
la montagne des Cordillieres, font très-belliquéux ,
haïffent mortellement les Efpagnols* & leur font une
guerre continuelle ; ils font : comme--lès. autres .de
haute taille Sc d’un teint bafané< : leurs armes font la
lance Sc la frondé, qu’ils manient avec- beaucoup de
dextérité. Us fe difperferit en différens partis dans ces
vaftes plaines, ayant th'acfih leur.cher ou.cacique ,
& montent à cheval comme à-peu-près nos hbuf-
fards d’Europe. Leurs étriers font un morceau.de befis
percé d’un trou: pour yi-piettrèlcrbbut.du pié ; leurs
brides, font de crinr, oc le mords eft de bois;. -, ;
Us n’ont point de demeures fixes, fo.nt.errans,:&:
•par-là même inacéèffibles aüx Efpagnols ; ils font de
tems en tems des courfes fur les. frontières efpagnô-
les * enlevent le bétail Sc les habitans ; mais de tous
les>prifoimiers‘qu’ils-font, ils ne gardent .que les
femmes & leS enfans piour en faire des .efclàves , Sc
tuent le refte. ( Le Chevalier de Jaucourt.)
Pa t a Gqns terre des , Ê Géog. riïod. ^ On donne
. le nom de terre des PaiagonsÀtetie partie de l’Amérique
meridionale qui eft au fud. des étàbliffemens dès
Efpagnols * & qui s’étend depuis, ces colonies; jusqu'au
détroit de Magellan. La partie orientale de ce
pays eft remarquable par une particularité qui ne fe
trouve dans aucune autre contrée de notKÉ .globe
connue,
P A T
connue^ c’eft que quoique tout le pays qui eft au
nord de la riviere de la Plata foit rempli de bois &
d’arbres de haute futaie, tout ce qui eft au fud de
cette riviere eft abfolument dépourvu d’ai'bres , à
l’exception de quelques .pêchers que les Efpagnols
ont plantés & fait multiplier dans le voifinage de
Buenos-Ayres ; de forte qu’on ne trouve dans toute
cette côte de quatre cens lieues de longueur, Sc auffi
avant dans les terres que les découvertes ont pu s’étendre
, que quelques chétives broffailles. Le chevalier
Narboroug, que Charles II. envoya exprès pour
découvrir cette cote Sc le détroit de Magellan , Sc
qui en 1670 hiverna dans le port Saint-Julien Sc dans
le port Défiré, affure qu’il ne vit pas dans tout le
pays un tronc d’arbre allez gros pour en faire le manche
d’un couperet. Voyage de G . Anfon , ï/2-40. Amfi
terdam 1749. ( D . J .)
PATAGONULA , f. f. ( Botan.\ genre de plante
dont voici les carafreres dans le fyftème de Linnæus.
Le calice particulier delà fleur eft extrêmement petit;
il fe partage en cinq fegmens, Sc demeure après que
la fleur eft tombée. La fleur confifte en un feul pétale
ovoïde dont le bord eft découpé en cinq parties aiguës.
Les étamines font cinq filets de la longueur de
la fleur ; leurs boffettes font fimples. Le germé du
piftil eft oval Sc pointu. Le ftile eft très-délié * Sc légèrement
fendu en deux ; il refte auffi après la chute
de la fleur. Les ftigmates font fimples. Le fruit eft une
cap fuie pointue, ovoïde, placée fur un large Calice
forme de cinq longs fegmens, légèrement découpés •
dans les bords. Les graines de cette plante font encore
inconnues , mais la ftrutture du calice qui porte
la capfule, eft feule fuffifante pour la diftin&ion de ce
genre de plante. ( D . J .)
PATAIQUES dieux , ou Patoeques, ( Mytkol. )
images de certains dieux que les Phéniciens mettoient
fur les proues de leurs vaiffeaux. Hérodote , /. IV.
les appelle 7naa.1y.e1 ; Bochard dérive ce mot du phénicien
; Scaliger n’eft point de cet avis. M. Morin le
tire du grec tt/ÔÛkoç , animal qui étoit l’objet du culte
des Egyptiens, Sc qui de-là peut avoir été honoré
par fes voifins. M. Elfiier, mémoires de Berlin , t. II.
a obfervé qu’Hérodote n’appelle pas Pataci des
dieux, mais ceux qui avoient obtenu cette dignité
de la libéralité d’Hefychius , de Suidas , Sc d’autres
anciens lexicographes qui les ont placés à l’éperon
des vaiffeaux, au lieu qu’Hérodote les plaçoit à la
proue. Scaliger , Bochard Sc Selden fe font donnés
bien des tourmens fur cette matière. Le difeours de
M. Morin dans les mémoires de t académie des Infcrip-
tions y tome I. n’apprend rien de plus ; Sc toutes les
étymologies du mot même font chimériques. M. Elf-
ner croit que les Pataci étoient les mêmes que les
diofeures, non pas Caftor Sc Pollux inventés par les
Grecs, mais les diofeures orientaux d’une plus haute
antiquité. Hérodote dit que les Pataci reffembloient
a de petites ftatues de Vulcain. Paufanias leur donne
environ un pié de hauteur. On les regardoit pour
etre les prote&eurs de la navigation. (D . J.')
PA TA LA , ( Géog. anc. ) île des Indes à l’embouchure
du fleuve Indus. Arrien nous apprend qu’on
a nomme auffi Delta, à caufe de fa figure triangu-
■ 1 Are> 11 y avoit dans cette île une ville qui portoitle
meme nom. (Z>. / .)
P A T A L A M ou P a d a l a s , ( ffi/l. H W H M I
que les uanians ou Idolâtres de l’indouiîan nomment
des atomes fouterreins ou des lieux de tourmens qui,
luivant leur religion, font deftinés à recevoir les criminels
fur qui Dieu exercera fa vengeance. Ils les
nomment mÆpaiala-logum ou enfer; c’eft Emen ou
H “ .“ r11 la B qui y préfide : fil cour eft compofée
de démons c’e ftjâ que les âmes
des damnés feront tourmentées. Suivant la mythologie
de ces P«>P}es, il y a fept royaumes dans le pau-
P A T 161
lam ; les hommes qui feront condamnés à ce féjour
affreux, ne recevront d’autre lumière que celle que
leur fourniront des ferpens qui porteront des pierres
étincelantes fur leurs tetes.-Cependant les Indiens ne
croient point que les tourmens des damnés feront
éternels : le patalam n’eft fait, félon e u x , que pour
lervir de purgatoire aux âmes criminelles, qui rentreront
enfuite dans le fein de la divinité, d’où elles
lont émanées.
PATALÈNE,f. f. ( Mytkol.') divinité romaine qui
prelidoit aux^ blés Iorfqu’ils commencent à faire pa-
roitre leurs épis. Le peuple lui donnoit le foin de les
taire fortir heureufement. Arnobe parlé d’une divinité
a-pes-pres femblable, qu’il nomme Patella Sc Patel-
lana. (D . J .)
P A T A M A R ( S ii l. m„d.) c’eft ie nomqu'oil
donne dans 1 Indoftan ou dans les états du grand-
mogol, à des meffagers qui vont d’une ville à l’autre.
P A T ANES ou Patans , ( Hift. mod. ) c’eft ainfi
que l’on nomme les reftes de l’ancienne nation fur
qui les Mogols ou Tartares monguls ont fait la conquête
de l’indoftan. Quelques auteurs croient que
leur nom leur vient de Patna, province du royaume
de Bengale au-delà du Gange ; mais d’autres imaginent
avec plus de vraiffemblance que ce font des reftes.
des Arabes , Turcs Sc Perfans mahométans qui
vers 1 an 1000 de l’ere chrétienne, firent la conquête
de quelques provinces de l’Empire fous la conduite
de Mahmoud le Gaznevide. Les Patanes habitent les
provinces feptentrionales de l’empire Mogol ; ils font
courageux & remuans, & ont eu part à la révolution
caufee dans l’indoftan par le fameux Thamas-Kouii-
Kan , ufurpateur du trône de Perfe.
t i l ?U Wm \ H S I mod' ) royaume des
Indes dans la prefqu’ile de Malaca, fur la cote orien-
ta ie, entre le royaume de Siam & de Paha. Les ha-
totans font en partie mahométans & en partie payens.
, r!?.lnols f ° nt avec eux un grand commerce ; on
n y diftingue que deux faifons , l’hiver & l’été ; l’hiver
dure pendant les mois de Novembre, Décembre
& Janvier, pendant lefquels il pleut Dns ceffe. Les
bois font remplis d’éléphans,, de fangliers & dq'gue-
nons. Le royaume, dit Gervaife, releve du roi de
Siam, & eft gouverné par une reine qui ne peut fe
marier, mais qui peut avoir des amans tant qu’elle
veut. La lubricité des femmes y eft fi grande, que les
hommes font contraints de fe faire de certaines garnitures
pour fe mettre à l’abri de leurs entreprifes.
C ’eft là , c’eft aux Maldives, c’eft à Bantan, que la
nature a une force Sc la pudeur une foiblefl'e qu’on
ne peut comprendre ; c’eft-là, ditM. de Montéfquieu
qu’on voit jufqu’à quel point les vices du climat laif-
fes dans la liberté, peuvent porter le défordre. Lone
itQ.lat. y. { D . J . ) 8
Pa tan e , ou Patany, ( Géog. mod. ) ville des Indes
dans la prefqu’île de Malaca, fur la côte orientale du
royaume dePatane, dont elle eft capitale. C’eft une
des villes fortes des Indes orientales ; elle a un port
Sc eft peuplée de Patanois qui font mahométans^ de
Chinois Sc de Siamois. Long. n o . lat. y. 24. >
P A T A N Q U IE N S , Pantochins, voyez Pan to -
QUÎNS.
PATANS, ( Géog. mod. ) peuples des Indes dans
!es états du grand-mogol. Us habitent les montâmes
de Dhely Sc d’Agra.
PATAR ASSE, ou Mal-bete , f. f. ( Marine. ) c’eft
une efpece de cifeau à froid dont on fe fert pour ouvrir
les joints d’entre deux bordages quand ils font
trop ferres, afin de mieux faire la couture. ( Z ) '
PAT ARE , P atara, ( Géog. anc. ) ville d’Afie dans
la L ycie , dont elle étoit capitale , félon Tite-Live,
L X X X V I I . c.xv. Elle avoit un temple célébré dédié
à Apollon Pataréen ; ce temple étoit auffi riche que
celui des Delphites, Sc l’oracle des deux temples paf