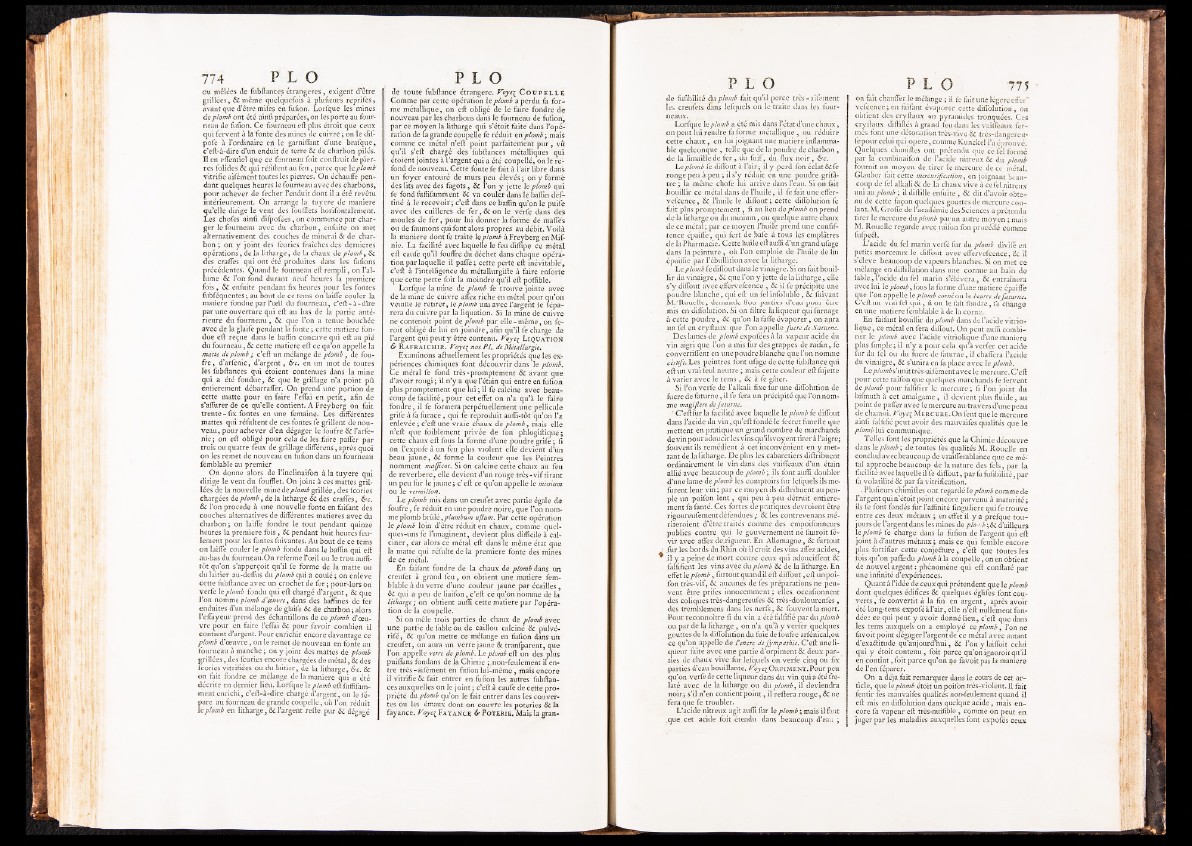
OU mêlées de fubftances étrangères, exigent d’être
grillées, 8c même quelquefois à plufieurs reprifes,
avant que d’être mifes en fufion. Lorfque lés mines
de plomb ont été ainfi préparées, on les porte au fourneau
de fufion. Ce fourneau eft plus étroit que ceux
qui fervent à la fonte des mines de cuivre ; on le dif-
pofe à l’ordinaire en le garniffant d’une brafque,
c’ eft-à-dire d’un enduit dé terre & de charbon pilés.
Il en effentiel que ce fourneau foit conftruit de pierres
folides & qui réliflent au feu, parce que le plomb
vitrifie aifémént toutes les pierres. On échauffe pendant
quelques heures le fourneau avec des charbons,
pour achever de fecher l’enduit dont il a éfé revêtu
intérieurement. On arrange la tuyere de maniéré
qu’elle dirige le vent des foufïlets hôrifontàlërhent.
Les chofes ainfi difpoféès, on commence par charger
le fourneau avec du charbon, enfuite on met
alternativement des couches de minerai & de charbon
; on ÿ joint des fcories fraîches des dernier es
opérations, de la litharge, de la chaux de plomb, 8c
des craffes qui ont éfé produites dans les fufions
précédentes. Quand le fourneau eft rempli, on l’allume
& l’on fond durant neuf heures la première
fois , & enfuite pendant fix heures pour les fontes
fubféquentes ; au bout de ce teins on laiffe couler la
matière fondue par l’oeil du fourneau, c’eft-à-dire
par une ouverture qui eft au bas dé la partie antérieure
du fourneau , 8c que l’on a tenue bouchée
avec de la glaife pendant la fonte ; cette matière fondue
eft reçue dans le baflin concave qui eft au pié
du fourneau, & cette matière eft ce qu’on appelle la
matte de plomb ; c’eft un mélange de plomb, de fou-
f re , d’arfènic, d’argent, &c. en un mot de toutes
les fubftances qui etoient contenues dans la mine
qui a été fondue, & que le grillage n’a point pu
entièrement débarraffer. On prend une portion de
cette matte pour en faire l’ effai en petit, afin de
s’affurer de ce qu’elle contient. A Freyberg on fait
trente - fix fontes en une femaine. Les différentes
mattes qui réfultent de ces fontes fe grillent de nouveau,
pour achever d’en dégager le foufre & l’arfe-
iîic ; on eft obligé pour cela de les faire paffer par
trois ou quatre feux de grillage différens, après quoi
on les remet de nouveau en fufion dans un fourneau
femblable au premier
On donne alors de l’inclinaifon à la tuyere qui
dirige le vent du fouffiet. On joint à ces mattes grillées
de là nouvelle mine de plomb grillée, des fcories
chargées de plomb, de la litharge 8c des craffes, &c.
8c l’on procédé à une nouvelle fonte en faifant des
couches alternatives de différentes matières avec du
charbon; on laiffe fondre le tout pendant quinze
heures la première fois, 8c pendant huit heures feulement
pour les fontes fuivantes. Au bout de ce tems
on laiffe couler le plomb fondu dans le baflin qui eft
àu-bas du fourneau.On referme l’oeil Ou le trou aufli-
tôt qu’on s’apperçoit qu’il fè forme de la matte ou
du laitier au-deffus du plomb qui a coulé ; oh enleve
cette fubftance avec un crochet de fer ; pour-lors On
verfe le plomb fondu qui eft chargé d’argent, 8c que
l’on nomme plomb d'&uvre, dans des b affines de fer
enduites d’un mélange de glaife & dé charbon ; alors
l’effayeiir prend dés échantillons de ce plomb d’oeuvre
pour en faire l’effai 8c pour favoir combien il
contient d’argent. Pour enrichir encore davantage ce
plomb d’oeuvre, on le remet de nouveau en fonte au
fourneau à manche ; on y joint des mattes de plomb
grillées, des fcories encore chargées dé métal, & des
fcories vitrifiées ou du laitier, de la litharge, bc. 8c
on fait fondre ce mélange de la maniéré qui a été
décrite en dernier lieu. Lorfque le plomb eft fuffifam-
ment enrichi, c’eft-à-dire chargé d’argent, on le fé-
pare au fourneau de grande coupelle, où l’on réduit
ïb plomb en litharge, 8c l’argent refte pur 8c dégagé
de toute fubftance étrangère. Voyé^ C o u p e l l é
C omme par cette opération le plomb a perdu fa for-*
me métallique, on eft obligé de lé faire fondre dé
nouveau par les charbons dans lé fourneau de fufion,
par ce moyen la litharge qui s’étoit faite dans l’operation
de la grande coupelle fe réduit én plomb ; maià
comme ce métal n’éft point parfaitement pu r, vu
cpi’il s’eft chargé des fubftances métalliques qui
etoient jointes à l ’argent qui a été coupellé, on le refond
de nouveau. Cette fonte fe fait à l ’air libre dans
i un foyer entouré de murs peu élevés ; on y formé
dés lits avec des fagots, & l’on y jette le plomb qui
fé fond fuffifamment 8c va coulër dans lé baflin def-
tihê à le recevoir; c’eft dans ce baflin qu’on le püifè
avec des cuillères de fe r , 8c on le verfe dans des
moules de fe r , pour lui donner là formé de mafles
ou de faumons qui font alors propres au débit. Voilà
là maniéré dont fe traite le plomb à Freyberg en Mifi
nie. La facilité avec laquelle le feu diflipe ce métal
eft caufe qu’il fouffre du déchet dans chaqué opération
par laquelle il paffé ; cette perte eft inévitable,
c’eft à l’intelligence du métallurgifté à. faire énfofte
que cette perte foit la moindre qu’il eft poflible.
Lorfque la miné de plomb fe trouve jointe avec
de la mine de cuivre alfez riche en métal pour qu’on
veuille le retirer, le plomb uni avec l’argent fe lépa-
rera du cuivre par la liquation. Si la miné dé cuivre
ne contenoit point de plomb par elle-mêmë, on fe-
roit obligé de lui en joindre, afin qu’il fe charge dé
l’argent qui peut y être contenu. Voye^ Liquation
& Rafraîchir. Voye^nosPl. de Métallurgie.
Examinons aéluellement les propriétés que les expériences
chimiques font découvrir dans le plomb.
Ce métal fe fond très-promptement.& avant que
d’avoir rougi ; il n’y a que l’étain qui entre en fufion
plus promptement que lui ; il fe calcine avec beaucoup
de facilité, pour cet effet on n’a qu’à le faire
fondre, il fe formera perpétuellement une pellicule
grife à fa furace, qui fe reproduit aufli-tôt''qu’on l’a
enlevée ; c’eft une vraie chaux de plomb, niais elle
n’eft que foiblement privée de fon phlogiftiqué;
cette chaux eft fous la forme d’une poudre grife ; fi
on l’expofe à un feu plus violent elle devient d’un
beau jaune, 8c forme la couleur que lés Peintres
nomment mafficot. Si on calcine cette chaux au feu
de reverbere, elle devient d’un roiige très-vif tirant
un peu fur le jaune ; c’ eft ce qu’on appelle le minium
ou le vermillon.
Le plomb mis dans un creufet avec partie égale de
foufre, fe réduit en une poudre noire, que l’on nomme
plomb brûlé 9plumbum uflum. Par cette opération
le plomb loin d’être réduit en chaux, comme quelques
uns fe l’imaginent, devient plus difficile à calciner,
car alors ce métal eft dans le même état que
la matte qui réfultc de la première fonte des mines
de ce métal.
En faifant fondre de la chaux de plomb dans un
creufet à grand feu, oh obtient une matière femblable
à du verre d’une couleur jaune par écailles,
8c qui a peu de liaifon, c ’eft ce qu’on homme de la
litharge; on obtient aufli cette matière par l'opération
de la coiipelle.
Si on mêle trois parties de chaux de plomb avec
une partie de fable ou de caillou calciné & pulvé-
rifé, 8c qu’on mette ce mélange en fufion dans un
creufet, on aura un verre jaune & tranfparent, que
l’on appelle verre de plomb. Le plomb eft un des plus
puiffans fondans de la Chimie ;_non-feulement il entre
très -aifémént en fiilion lui-même, mais encore
il vitrifie & fait entrer en fufion les autres fubft^n-
ces auxquelles on le joint ; c’eft à caufe de cette propriété
du plomb qu’on le fait entrer dans les couvertes
ou les émaux dont on couvre les poteries 8c la
fayance. Voye^ Fa y an ce 6* Poterie. Mais la grande
fufibilité du plomb fait qu’il perce très-aifémént
les creufets dans lefquels on le traite dans les fourneaux.
,
Lorfque le plomb a été mis dans l’état d’une chaux,
.on peut lui rendre fa forme métallique, ou réduire
.cette chaux, en lui joignant une matière inflammable
quelconque , telle que de la poudre de charbon,
de la limaille de fer , du fiiif, du flux n o ir, &c.
Le plomb fe diflout à l’air; il y perd fon éclat & fe
.ronge peu à peu ; il s’y réduit en une poudre grifâ-
tre ; la même chofe lui arrive dans l’eau. Si on fait
bouillir ce métal dans de l’huile, il fe fait une effer-
vefcence, 8c l’huile le diflout ; cette diflolution fe
fait plus promptement, fi au lieu de plomb on prend
de la litharge ou du minium, ou quelque autre chaux
.de ce métal; par ce moyen l’huile prend une confif-
tence épaifîe, qui fert de bafe à tous les emplâtres
ide la Pharmacie. Cette huile eft aufli d’un grand ufage
dans la peinture , où l’on emploie de l’huile de lin
épaiflie par l’ébullition avec la litharge.
Le plomb fe diflout dans le vinaigre. Si on fait bouillir
du vinaigre, 8c que l’on y j ette de la litharge, elle
s’y diflout avec effervefcence , 8c il fe précipite une
poudre blanche, qui eft un fel infoluble, 8c fuivant
M.'Rouelle, demande 8oo parties d’eau pour être
.mis en diflolution. Si on filtre la liqueur qui fumage
à cette poudre, 8c qu’on la faffe évaporer, on aura
un fel en cryftaux que l’on appelle fucre de Saturne.
Des lames de plomb expofées à la vapeur acide du
vin aigri que l’on a mis fur des grappes de raifin,. fe
. conveniffent en une poudre blanche que l’on nomme
cérufe. Les peintres font ufage de cette fubftance qui
.eft un vrai feul neutre ; mais cette couleur eft fujette
à varier avec le tems , 8c à fe gâter.
, Si l’on verfe de l’alkali fixe fur une diflolution de
fucre de faturne, il fe fera un précipité que l’on nomme
magijlere de Jaturne.
* C ’eft fur la facilité avec laquelle le plomb fe diflout
dans l’acide du v in , qu’eft fondé le fecret funefte que
mettent en pratique un grand nombre de marchands
de vin pour adoucir les vins qu’ilsvoyent tirer à l’aigre;
fouvent ils remédient à cet inconvénient en y méfiant
de la litharge. De plus les cabaretiers diftribuent
ordinairement le vin dans des vaiffeaux d’un étain
allié avec beaucoup de plomb ; ils font aufli doubler
d’une lame de plomb les comptoirs fur lefquels ils me-
furent leur vin; par ce moyen ils diftribuent au peuple
un poifon len t, qui peu à peu détruit entièrement
fa fanté. Ces fortes de pratiques devroient être
rigoureufement défendues ; 8c les contrevenans mé-
riteroient d’être traités comme des empoifonneurs
publics contre qui le gouvernement ne fauroit fé-
vir avec affez defrigueur. En Allemagne, 8c furtout
■ fur les bords du Rhin où il croît des vins affez acides,
” i l y a peine de mç>rt contre ceux qui adouciffent 8c
falfifient les vins avec du plomb 8c de la litharge. En
effet 1 e plomb, furtout quand il eft diflout, eft un poifon
très-vif, 8c aucunes de fes préparations ne peuvent
être prifes innocemment ; elles occafionnent
des coliques très-dangereufes 8c très-doulourenfes ,
des tremblemens dans les nerfs, 8c fouvent la mort.
Pour reconnoître fi du vin a été falfifié par du plomb
-ou par de la litharge, on n’a qu’ày v e r fe r quelques
gouttes de la diflolution du foie de foufre arfénical,ou
ce qu’on appelle de C encre de fympathie. C’eft une liqueur
faite avec une partie d’orpiment 8c deux parties
de chaux vive fur lefquels on verfe cinq ou fix
parties d’eau bouillante. P’oye^Orpiment. Pour peu
qu’on verfe de cette liqueur dans du vin qui a été frelaté
avec de la litharge ou du plomb, il deviendra
noir; s’il n’en contient point, il reftera rouge, 8c ne
fera que fe troubler.
L’acide nitreux agit aufli fur le plomb ; mais il finit
.que cet acide , foit étendu dans beaucoup d’eau ;
on fait chauffer le mélange ; il fe fait une légère effervefcence
;e n faifant évaporer cette diflolution , on
obtient des Cryftaux en pyramides tronquées. Ces
.cryftaux diftillés à grand feu dans les vaiffeaux fermes
font une détonation très-vive 8c très-dangereu*
fepour celui qui opéré, comme Kunckel l’a éprouvé.
Quelques chimiftes ont prétendu que ce fel formé
par la combinaifon de l’acide nitreux 8c du plomb
fournit un moyen de tirer le mercure, de ce métal.
Glauber fait cette mercurification, en joignant beaucoup
de fel alkali & de la chaux vive à ce fel nitreux
uni au plomb ; il diftille enfuite , 8c dit d’avoir obtenu
de cette façon quelques gouttes de mercure coulant.
M. Groffe de l’académie des Sciences a prétendu
tirer le mercure du plomb par un autre moyen ; mais
M. Rouelle regarde avec raifon fon procédé comme
fufpett.
L’acide du fel marin verfé fur du plomb divifé en
petits morceaux le diflout avec effervefcence, 8c il
s’élève beaucoup de vapeurs blanches. Si on met ce
mélange en diftillation dans une cornue au bain de
fable, l’acide du fel marin s’élèvera, & entraînera
avec lui le plomb ^ fous la forme d’une matière épaiffe
que l’on appelle 1 e plomb corné on le beurre de faturne.
C ’eft un vrai fel q ui, fi on le fait fondre, fe change
en une matière femblable à de la corne.
En faifant bouillir du plomb dans de l’acide vitrio-* '
lique, ce métal en fera diflout. On peut aufli combiner
le plomb avec l’acide vitriolique d’une maniéré
plus fimple ; il n’y a pour cela qu’à verfer cet acide
fur du fel ou du fucre de faturne, il chaffera l’acide
du vinaigre, 8c s’unira en fa place avec le plomb.
Le plomb s’nmttrès -aifémént avec le mercure. C ’eft
pour cette raifon que quelques marchands fe fervent
de plomb pour fallifier le mercure ; fi l’on joint du
bifmuth à cet amalgame , il devient plus fluide, au
point de paffer avec le mercure au-travers d’une peau
de chamoi. Voye^ M e r c u r e . On fent que le mercure
ainfi falfifié peut avoir des mauvaifes qualités que le
plomb lui communique.
Telles font les propriétés que la Chimie découvre
dans \eplomb-, de toutes fes qualités M. Rouelle en
eoncludavecbeaucoup de vraiffembla'nce que ce métal
approche beaucoup de la nature des fels, par la
facilité avec laquelle il fe diflout, par fa fufibilité, par
fa volatilité 8c par fa vitrification.
.Piufieurs chimiftes ont regardé le plomb comme de
l’argent quin’étoit point encore parvenu à maturité;
ils fe font fondés fur l’affinité finguliere qui fe trouve
entre ces deux métaux ; en effet il y a prefque toujours
de l’argent dans les mines de plomb ; 8c d’ailleurs
le plomb (e charge dans la fufion de l’argent qui eft
joint à d’autres métaux ; mais ce qui femble encore
plus fortifier cette conje&ure, c’eft que toutes les
fois qu’on paflè du plomb à la coupelle, on en obtient
de nouvel argent : phénomène qui eft conftaté par
une infinité d’expériences.
Quant à l’idée de ceux qui prétendent que le plomb
dont quelques édifices 8c quelques églifes font couverts
, fe convertit à la fin en argent, après avoir
été long-tems expoféàl’air, elle n’eft nullement fondée:
ce qui peut y avoir donné lieu, c’eft que dans
les tems auxquels on a employé ce plomb, l’on ne
favoit point dégager l’argent de ce métal avec autant
d’exaéfitude qu’aujourd’hui, 8c l’on y laiffoit celui
- qui y étoit contenu, foit parce qu’on ignoroit qu’il
en contînt, foit parce qu’on qe favoit pas la maniéré
de l’en féparer.
On a déjà fait remarquer dans le cours de cet article,
que le plomb étoit un jpoifon très-violent. Il fait
fentir les mauvaifes qualités non-feulement quand il
eft mis en diflolution dans quelque acide, mais encore
fa vapeur eft très-nuifible, comme on peut en
juger par les maladies auxquelles font expofés ceux