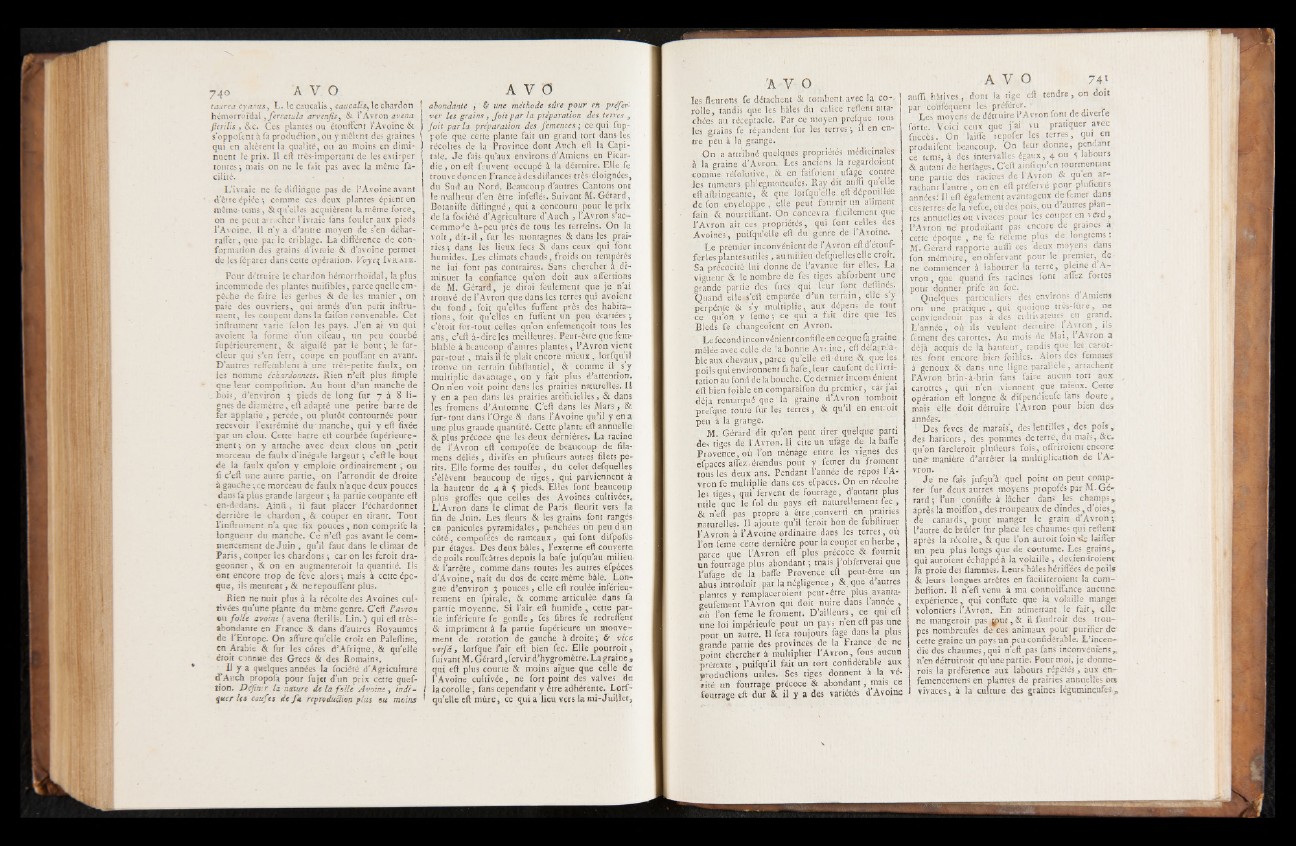
taure a cyanus, L. le caucalis, caucalis-, le chardon
hémorroïdal,ferratula arvcnfis, & l’Avron ayena
fierilis t &c. Ces plantes ou étouffent fAvoine &
s’oppoftnt à fa produélion,ou y mêlent des graines
qui en altèrent la qualité, ou an moins en diminuent
le prix. Il eft très-important de les extirper
toutes*, mais on ne le fait pas avec la même facilité.
L’ivraie ne fe diflirfgçte pas de l’Avoine avant
d’être épiée *, comme ces deux plantes épient en
même- tems, & qu’elles acquièrent la même force,
on ne peut arracher l’ivraie fans fouler aux pieds
l’Avoine. 11 n’y a d’autre moyen de s’en déhar-
raller, que par le criblage. La différence de conformation
des grains d’ivraie & d’avoine permet
de les féparer dans cette opération. Voye\ Ivraie.
Pour détruire le chardon hémqrrhoïdal, la plus
incommode des plantes nuifibles, parce quelle empêche
de faire les gerbes & de les manier , on
paie des ouvriers, qui armés d’un petit inftrii-
oeent, les coupent dans la faifon convenable. Cet
infiniment varie félon les pays. J ’en ai vu qui
avoient la forme' d’un cifeau, un peu courbé
fupérieurement, & aiguifé par le bout *, le far-
cleur qui s’en ferr, coupe en pouffant en avanr.
D’autres reflemblent à une très-petite faulx, on
les nomme échardonnets. Rien n’eft plus fimple
que leur compofition. Au bout d’un manche de
. bois, d’environ 3 pieds de long fur 7 à 8 lignes
de diamètre, eft adapté une petite barre de
fer applatie , percée, ou plutôt contournée pour
recevoir l’extrémité du - manche, qui y eft fixée
par un clou. Cette barre ell courbée fupérieurement
j on y attache avec deux clous un .petit
morceau de faulx d’inégale largeur *, c’eft le bout
de la faulx qu’on y emploie ordinairement ' ou I
fi c’eft une autre partie, on l’arrondit de droite
à gauche -, ce morceau de faulx n’a que deux pouces J
dans fa plus grande largeur , la partie coupante eft
en-dedans. Ainfi, il faut placer l’échardonnet |
derrière le chardon, & couper en tiranr. Tout
l’inftrumenr n’a que iix pouces, non eomprife la
longueur du manche. Ce ri’eft pas avant le commencement
de Juin, qu’il faut dans le climat de
Paris, couper les chardons ; car on les feroit dra-
geonner, & on en augmenteroit la quantité. Ils
ent encore trop de fève alors } mais à cette époque,
ils meurent, & nerepouflent plus.
Rien ne nuit plus à la récolte des Avoines cultivées
qu’une plante du même genre. C’eft Pavron
ou folle avoine (avena fterilis. Lin.) qui eft très-
abondante en France & dans d’autres Royaumes
de l’Europe. On affure qu’elle croît en Paleftine,
en Arabie & fur les côtes d’Afrique, & qu’elle
étort connue des Grecs & des Romains.
Il y a quelques années la fociété d’Agriculture
d Au ch propofa pour fujet d’un prix cetre quef-
tion. Définir la nature delà folle Avoine, indiquer
Us caiif ts de fa reproduction plus ou moins
[ abondante , & une méthode sûre pour en préfer*
] ver les grains , Joit par la préparation des terres ,
1 Joit parla préparation des femences; ce qui fup-
( pofe que cette plante fait un grand tort dans les
récoltes de la Province dont Au ch eft la Capitale.
Je fais qu’aux environs d’Amiens en Picardie,
on eft fou vent occupé à la détruire. Elle fe
trouve donc en France à des diflances très-éloignées,
du Sud au Nord. Beaucoup d’autres Cantons ont
le malheur d’en être infeftés. Suivant M. Gérard,
Botanifte diftingué, qui a concouru pour le prix
de la fociété d’Agriculture d’Auch , l’Avron s’ac-
• commode à-peu près de tous les terreins/On la
voit, d it-ilfu r les montagnes. & dans les prairies*,
dans les lieux fecs & dans ceux qui font
humides. Les climats chauds, froids ou tempérés
ne lui font pas contraires. Sans chercher à diminuer
la confiance qu’on doit aux affertions
de M. Gérard, je dirai feulement que jie n’ai
trouvé de l’Avron que dans les terres qui avoient
du fond , foit qu’elles fuffent près des habitations,
Toit quelles en fuffent un peu écartées 5
c’étoit fur-tout celles qu’on ènfemençoit tous les
ans, c’eft à-dire les meilleures. Peut-être que ferre
blable à beaucoup d’autres plantes, l’Avrpn vient
par-tout , mais il fe. plaît encore mieux , lorfqu’il
trouve un . terrain fubftantïel, & comme il s y
multiplie davantage, on y fait plus d’attention.
On n’en voit point dans les prairies naturelles. Il
y en a peu dans les prairies artificielles, & dans
les fromèns d’Autourne. C’eft dans les Mars, &
fur-tout dans l’Orge & dans l’Avoine qu’il y en a
une plus grande quantité. Cette plante eft annuelle
& plus précoce que les deux dernières. La racine
de i’Avron eft compofée de beaucoup de fila-
mens déliés, divifés en plufieurs autres filets petits.
Elle forme des touffes , du colet defquelles
s’élèvent beaucoup de tiges,, qui parviennent à
la hauteur de 4 à 5 pieds. Elles font beaucoup
plus groffes que celles des Avoines cultivées».
L’Avron dans le climat de Paris fleurit vers la
fin de Juin. Les fleurs & les grains font rangés-
en panicules pyramidales, penchées un peu d un
côté, compofées de rameaux, qui font difpofés
par étages. Des deux bâles, l’externe eft couverte
de poils rouffeâtres depuis la bafe jufqu’au milieu-
& l’arrête, comme dans toutes les autres efpèçes
d’Avoine, naît du dos de cette même Bâle. Longue
d’environ 3 pouces, elle eft roulée inférieurement
en fpirale, & comme articulée dans fa
partie moyenne. Si l’air eft humide , cette partie
inférieure fe gonfle, fes fibres fe redreffent
& impriment à la partie fupérieure im mouvement
de rotation de gauche à droite} & vice
verfd, lorfque l’air eft bien fec. Elle pourroit,
fuivant M.Gérard ,fervir d’hygromètre. La graine a
qui eft plus courte & moins aigue que celle de
Y Avoine cultivée, ne fort point des valves de
la corolle, fans cependant y être adhérente. Lorf-
qu’elle eft mitre, ce qui a lieu vers la mi-Juillet.,
les fleurons fe détachent & tombent, avec la co-- |
rolle, tandis que les bâles du calice reftent attachées
au réceptacle. Par ce moyen prcfque tous
les grains fe répandent fur les terres} il en entre
peu à la grange.
On a attribué quelques propriétés médicinales
à la graine d’Avron. Les anciens la regardoient
comme, réfolutive, & en faifûient ufage contre
les tumeurs phîegmoneufes. Ray dit aufli qu’elle
eft afttingéante, & que lorfqu elle, eft dépouillée
de fon enveloppe , elle peut fournir un aliment
fain St nourriffant. On concevra facilement que
l’Avron ait ces propriétés", qui font celles des
Avoines, puifqu’eüe eft du genre de l Avoine.
Le premier inconvénient de l’Avron eft d’étouffer
les plantes utiles, au milieu defquelles elle croît.
Sa précocité lui donne de l’avance fur elles. La
vigueur & le nombre de fes tiges abforbent une
grande partie des fucs qui leur font deftinés.
Quand elle s’eft.emparée d’un terrain, elle s’y
perpétue & 7s’y multiplie, aux dépens de tout
de qu’on y ferne*, ce qui à fait dire que les
Bleds fe changeoiemt en Avron.
Le fécond inçonvénientconfifte en ceque fa graine
mêlée avec celle de la bonne Avc.ine, eft défagréa-
hleaux chevaux, parce quelle eft-dure & que les
poils qui environnent fa bafe, leur caufent de l irritation
au fond de la bouche. Ce dernier fnconv énient
eft bien foible en comparaifon du premier, car j ai
déjà remarqué que Ma graine d’Avron tomboit
•prefque toute fur les terres, & qu’il en entroit
peu à la grange.
M. Gérard dit qu’on peut tirer quelque parti
des tiges de lAvron. Il cite un ufage de la baffe
Provence, où l’on ménage entre les vignes des
efpaces affez.étendus pour ^.fetner du froment
tous les deux ans. Pendant l’année de repos l’A-
vron fe multiplie dans ces efpaces. On en récolte
les tiges, qui fervent de fourrage, d’autant plus
utile que le fol du pays eft naturellement fec ,
& n’eft pas propre à être .converti en prairies
naturelles. Il ajoute qu’il feroit bon de fubfiituer
l’Avron à l’Avoine ordinaire dans les terres, où
l’on feme cette dernière pour la couper en herbe ,
parce que l’Avron eft plus précoce & fournit
un fourrage plus abondant} mais j obferverai que
l’ufage de la baffe Provence eft peut-être un
abus introduit par la négligence, & que d’autres
■ plantes y remplacer oient peut-être plus avanta-
geufement i’Avron qui doit nuire dans 1 année ,
où l’on feme le froment. D ailleurs, ce qui eft
une loi impérieufe pour un pays nen eft pas une
pour un autre. Il fera toujours fage dans la plus
orande partie des provinces de la France de ne
point chercher à multiplier l’Avron, fous aucun
prétexte , puifqu’il fait un tort considérable aux
productions utiles. Ses tiges donnent à la vérité
un fourrage précoce abondant, niais ce
fourrage eft dur & il y a d e s variétés d’Avoine
auffl hâtives, dont la tige eft tendre, on doit
par coiiféquem les préférer. r i
Les moyens’ de détruire l’Avron font de diverle
forte. Voici ceux que j’ai vu pratiquer arec
fiiccès. On laiffc repofer les terres, qui en
produifent beaucoup. On leur donne, pendant
ce tems, à des intervalles égaux, 4 ou 5 labours
& autant de herfages. C’eft ainfi qu’en tourmentant
une partie des racines de l’Avron & qu en arrachant
l’autre , on en eft préfervé pour plufieurs
années: II eft également avantageux de ferner dans
ces terres dé la vefee, on des pois, ou d’autres plantes
annuelles ou vivaces pour les couper en verd,
l’Avron ne produifant pas encore de graines à
cette époque , ne fe refeme plus de.longtems:
M. Gérard rapporte auffl ces deux moyens dans
fon mémoire, en ob fer vant pour le premier, de
ne commencer à labourer la terre, pleine d A-
vron, que quand fes racines font affez fortes
pour donner prife au foc. . ,
Quelques particuliers des environs d Amiens
ont une pratique , qui quoique très-fure, ne
conviendroit pas à des cultivateurs^ en grand.
L’année, où ils veulent détruire lAvron, ils
. Cernent des carottes. Au mois de Mai, l’Avron a
déjà acquis dé la hauteur, tandis que les carottes
font encore bien foibles. Alors des femmes
à genoux & dans une ligne parallèle, arrachent
l'Avron brin-à-brin fans faire aucun tort aux
carottes, qui n’en .viennent que mieux. Cetre
opération eft longue & difpendieufe fans doute,
mais elle doit détruire l’Avron pour bien des
années.
Des feves de marais, des lentilles, des pois ,
des haricots, des pommes de terre, du maïs, &c,
qu’on farder oit plufieurs fois, offriraient encore
unè- manière d’arrêter la multiplication de 1A-
vron.
Je ne fais jufqu’à quel point on peut compter
fur deux autres moyens propofés par M. Gér
rard} l’un confifte à lâcher d'ans lès champs,
après la moiffon, des troupeaux de dindes, d’oies,
de canards, pour manger le grain d’Avron},
l’autre de brûler fur place les chaumes qui reftent
après la récolte, & que l’on auroit foin vie laiffer
rtn peu plus longs que de coutume. Les grains,
qui auroient échappé à la volaille deviendroienr
îa proie des flammes. Leurs~bâles hériffées de poils;
& leurs longues arrêtes en faciliteroient la com-
buftion. Il n eft venu à ma connoiffance aucune,
expérience, qui conftate que la volaille mange
volontiers l’Avron, En admerrant le fait, elle
ne mangeroit pas il f au droit des ^ troupes
nombreufes de ces animaux pour purifier de
cette graine un pays un peu confidérable. L’incendie
des chaumes, qui n eft pas fans inconvénièns ^
n’en détruiroit qu’une partie. Pour moi, je donne-
rois la préférence aux labours répétés, aux en-
| femencemens en plantes de prairies annuelles oit
1 vivaces a à la culture des graines Iégumincufeî>