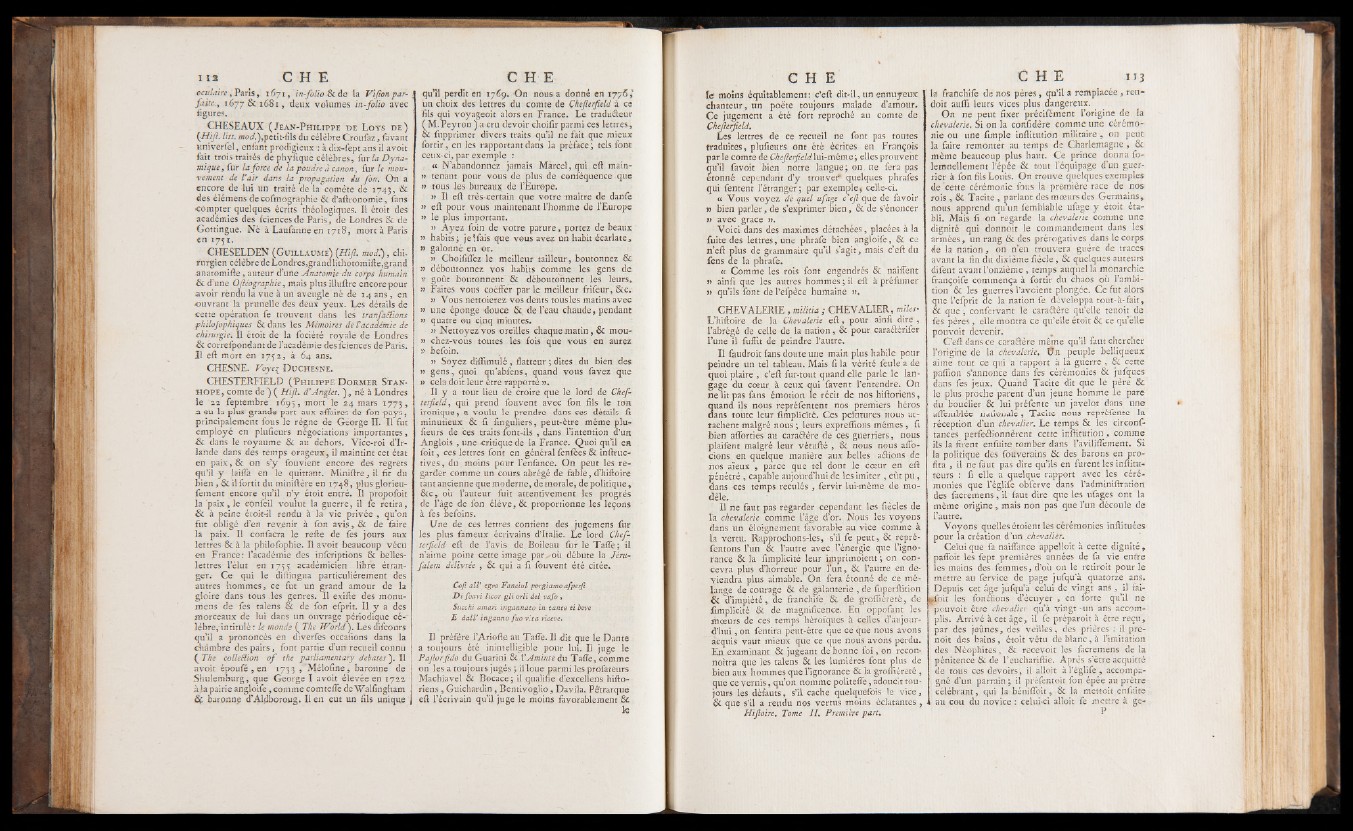
lia CHE
oculaire, Paris, 16 71, in-folio 8c de la V i f on par-
faite., 1677 & 1681, deux volumes in-folio avec
figures.
CHESEAUX ( J e a n -P h il ip p e d e L o y s d e )
(JJifl. Int. mod.),petit-fils du célèbre Croufaz , favant
univerfel, enfant prodigieux : à dix-fept ans il avoit
{ait trois traités dephyfique célèbres, fur la Dynamique
> fur la force de la poudre à canon, fur le mouvement
de Vair dans la propagation du fon. On a
encore de lui un traité de la comète de 1743, 8c
des élémens de cofmographie & d’aftronomie, farts
■ compter quelques écrits théologiques. Il étoit des
académies des foiencesde Paris , de Londres & de
Gottingue. Né à Laufanne en 1718, mort à Paris
en 1751.
CHESELDEN (G u il l a um e ) (HiJL mod! ) , chl.
rurgien célèbre de Londres,grand lithotomifte,grand
anatomifte, auteur d’une Anatomie du corps humain
& d’une Ofléographie, mais plus illuftre encore pour
avoir rëndu la vue à un aveugle né de 14 ans, en
ouvrant la prunelle des deux yeux. Les détails de
cette opération fe trouvent dans les tranfaâlions
philojophiques 8c dans les Mémoires de t'académie de
chirurgie. Il étoit de la fociété royale de Londres
& correfpondant de l’académie des fciences de Paris.
I l eft mort en 1752, à 64 ans.
CHESNE. Voye^ D u chesn e.
CHESTERFIELD ( P h il ip p e D o rm e r St a n -
HOPE, comte de ) ( Hifl. d3Anglet. )., né à Londres
le 22 feptembre 1693, mort le 24 mars 17 73 ,
.a eu la plus grande part aux affaires de fon pay s ,
principalement fous le règne de George H. Il fut
employé en plufieurs négociations importantes,
■ & dans le royaume & au dehors. Vice-roi d’Irlande
dans des temps orageux, il maintint cet état
en paix, & on s’y fouvient encore des regrets
qu’il y laifiâ en le quittant. Miniftre, il fit du
bien , & iifortit du miniftère en 1748, plus glorieu-
fement encore qu’il n’y étoit entré. Il propofoit
la paix, le eonfeil voulut la guerre, il fe retira,
& à peine éroi-t-il rendu à la vie privée , qu’on
fut obligé d’en revenir à fon avis, 8c de faire
la paix. Il confacra le relie de fes jours aux
lettres & à la philofophie. Il avoit beaucoup vécu
en France: l’académie des inferiptions & belles-
lettres l’élut en 1755 académicien libre étranger.
C e qui le diftingua particuliérement des
autres hommes, ce fut un grand amour de la
gloire dans tous .les genres. Il exifte des monu-
mens de fos talens & de fon efprit. Il y a des
morceaux de lui dans un ouvrage périodique célèbre,
intitulé: le monde ( The World). Les difco'urs
qu’il a prononcés en diverfes occafions dans la
chambre des pairs , font partie d’un recueil connu
( The collection o f the parliamentary debates ). Il
avoit époufé , en 1733 ,'Mélofine, baronne de
Shulemburg; que George I avoit élevée en 1722
à,la pairie angloife, comme comteffe dcWalfingham
baronne d’Aldborong. Il en eut un fils unique
C H E
qu’il perdit en 1769. On nous a donné en 1776 »
un choix des lettres du comte de Cheflerfield à ce
fils qui voyageoit alors en France. Le traducteur
( M. JPeyron ) a cru devoir choiiir parmi ces lettres,
8c fupprimer divers traits qu’il ne fait que mieux
fortir, en les rapportant dans la préface ; tels font
ceux-ci, par exemple :
« N’abandonnez jamais Marcel, qui eft main-
» tenant pour vous de plus de conséquence que
» tous les bureau?: de l’Europe.
» Il eft très-certain que votre maître de danfe
» eft pour vous maintenant l’homme de l’Europe
» le plus important.
» Ayez foin de votre parure, portez de beaux
» habits; je 1 fais que vous avez un habit écarlate,
» galonné en or.
» Choififfez le meilleur tailleur, boutonnez &
» déboutonnez vos habits comme les gens de
» goût boutonnent & déboutonnent les leurs.
» Faites vous coëffer par le meilleur frifeur, &c.
» Vous nettoierez vos dents tousles matins avec
» une éponge douce & de l’eau chaude, pendant
» quatre ou cinq minutes.
» Nettoyez vos oreilles chaque matin, & mou-
» chez-vous toutes les fois que vous en aurez
» befoin.
» Soyez diftimulé , flatteur ; dites du bien des
» gens, quoi qu’abfens, quand vous favez que
» cela doit leur être rapporté ».
Il y a tout lieu de croire que le lord de Chef
terfield, qui prend fouvent avec fon fils le ton
ironique, a voulu le prendre dans ces détails fi
minutieux & fi finguliers, peut-être même plufieurs
de ces traits font-ils , dans l’intention d’un
Anglois , une-critique de la France. Quoi qu’il en
foit, ces lettres font en général fonfées & inftruc-
tives, du moins pour l’enfance. On peut les regarder
comme un cours abrégé de fable, d’hiftoire
tant ancienne que moderne, de morale, de politique ,
& c , où. l’auteur fuit attentivement les progrès
de i’âge de fon élève, & proportionne les leçons
à fes befoins.
Une de ces lettres contient des jugemens fiir
les plus fameux écrivains d’Italie. Le lord Chef-
terfield eft de l’avis de Boileau fur le Taffe; il
n’aime point cette image par^où débute la Jéru-
falem délivrée , & qui a fi fouvent été citée.
Cofi a lV egro F a n c iu l porgiamo afperji
D i fo a v i liç o r g l i o r li de l vafo ,
Succhi aman in gan na to in tan to ei beve
E d a lV in g an n o fu o v it a riceve.
Il préfère l’Ariofte au Taffe. Il dit que le Dante
a toujours été inintelligible pour lui. Il juge le
Pajlorfido du Guarini 8c YAminte du Taffe, comme
on les a toujours jugés ; il loue parmi les profateurs
Machiavel 8c Bocace; il qualifie d’excellens hifto-
riens , Guichardin, Bentivoglio, Davila. Pétrarque
eft l’écrivain qu’il juge le moins favorablement &te
C H E
fe moins équitablement: c’eft dit-il, un ennuyeux
chanteur, un poète toujours malade d’amour.
Ce jugement a été fort reproché au comte de
Cheflerfield.
Les lettres de ce recueil ne font pas toutes
traduites, plufieurs ont été écrites en François
par le comte de Cheflerfield lui-même; elles prouvent
qu’il favoit bien notre langue; on, ne fera pas
étonné cependant d’y trouvef' quelques phrafes
qui tentent l’étranger; par exemple* celle-ci.
« Vous voyez de quel ufage cefl que de favoir
» bien parler, de s’exprimer bien, & de s’énoncer
» avec grâce ».
Voici dans des maximes détachées, placées à la
fuite des lettres, une phrafe bien angloife, 8c ce
n’eft plus de grammaire qu’il s’agit, mais c’eft du
fens de la phrafe.
« Comme les rois font engendrés & naiffent
» ainfi que les autres hommes ; il eft à préfumer
» qu’ils font de l’efpèce humaine »♦
CHEVALERIE , militia ; CHEVAL IER, miles*
L’hiftoire de la Chevalerie e ft , pour ainfi d ire,
l’abrégé de celle de la nation, & pour caraCtérifer
l’une il fufïit de peindre l’autre.
Il faudroit {ans doute une main plus habile pour
peindre un tel tableau. Mais fi la vérité feule a de
quoi plaire , c’eft fur-tout quand elle parle le langage
du coeur, à ceux qui favent l’entendre. On
ne lit pas fans émotion le récit de nos hiftoriens,
quand ils nous repréfentent nos premiers héros
dans toute leur fimplicitè. Ces peintures nous attachent
malgré nous ; leurs expreffions mêmes , fi
bien afforties au caraCtère de ces guerriers, nous
plaifent malgré leur vétufté , & nous nous affo-
cions en quelque manière aux belles aCtions de
nos aïeux , parce que tel dont le coeur en eft
pénétré , capable aujourd’hui de les imiter , eût pu,
dans ces temps reculés , fervir lui-même de modèle.
Il ne faut pas regarder cependant les fiècles de
la chevalerie comme l’âge d’or. Nous les voyons
dans un éloignement favorable au vice comme à
la vertu. Rapprochons-les, s’il fe peut, 8c repré-
fentons l’un 8c l’autre avec. l’énergie que l’ignorance
& la fimplicitè leur imprimoient ; on concevra
plus d’horreur pour Fun, 8c l’autre en deviendra
plus aimable. On fera étonné de ce mélange
de courage & de galanterie , de fuperftition
& d’impiété, de franchife & de grofîiéreté, de
fimplicitè & de magnificence. En bppofant les
moeurs de ces temps héroïques à celles d’aujourd’hui
, on fentira peut-être que ce que nous avons
acquis vaut mieux que ce que nous avons perdu.
En examinant & jugeant de bonne fo i, on recon-
noîtra que les talens & les lumières font plus de
bien aux hommes que l’ignorance & la grofiïéreté,
que ce vernis, qu’on nomme politeffe, adoucit toujours
les défauts, s’il cache quelquefois le vice,
8c que s’il a rendu nos vertus moins éclatantes,
Hifloire. Tome IL Première part.
CHE 113
la franchife de nos pères, qu’il a remplacée, ren-
doit aufli leurs vices plus dangereux.
On ne peut fixer précifément l’origine de la
chevalerie. Si on la confidère comme une cérémonie
ou une fimple inftitution militaire, on peut
la faire remonter au temps de Charlemagne, &
même beaucoup plus haut. Ce prince donna fo-
lemnellement l’épée & tout l’équipage d’un guerrier
à fon fils Louis. On trouve quelques exemples
de 'cette cérémonie fous la première race de nos
rois, & Tacite, parlant des moeurs des Germains,
nous apprend qu’un femblable ufage y étoit étab
li Mais fi on regarde la chevalerie comme une
dignité qui donnoit le commandement dans les
armées, un rang & des prérogatives dans le corps
de la nation, on n’en trouvera guère de traces
avant la fin du dixième fiècle, 8c quelques auteurs
difent avant l’onzième , temps auquel la monarchie
françoife commença à fortir du chaos où l’ambition
& les guerres l’avoient plongée. Ce fut alors
que l’efprit de la nation fe développa tout-à-fait,
& que, confervant le caraCtère qu’elle tenoit de
fes pères, elle montra ce qu’elle étoit & ce quelle
pouvoit devenir.
C ’eft dans ce caraCtère même qu’il faut chercher
l’origine de la chevalerie. Un peuple belliqueux
aime tout ce qui a rapport à la guerre , & cette
paflion s’annonce dans fes cérémonies & jufques
dans fes jeux. Quand Tacite dit que le père &
le plus prêche parent d’un jeune homme le pare
du bouclier & lui préfente un javelot dans une
affemblée nationale, Tacite nous repréfente la
réception d’un chevalier. Le temps & les circonf*
tances perfectionnèrent cette inftitution , comme
ils la firent enfuite tomber dans l’aviliftement. Si
la politique des fouverains 8c des barons en profita
, il ne fâut pas dire qu’ils en furent les inftitu-
teurs : fi elle a quelque rapport avec les cérémonies
que l’églife obferve dans l’adminiftration
des facremens, il faut dire que les ufages ont la
même origine, mais non pas que l’un découle de
l’autre.
Voyons quelles étoient les cérémonies inftituées
pour la création d’un .chevaliér.
Celui que fa naiffance appelloit à cette dignité ,
paffoit les fept premières années de fa vie enfre
les mains des femmes, d’où on le retiroit pour le
mettre au fervice de page jufqu’à quatorze ans.
Depuis cet âge jufqu’à celui de vingt ans, il fai-
*foit les fonctions d’écuyer , en forte qu’il ne
pouvoir être chevalier qu’à vingt-un ans accomplis.
Arrivé à cet âge, il fe préparoit à être reçu,
par des jeûnes, des veilles, des prières : il pre-
noit des bains, étoit vêtu de blanc, à l’imitation
des Néophi tes , & recevoit les facremens de la
pénitence & de l’euchariftie. Après s’être acquitté
de tous ces devoirs, ii alloit à l’églife , accompagné
d’un parrain ; il préfentoit fon épée au prêtre
célébrant, qui la béniffoit, 8c la mettoit enfuite
au cou du novice : celui-ci alloit fe mettre à ge-
P