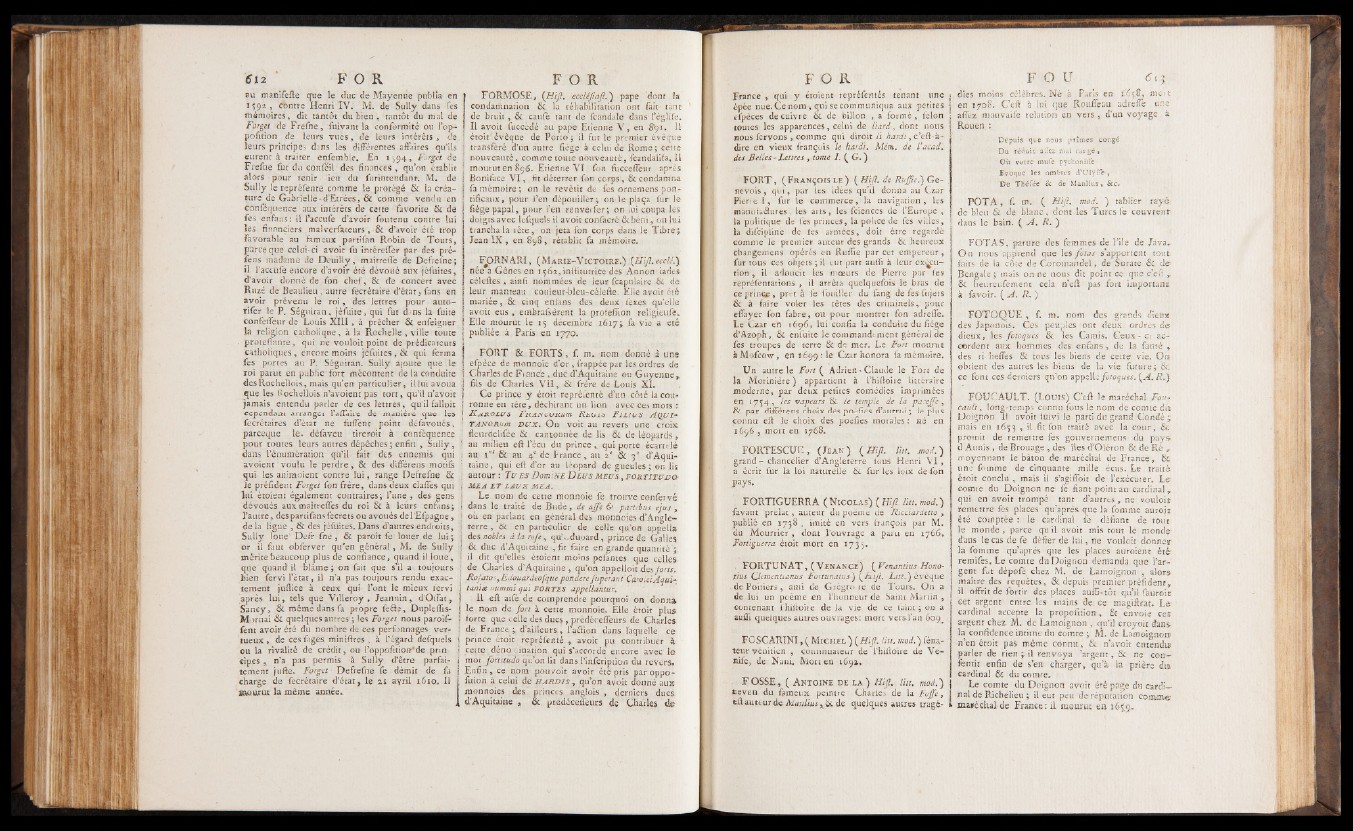
512 F O R
au manifefte que le duc de Mayenne publia en
1592 , contre Henri IV. M. de Sully dans Tes
mémoires, dit tantôt du bien. tantôt du mal de
Forget de Frefne, fuivant la conformité ou l’op- |
pofition de leurs vues, de leurs intérêts, de,1
leurs principe; d.ins les différentes affaires qu’ils ]
eurent à traiter enfemble. En 1394, Forget de 1
Frefne fut du conféil des finances , qu’on établit
alors pour tenir ieu du furintendanr-. M. de
Sully le repréfente comme le protégé & la créature
de Gabriellè-d’Etrées, & comme vendu en
conféquence aux intérêts de cette favorite & de
fes enfans: il i'accufe d’avoir fouténu contre lui
les financiers malverfateurs, & d’avoir été trop
Favorable au fameux partifan Robin de Tours,
parce que celui-ci avoit fu întéreffer par des pré-
îens madame de Deuilly, maîtreffe de Defrefne;
il I’accufe encore d’avoir été dévoué aux jéfuites,
d’avoir donné de fon chef, 8c de concert avec
Ruzé de Beaulieu . autre fecrétaire d’état, fans en
avoir prévenu le roi, des lettres pour ■ auto-
rifer le P. Séguiran, je fuite, qui fut dans la fuite
confèffeur de Louis XIII, à prêcher 8c enfeigner
la religion catholique, à la Rochelle , ville toute
proteftante, qui ne vouloit point de prédicateurs
catholiques , encore moins jéfuites, 8c qui ferma
fes portes au P. Séguiran. Sully ajoute que le
roi parut en public fort mécontent de la conduite
desRochellois, mais, qu’en particulier, il lui avoua
que les Rochellois n’avoient pas tort, qu’il n’avoit
jamais entendu parler de ces lettres, qu’il falloit
cependant arranger l’affaire de manière que les
fecrétaires d’état ne fuffent point défavoués,
parceque le- défaveu tireroit à conféquence
pour toutes leurs autres dépêches ; enfin , Sully, |
dans l’énumération qii’il fait des ennemis qui
avoient voulu le perdre, & des d'ifférens motifs
qui les animoient contre lui, range Defrefne &
le préfident Forget fon frère, dans deux claffes qui j
lui étoient également contraires; l’une , des gens I
dévoués aux maîtreffes du roi & à leurs enfans; j
l’autre, despartifansfecrets ou avoués del’Efpagne,
delà ligue , & des je fuites. Dans d’autres endroits,
Sully loue'Defr fne, 8c paroît fe louer de lui ;
or il faut obferver qu’en général, M. de Sully
mérite beaucoup plus de confiance, quand il loue,
que quand il blâme ; on fait que s’il a toujours
bien fervi l’ètat, il n’a pas toujours rendu exactement
juftice à ceux qui l’ont le mieux tervi J
après, lui, tels que Villeroy, Jeannin, d’Qffat, J
Sancy, & même dans fa propre feâé, Dupleflis- J
M >rnai 8c quelques autres1 ; les Forget nous paroifi- j
fent avoir été du nombre de ces perfonnages ver- !
îueux, de ces fages miniftres . à l’égard defquels. i
ou la rivalité de crédit, ou roppofitionr*de pria |
cipes y n’a pas permis à Sully d’être parfais j
tentent jufte. Forget Defrefne fe démit de fa j
charge de fecrétaire d’état* le ai avril 1610. Il
x&ourut la même année,.
F O R
FORMOSE, {Hiß. eccleßaß. ) pape dont la
condamnation 8c la réhabilitation ont fait tant
de bruit, & caufé tant de fcandale dans Féglîfe.
Il avoir fuccédè au pape Etienne V , en 891. 11
| étoit'ëvêqne de Porto; il fut le premier évêque
j transféré d’un autre fiége à celui de Rome; cette
j nouveauté, comme toute nouveauté, fcandalifa, Il
mourut en 896. Etienne V I . fon fuccefîeur . après
Boniface V I , . fit déterrer fon corps, 8c condamna
fa mémoire; on le revêtit de fes ornemens pontificaux,
pour l’en dépouiller; on le plaça fur le
fiége papal, pour l’en renvetfer; on lui coupa les
doigts avec lefquels il avoir confaeré 8c béni , on }ui
trancha la tête, on jeta fon corps dans le Tibre ;
, Jean I X , en 898, rétablit fa mémoire.
| F pRN ARÏ, ( Màrie-V ictoire.) {Hiß. ecclé.)
née à Gênes en 1562, inftitutrice des Ann on cia des
célefies, ainfi nommées de leur (capillaire 8c de
leur manteau couleur-bleu-célefte. Elle avoit été
mariée, 8c cinq enfans des deux fexes, qu’elle
avoit eus , embrafsèrent la profefîion religieufe..
Elle mourut le 15 décembre 16 17; fa vie -a été
publiée à Paris en 1770.
FORT 8c FO R T S , fi m. nom donné à une
efpèce de monnoie d’or , frappée par les ordres de
Charles de France , duc d’Aquitaine ou Guyenne r
fils de Charles V I I , 8c frère de Louis XI.
Ce prince y étoit représenté d’un, côté la couronne
en tête, déchirant un lion , avec ces mots :
K a r o lu s Fr a n c ORum R é g is Fil iu s A qul-
TAN'ORutn d u x . On voit au revers une croix
fleurdelifée 8c cantonnée de lis 8c de léopards,
au milieu eft l’écu du prince , qui porte écartelé
au i er 8c au 4e de France , au ae 8c 3e d’Aquitaine,
qui eft d’or au léopard de gueules ; on lis
autour : Tu e s D omine D e u s m e u s , f o r t ie u do
ME A ET LAUX ME A.
Le nom de cette monnoie fe trouve confervé
dans le traité de Bridé , de affe & partibus ejus ,
où en parlant en général des monnoies d’Angleterre
, 8c en particulier de celle qu’on appella
tes nobles àlarofe, qu’ .-duoàrd, prince de Galles
8c duc d’Aquitaine , fit faire en grande quantité
il dit qu’elles étoient moins pefantes que celles
de Charles. d’Aquitaine, qu’on appelloit des forts.
Rofatos, Edouardeofcjue pondéré fuperant laroïeiAqui-
tanuz nummi qui FORTES appellantur.
Il eft aifé de comprendre pourquoi on donna
le nom de fort à cette monnoie. Elle étoit plus
forte que celle des ducs , prédéceffeurs de Charles
de France;, d’ailleurs., l’aâion dans laquelle ce
prince étoit repréfènté ,. avoit pu contribuer à
cette déno r.ination qui s’accorde encore avec le
mot fortïtudo qu’on lit dans l’infcription du revers.
Enfin , ce nom pouvoit avoir été pris par oppo-
fition à celui de h a r d i s , qu’on avoit donné aux
monnoies des princes anglois , derniers ducs.
d’Aquitaine , & prédéceffeurs de Charles de
F O R
France , qui y étoient repréfentés tenant une
épée nue. Ce nom -, qui se communiqua aux petites
efpèces de cuivre 8c de billon , a formé, félon
toutes les apparences, celui de liard, dont nous
nous fervons , comme qui diroit li hardi, c’eft-à-
dire en vieux françois le hardi. Mém. de Tacad.
des Belles-Lettres, tome I. ( G. )
F O R T , ( F rançois l e ) ( Hiß. de Ruße.) Genevois
, qui, par les idées qu’il donna au Czar
Pierre i , fur le commerce, la navigation , les
manufaéfures. les arts, les fciences de l’Europe ,
la politique de fes princes, la police de fes villes,
la difcipline de les armées, doit être regardé
comme le premier auteur des grands 8c heureux
changeai eus opérés en Ruftie par cet empereur,
fur tous ces objets ; il eut part aulîi à leur exécution
, il adoucit les moeurs de Pierre par fes
repréfentations , il arrêta quelquefois le bras de
ce prince, prêt à fe fouiller du fang de fes ftijets
8c .à faire voler les têtes des criminels, pour
effayer fon fabre, ou pour montrer fon adreftè.
Le Czar en 1696, lui confia la conduite du fiége
d’Azoph, 8c enfuite le commandement général de
fes troupes de terre 8c de mer. Le Fort mourut
à Mofcow, en 1699 : le Czar honora fa mémoire.
Un autre le Fort ( Adrien - Claude le Fort de
la Morinière ) appartient à l’hiftoire littéraire
moderne, par deux petites comédies imprimées
en 1734 , les vapeurs 8c le temple de la pareße,
8c par différens choix des poéfies d’autrui ; le plus
connu eft le choix des poéfies morales : né en
1696 , mort en 1768.
FORTESCUE, (Je a n ) {H iß . litt, mod.)
grand - chancelier d’Angleterre lous Henri V I ,
a écrit fur la loi naturelle 8c fur les loix de Fon
pays.
. FORTIGUERRA ( Nicolas) ( Hiß. litt. mod. )
favant prélat, auteur du poème de Ricciardetto ,
publié en 1738 , imité en vers françois par M.
du Mourrier , dont l’ouvrage a paru en 1766.
Fortiguerra étoit mort en 1735.
• FO R TU N A T , ( V enance) {Venantius Hono-
rius Qlcmentianus Fortunatus) {Hiß. Lut.) évêque
de Poitiers, ami de Grégro re de Tours. On a
de lui un pcéme en l’honneur de Saint Martin ,
contenant fhifiohe de la vie de ce faint; on a
aufti quelques autres ouvrages: mort vers l’an 609^
FGSCARINI, ( Mich e l ) {Hiß. litt, mod.) féDateur
vénitien , continuateur de l’hiftoire de Ve-
nife, de Nani. Mort en 1692.
FO S S E , ( A ntoine d e l à ) Hiß. litt, mod.)
neveu du fameux peintre Charles de la Fuße,
eft auteur de Manlius v8c de quelques autres trage*
F O U 6 1-3
dies moins célèbres. Né à Paris en F65.8, meut
en 1708. C ’eft à lui que Rouffeau adreffe une
affez mauvaife relation en v e r s , d’un voyage à
Rouen :
Depuis que nous prîmes congé
Du réduic affez mal r a n g é ,
Où votre mufe pythonifie
Evoqué les ombrés d’Ulyfie-,-
De Tbéfée & de Manlius, & c.
PO T A , fi m. ( Hift. mod. ) tablier rayé
de bleu 8c de blanc, dont les Turcs fe couvrent
dans le bain. ( A . R. )
F O T A S , parure des femmes de Pile de Java.
On nous apprend que les fotas s’apportent tout
faits de la côte de Coromandel, de Surate & de
Bengale ; mais on ne nous dit point ce que c’eft »
8c heureufement cela n-’eft pas fort important
à favoir. ( A . R. )
FO TO Q UE , fi m. nom des grands dieux
des Japonois. Ces peuples ont deux ordres de
dieux, les fotùques 8c les Garnis. C e u x -c i accordent
aux hommes des enfans , de la fanté ,
des ri-heffes 8c tous1 les biens de cette vie. On
obtient des autrés les biens de la vie future; 8c
ce font ces derniers qu’on appelle fotoques. {A. R.)
FOUCAULT. (LOUIS) C ’eft le maréchal Foucault
, long-temps connu fous lé nom de comte dû
Doignon II avoit fuivi le parti du grand Condé ;
mais en 1653 , il fit fon traité avec la cour, 8c
promit de remettre fes gôuvernemens du pays
d Aunis , de Brouage , des îles d’Oléron 8c de Ré ,,
moyennant le bâton de maréchal de France, 8c
une femme de cinquante mille écus. Le traité
étoit conclu , mais il s’agifloit de l’exécuter. Le
comie du Doignon ne fe fiant point au cardinal,
qui en avoit trompé tant d’autres n-e vouloit
remettre fes places qu’après que la fournie aurois
été comptée : le cardinal fe défiant de tout
le monde , parce qu il avoit mis tout le monde
dans le cas de fe défier de lu i, ne vouloit donneir
la fomme qu’après que les places auroient été
remifes. Le comte du Doignon demanda, que l’argent
fut dépofé^ chez M. de Lamoignon , alors
maître des requêtes, 8c depuis premier préfident,
il offrit de fbrtir des places auftj-tôt qu’il fauroie
cet argent entre les mains de ce magiftrat. Le
cardinal accepte la propofition, 8c envoie cet
argent chez M. de Lamoignon , qu’il croyoit dans
la confidence intime du comte ; M. de Lamoignon
n’en étoit pas même connu., 8c n’avoit entendu
parler de rien ; il renvoya ’argent, 8c ne con-
fentit enfin de s’en charger, qu’a la prière dis
cardinal 8c du comte.
Le comte du Doignon avoit été page du cardi—
liai de Richelieu ; il eut peu de réputation comme
»• maréchal.de France: il mourut en. 165,9.