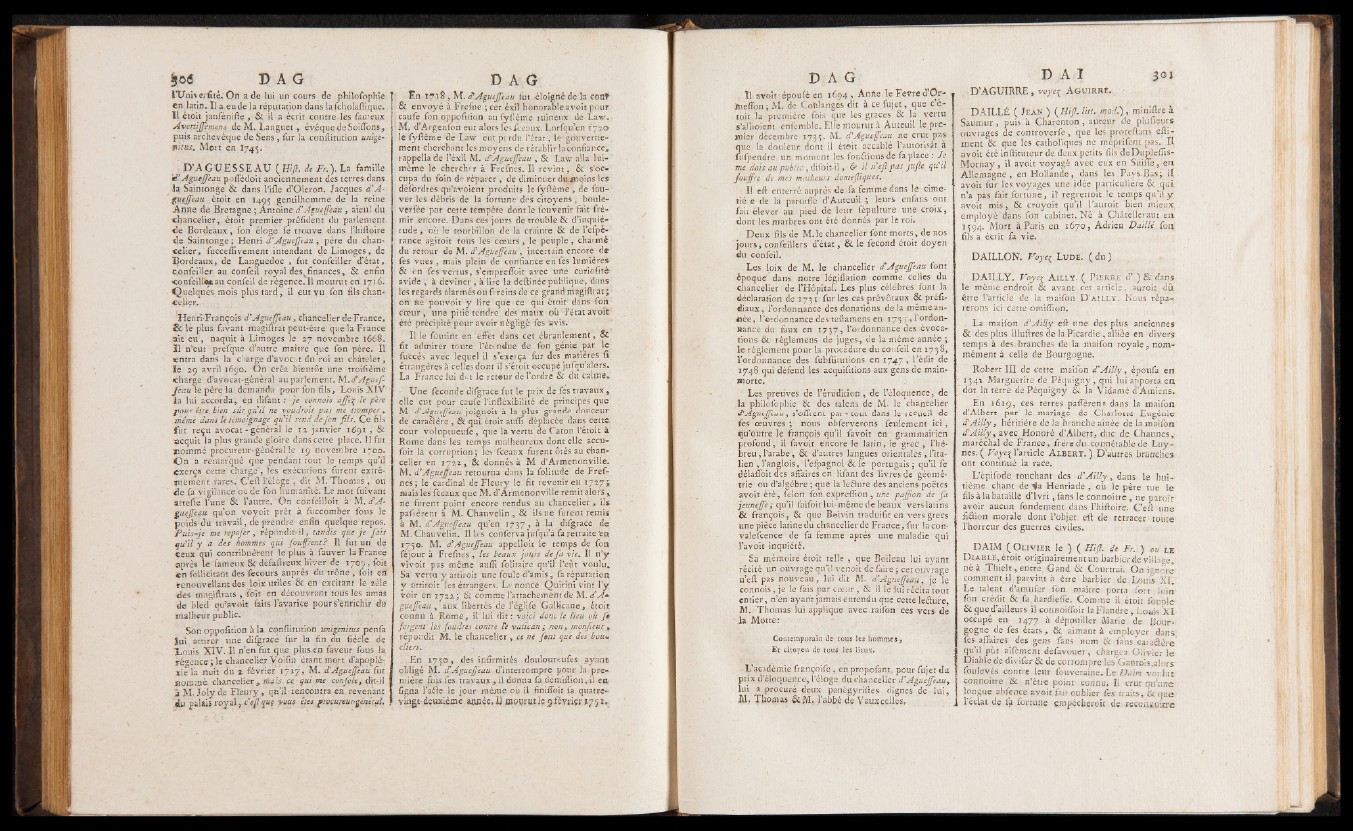
D A G
l ’Unrve/fitê. On a de lui un cours de philofophîô
en latin. Il a eu de la réputation dans lafcholaftique.
Il étoit janfénifte , & . i l a écrit contre les fanreux
Avertijfemens .de M.Xanguet , évêque de Soiffons ,
puis archevêque de Sens , fur la conftitution unige-
ji'uus. Mort en 1745<
D ’A G U E S S E A U ( Hif. de Fr.). La famille
«£’ Aguejfeau poffédoit anciennement des terres dans
■ la Saintonge & dans Pille d’Oleron. Jacques d’A-
guejfeau étoit en 1405 gentilhomme de la reine
Anne de Bretagne ; Antoine d’Aguejfeau, aïeul du
chancelier, étoit premier préfident du parlement
de Bordeaux, fon éloge fe trouve dans l’hiftoire
de Saintonge ; Henri d’Aguejfeau -, père du chancelier,
fucceffivement intendant de Limoges, de
Bordeaux, de Languedoc , fut confeiller d’état,
c.onfeiller au confeil royal des finances, & enfin
confeill«*au confeil de régence. Il mourut en 1716.
Quelques mois plus tard, il eut vu fon fils chancelier
»
Henri-François d’Aguejfeau, chancelier de France,
& le plus favant magiftrat peut-être que la France
ait e u , naquit à Limoges le 2,7 novembre 1668.
I l n’eut prefque d’autre maître que fon père. Il
entra dans la charge d’avocat du- roi au châtelet,
le 29 avril lôç'o. On créa bientôt une troifième
charge d?a y ©cari général au parlement. M. £ Agitef
feau le père la demanda pour fon fils, Louis XIV
la lui accorda, en difant : je cannois ajft^le pere
jpour être bien sûr q f il ne voudroit pas me tremper,
même dans le témoignage qu'il rend de jo i i f ls . Ce fils
fut reçu avocat - général le 12 janvier 1691 ,c &
acquit la plus grande gloire dans cette place. 11 fut
nommé procureur-général le 19 novembre 1700.
«On a remarqué que pendant tout le temps qu’il
exerça cette charge'1, les exécutions furent extrêmement
rares. C’eft l’éloge , dit M. Thomas, ou
de fa'vigilance où de fon humanité. Le mot fuivant
attelle l’une & l’autre. On confeilloit, à‘ M. d'A-
guejfequ qu’on voyoit prêt à fuccomber fous le
poids du travail, de prendre enfin quelque repos.
Puis-je me repofer, répondit-il, tandis que je fais
qu'il y a des ^hommes qui fouffrent? Il fut un dé
ceux qui contribuèrent le plus à fauver la France
après le fameux & dèfaftreux hiver de 1709 , foit
en follicitant des fecours auprès du trpne, foit e t
renouvellant des loix utiles & en excitant le zèle
des magiftrats , Toit en découvrant tous les amas
de bled qu’avoit faits l’avarice pour s’enrichir du
malheur public*
Son oppofition à la conftitution Unigenitus penfa
lui. attirer une difgraçé fur la fin du fiècle de
Xouis XIV. Il n’en fut que plus en faveur fous la.
régence;le chancelierVoifin étant mort d’apoplé-
xie la nuit du a février 17 17 , M. dé Aguejfeau fut
nommé chancelier „ mais| ce. qui me confole, dit-il
à M. Joly d.e F leury, qu’il-rencontra en revenant
«Lu palais royal c e f que vous êtes procureur-général.
D A G
Ên 17 18, M. d*Aguejfeau fut 'éloigné de la côtîf
& envoyé à Frefne ; cet éxil honorable avoit pour
caufe fon oppofition au fyfiême ruineux de Law.
M. d’Argenfon eut alors lesiceaux. Lorfqu’en 1720
le fyftême de Law eut perdu l’état, le :gouverne- .
ment cherchant les moyens de rétablir la confiance,
rappellade l’éxil M. d’Aguejfeau , & Law alla lui-
même le chercher à Frefnes. Il revint, & s’occupa
du foin de réparer , de diminuer du jaioins les
défordres qn’avoient produits le fyfiême , de fauver
les débris de la fortune des citoyens, boule-
verfée par cette tempête dont le fouvenfr fait frémir,
encore. Dans cés jours de trouble & d’înquié-
rude, où lé tourbillon de la crainte & de l’efpê-
rance agitoît tous les coeurs, le peuple , charmé
du retour de M. £Aguejfeau , incertain encore de-
fes vues , mais plein de confiance en fes lumières
& en fes-vertus, s’empreffoit avec une curiofité
avide , à deviner ; a lire la deftinée publique, dans
les regards alarmés ou fereins de ce grand magiftrat 5
on ne pouvoir y lire que ce qui étoiri dans fon
coeur une pitié tendre dés maux où l’état avoit:
été précipité pour avoir négligé les avis.
Il le foutirit en effet dans cet ébranlement, &
fit admirer toute l’étendue de fon génie par le^
fucçès avec lequel il s'exerça fur des matières fi
étrangères à celles dont il s’étoit occupé jufqu’alors*
La France lui dût le retour de l’ordre & du calme*
Une féconde difgrace fut le prix de fes travaux *
elle eut pour caufe l’inflexibilité de principes que
M. d'Aguejfeau joigiioit à la plus grande douceur
de cara&êre , & quï étoit auflj déplacée, dans cette
Cour voluptueufe, que la vertu de Caton l’étoit à
Rome dans les temps malheureux dont elle accu-
foit la corruption; les'fceaux furent ôtés au chancelier
én 1722, & donnés à M d’Armenonville*
M. d’Aguejfeau retourna dans la folitude de Frefnes;
le cardinal de Fleury le fit revenir en 1727
mais les fceaux que M. d’Armenonville remit alors,.
ne furent point encore rendus au chancelier, ils.
passèrent à M. Chauvelin , & ils ne furent remis
à M. d'Aguejfeau qu’en 17 3 7, à la difgrace de
M. Chauvelin. Il les cpnferva jufqu’à fa retraite'en
1750. M. dyAguejfeau appeljoit le temps de fon
féjour à Frefnes , les beaux joufrs de fa vie. Il n’y
vivoit pas même aufli folitaire qu’il l’eût voulu*
Sa vertu y attiroit une foule d’amis, fa réputation
y attiroit les étrangers. Le nonce Quirini vint l:’y
Voir en 172.2 ; & comme l’attachement de M. d'A*-
guejfeau , aux libertés de l’églifè Gallicane, étoit
connu à Rome, il lui dît: voici donc le lieu oit fe
forgent les foudres Contre të Vatican ; non, motif eut; *
répondit M. le chancelier, ce né font que des bon-
(Hiers.
En 1750 , des infirmités douloureufes ayants
obligé M. (FAgueJJ'eau d’interrompre pour la première
fois fes travaux , il donna fa démiflion.,41 en-
figna l’aéîe le jour même où il finifibit fa quatre-
vingt- deuxième aanée, Il meyrut le 9 février *7 5.1^
D A G
Il avoit époufè en 1694, Anne le Fevte d’Or-
ïneffon; M. de Coblanges dit à ce fujet, que c’é-
toit la première fois que les grâces & la vertu
s’allioiem enfemble. Elle mourut k Auteuil le,premier
décembre 1735. M. d'Aguejfeau ne crut pas-
que la douleur dont il étoit accablé l’autorisar à
iufpendre un moment les fondions de fa place : Je
me dois au public , difoit-il , & il n e f pas ju fe qu'il
foujfre de mes malheurs domefiques.
; Il eft enterré auprès de-fa femme dans le cime-
tiè e de la paroiffe d’Auteuil ; leurs enfans ont
fait élever au pied de leur fepulture une croix,
dont les marbres ont été donnés par le roi.
Deux fils de M.le chancelier font morts, de nos
jours, confeillers d’état, & le fécond étoit doyen
du confeil.
Les loix de M. le chancelier £ Aguejfeau font
époque^ dans notre légiflàtion comme celles du
chancelier de l’Hôpital. Les plus célèbres font la
déclaration de 1731 fur les cas prévôtaux & préfi-
diaux, l’ordonnance des donations delà même an-
«aée, l ’ordonnance des tefiamens en 173 3 ,1 ordonnance
du faux en 1737, l’ordonnance des évocations
& réglemens de juges, de la même année ;
le réglement pour la procédure du confeil en 1738,
l’ordonnance des fubfiitufions en 1747 , l’édit de
1748 qui défend les acquifitions aux gens de mainmorte.:
Lès preuves de l’érudition , de l’éloquence, de
la philofophie & des talens de M. le chancelier
£ Aguejfeau, s’offrent par-tout dans le recueil de
fes oeuvres; nous obferverons feulement ic i,
qu’outre le françois qu’il favoit en grammairien
profond, il favoit encore le latin, le grec , l’hébreu
, l’arabe ; & d’autres langues orientales , l’italien
, l’anglois, l’efpagnol & le portugais ; qu’il fe
délàffoitdes affaires en lifant des livres de géométrie
ou d’algèbre ; que la leélure des anciens poètes
avoit été, félon fon.expreffion, une pajfon de fa
jeunejfe ; qu’il faifoit lui-même de beaux vers latins
& françois , & que Beivin traduifit en. vers grecs
unepièce latinedu chancelier de France, fur lacon-
valefcence de fa femme après une maladie qui
l’avoit inquiété.
Sa mémoire étoit telle , que Boileau lui ayant
récité un ouvrage qu’iUvenoit de faire ; cet ouvrage
n’eft pas nouveau, liii dit M. d’AgueJfe-au j je le
connois, je le fais par coeur , & il le lui récita tout
entier, n’en ayant jamais entendu que cettelechire,
M. Thomas lui applique avec raifon ces vers de
la Motte:
Contemporain de tous les hommes,
Et citoyen de tous.les lieux,
L’académie françoife , en propofant, pour fujet du
prix d’éloquence, l’éloge du chancelier d’Aguejfeau,
lui a procuré deux panégyrifies dignes de lui,
M. Thomas &JVL l’abbé de Vaux celles.
D A I
D’AGUIRRE , voye^ A g u ir r e .
DAILLÉ ( Je an ) (Hi/Z. litt. tnodf) , miniftre à
Saumur, puis à Charenton, auteur de plùfîçurs
ouvrages de,controverfe, que les proteftans èfH-
ment & que'lés catholiques ne méprifent pas. Il
avoit été inffituteur de deux petits fils deDuplefiis-
Mornay, il avoit voyagé avec eux en Suiffe, en
Allemagne, en Hollande, dans les Pays-Bas; il
avoit fur les voyages une, idée particulière & qui
n’a pas fait fortune, iï regrettoit le temps qu’il y
avoit mis, & croyoit qu’il l ’auroit bien mieux
employé dans fon cabinet. N é ’ à Qiâtelleraut en
1594. Mort à Paris en 1670, Adrien D aillé fon
fils a écrit fa vie.
DAILLON. Voye{ L u d e . ( du )
DAILLY. Voyei A ïl l y . ( Pier r e d’ ) & dans
le même endroit & avant cet article, auroit, dû.
être l’article de la maifon D ’a i l l y . Nous répa-,
rerons ici cette omiflion.
. La maifon d'Ailly efl une des plus anciennes
& des plus illuftres de la Picardie , alliée en divers
temps à des .branches de la maifon royale, nommément
à celle de Bourgogne.
Robert III de cette maifon £ A illy , époufa en
r 1342 Marguerite de Péquigny, qui lui apporta en
dot la terre de Péquigny & la Vidamé d’Amiens.
En 1619, ces terres paffèrent dans la maifon
d’Albert par le mariage de Charlotte Eugénie
d'Ailly, héritière de la branche aînée de la maifon
d'Ailly, avec Honoré d’Albert, duc de Chaunes,
maréchal de France, frère du-connétable de Luy-
nes. ( Voye[ l’article A l b e r t . ) D ’autres branches
ont continué la raée.
L’épifode touchant des d’Ailly 9 dans le huitième
chant de ^a Henriade , où le père tue le
fils à la bataille d’i v r i , fans le connoître , ne paroîc
avoir aucun fondement dans l’hifloire. C ’eft une
fi&ion morale dont l’objet eft de retracer toute
l’horreur des guerres çiviles.
DAIM ( O l iv ie r le ) ( Hifi. de Fr. } ou le
D ia b l e , étoit originairement un barbier de village •
né à T hielt, entre, Gand & Courtrai. On ignore
comment il parvint à être barbier de Louis XI.
Le talent d’amufer fon maître' porta fort loin
fon crédit & fa hardiefie. Comme il étoit fouple
& que d’ailleurs il connoiffoir la Flandre, Lo«is XI
occupé en 1477 à dépouiller Marie de Bour-
. gogne de fes états, & aimanta employer dans
fes affaires des gens fans nom & fans caraftère
qu’il put aifément défavouer, chargea Olivier le
Diable de divifer & de corrompre les Gantois,alors
1 foulevés contre leur foiiveraine. Le Daim voulut connoître & n’être point connu. Il crut qu’une
longue abfence avoit fait oublier fes traits, & q u e
l ’éelat de .f? fortune ^mpêcheroit de recoùspiWe