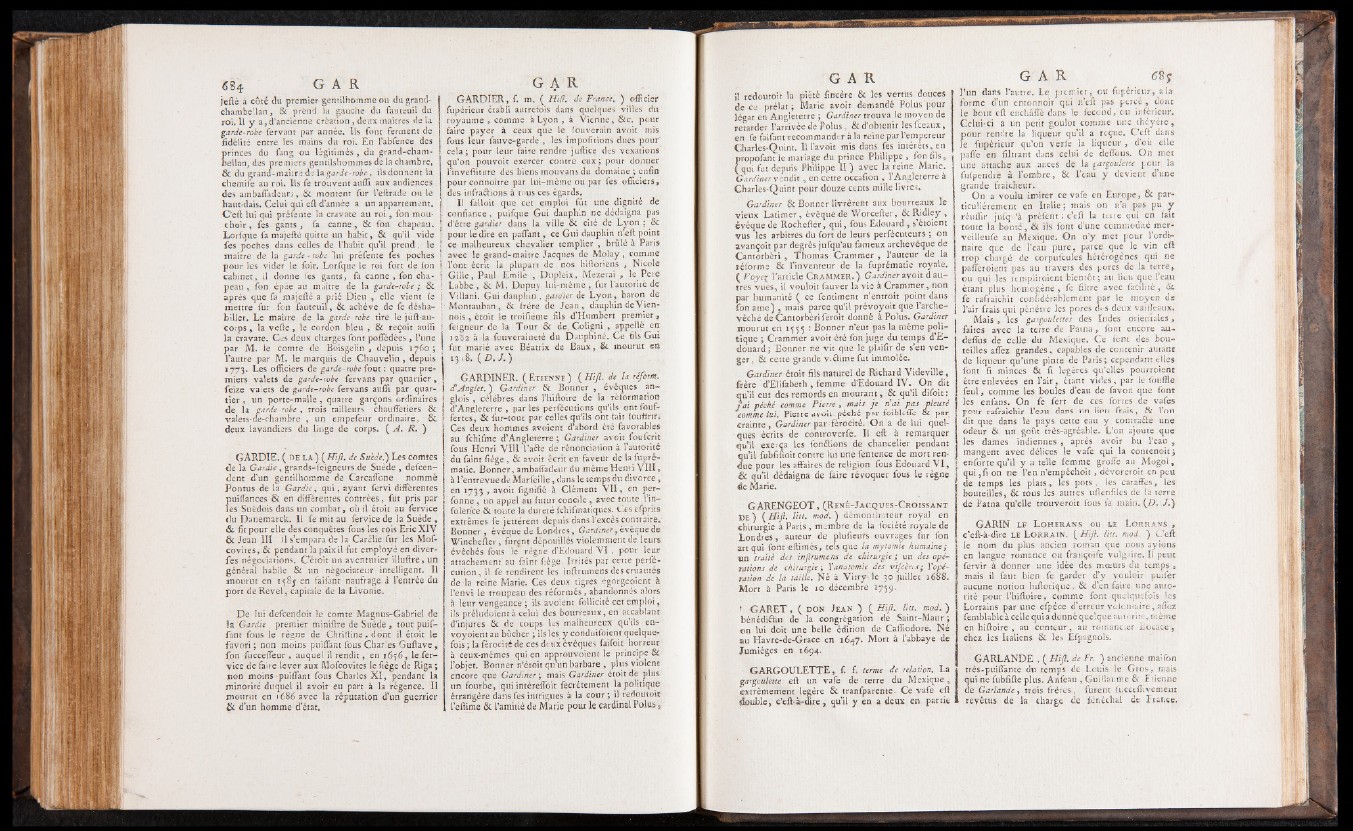
6 8 4 G A R
jefté.à côté du premier gentilhomme ou du grand-
chambellan , & prend la gauche du fauteuil du
roi. Il y a, d’ancienne création , deux maîtres de la
garde-robe fervant par année. Ils font ferment de
fidélité entre les mains du roi. En l’abfence des
princes du fan g ou légitimés , du grand-chambellan,
des premiers gentilshommes dé la chambre,
& du grand-maître de la garde-robe , ils donnent la
chenille au roi. Ils fe trouvent auffi aux audiences
des ambaffadeurs, & montent fur l’eftràde ou le
haut-dais. Celui qui eft d’année a un appartement.
C ’efi lui qui prèfente la cravate au r o i, fon mouchoir
, fes gants, fa canne, 8c fon chapeau.
Lorfque fa majefté quitte un habit, 8c qu’il vide !
fes poches dans celles de l'habit qu’il prend , le !
maître de la garde - robe lui préfente fes poches \
pour les vider le foir. Lorfque le roi fort de fon i
cabinet, il donne les gants, fa canne , fon cha- j
peau , fon épée au maître de la garde-robe ; 8c {
après que fa majefté a prié Dieu , elle vient fe 1
mettre fur fon fauteuil, 8c achève de fe désha- f
biller. Le maître de la garde robe tire le jùft-au- \
corps, la vefte, le cordon bleu , 8c reçoit aufîl 5
la cravate. Ces deux charges font poffédées , l’une j
par M. le comte de Boisgelin , depuis 1760; j
l’autre par M. le marquis de Chauvelin , depuis j
1773. Les officiers de garde-robe fout : quatre prè- I
miers valets de garde-robe fervans par quartier, j
feize valets de garde-robe fervans auffi par quar- j
tier , un porte-malle , quatre garçons ordinaires |
de la garde robe , trois tailleurs chauffetiers 8c j
valets-de-chambre , un empefeur ordinaire, 8c I
deux lavandiers du linge de corps. ( A . R. )
GARDIE. ( d e l a ) {FUJI. de Suède.) Les comtes
de la Gardie, grands-feigneurs de Suède , defcen-
dent d’un gentilhomme de CarcafTone nommé
Pontus de la Gardie, q u i, ayant fervi différentes
puiffances 8c en différentes contrées, fut pris par
les Suédois dans un combat, où il étoit au fervice
du Danemarck. Il fe mit au fervice de la Suède ,
& fit pour elle des conquêtes fous les rois Eric XIV
8c Jean III il s’empara de la Carélie fur les Mof-
covites, 8c pendant la paix il fut employé en diver-
fes négociations. C’étoit un aventurier illuftre, un
général habile 8c un négociateur intelligent. Il
mourut en i$8j en faifant naufrage à l’entrée du
port de Revel, capitale de la Livonie-.
De lui defcendoit le comte Magnus-Gabriel de
la 'Gardie , premier miniftre de Suède , tout puif-
fant fous le règne de Chriftine, dont il étoit le
favori ; non moins puiffant fous Charles Guftave ,
fon fucçéffeur , auquel il rendit, en 1656, le fervice
de faire lever aux Mofcovites le liège de Riga ;
non moins-puiffant fous Charles X I , pendant la
minorité duquel il avoir eu part à la régence. Il
mourut en j 686 avec la réputation d’un guerrier
8c d’un homme d’état.
G A R
GARDIER, f. m. ( Hi(l. de France. ) officier
fupérieur établi autrefois dans quelques villes du
royaume , comme à Lyon , à Vienne, 8cc. pour
faire payer à ceux que le fouverain avoit mis
fous leur fauve-garde , les impofuions dues pour'
cela ; pour leur faire rendre juftice des vexations
qu’on pouvoit exercer contre eux ; pour donner
l’inveftiture des biens rnouvans du domaine ; enfin
pour connoître par lui-même ou par fes officiers,
des infra&ions à tous ces égards.
Il falloit que cet emploi fût une dignité de
confiance , puifque Gui dauphin ne dédaigna pas
d’être gardier dans la ville 8c cité de Lyon ; 8c
pour le dire en paffant, ce Gui dauphin n’eft point
ce malheureux chevalier templier , brûlé à Paris
avec le grand-maître Jacques de Molay, comme
l’ont écrit la plupart de nos hiftoriens , Nicole
G ille, Paul Emile , Dupleix, Mezerai , le Pere
Labbe , 8c M. Dupuy lui-mêmè , fur l’autorité de
Villani. Gui dauphin , gardier de Lyon, baron de
Monrauban , 8c frère de Jean , dauphin de Viennois
, étoit le troifième fils d’Humbert premier ,
feigneur de la Tour 8c de,Coligni , appellé en
12.02 à la fouveraineté du Dauphiné. Ce fils Gui
fut marié avec Beatrix de Baux, & mourut en
13,8. { D .J . )
GARDINER. (E tienne) ( Hifl. de^ la rèfom.
ePAnglet. ) Gardiner 8c Bonner , évêques an-
glois , célèbres dans l’hiftoire de la réformation
d’Angleterre , par les perfécutions qu’ils ont fouf-
fertes, 8c fur-tout par celles qu’ils ont fait fouffrir.
Ces deux hommes avoient d’abord été favorables
au fchifme d’Angleterre ; Gardiner avoit foufcrit
fous Henri VIII l ’aâe de rénonciation à l’autorité
du faint fiége , 8c avoir écrit en fa vêtir de la fupré-
matie. Bonner, âmbaffadcur du même Henri V I I I9
à l’entrevuede Marfeille, dans le temps du divorce,
en 1733 » avolt fignifié à Clément V I I , en per-
fonne , un appel au futur concile , avec toute l’in-
folènce 8c toute la dureté fchifmatiques. Ces èfprits
extrêmes fe jettèrent depuis dans l’excès contraire.
Bonner , évêque de Londres, Gardiner, évêque de
Winchefter, fùrint dépouillés violemment de leurs
évêchés fous le règne d’Edouard V I , pour leur
attachement au faint fiége. Irrites par cette perfe-
cution, il fe rendirent les inftrtimens des cruautés
de la reine Marie. Ces deux tigres égorgeoient à
l’envi le troupeau des réformés , abandonnés alors
à leur vengeance ; ils avoient follicitécet emploi,
ils préludoient à celui des bourreaux, en accablant
d’injures 8c de coups les malheureux qu’ils en-
voyoientau bûcher ; ils les y conduifoient quelquefois
; la férocité de ces deux évêques faifoit horreur
à ceux-mêmes qui en approuvoient le principe 8c
l’objet. Bonner n’étoit qu’un barbare , plus violent
encore que Gardiner ;. mais Gardiner étoit de plus
un fourbe, qui intéreffoit fecrétement la politique
étrangère dans fés intrigues à la cour ; il redoutoit
l’effime 8c l’amitié de Marie pour le cardinal Polus -
G A R
il redoutoit la piété furcère 8c les vertus douces
de ce prélat; Marie avoit demandé Polus pour
légat en Angleterre ; Gardiner trouva le moyen de
retarder l’arrivée de Polus , 8c d’obtenir lesfceaux,
en fe faifant-recommander à la reine par l’empereur
Charles-Quint. Il l’avoit mis dans fes intérêts, en
propofant le mariage du prince Philippe , fon fils,
( qui fut depuis Philippe II ) avec la reine Marie.
Gardiner vendit, en cette occafion , l’Angleterre à
Charles-Quint pour douze cents mille livres.
Gardiner 8c Bonner livrèrent aux bourreaux le
vieux Latimer , évêque de Worcefter, 8c Ridley ,
évêque de Rochefter, qui, fous Edouard , s’etoient
vus les arbitres du fort de leurs perfécuteurs ; on
avançoit par degrés jufqu’au fameux archevêque de
Cantorbéri , Thomas Crammer , l’auteur de la
réforme 8c l’inventeur de la fuprématie royale.
{Foye^ l’article C rammer.) Gardiner avoit d autres
vues, il vouloit fauver la vie à Crammer, non
par humanité ( ce fentiment n’entroit point dans
fon aine) , mais parce qu’il prévoyoit que l’archevêché
de Cantorbéri feroit donné à Polus. Gardiner
mourut en 1555 : Bonner n’eut pas la même politique
; Crammer avoit été fon juge du temps d’E douard
; Bonner ne vit que le plaifir de s’en venger
, 8c cette grande v*&ime fut immolée.
Gardiner étoit fils naturel de Richard Videville ,
frère d’Elifabeth , femme d’Edouard IV . On dit
qu’il eut des remords en mourant, 8c qu’il difoit :
J ai péché comme Pierre, mais je ri ai pas vleurè
comme lui. Pierre avoit péché par foibleffe oc par
crainte, Gardiner par férocité. On a de lui quelques
écrits de controverfe. Il eft à remarquer
qu’il exerça les fon étions de chancelier pendant
qu’il fubfiftoit contre lui une fentence de mort rendue
pour les affaires de religion fous Edouard V I ,
& qu’il dédaigna de faire révoquer fous le règne
de Marie.
G A R ENG EOT, (René-Jacques-Croissant
De ) {FUJI. mod.) démonilnteur royal en
chirurgie à Paris , membre de la fociété royale de
Londres, auteur de plufieufs ouvrages fur fon
art qui font eftimés, tels que La mytomie humaine;
un traité des injlrumens de chirurgie ; un des opérations
de chirurgie; X anatomie des vif cens; Xopération
de là taille. Né à Vitry le 30 juillet 1688.
Mort à Paris le 10 décembre 1759.
f GARET , ( don Jean ) ( Hijl. litt. mod. )
bénédictin de la congrégation de Sainr-Maur ;
©n lui doit une belle édition de Caffiodore. Né
au Havre-de-Grace en 1647. Mort à Fabbaye de
Jumiéges en 1694.
G ARG OU LE T TE , f. f. terme de relation. La
gargoulette eft un vafe de terre du Mexique,
extrêmement légère 8c tranfparente. Ce vafe eft
Rouble, c’eft-à-dire, qu’il y en a deux en partie
G A R 68?
l’ un dans l’autre. Le pjtmier, eu fupérieur, a la
forme d’un entonnoir qui n’eft pas percé , dont
le bout eft enchâffé dans le fécond, ou inférieur.
Celui-ci a un petit goulot comme une théyère,
pour rendre la liqueur qu’il a reçue. C ’eft dans
le fupérieur qu’on verfe la liqueur, d’où elle
paffe en filtrant dans celui de deffous. On met
une attache aux accès de la gargoulette peur la
fufpendrè à l’ombre, 8c l’eau y devient aune
grande fraîcheur.
On a voulu imiter ce vafe en Europe, 8c particulièrement
en Italie ; mais on n’a pas pu y
réuffir jufqu’à préfent : c’eft la terre qui en fait
toute la bonté, 8c ils font d’une commodité mer-
veilleufe au Mexique. On n’y met pour l’ordinaire
que de l’eau pure, parce que le vin eft
trop chargé de corpufcules hétérogènes qui ne
pafferoient pas au travers des pores de la terre,
ou qui les rempliroient bientôt; au lieu que l’eau
étant plus homogène, fe filtre avec facilité, &.
fe rafraîchit considérablement par le moyen de
l’air frais qui pénètre les pores d^s deux vaiffeaux.
Mais , les gargoulettes des Indes orientales,
faites avec la terre de Patna , font encore au-
deffus de celle du Mexique. Ce font des bouteilles
affez grandes, capables de contenir autant
de liqueur qu’une pinte de Paris; cependant elles
font fi minces 8c fi légères qu’elles pourroient
être enlevées en l’air, étant vides, par le fouffle
feul, comme les boules d’eau de favon que font
les enfans. On fe fert de ces fortes de vafes
pour rafraîchir l’eau dans un lieu frais, 8c l’on
dit que dans le pays cette eau y . contraéle une
odeur & un goût très-agréable. L’on ajoute que
les dames indiennes , après avoir bu l’eau ,
mangent avec délices le vafe qui la contenoit;
en forte qu’il y a telle femme groffe au Mogoi,
qui ,fi on ne l’en n’empêchoit, dévoreroit en peu
de temps les plats, les pots , les caraffes, les
bouteilles, 8c tous les autres uftenfiles de là terre
de Patna qu’elle trouveroit fous la main. (D. /.)
GARIN lf Loherans ou le Lorrans ,
c ’eft-à-dire le Lorrain. {Hijl. litt. mod. ) C ’eft
le nom du plus ancien roman que nous ayions
en langue romance ou françoife vulgaire. Il peut
fervir à donner une. idée des moeurs du temps ,
mais il faut bien fe garder d’y vouloir puifer
aucune notion hiftorique, 8c d’en faire une autorité
pour l’hiftoire, comme font quelquefois les
Lorrains par une efpèce d’erreur volontaire, affez
femblable à celle qui a donné quelque autorité, même
en hiftoire , au conteur, au romancier Boeace,
chez les Italiens 8c les Efpagnols.
GARLANDE , ( Hijl. de Fr. ) ancienne mai fon
très-puiffante du temps de Louis le Gros, mais
qui ne fubfifte plus. Anfeau , Guillaume 8c Etienne
de Garlande, trois frères, lurent (ucceftivement
revêtus de la charge de fénéchal de France.