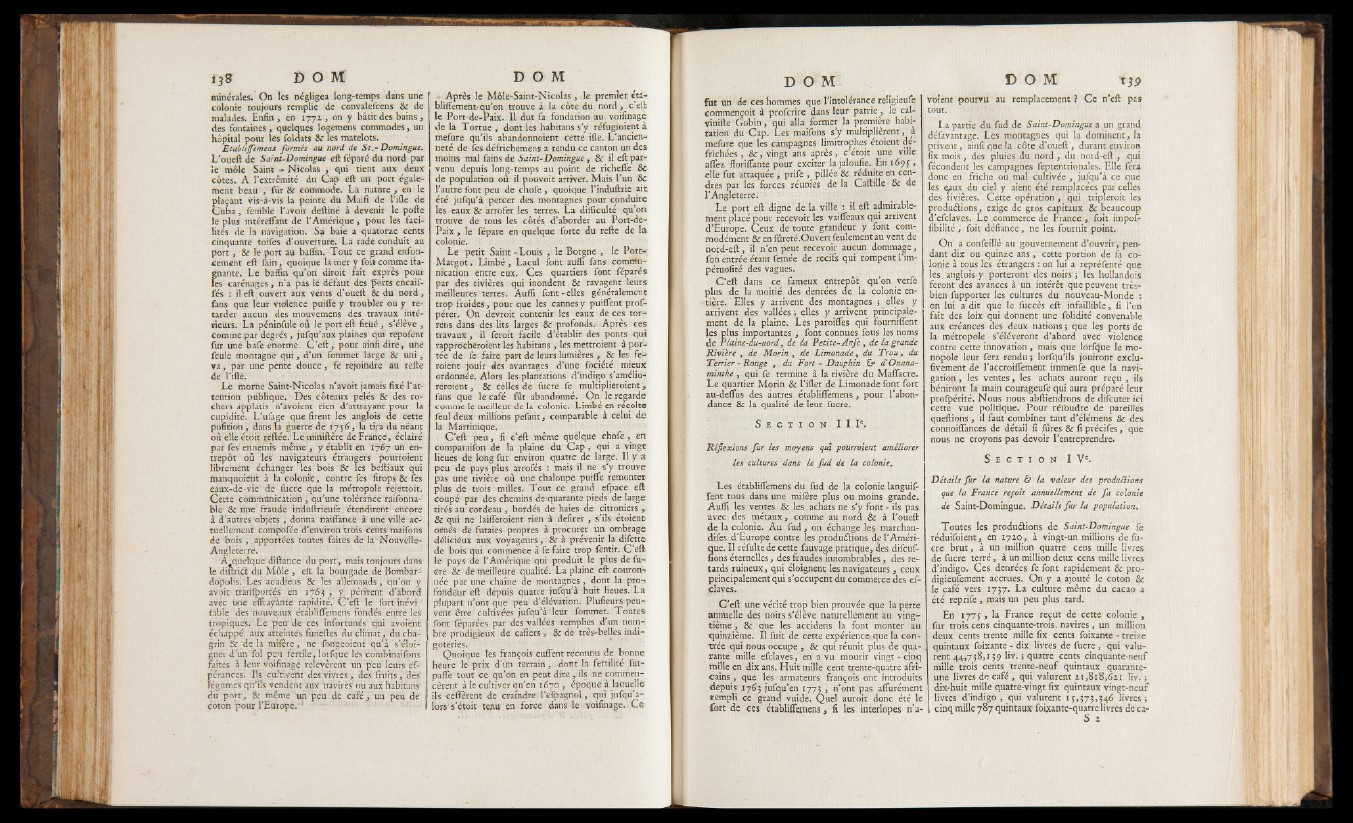
minérales. On les négligea long-temps dans une
colonie toujours remplie de convalefcens 8c de
malades. Enfin, en 1772.3 on y bâtit des bains ,
des fontaines , quelques logemens commodes , un
hôpital pour les foldats 8c les matelots.
Etablijfemens formés au nord de St.- Domingue.
L ’ouefl de Saint-Domingue eft féparé du nord par
le môle Saint » Nicolas > qui tient aux deux
côtes. A l’extrémité du Cap èft un port également
beau "fûr & commode. Là nature , en le
plaçant vis-à-vis là pointe du Maifi de Tille de
C u b a , femble l’avoir deiliné à devenir le polie
le plus intérèlfant de T Amérique, pour les facilités
de la navigation. Sa baie a quatorze cents
cinquante toifes d’ouverture. La rade conduit au
p o r t, 8c le port au baflïn. Tout ce grand enfoncement
eft fain, quôique la mer y fois comme lia-
gnante. Le baffin qu’on diroit fait exprès pour
les carénages, n’â pas lé défaut des ports encaif-
fés : il èft. ouvert aux vents d’oueft 8c du nord,
fans qué leur violence puiffe y troubler ou y retarder
aucun des mouvemens des travaux intérieurs.
La péninfüle où le port eft fitùé, s’élève ,
comme par degrés , jufqu’aux plaines qui repofént
fur une bafe enorme. C ’e ft, pour ainft dire, une
feule montagne q u i, d’un fommet large 8c Uni ,
v a , par une pèntè douce, fe rejoindre âu rélle
de Tiftè.
Le morne Saint-Nicolas n’ avèit jamais fixé l’ attention
pubEque. Des coteaux pelés & des rochers
applatis n’avoient rien d’ attrayant pour la
cupidité. L ’ ufage que firent les anglois de cette
pofition, dans la guerre de 1 7 ^ 3 la tira du néant
où elle étoit reliée. Le mirtiftère de France, éclairé
par fés ennemis mente , y établit en iy^ yu n entrepôt
oü navigateurs étrangers pourfoient
librement échanger les bois 8c les bëftîaux qui
fnanquoietit à la colonie, contre fes fitops & les
êâux-de-vie dé fucre qüê la métropole fejettoit.
Cette communication, qu’une tolérance râifohna-
ble 8c une fraude induftrieufe étendirent encore
à d’autrés'objets , dorina tiâiflànce à une villé actuellement
compofée d’èriviron trois cents maifons
de bois , apportées toutes faites de la Nouvel le-
AngleteiTë.
A^quel'que diftance du port, mais toujours dans
le diltr^ét du Môlè , eit la bourgade.de Bombai
dopolis. Les acadiens & les allemands , qu’on y
avoit trarft’poït'és en 1^63 , ÿ périrent d’à'bord
avec Une effrayante rapidité/ C ’ eft le fort inévi
table des bouveaux établiffemëns fondés entre lés
tropique^.'.Le peil de ces infortunés qui avoient
échappé .aiix atteintes funeftes du climat, du chagrin
& de la mrfère, né fôngeoient qu’ à s’eloi- :
gner d’un fol peu fertile, lorfqUe lés combinaifons
faites à leur voififfagé relevèrent uh pëu leurs ëP
pérânces. Ils cultivent ' des'vivrès > des fruits des'
légumes qu’ ils vendërtt aux navires1 ou aux habifahs
du port, 8c même uji peu de café ^ un peu de
coton pour TEtnope. •• -
• Après le Môle-Saint-Nicolas, le premier éta-
bEffement-qu’on trouve à la côte du nord, c’eft
le Port-de-Paix. Il dut fa fondation au voifinagè
de la Tortue , dont les habitans s’y réfugioient à
mefure qu’ils abandonnoient cette ifle. L ’ ancienneté
de fes défrichemens a rendu ce canton un des
moins mal fains de Saint-Domingue , & il eft parvenu
depuis long-temps au point de richeffe &
de population où il pouvoit arriver. Mais l’un 8c
l’autre font peu de cnofe, quoique Tinduilrie ait
été jufqu’ à percer des montagnes pour conduire
les eaux 8c arrofer les terres. La difficulté qu’on
trouve de tous les côtés d’aborder au Port-de-
P a ix , le fépare en quelque forte du refte de la
colonie. .
Le petit Saint - Louis , le Borgne , le Port-
Margot , Limbé, Lacul font auffi fans comnfu-
| nication entre eux. Ces quartiers font réparés
I par des rivières qui inondent, 8c ravageht leurs
meilleures terres. Auffi font -elles généralement
j trop froides, pour que les cannes y puiffent prof-
pérer. On devroit contenir les eaux de ces tor-* 1 rens dans des lits larges 8c profonds.' Après ces
travaux, il feroit facile d’ etâblir des ponts qui
rapprocheroient les habitans, les mettroient à por-*
tée de fe faire part de leurs lumières , 8c les fe-j
roient jouir dès avantages d’une fociété mieux
ordonnée. Alors les plantations d’indigo s’amélio-
reroient, 8c celles de fucre fe multiplieroient,
fans que le café fût abandonné. On le regarde
comme le meilleur de la colonie. Limbe en récolté
feuî deux millions pefant, comparable à celui de
la Martinique.
C ’eft peu, fi c’eft même quelque chofe, en
comparaifbn de la plaine du C a p , qui a vingt
lieues de long fur environ quatre de large. Il y a
peu de pays plus arrofés : mais il ne s’y trouve
pas une rivière où une chaloupe puiffe remonter
plus de trois milles. Tout ce grand efpace eft
coupé par des chemins de quarante pieds de large
tirés au cordeau, bordés de haies de citroniers ,.
8c qui ne laifferoient rien à defiret, s’ ils étoient
ornés de futaies propres à procurer un ombrage
délicieux aux voyageurs, 8c à prévenir la difette
de bois qui commence à fe faire trop fentir. C ’ eft
le pays de T Amérique qui produit le plus de fu-
ére 8c de meilleure qualité. La plaine eft courori-»
née par une chaîne de montagnes, dont là pro^
fondeur eft depuis quatre jufqu’à huit lieues. La
plupart n’ont que peu d’ élévàtron. Plufieurspeu-
vent être cultivées jufqu’ à leur : fommet; Toutes
font réparées par des vallées remplies d’ un nom-i
bré prodigieux de cafiers, 8c de très-belles indi-
goteVrés.
Quoique les ftançois euffent reconnu de bonne
heure le prix d’un -terrain , dont là' fertilité .'fur-
pafle tout ce- qu’on en peut dire , ils ne commencèrent
à le cultiver qu’en 1670 , époque à laquelle
ils Çe’fïerènt de craindre Tefpagnol, qui jufqu’a-
lôr-s s’ étoit tenu en force dans le voifinagè., C e
fut un de ces hommes que l’intolérance reîigieufe
commençoit à profcrire dans leur patrie, le cal-
vinifle Gobin, qui alla former la première habitation
du Cap. Les maifons s’y multiplièrent, à
mefure que les campagnes limitrophes étoient défrichées
, 8c, vingt ans après, c’étoit une ville
allez floriffante pour exciter la jaloufie. En 169y ,
elle fut attaquée, prife , pillée 8c. réduite en cendres
par les forces réunies de la Caftille • 8c de
l ’Angleterre:
Le port eft digne de la ville : il eft admirablement
placé pour recevoir les vaiffeaux qui arrivent
d’Europe. Ceux de toute grandeur y font commodément
8c en fûreté.Ouvert feulement au vent de
nord-eft, il n’en peut recevoir aucun dommage,
fon entrée étant femée de récifs qui rompent l’im-
pétuofité des vagues.
C ’ell dans ce fameux entrepôt qu’on verfe
plus de la moitié des denrées de la colonie entière.
Elles y arrivent des montagnes } elles y
arrivent des vallées j elles y arrivent principalement
de la plaine. Les paroiffes qui fourniffent
les plus importantes , font connues fous les noms
de P laine-du-nord, de la Petite-An fe , de la grande
Rivière , de Morin , de Limonade, du Trou, du
Terrier - Rouge , du Fort - Dauphin & d’Onana-
minthe, qui fe termine à la rivière du Maffacre.
Le quartier Morin 8c Tiflet de Limonade font fort
au-deffus des autres établiffemens, pour l’abondance
8c la qualité de leur fucre.
S e c t i o n I I Ie.
Réflexions fur les moyens qui pourroient améliorer
l,es cultures dans le fud de la colonie.
Les établiffemens du fud de la colonie languif-
Fent tous dans une mifère plus ou moins grande.
Audi les ventes 8c les achats ne s’y font - ils pas
avec des métaux, comme au nord 8c à Touell
de la colonie. Au fud , on échange le$ marchan-
difes d’Europe contre les productions de l’Amérique.
Il réfulte de cette fauvage pratique, des difcuf-
fions éternelles, dçs fraudes innombrables, des retards
ruineux, qui éloignent les navigateurs , ceux
principalemenfqui s’occupent du commerce des ef- .
claves.
C ’eft. une vérité trop bien prouvée que la perte
annuelle des noirs s’élève naturellement au vingtième,
8c que les acçidens la font monter au
quinzième. Il fuit de cette expérience*que la contrée
qui nous occupe , 8c qui réunit plus de qua-.
rante mille efclaves, en a vu mourir vingt - cinq
mille en dix ans. Huit mille cent trente-quatre africains
, que les armateurs françois ont introduits
depuis .1763 jufqu’en 17 7 3 , n’ ont pas affurément
rempli ce grand vuide. Quel auroit donc été le
fort de ces établiffemens, fi les interlopes n’avoient
pourvu au remplacement ? C e n*eft pas
tout..
La partie du fud de Saint-Domingue a un grand
défavantage. Les montagnes qui la dominent, la
privent, ainfi que la côte d’oueft , durant environ
fix mois, des pluies du nord, du nord-eft , qui
fécondent les campagnes feptentrionales. Elle fera
donc en friche ou mal cultivée, jufqu’ à ce auë
les eaux du ciel y aient été remplacées par celles
des livières. Cette opération, qui tripleroit les
productions, exige de gros capitaux 8c beaucoup
d’efclaves. Le .commerce de France , foit impof-
fibilité, foit défiance, ne les fournit point.
On a confeillé au gouvernement d’ouvrir, pendant
dix ou quinze ans, cette portion de fa colonie
à tous les étrangers : on lui a repréfenté que
les. anglois y porteront des noirs } les hollandois
feront des avances à un intérêt que peuvent très-
bien fupporter les cultures du nouveau-Monde :
on lui a dit que le fuccès eft infaillible, fi Ton
fait des loix qui donnent une folidité convenable
aux créances des deux nations ; que les ports de
la métropole s’élèveront d’abord avec violence
contre cette innovation, mais que lorfque le monopole
leur fera rendu j lorfqu’ils jouiront exclu-
fivement de Taccroiffement immenfe que la navigation
, les ventes, les achats auront reçu , ils
béniront la main courageufe qui aura préparé leur
profpérité. Nous nous abfliendrons de difcuter ici
cette vue politique. Pour réfoudre de pareilles
queflions , il faut combiner tant d’élémens 8c des
connoiffances de détail fi fûres 8c fi précifes, que
nous ne croyons pas devoir l’entreprendre.
S e c t i o n I V e.
Détails fur la nature & la valeur des productions
que la France reçoit annuellement de fa colonie
de Saint-Domingue. Détails fur la population.
Toutes les productions de Saint-Domingue fe
réduifoient, en 1720, à vingt-un milEons de fu-
cre brut, à un million quatre cens mille livres
de fucre terré, à un million deux cens mille livres
d’indigo. Ces denrées fe font rapidement 8c pro-
digieufement accrues. On y a ajouté le coton 8c
le café vers 1737. La culture même du cacao a
été reprife, mais un peu plus tard.
En 1775 , la France reçut de cette colonie ,
fur trois cens cinquante-trois, navires, un million
deux cents trente mille fix cents foixante - treize
quintaux foixante - dix livres de fucre, qui valurent
44,738,139 liv. î quatre cents cinquante-neuf
mille trois cents trente-neuf quintaux quarante-
une livres de c a fé , qui valurent 21,818,621 liv. ;
dix-huit mille quatre-vingt fix quintaux vingt-neuf
livres d’indigo , qui valurent 1^,373,346 livres;
cinq mille 787 quintaux foi^ante-quatre livres de ca