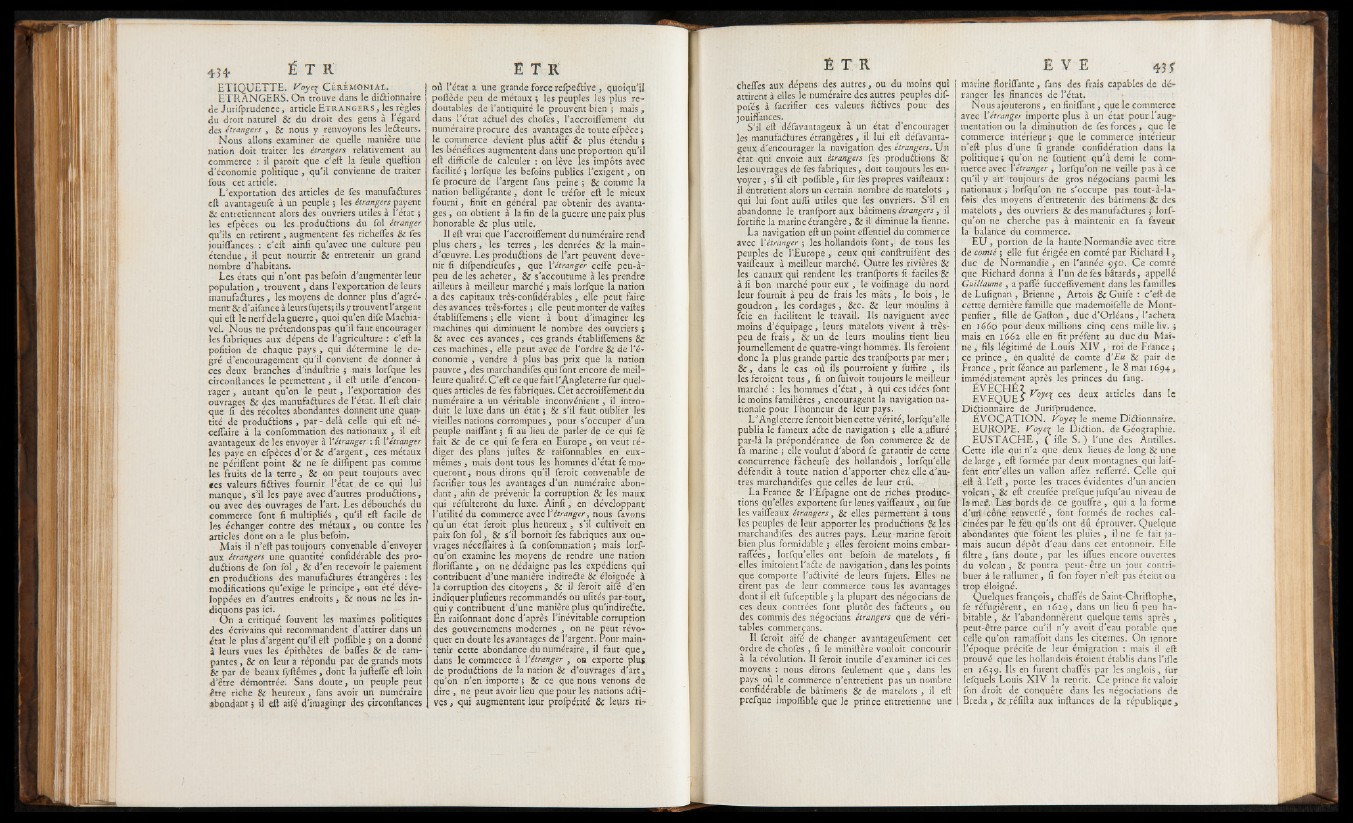
E T IQ U E T T E . Voyc^ C é r ém o n ia i .
E TR AN G ER S . On trouve dans le diélionnaire
de Jurifprudenee, article Et r a n g e r s , les règles
du droit naturel & du droit des gens à l'égard
des étrangers , & nous y renvoyons les lecteurs.
Nous allons examiner de quelle manière une
nation doit traiter les étrangers relativement au
commerce : il paroït que c’ eft la feule queition
d’économie politique, qu'il convienne de traiter
fous cet article.
L ’exportation des articles de fes manufaétures
eft avantageufe à un peuple -, les étrangers payent
& entretiennent alors des ' ouvriers utiles à l’ état ;
les efpèces ou les produétions du fol étranger
qu’ ils en retirent, augmentent fes richeffes & fes
jouiffances : c ’eft ainfi qu’ avec une culture peu
étendue, il peut nourrir & entretenir un grand
nombre d’habitans.
Les états qui n’ont pas befoin d’augmenter leur
population, trouvent, dans l'exportation de leurs
manufaétures, les moyens de donner plus d’agrément
& d’ aifance à leurs fujets; ils y trouvent l’argent
qui eft lenerfdelaguerre, quoi qu’en difeMachiavel.
Nous ne prétendons pas qu’il faut encourager
les fabriques aux dépens de l’agriculture : c’eft la
pofition de chaque pay s , qui détermine le degré
d’encouragement qu’il convient de donner à
ces deux branches d’induftrie ; mais lorfque les
circonftances le permettent, il eft utile d’encourager
, autant qu’on le p eut, l’exportation des
ouvrages & des manufaétures de l’état. 11 eft clair
que fi des récoltes abondantes donnent une quantité
de produétions , par - delà celle qui eft né-
cefîaire à la confommation des nationaux, il eft
avantageux de les envoyer à Yétranger : fi Yétranger
les paye en efpèces d’or & d’argent, ces métaux
ne périffent point & ne fe dimpent pas comme
les fruits de la terre, & on peut toujours avec
*es valeurs fiétives fournir l’etat. de ce qui lui
manque, s’il les paye avec d’autres produétions,
ou avec des ouvrages de l’art. Les débouchés du
commerce font fi multipliés , qu’il eft facile de
les échanger contre des métaux, ou contre les
articles dont on a le plus befoin.
Mais il n’ eft pas toujours convenable d’envoyer
aux étrangers une quantité confidérable des produirions
de fon fo l , & d’en recevoir le paiement
en produétions des manufaétures étrangères : les
modifications qu’exige le principe, ont été développées
en d’autres endroits, & nous ne les indiquons
pas ici.
On a critiqué fouvent les maximes politiques
des écrivains qui recommandent d’attirer dans un
état le plus d’argent qu’il eft polfible s on a donné à leurs vues les épithètes de baffes & de rampantes
, & on leur a répondu par de grands mots
& par de beaux fyftêmes, dont la jufteffe eft loin
d’être démontrée. Sans doute, un peuple peut
être riche & heureux, fans avoir un numéraire
abondant ; il eft aifé d’imaginer des çirconftances
où Petit a une grande force refpeétfve * quoiqu’ il
poflède peu de métaux ; les peuples les plus redoutables
de Pantiquité le prouvent bien j maïs,
dans Pétat aétuel des chofes, l’accroiffement du
numéraire procure des avantages.de toute efpèce;
le commerce devient plus aétif & plus étendu >
les bénéfices augmentent dans une proportion qu’il
eft difficile de calculer : on lève les impôts avec
facilité } lorfque les befoins publics l’exigent, on
fe procure de Pargent fans peine } & comme la
nation belligérante , dont le tréfor eft le mieux
fourni, finit en général par obtenir des avantages
, on obtient à la fin de la guerre une paix plus
honorable & plus utile.
Il eft vrai que Paccroiffement du numéraire rend
plus chers, J les terres , les denrées & la main-
d’oeuvre. Les produétions de Part peuvent devenir
fi difpendieufes, que Xétranger ceffe peu-à-
peu de les acheter, & s’accoutume à les prendre
ailleurs à meilleur marché } mais lorfque la nation
a des capitaux très-confidérables, elle peut faire
des avances très-fortes} elle peut monter de vaftes
établiffemens j elle vient à bout d’imaginer les
machines qui diminuent le nombre des ouvriers }
& avec ces avances, ces grands établiffemens &
ces machines, elle peut avec de l’ordre & de Pé-
conomie , vendre à plus bas prix que la nation
pauvre, des marchandifes qui font encore de meilleure
qualité. C ’ eft ce que fait l’Angleterre fur quelques
articles de fes fabriques. C et accroiffement du
numéraire a un véritable inconvénient, il introduit
le luxe dans un éta t} & s’il faut oublier les
vieilles nations corrompues, pour s’occuper d’ un
peuple naiffant 5 fi au lieu de parler de ce qui fe
fait & de ce qui fe fera en Europe, on veut rédiger
des plans juftes & raifonnables en eux-
memes, mais dont tous les hommes d’état fe moqueront,
nous dirons qu’ il feroit convenable de
facrifier tous les avantages d’un numéraire abondant
, afin de prévenir la corruption & les maux
qui réfulteront du luxe. A in fi, en développant
l’utilité du commerce avec l’ étranger, nous favons
qu’ un état feroit plus heureux, s’ il cultivoit en
paix fon fo l, & s’il bornoit fes fabriques aux ouvrages
néceffaires à fa confommation} mais lorf-
qu’on examine les moyens de rendre une nation
floriffante , on ne dédaigne pas les expédiens qui
contribuent d’une manière indirecte & éloignée à
la corruption des citoyens, & il feroit aifé d’ en
indiquer plufieurs recommandés ou ufités par tout,
qui y contribuent d’une manière plus qu’indireéte.
En raifonnant donc d’après l’inévitable corruption
des gouvernemens modernes , on ne peut révo*
quer en doute les avantages de l’argent, rour main-»
tenir cette abondance du numéraire, il faut que,
dans le commerce à Xétranger , on exporte plus
de produétions de la nation & d’ouvrages d’art,
qu’on n’en importe j & ce que nous venons de
dire , ne peut avoir lieu que pour les nations aéti-
v ç s , qui augmentent leur profpérité & leurs n?
cheffes aux dépens des autres, ou du moins qui
attirent à elles le numéraire des autres peuples dif-
pofés à facrifier ces valeurs fiétives pour des
jouiffances.
S’il eft défavantageux à un état d’encourager
les manufaétures étrangères, il lui eft défavantageux
d’encourager la navigation des étrangers. Un
état qui envoie aux étrangers fes produétions &
les ouvrages de fes fabriques, doit toujours les envoy
e r , s’ il eft poffible, fur fes propres vaifleaux:
il entretient alors un certain nombre de matelots ,
qui lui font aufli utiles que les ouvriers. S ’il en
abandonne le tranfport aux bâtimens étrangers, il
fortifie la marine étrangère, & il diminue la fienne.
La navigation eft un point effentiel du commerce
avec Xétranger ï les hollandois font, de tous les
peuples de l’Europe, ceux qui conftruifént des
vaifleaux à meilleur marché. Outre les rivières &
les canaux qui rendent les tranfports fi faciles &
à fi bon marché pour eux , le voifinage du nord
leur fournit à peu de frais les mâts, le b o is , le
goudron, les cordages, & c . & leur moulins à
feie en facilitent le travail. Ils naviguent avec
moins d’équipage, leurs matelots vivent à très-
peu de frais, & un de leurs moulins tient lieu
journellement de quatre-vingt hommes. Ils feroient
donc la plus grande partie des tranfports par mer 5
& , dans le cas où ils pourroient y fuffire , ils
les feroient tous, fi on fuivoit toujours le meilleur
marché : les hommes d’état, à qui ces idées font
le moins familières, encouragent la navigation nationale
pour l’honneur de leur pays.
L ’ Angleterre fentoit bien cette vérité, lorfqu’elle
publia le fameux aéte de navigation 5 elle a.affuré
par-là la prépondérance de fon commerce & de
fa marine } elle voulut d’abord fe garantir de cette ,
concurrence fâcheufe des hollandois, lorfqu’elle
défendit à toute nation d’apporter chez elle d’autres
marchandifes que celles de leur crû.
La France & l’Efpagne ont de riches productions
qu’elles exportent fur leurs vaifleaux, ou fur
les vaifleaux étrangers y & elles permettent à tous
les peuples de leur apporter les produétions & les
marchandifes des autres pays. Leur marine feroit
bien plus formidable.} elles feroient moins embar-
raflees, lorfqu’ elles ont befoin de matelots, fi
elles imitoient l’aéte de navigation, dans les points
que comporte l’aélivité de leurs fujets. Elles' ne
tirent pas de leur commerce tous les avantages
dont il eft fufceptible 3 la plupart des négocians de
ces deux contrées font plutôt des faéteurs , ou
des commis des négocians étrangers que de véritables
commerçans.
Il feroit aife de changer avantageufement cet
ordre de chofes , fi le miniftère vouloit concourir
à la révolution. Il feroit inutile d’examiner ici ces
moyens : nous dirons feulement que, dans les
pays où le commerce n’entretient pas un nombre
confidérable de bâtimens & de matelots , il eft
prefque impoflible que le prince entretienne une
marine floriffante, fans des frais capables de déranger
les finances de l’état.
Nous ajouterons, en finiffant, que le commerce
avec Xétranger importe plus à un état pour l’augmentation
ou la diminution de fes forces , que Te
commerce intérieur} que le commerce intérieur
n’eft plus d’une fi grande confidération dans la
politique; qu’on ne foutient qu’ à demi le conv-
merce avec Xétranger, lorfqu’on ne veille pas à ce
qu’il y ait’ 1 toujours de gros négocians parmi les
nationaux ; lorfqu’on ne s’occupe pas tout-à-la-
fois des moyens d’ entretenir des bâtimens & des
matelots, des ouvriers & des manufaétures ; lorfqu’on
ne cherche pas à maintenir en fa faveur
la balance du commerce.
E U , portion de la haute Normandie avec titre
de comté j elle fut érigée en comté par Richard I ,
duc de Normandie, en l’année 950. C e comté
que Richard donna à l’un de fes bâtards, appellé
Guillaume, a paffé fucceflivement dans les familles
de Lufignan , Brienne , Artois & Guife : c ’eft de
cettte dernière famille que mademoifelle de Mont-
penfier, fille de Gafton, duc d’Orléans, l’acheta
en 1660 pour deux millions cinq cens mille liv. ;
mais en 1661 elle en fit préfent au duc du Main
e , fils légitimé de Louis X I V , roi de France ;
ce prince , én qualité de comte d*Eu 8>c pair de
France , prit féance au parlement, le 8 mai 1694,
immédiatement après les princes du fang.
É V ÊQ U E ^ ces deux d ic te s dans le
Diéfcionnaire de Jurifprudenee.
E V O C A T IO N . Voye% le meme Diétionnaire.
EUROPE. Voyez le Diétion. de Géographie.
E U S T A C H E , ( ifle S. ) l’une des Antilles.
Cette ifle qui n’a que deux lieues de long & une
de large , eft formée par deux montagnes qui laif-
fent entr’elles un vallon affez refferré. Celle qui
..eft à l ’-eft, porte les traces évidentes d’ un ancien
volcan y & eft creufée prefque jufqu’au niveau de
la rhef.'Les .bords de ce gouffre, qui a la forme
d’ tnî cône renverfé, font formés de roches calcinées
par le feu qu’ ils ont dû éprouver. Quelque
. abondantes que fdient les pluies, il ne fe fait jamais
aucun dépôt d’eau dans cet entonnoir. Elle
filtre, fans doute, par les iffues encore ouvertes
du volcan, & pourra peut- être un jour contribuer
à le rallumer, fi fon foyer n’ eft pas éteint ou
trop éloigné.
Quelques françois, chaffés de Saint-Chriftophe,
fe réfugièrent, en 1629, dans un lieu fi peu habitable
, & l’abandonnèrent quelque tems après ,
peut-être parce qu’ il n’y avoit d’eau potable que
celle qu’on ramaffoit dans les citernes. On ignore
l’époque précife de leur émigration : mais il eft
prouvé que les hollandois étoient établis dans l’ ifle
en 16*9. Ils en furent chaffés par lesanglois, fur
lefquels Louis X IV la reprit. C e prince fit valoir
fon droit de conquête dans les négociations de
Breda, & péfifta aux inftances de la république,