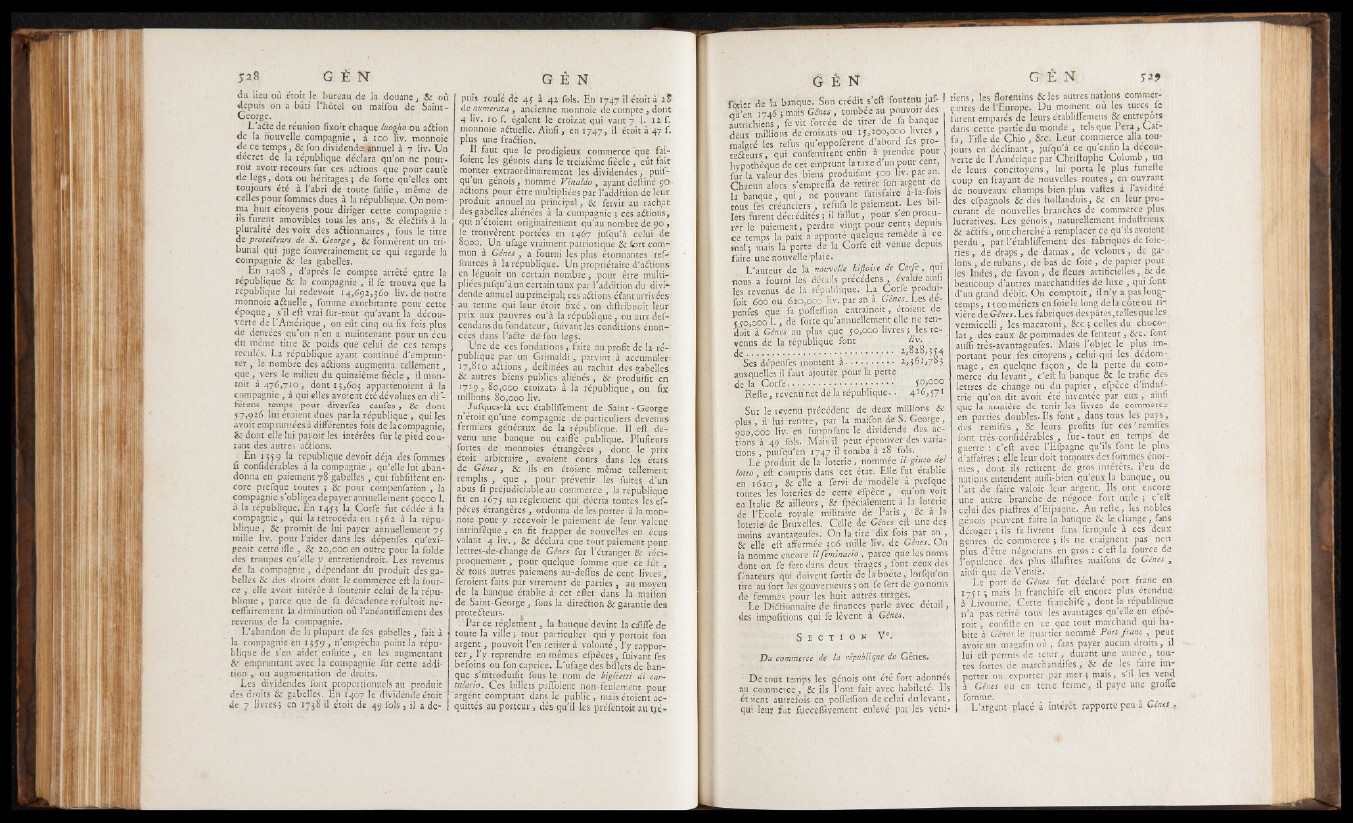
S*S G É N
du lieu où étoit le bureau de la douane , 8c où
depuis on a bâti l’hôtel ou maifon de Saint -
George.
L'adte de réunion fixoit chaque luogho ou a&îon
de la nouvelle compagnie, à ioo iiv. monnoie
de ce temps, & fon dividcnde»annuel à 7 Iiv- Un
décret de la république déclara qu'on ne pour-
roit avoir recours fur ces allions que pour caufe
de legs, dots ou héritages; de forte qu'elles ont
toujours été à l’abri de toute faifie, même de
celles pour fommes dues à la république. On nomma
huit citoyens pour diriger cette compagnie :
ils furent amovibles tous les ans, 8c éleaifs à la
pluralité des voix des aétionnaires, fous le titre
de protecteurs de S. George , & formèrent un tribunal
qui juge fouverainement ce qui regarde la
compagnie & les gabelles.
\ En 1408 , d’après le compte arrêté eptre la
republique & la compagnie , il fe trouva que la
république lui redevoit 14,692,360 liv. de notre
monnoie aétuelle, fomme exorbitante pour cette
époque, s'il eft vrai fur-tout qu'avant la découverte
de l’Amérique, on eût cinq ou fix fois plus
de denrées qù’on n’en a maintenant pour un écu-
du même titre & poids que celui de ces temps
reculés. La république ayant continué d’emprunter
, le nombre des a étions augmenta tellement,.
que, vers le milieu du quinzième fiècle , il mon-
toit à 476,71 o , dont 13,603 appartenoient a la
compagnie, à qui elles avoient été dévolues en
férens temps pour diverfes caufes, & dont
■ 57,926 lui etoient dues par la république , qui les
avoit empruntées à différentes fois de la compagnie,
Sc dont elle lui payoit les intérêts fur le pied courant
des autres aétions.
En 13^9 la république devoit déjà des fommes
fi confidérables à la compagnie , qu'elle lui abandonna
en paiement 78 gabelles , qui fubfîftent encore
prefque toutes ; & pour compenfation , la
compagnie s'obligea depayer annuellement yoooo I.
à la république. En 145-3 la Corfe fut cédée à la
compagnie, qui la rétrocéda en 1562 à la république
, & promit de lui payer annuellement 7 ;
mille liv. pour l’ aider dans les dépenfes qu’exi-
geoit cette ille , 8c 20,000 en outre pour la folde
des troupes qu’elle y entretiendroit. Les revenus
de la compagnie, dépendant du produit des gabelles
& des droits dont le commerce eft la four-
ce , elle avoit intérêt à foutenir celui de la république
, parce que de fa décadence réfuîtoit né-
ceflairement la diminution où l’anéantiffement des
revenus, de la compagnie.
L ’abandon de la plupart de fes gabelles, fait à
la compagnie 'en 1359 , n’empêcha point la 'république
de s’en aider enfiiite , en les augmentant
& empruntant avec la compagnie fur cette addition
, ou augmentation de droits.
Les dividendes font proportionnels au produit
des droits & gabelles. E n 1407 le dividende étoit
de 7 livres; en 1738 il jçtoit de 49 fols , il a de-
G Ê N
puis roulé de 45 à 42 fols. En 1747 il étoit à 2&
de numerüta , ancienne monnoie de compte, dont
4 Iiv. 10 f. égalent le croizat qui vaut 7 1. 12 f.
monnoie aétuelle. Ainfi ,■ en 1747, il étoit à 47 f.
plus une fraétion. ’
Il faut que le prodigieux commerce que fai-
foient les génois dans le treizième fiècle , eût fait
monter extraordinairement les dividendes puif-
qu un génois, nommé Vinaldo , ayant deftiné 90
aâions pour être multipliées par l'addition de leur
produit annuel au principal, & fervir au rachat
des gabelles aliénées à la compagnie ; ces aétions,
qui n'étoient originairement qu’au nombre de 90 ,
fe trouvèrent portées en 1467 jufqu’ à celui de
8000.^ Un ufage vraiment patriotique & fort commun
à Gênes , a fourni les plus étonnantes ref-
fources à la république. Un propriétaire d’aétions
en léguoit un certain nombre, pour être multipliées
jufqu’à un certain taux par l'addition du divi-
dende annuel au principal; ces aétions éfant arrivées
au terme qui leur étoit fix é, on diftribuoit leur
prix aux pauvres ou*à la république, ou aux def-
cendansdu fondateur, fuivantles conditions énoncées
dans l’aéte dé foti legs.
Une de cés fondations, faite au profit de la république
par un Grimaldi, parvint à accumûler
17,81.0 aétions , deltinées au rachat des gabelles
& autres biens publies aliénés, & produifit en
1729, 80,000 croizats à la république, ou fis
millions 80,000 Iiv.
Jufques-là cet établiflement de Saint-George
n’ étoit qu’une compagnie . de particuliers devenus
fermiers généraux de la république. Il eil devenu
une ' banque ou caille publique. Plufieurs
fortes ■ cfo monnoies étrangères , dont le prix
étoit arbitraire, .«voient cours dans les états
de Gênes, & ils en éroient même tellement
remplis , que , pour prévenir., les fuites d’un
abus fi préjudiciable au commerce , la république
fit en 1675 un règlement qui décria toutes les ef-
pèces étrangères, ordonna de les porter à la monnoie
pour y recevoir le paiement de leur valeur
intrinfèque, en fit frapper de nouvelles en ècus
valant 4 liv ., & déclara que tout paiement pour
lettres-de: change de Gênes fur l’étranger- & réciproquement
, pour quelque fomme que cè fût ,
& tous autres paiemens au-deffus de cent livres,'
feroient faits par virement de parties, au moyen
de la banque établie à- cét effet dans la maifon
de Saint-George, fous la dircétion & garantie des
proteéleurs. ,
Par ce réglement, la banque devint la calife cfe
toute la ville ; tout particulier qui y portoit fon
argent, pouvoir l’en retirer à volonté, l’y rapporte
r , l’y reprendre en mêmes efpèces, fuivant fes
befoins ou fon caprice. L ’ufage des billets de-banque
s’introduifit fous le nom de higlietti di car-
tulario. Ces billets palfoieut non-feulement pour
argent comptant, dans le public, mais étoîent acquittés
au porteur, dès qu’il les préfentoit au tjéÙ
Ê N
ferler de la banque. Son crédit s’ eft foutenu iuf- I
ou’en 1746 i mais Gênes, tombée au pouvoir des
autrichiens, fev it forcée de tirer de fa banque
deux millions decroizats ou 15,200,000 livres,
malgré les refus qu’oppofèrent d’abord fes pro-
téâeurs, qui confentirent enfin à prendre pour
hypothèque de cet emprunt la taxe d’un pour cent,
fur la valeur des.biens produifant jdo liv. par an.
Chacun alors s’empreflà de retirer foi! argent de
la banque, q ui, ne pouvant fatisfaire a-la-rois
tous fes créanciers , refufa le paiement^. Les billets
furent décrédités ; il fallut, pour s en procurer
le paiement, perdre vingt pour cent; depuis
ce temps la paix a apporté quelque remede a ce
mal; mais la perte de la Corfe eft venue depuis
faire une nouvelle plaie.
L ’auteur de la nouvelle kijtoire de Corfe, qui
nous a fourni lei détails précédens, évalife ainfi
les revenus de la république. La Corfe produi-
jfoit 66o ou 620,000 liv. par an à Gênes. Les de-
penfes que fa pofleflion entraînoit, étoient de
5. 50,000 1 ., de forte qu’annuellement elle ne ren-
doit à Gênes au plus que yô,ôôô livres-;, les revenus
de la république font - £v.
d e - . . . - .........................; • ............. ..
Ses dépenfes montent a .................. .
auxquelles il faut ajouter pour la perte
de la Corfe . . . . . . . . . . . • • . . . . . V ■ 50,000
Refte, revenu net dé la république. » 416,571
Sur le revenu précédent de deux millions 8c
plus, il lui rentre , par la maifon-de S. George,
900jÔ0,0 liv- en fuppofant le dividende des actions
à 49 fols. Mais il peut éprouver des variations,
puifqu’ en 1747 il tomba à 28 fols. ■
Le produit de la loterie| nommée il giuco del
lotto, eft compris dans cet état. Elle fut établie
en 1620, & elle a fervi de'modèle à prefque
toutes les loteries de cette efpèce , qu’on voit
en Italie & ailleurs, 8c fpécialèment à la loterie
de l'École royale militaire de Paris , 8c a la
loterie* de Bruxelles. Celle de Gênes eft une des
moins avantageufes. On la tire dix fois par an , 8c elle eft affermée 306 mille liv. de Genes. On
la nomme encore tl feminario , parce que les noms
dont on fe fertdans deux tirages , font ceux des
fënateurs qui doivent fortir de la boëte, lorfqu’on
tire au fort les gouverneurs ; on fe fert de cjonoms
de femmes pour les huit autres tirages.
Le Dictionnaire de financés parle avec détail,
des impofitions qui fe lèvent à Gênes.
S e c t i o n V e.
Du commerce de la. république de Genes.
De tout temps les génois ont été fort adonnes
au commerce , ils l’ont fait avec habileté. Ils
et >ient autrefois en pofteftion de celui du levant ,
qui leur fat fucceflivement enlevé par lés véni-
G-'Ê. N
I tiens, les florentins & les autres nations commerçantes
de l’Europe. Du moment ou les turcs ^fe
. furent emparés de leurs établiflemens & entrepôts
dans cette partie du monde 0 tels que Pera, Caf-
fa , l’ifle de C h io , 8cc. Leur commerce alla toujours
en déclinant, jufqu’à ce qu’enfin la decouverte
de l’Amérique par Chriftophe Colomb, un
de leurs concitoyens, lui porta le plus funefte
coup en frayant de nouvelles routes, en ouvrant
de nouveaux champs bien plus vaftes à 1 avidité
des efpagnols 8c des hollandois, 8c en leur procurant
de nouvelles branches de commerce plus
lucratives. Les génois, naturellement induftrieux
& actifs , ont cherché à remplacer ce qu’ils avoient
perdu , par i’établiflement des fabriques de foie-
r ie s , de draps, de damas , de velours, de galons
, de rubans, de bas de fo ie , de papier pour
les Indes,.de favon, de fleurs artificielles, & de
beaucoup d’autres marchandifes de luxe, qui font
d’un grand débit. On comptoit, il n y a jpas longtemps,
15 00 métiers en foie le long delà cote ou rivière
de Gênes. Les fabriques des pâtes, telles que les
vermicelli, les macaroni, & c ; celles du chocola
t , . des eaux & pommades de fenteur, 8cc. font
auffi trèsravantageufes. Mais l’objet le plus important
pour . fes.citoyens , celui qui les dédommage
> en quelque façon, de la perte du commerce
du levant, c ’eft la banque 8c le trafic des
lettres de change ou du papier , efpèce d’induf-
trie qu’on dit avoir été inventée par eux, ainfi
que la manière de tenir les livres de commerce
en parties doubles» Ils fo n t , dans tous les pays,
des remifés , & leurs profits fur ces ! remifes
'-font très-confidérables , fur-tout en temps de
guerre : c’ eft avec l’Efpagne qu’ils font le plus •
d’affaires ; elle leur doit toujours des fommes énormes,
dont ils retirent de gros intérêts. Peu de
nations entendent auftî-bien qu’eux la banque, ou
" l’art de' faire valoir leur argent. Ils ont encore
une autre branche de négoce fort utile ; c eft
celui des piaftres d’Efpagne. Au refte., les nobles
génois peuvent faire la banque & le change, fa-ns
déroger > ils fe livrent fans fcrüpule à ces deux
genres de commerce ; ils ne craignent pas non
plus d’être négocians en gros : c’eft la fource de
l'opulence des plus illuftres maifons de Gênes ,
ainfi que de Venife.
Le port de Gênes fut déclaré port franc en
1751 ; mais la franchife eft encore plus étendue,
à Livourne. Cette franchife, dont la république
n'a pas retiré tous les avantages qu’elle en efpé-
ro it, confifte en ce que tout marchand qui habite
à Gênés l e quartier nommé Port franc , peut
avoir un magafin où , fans payer aucun droits, il
lui eft permis de tenir, durant une année, toutes
fortes de marchandifes, 8c de les faire importer
ou exporter par mer ; mais, s’il les vend
à Gênes ou en terre ferme, il paye une grofle
fomme. , N
L ’ argent placé à intérêt rapporte peu a Genes *