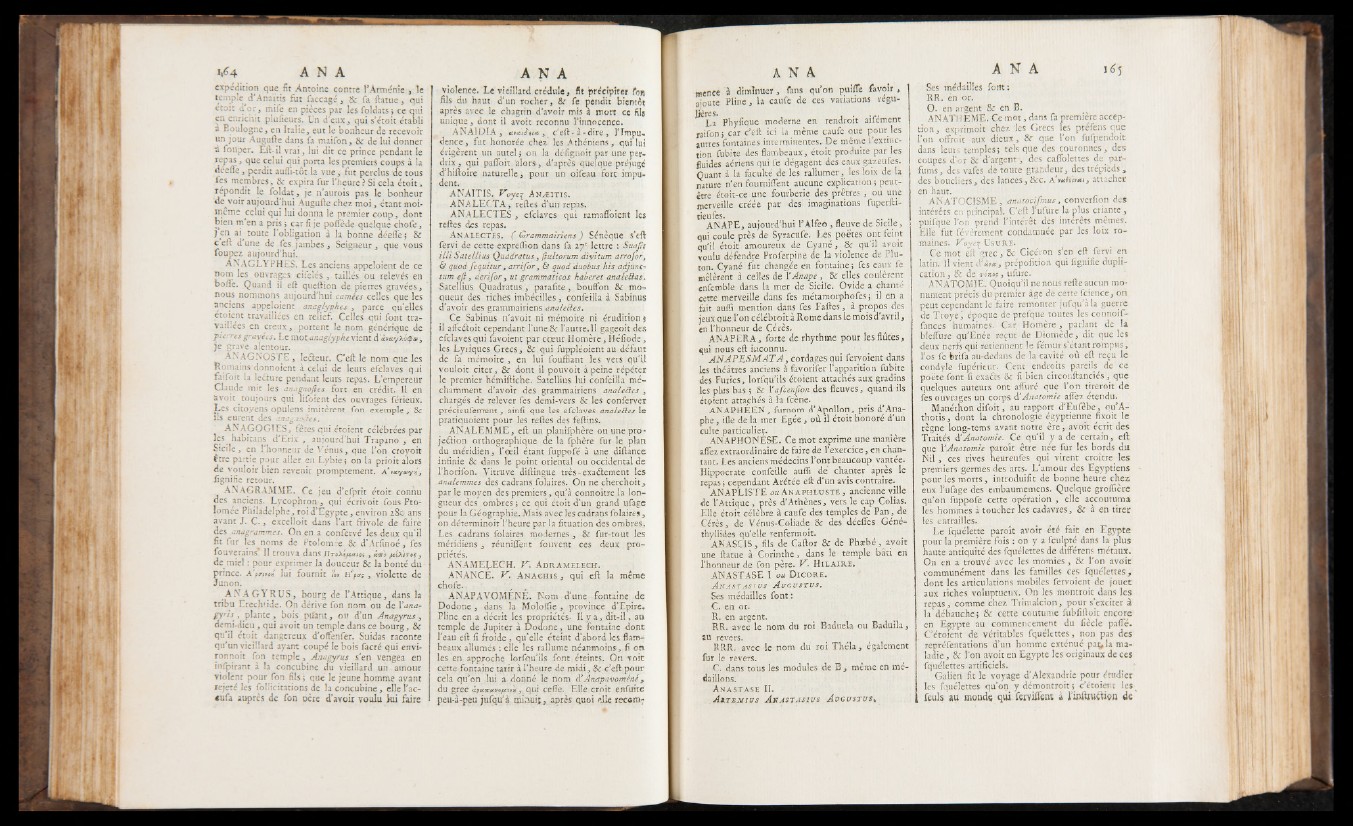
expédition que fit Antoine contre l’Arménie 3 le
temple d’Anaïtis fut faccagé, & fa ftatue3 qui
etoit d or , mife en pièces par les foldats 5 ce qui
en enrichit plufieurs. Un d’eux, qui s’étoit établi
a Boulogne, en Italie, eut le bonheur de recevoir
un jour Augulle dans fa maifon, & de'lui donner
d fouper. Eli-il vrai, lui dit ce prince pendant le
repas, que celui qui porta les premiers coups à la
dé elle, perdit aufli-tôt la vue, fut perclus de tous
les membres, & expira fur l’heure?Si cela étoit,
répondit le foldat, je n’aurois pas le bonheur
de^voir aujourd’hui Augufte chez moi, étant moi-
ineme celui qui lui donna le premier coup, dont
bien m en a pris 5 car fi je poflede quelque chofe,
] icn ai} toute l’obhgation à la bonne déefie > &
c eft d une de fes jambes , Seigneur , que vous
foupez aujourd’hui.
ANAGLYPHES. Les anciens appeloient de ce
nom les ouvrages cifelés , taillés ou relevés en
bofïè. Quand il eft queftion de pierres gravées,
nous nommons aujourd’hui camées celles que les
anciens appeloient anaglyphes, parce qu’elles
etoient travaillées en relief. Celles qui font travaillées
en creux, portent Je nom générique de
pierres gravées. Le mot anaglyphe vient d ,
je grave alentour.
AN A G NOS TE, leéteur. C’eft le nom que les
Romains donnoient à celui de leurs efclaves qui
fàifoit la leéture pendant leurs repas. L ’empereur
Claude mit les anagnoftes fort en crédit. Il en
avoir toujours qui lifoient des ouvrages férieüx.
Les citoyens opulens imitèrent fon exemple, &
ils eurent des anag.ioîtes.
ANAGOGIES, fêtes qui étoient célébrées par
les habitans d Erix , aujourd’hui Trapano , en
Sicile, en 1 honneur de Vénus, que l’on croyoit
être partie pour aller en Lybie» on la prioit alors
de vouloir bien revenir promptement. Avayayé,
ügnifie retour.
ANAGRAMME. Ce jeu d’efprit étoit connu
des anciens. Lycophron , qui écrivoit fous Pto-
lomee Philadelphe, roi d’Egypte, environ 28c ans
avant J. C . , excelloit dans l’art frivole de faire
des anagrammes. On en a confervé les deux qu’il
fit fur les noms de Ptoîomée & d’Arfinoé, fes
fouverains* Il trouva dans nroxé^aios, à** yÀxWoç,
de miel : pour exprimer la douceur & la bonté du-
prince. A’pa-itoé lui fournit ut h ''pas , violette de .
Junon.
A NA G Y RUS , bourg de l’Attique, dans la
tribu Erechtide. On dérive fon nom ou de Yana-
gyns , plante, bois pifant, ou d’un Anagyrus,
demi-dieu, qui avoit un temple dans ce bourg, &
qu’il étoit dangereux d’offenfer. Suidas raconte
qu’un vieillard ayant coupé le bois facré qui envi-
ronnoit fon temple, Anagyrus s’en vengea en
infpirant à la concubine du vieillard un amour
violent pour fon fils 5 que le jeune homme ayant
rejeté les follicitations de la concubine, elle l’ac- j
4ufa auprès de fon oère d’avoir voulu lui faire '
violence. Le vieillard crédule 3 fit précipiter fo»
fils du haut d’un rocher, &r fe pendit bientôt
après avec le chagrin d’avoir mis a mort cc fils
unique, dont il avoit reconnu l’innocence,
ANA1DIA , tuittiéute, , c’eft- à-dire, l’Impudence
, fut honorée chez les Athéniens ,■ qui lui
érigèrent un autel j on la défignoit par une perdrix,
qui pafioit. alors, d’après quelque préjugé
d’hiftoire naturelle, pour un oifeau fort impudent.
ANAÏTIS. Voyt^ Anæitis.
ANALE CTA, reftes d’un repas.
ANALECTES , efclaves qui ramafioient les
reftes des repas.
ANALECTES, ( Grammairiens ) Sénèque s’eft
fervi de cette expreflion dans fa 27e lettre : Suaftt
illi Satellius Quadratus , ftultorum divitum arrofor,
6* qùod fequitur , arrifor, & quod duobus his adjunç-
tum eft, derifor, ut grammatiços haberet analeçîas.
Satellius. Quadratus, parafite, bouffon & mo^
que.ur des riches imbécilles, confeilla à Sabinus
d’avoir des grammairiens analectes.
Ce Sabinus n’avoit ni mémoire ni érudition 3
il affeéfcoit cependant l’une & l’autre, Il gageoit des
efclaves qui favoient par coeur Homère, Héfiode,
les Lyriques Grecs, 8c qui fupplé oient au défaut
de fa mémoire, en lui foufflant les vers qu’il
vouloit citer, 8c dont il pouvoit à peine répéter
le premier hémiftiche. Satellius lui confeilla méchamment
d’avoir des grammairiens analectes ,
chargés de relever fes demi-vers 8c les conferver
précieufenrrent, ainfi que les efclaves analettes le
pratiquoient pour les reftes des feftins.
ANALEMME, eft un planifphère ou une projection
orthographique de la fphère fur le plan
du méridien, l’oeil étant fuppofé à une diftance
infinie 8c dans le point oriental ou occidental de
l’horifon. Yitruve diftingue très-exactement les
analemmes des cadrans folaires. On ne cherchoit,
par le moyen des premiers, qu’à connoître la longueur
des ombres 5 ce qui étoit d’un grand ufage
pour la Géographie. Mais avec les cadrans folaires,
on déterminoit l’heure par la fituation des ombres.
Les cadrans folaires modernes, 8c fur-tout les
méridiens, réunifient fouvent ces deux propriétés.
ANAMELEOH. V. àdramelech.
A N AN CE. V. Anachis , qui eft la même
chofe.. '
ANAPAVOMÉNE. Nom d’une fontaine de
Dodone, dans la Moloflîe , province d’Epïre,
Pline en a décrit les propriétés. Il y a , dit-il, au
temple de Jupiter à Dodone, une fontaine dont
l’eau eft fi froide, qu’elle éteint d’abord les flambeaux
allumés : elle les rallume néanmoins , fi on
les en approche lorfqu’ ils font éteints. On voit
cette fontaine tarir à l’heure de midi, 8c. c’eft-pour
cela qu’on lui a donné le nom d’Anapavojnèné,
du grec ùiufFftvoftîvlt 3, qui cefie. Elle croît enfuîre
peu-à-peu jufqu'à minuit, après quoi elle recom^
A N A
mtnee à diminuer, fans qu’on puifle favoir,
ajoute Pline, la caufe de ces variations régul
a Phyfîque moderne en rendroit aifément
raifon i car c’ eft ici la même caufe que pour les
autres fontaines intermittentes. De même l’extinction
fubite des flambeaux, étoit produite par les
fluides aériens qui fe dégagent des eaux gazeufes.
Quant à la faculté de les rallumer, les loix de la
nature n’en fourniflent aucune explication ; peut-
être étoit-ce une fourberie des prêtres, ou une
merveille créée par des imaginations fuperfti-
tieufes. : ;
AN APE, aujourd’hui l’AlfeO, fleuve de Sicile,
qui coule près de Syracufe. Les poètes ont feint
qu’il étoit amoureux de Cyané, & qu’il avoit
voulu défendre Proferpine de la violence de Plu-
ton. Cyané fut changée en fontaine i fes eaux fe
mêlèrent à celles de l'Atiapt, & elles coulèrent
cnfeipble dans la mer de Sicile. Ovide a chanté
cette merveille dans fes métamorphofes ; il en a
fait aufli mention dans fes Faites, à propos des
jeux que l’on célébroità Rome dans le mois d avril,
en l’honneur de Cérès.
ANAPERA, forte derhythme pour les flûtes,
qui nous eft inconnu.
A N A PE SM A T A , cordages qui fervoient dans
les théâtres anciens à favorifer l’apparition fubite
des Furies, iorfqu’ils étoient attachés aux gradins
les plus bas > & l’afcenfiqn des fleuves, quand ils
étoient attachés à ta feene.
ANAPHÉEN, furnom d’Apollon, pris d’Ana-
phe, ifle de la mer Egée, où il étoit honoré d’un
culte particulier
ANAPHONESE. Ce mot exprime une manière
afîez extraordinaire de faire de l’exercice, en chantant.
Les anciens médecins l’ont beaucoup vantée-
Hippocrate confeille aufli dé chanter après le
repas ; cependant Arétée eft d’un avis contraire-
ANAPLISTE ouAnaphluste, ancienne ville
de l’Attique, près d’Athènes, vers le cap Colias.
Elle étoit célèbre à caufe des temples de Pan, de
Cérès, de Vénus-Coliade & des déelfes Géné-
thyllides quelle renfermoit.
ANASCIS, fils de Caftor & de Phæbé, avoit
une ftatue à Corinthe, dans le temple bâti en
l’honneur de fon père. F". Hilaire,
. ANASTASE I ou Dicore.
A n a s t a s t u s A u g u s t u s .
Ses médailles font :
C. en or.
R. en argent,
RR. avec le nom du roi Baduela ou Baduila,
au revers.
R RR. avec le nom du roi T h é la, également
fur le revers.
C. dans tous les modules de B , même en médaillons.
Anastase II.
A r t s m i u s A n a s t a s i u s A u g u s t u s%
A N A 165
Ses médailles font:
RR. én or.
O. en argent & en B.
ANATHEME. Ce m ot, dans fa première acception
, exprimoit chez les Grecs les préfens que
l’on offroit aux dieux, 8c que l’on fufpendoit
dans leurs temples j tels que des couronnes, des
coupes d’or & d’argent-, des caflolettes de parfums,
des vafes de toute grandeur, des trépieds,
des boucliers, des lances, 8cc. Â’vesôèWf, attacher
en haut.
ANATOCISME, anatocifmus> converfion des
intérêts en principal. C’eft l’ufure la plus criante ,
puifque l’on prend l’ intérêt des interets memes.
Elle fut févèrement condamnée par les loix romaines.
Voye£ Usure.
Ce mot eft grec, 8c Cicéron s’en eft fervi en
latin. 11 vient d’àv* , prépofition qui fignifie duplication
, & de rUoc y ufure.
ANATOMIE. Quoiqu’il ne nous refte aucun monument
précis du premier âge de cette fcience, on
peut cependant le faire remonter jufqu’àla guerre
de Troye j époque de prefque toutes les connoif-
fances humaines. Car Homère, parlant de la,
bleffure qu’Enée reçut de Diomède, dit que les
deux nerfs qui retiennent le fémur s’étant rompus,
l’os fe fcrifa au-dedans de la cavité ou eft reçu le
condyle fupérieur. Cent endroits pareils de ce
poète font fi exa&s & fi bien circonftanciés, que
quelques auteurs ont afiuré que l’on tireroit de
fes ouvrages un corps à" Anatomie a fiez etendu.
Manéthon difoit, au rapport d’Eufèbe, ou’A-
thotis, dont la chronologie égyptienne fixoit le
règne long-tems avant notre ère, avoit écrit des
Traités & Anatomie. Ce qu’ il y a de certain, eft
que Y Anatomie paroît être nee fur les bords du
N i l , ces rives heureufes qui virent croître les
premiers germes des arts. L’amour des Egyptiens
pour les morts, introduifit de bonne heure chez
eux l’ufage des embaumemens. Quelque groflière
qu’on fuppofe cette opération , elle accoutuma
les hommes à toucher les cadavres, & à en tirer
les entrailles.
Le fquélette paroît avoir été fait en Egypte
pour la première fois : on y a fculpté dans la plus
haute antiquité des fquélettes de différens métaux.
On en a trouvé avec les momies, & l’on avoit
communément dans les familles ce s fquélettes,
dont les articulations mobiles fervoient de jouet
aux riches voluptueux. On les montroit dans les
repas, comme chez Trimalcion, pour s’exciter à
la débauche j & cette coutume fubfiftoit encore
en Egypte au commencement du fiècle pafie.
Cetoient de véritables fquélettes, non pas des
repréfentations d’un homme exténué pa^ la maladie
, & l'on avoit en Egypte les originaux de ces
fquélettes artificiels.
Galien fit le voyage d’Alexandrie pour étudier
les fquélettes qu’on y démontroit 5 c’étoient les
feuls au monde qui fervifient à finftru&ion de