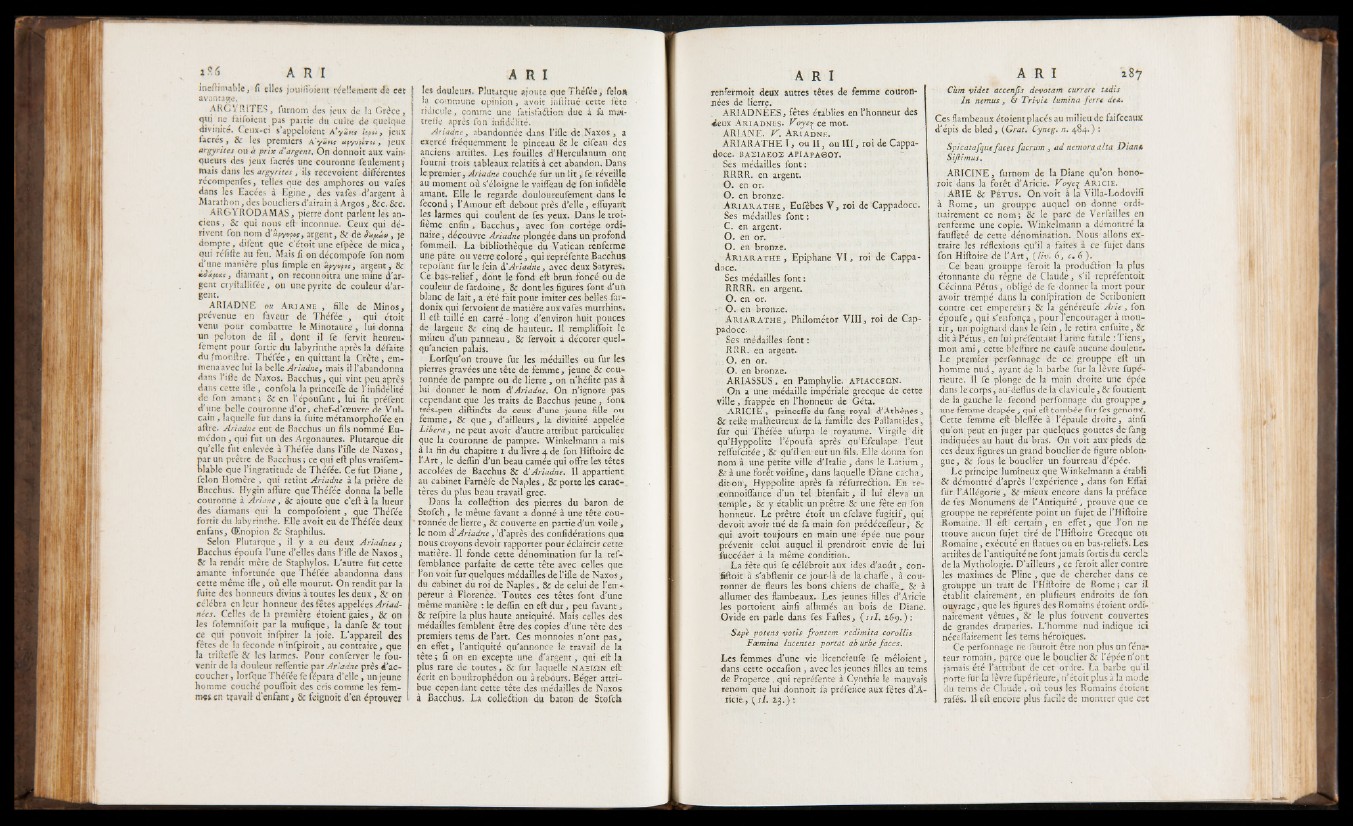
ineftimable, fi elles jouixibienc réellement de cet
avantage.
À R G YR IT ES furn om des jeux de la Grèce,
ne faifoient pas partie du culte de quelque
divinité. Ceux-ci s’appeloient a*yûns hpot, jeux
facres, & les premiers A’ySvtj- afyvfLrta , jeux
orgy rie es ou à prix d’argent. On donnoit aux vainqueurs
des jeux facrés une couronne feulement j
mais dans les argyrites, ils recevaient différentes
recompenfes, telles que des amphores ou vafes
dans les Eacées à Egine, des vafes d’argent à
Marathon , des boucliers d’airain à Argos, &c. & c.
ARGYRODAMAS , pierre dont parlent les anciens
, & qui nous eft inconnue. Ceux qui dérivent
fon nom d’ 'àpyvpoç, argent, & de àct/xâa, je
dompte, difent que c'étoit une efpèce de mica,
qui réfîfte au feu. Mais fi on décompofe fon nom
d’une manière plus fimple en «pyvpes, argent, &
iè*t**ç, diamant, on reconnoîtra une mine d’argent
cryftallifée, ou une pyrite de couleur d’argent.
ARIADNE ou Ariane , fille de Minos,
prévenue en faveur de Théfée , qui étoit
venu pour combattre le Minotaure, lui donna
un peloton de f i l , dont il fe fervit heureu-
fement pour fortir du labyrinthe après la défaite
du fmonftre. Théfée, en quittant la Crète, emmena
avec lui la belle Ariadne, mais il l’abandonna
dans l’ifîe de Naxos. Bacchus, qui vint peu après
dans cette ifle, confola la princeffe de l’infidélité
de fon amant ; & en l’époufant, lui fit préfent
d’ une belle couronne d’or, chef-d’oeuvre de Vul-
cain, laquelle fut dans la fuite métamorphofée en
aftre. Ariadne eut de Bacchus un fils nommé Eu-
fnédon, qui fut un des Argonautes. Plutarque dit
qu’ elle fut enlevée à Théfée dans Tille de Naxos,
ar un prêtre de Bacchus; ce qui eft plusvraifem-
lable que l’ingratitude de Théfée. Ce fut Diane,
félon Homère , qui retint Ariadne à la prière de
Bacchus. Hygin allure que Théfée donna la belle
couronne à Ariane, & ajoute que c’eft à la lueur
des diamans qui la compofoient, que Théfée
fortit du labyrinthe. Elle avoit eu de Théfée deux
enfans, QEnopion & Staphilus.
Selon Plutarque , il y a eu deux Ariadnes ;
Bacchus époufa Tune d’elles dans Tille de Naxos,
la rendit mère de Staphylos. L ’autre fut cette
amante infortunée que Théfée abandonna dans
cette même ifle, où elle mourut. On rendit par la
fuite des honneurs divins à toutes les deux, & on
célébra en leur honneur des fêtes appelées Ariad-
nées. Celles de la première étoient gaies, & on
les folemniroit par la mufique, la danfe & tout
ce qui pouvoit infpirer la joie. L’appareil des
fêtes de la fécondé n’infpiroit, au contraire, que
la triftefle & les larmes. Pour conferver le fou-
venir de la douleur relfentie par Ariadne près d’accoucher,
lorfque Théfée fe fépara d’elle, un jeune
homme couché pouflfoit des cris comme les femmes
en travail d’enfant, & feignoit d’en éprouver
les douleurs. Plutarque ajoute que T h é fé e , félon
la commune opinion, avoit inilitué cette fête
ridicule, comme une fatisfaélion due à fa matf-
trçfie après fon infidélité.
Ariadne, abandonnée dans l’ifle de Naxos, a
exercé fréquemment le pinceau 3c le cifeau des
anciens artiftçs. Les fouilles d’Hçrculanum ont
fourni trois tableaux relatifs à cet abandon. Dans
le premier, Ariadne couchée fur un li t , fe réveillé
au moment où s’éloigne le vaifleau de fon infidèle
amant. Elle le regarde douloureufement dans le
fécond ; l’Amour eft debout près d’elle, efiuyan't
les larmes qui coulent de fes yeux. Dans le troi-
fième enfin , Bacchus, avec fon cortège ordi-*
naire, découvre Ariadne plongée dans un profond
fommeil. La biblfothèque du Vatican renferme
une pâte ou verre coloré, qui repréfente Bacchus
repofant fur le fein à'Ariadne, avec deux Satyres*
Ce bas-relief, dont le fond eft brun foncé ou de
couleur de fardoine, & dont les figures font d’ un
blanc de lait, a été fait pour imiter ces belles far-
donix qui fervoient de matière aux vafes murrhins.
Il eft taillé en carré-long d’environ huit pouces
de largeur &: cinq de hauteur. Il rempliffoit le
milieu d’un panneau, & fervoit à décorer quel-
qu’ancien palais.
Lorfqu’on trouve fur les médaitles ou fur les
pierres gravées une tête de femme, jeune & couronnée
de pampre ou de lierre, on n’héfite pas à
lui donner le nom & Ariadne. On n’ignore pas
cependant que les traits de Bacchus jeune, font
très-peu diftin&s de ceux d’une jeune fille ou
femme, & q ue , d’ailleurs, la divinité appelée
Libéra, ne peut avoir d’autre attribut particulier
que la couronne de pampre. Winkelmann a mis
à la fin du chapitre i du livre 4 de fon Hiftoire de
l’A r t, le deffin d’un beau camee qui offre les têtes
accolées de Bacchus & d’Ariadne. Il appartient
au cabinet Famèfe de Naples, & porte les carac-_
tères du plus beau travail grec.
Dans la colle&ion des pierres du baron de
Stofch, le même favant a donné à une tête cou-
* ronnée de lierre , & couverte en partie d’un voile ,
le nom d’Ariadne, 'd’après des confédérations que.
nous croyons devoir rapporter pour éclaircir cette
matière. Il fonde cette dénomination fur la ref-
femblance parfaite de cette tête avec celles que
- Ton voit fur quelques médailles de Tifle de Naxos,
du cabinet du roi de Naples, & de celui de l’err.-.
pereur à Florence. Toutes ces têtes font d’une
même manière : le deffin en eft dur, peu favant,
& refpire la plus haute antiquité. Mais celles des
médailles femblent être des copies d’une tête des
premiers tems de l’art. Ces monnoies n'ont pas,
en effet, l’antiquité qu’annonce le travail de la
tête ; fi on en excepte une d’argent, qui eft la
plus rare de toutes,* & fur laquelle n a s io n eft
écrit en bouftrophédon ou à rebours. Béger attribue
cependant cette tête des médailles de Naxos
à Bacchus. La colle&ion du baron de Stofch
renfermoit deux autres têtes de femme couron- !
nées de lierre.
ARIADNÉES, fêtes établies en l’ honneur des 1
deux Ariadnes. Voyez ce mot.
ARIANE. V. Ariadne.
ARIARATHE I , ou I I , ou I I I , roi de Cappa-
doce. BASIAEOS APIAPA0 OY.
Ses médailles font;
RR RR. en argent.
O. en or.
O. en bronze.
Ariar a th e , Eufèbes V, roi de Cappadoce.
Ses médailles font ;
C. en argent.
O. en or.
O. en bronze.
Ariarathe , Epiphane V I , roi de Cappadoce.
Ses médailles font:
RRRR. en argent.
O. en or.
- O. en bronze.
Ariarath e, Philométor V I I I , roi de Cappadoce.
Ses médailles font :
RR R. en argent.
O. en or.
O. en bronze.
ARIASSUS, en Pamphylie. apiacceun.
On a une médaille impériale grecque de cette
v ille , frappée en l’honneur de Géta.
ARICIE, princefte du fang royal d’Athènes-,
& refte malheureux de la famille des Pallantides,
fur qui Théfée ufurpa le royaume. Virgile dit
qu’Hyppolite Tépoufa après qu’Efculape l’eut
reffufeitée, & qu’iTen eut un fils. Elle donna fon
nom à une petite ville d’Italie, dans le Latium,
& à une foret voifine, dans laquelle Diane cacha,
dit-on^, Hyppolite après fa réfurre&ion. En re-
connoiffance d’un tel .bienfait, il lui éleva un
temple, & y établit un prêtre & une fête en fon
honneur. Le prêtre étoit un efclave fugitif, qui
de voit avoir tué de fa main fon prédéceffeur, &
qui avoit toujours en main une épée nue pour
prévenir celui auquel il prendroit envie de lui
fuccéder à la même condition.
La fête qui fe célébroit aux ides d’août, con-
fiiftoit à s’abftenir ce jour-là de lachaflfe, à couronner
de fleurs les bons chiens de chaffe_ & à
allumer des flambeaux. Les jeunes filles d’Aride
les portoient ainfi allumés au bois de Diane.
Ovide en parle dans fes Faites, ( n i . 269.) :
■ Sape potens votis frontem redimita corollis
Fcemina lacent es portât ab urbe faces.
Les femmes d’une vie licencieufe fe mêloient,
dans cette occafion , avec les jeunes filles au tems
de Properce , qui repréfente à Cynthie le mauvais
renom que lui donnoit fa préfence aux fêtes d’A-
riciè> ( i l . 23.1)';
Cum videt accenfis devotam currere tadis
In nemus, G? Trivia lumina ferre dea.
Ces flambeaux étoient placés au milieu de faifeeaux
d’épis de bled, (Grat. Cyneg. n. 484.) :
Spicatafque faces facrum , ad nemoraalta Diana
Sifiimus.
ARICINE, furnom de la Diane qu’on hono-
roit dans la forêt d’Aricie. Voye% Aricie.
ARIE & Pétus. On voit à la Villa-Lodovifî
à Rome, un grouppe auquel on donne ordinairement
ce nom; & le parc de Verfailles en
renferme une copie. Winkelmann a démontré la
fauffeté de cette dénomination. Nous allons extraire
les réflexions qü’il a faites à ce fujet dans
fon Hiftoire de l’A rt, (liv. 6, c. 6 ).
Ce beau grouppe feroit la production la plus
étonnante du règne de Claude, s’il repréfentoit
Cécinna Pétus, obligé de fe donner la mort pour
avoir trempé dans la confpiration de Scribonien
contre cet empereur; & la généreufe Arie, fon
époufe, qui s’enfonça, pour l’encourager à mourir,
un poignard dans le fein, le retira enfuite, &
dit à Pétus, en lui pré Tentant l'arme fatale .’ Tiens,
mon ami, cette bleffure ne càufe aucune douleur.
Le premier perfonnage de ce. grouppe eft un
homme nud, ayant de la barbe fur la levre fupè-
rieure. Il fe plonge de la main droite une épée
dans le corps, au:defi’us de la clavicule, & foutient
de la gauche le fécond perfonnage du grouppe L
une femme drapée, qui eft tombée fur fes genoax.
Cette femme eft bleflfée à l’épaule droite, ainfi
qu’on peut en juger par quelques gouttes de fang
indiquées au haut du bras. On voit aux pieds de
ces deux figures un grand bouclier de figure oblon*
gue, & fous le bouclier un fourreau d’épée.
Le principe lumineux que Winkelmann a établi
& démontré d’après l’expérience, dans fon Eflai
fur l’Allégorie, & mieux encore dans la préface
de fes Monumens de l’Antiquité, prouve que ce
grouppe ne repréfente point un fujet de THiftoire
Romaine. Il eft certain, en effet, que Ton ne
trouve aucun fujet tiré de THiftoire Grecque oit
Romaine, exécuté en ftatues ou en bas-reliefs. Les
artiftes de l’antiquité ne font jamais fortisdu cercla
de la Mythologie. D’ail leurs, ce feroit aller contre
les maximes de Pline, que de chercher dans ce
grouppe un trait de THiftoire de Rome ; car il
établit clairement, en plufieurs endroits de fon
ouvrage, que les figures des Romains étoient ordinairement
vêtues, & le plus fouvent couvertes
de grandes draperies. L’homme nud indique ici
néceflairement les tems héroïques.
Ce perfonnage ne fauroit être non plus un féna-
teur romain, parce que le boucli.er & l’épée n’ont
jamais été l’attribut de cet ordre. La barbe qu’il
porte fur la lèvre fupérieure, n’étoit plus à la mode
du tems de Claude, où tous les Romains étoient
. rafés. H eft encore plus facile de montrer que cet