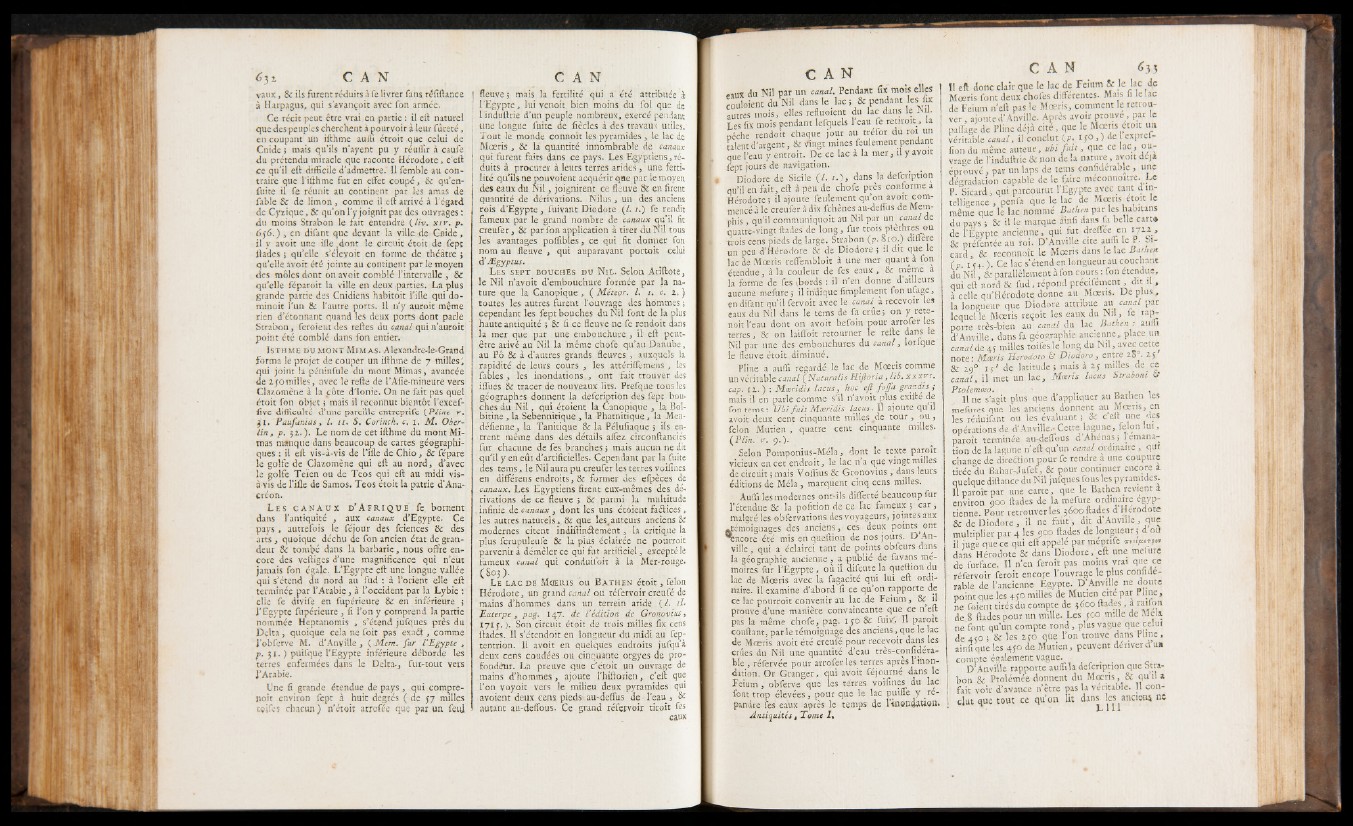
vaux, & ils furent réduits à fe livrer fans réfiftance
à Harpagus, qui s’avançoit avec fon armée.
Ce récit peut être vrai en partie : il eft naturel
que des peuples cherchent à pourvoir à leur fureté,
en coupant Un ifthme auffi étroit que celui de
Cnide > mais qu’ils n’ayent pu y réuffir à caufe
du prétendu miracle que raconte Hérodote, c eft
ce qu’il eft difficile d’admettre.’ Il femble au contraire
que l ’ifthme fut en effet coupé , & qu’ea-
fuite il fe réunit au continent par les amas de
fable & de limon, comme il eft arrivé à l’égard
de Cyzique, & qu’on l’y joignit par des ouvrages :
du moins Strabon le fait entendre (/iv. x iv . p,
656.) , en difant que devant la ville de Cnide,
il y avoir une iile .dont le circuit étoit de fepj
ftades ; qu’elle s’éîeyoit en forme de théâtre >
qu’elle avoit été jointe au continent par le-moyen
des môles dont on avoit comblé l’intervalle , &
qu’elle féparoit la ville en deux parties. La plus
grande partie des Cnidiens habitait rifle qui do-
minoit l’un & l’autre ports. 11 n’y auroit même
rien d’étonnant quand les deux ports dont parle
Strabon , feroient des reftes du canal qui n’auroit
point été comblé dans fon entier.
I s t h m e d u m o n t M i m a s . Alexandre-le-Grand
forma le projet de couper un ifthme de 7 milles '3
qui joint la péninfule du mont Mimas, avancée
de 2 50milles, avec le refte de l’Afie-mineure vers
Clazomêne à la côte d’Ionie. On ne fait pas quel
étoit fon objet ; mais il reconnut bientôt l’excef-
live difficulté d’une pareille entreprife ( Pline r .
$ I . Paufanias, l. 11. S. Corinth. c. 1. Af. Ober-\
lin , p. 32. ). Le nom de cet ifthme du mont Mimas
manque dans beaucoup de cartes géographiques
: il eft vis-à-vis de l’ifle de C hio, & fépare
le golfe de Clazomêne qui eft au nord, d’avec
le golfe Teïen ou de Teos qui eft au midi vis-
à-vis de l’ifle de Samos. Teos étoit la patrie d’Anacréon.
L e s c a n a u x d ’ A f r i q u e * fe, bornent
dans l’antiquité , aux canaux d’Egypte. Ce
p a y s , autrefois le féjour des fciences & des
arts, quoique déchu de fon ancien état de grandeur
& tombé dans la barbarie, nous offre encore
des veftiges d’une magnificence qui n’eut
jamais fon égale. L’Egypte eft une longue vallée
qui s’ étend du nord au fud : à l’orient elle eft
terminée par l’Arabie, à l’occident par la Lybie ï
elle fe divife en fupérieure & en inférieure j
l’ Egypte fupérieure , fi l’on y comprend la partie
nommée Heptanomis , s’étend jufques près du
Delta, quoique cela ne foit pas exaél, comme
J’obferve M. d’Anville , ( Mem. fur l’Jïgypte ,
p. 31. ) pùifque l’Egypte inférieure déborde les
terres enfermées dans le Delta-., fur-tout vers
l ’Arabie.
Une fi grande étendue de pays, qui compre-
poit environ fept à huit degrés ( de 57 milles
tçifcs chacun) nétoit arrofée que par un feifl
fleuve J mais la fertilité qui a été attribuée à
l’Egypte, lui venoit bien moins du fol que de
1 induftrie d’un peuple nombreux, exercé pendant
une longue fuite de fiècles à des travaux utiles.
Tout le monde connoît les pyramides, le lac de
Moeris , & la quantité innombrable de canaux
qui furent faits dans ce pays. Les Egyptiens, réduits
à procurer à leurs terres arides, une fertilité
qu’ils ne pouvoient acquérir que par le moyen
des eaux du Nil, joignirent ce fleuve & en firent
quantité de dérivations. Nilus, un des anciens
rois d’Egypte, fuivant Diodore làJ il) fe rendit
fameux par le grand nombre de canaux qu’il fit
creufer, & par fon application à tirer du Nil tous
les avantages poffibles, ce qui fit donner fon
nom au fleuve , qui auparavant portoit celui
d* Ægyptus.
L es sept bouches du Nil . Selon Arîftote,
le Nil n’avoit d’embouchure formée par la nature
que la Canopique , ( Méteçr. I, 1, c. 2» )
toutes les autres furent l’ouvrage des hommes ;
cependant les fept bouches du Nil font de la plus
haute antiquité j & fi ce fleuve ne fe rendoit dans
la mer que par une embouchure , il eft peut-
être arivé au Nil la même chofe qu’au Danube,
au Pô & à d’autres grands fleuves , auxquels la
rapidité de leurs cours , les attériflemens , les
fables, les inondations , ont fait trouver des
ifliies & tracer de nouyeaux lits. Prefque tous les
géographes donnent la defcription des fept bouches
du Nil, qui étoient la Canopique ,, la Bol-
bitine, la Sebennitique, la Phatnitique, la Mendélienne,
la Tanitique & la Pélufiaque i ils entrent
même dans des détails aflez circonftanciés
fur chacune de fes branches ; mais aucun ne dit
qu’il y en eût d’artificielles. Cependant par la fuite
des tems, le Nil aura pu creufer les terres voifînes
en différens endroits, & former des efpèces de
canaux. Les Egyptiens firent eux-mêmes des dérivations
de ce fleuve î & parmi la multitude
infinie de canaux, dont les uns étôient faélices,
les autres naturels, & que les#auteurs anciens &
modernes citent indiftinélement, la critique la
plus fcrupuleufe & la plus éclairée ne pourroit
parvenir à démêler ce qui fut artificiel, excepté le
fameux canal qui conduifoit à la Mer-rouge.
( S©3 )-
Le lac de Moeris "ou Bathen étoit, félon
Hérodote, un grand canal ou réfervoir creufé de
mains d’hommes dans un terrein aride ( /. /L
Euterpe, pag. 147. de l’édition de Gronovius,
171 y. ). Son circuit étoit de trois milles fîx cens
ftades. 11 s’étendoit en longueur du midi au fep-
tentrion. 11 avoit en quelques endroits jufqu’a
deux cens coudées ou cinquante orgyes de profondeur.
La preuve que c’étoit un ouvrage de
mains d’hommes, ajoute l’hiftorien, c’eft que
l’on voyoit vers le milieu deux pyramides qui
avoient deux cens pieds- au-deflus de l’eau , &
autant au-defious. Ce grand réfervoir tiroît fes
éaux
«us du Nil par un canal. Pendant iix mois elles
coûtaient du Nil dans le lac ; & pendant les fix
autres mois, elles refluoient du lac dans le N il.
Les fîx mois pendant lefquels l’eau fe retiroit, la
pêche rendoit chaque jour au tréfor du roi un
talent d’argent, vingt mines feulement pendant
que l’eau y entroit. De ce lac à la mer, il y avoit
fept jours de navigation.
« Diodore de Sicile (/. dans la defcription
qu’il en fait, eft à peu de chofe près conforme a
Hérodote î il ajoute feulement qu’on avoit commencé
à le creufer à dix fchènes au-deffus de Memphis
, qu’il communiquoit au Nil par un^ canal de
quatre-vingt ftades'de long, fur trois plethtes ou
trois cens pieds de large. Strabon (p. B10.) différé
un peu d’Hérodote & de Diodore j il dit que le
lac de Moeris reflembloit à une mer quanta fon
étendue, à la couleur de fes eaux, & a
la forme de fes abords : il n’en donne d’ailleurs
aucune mefure j il indique Amplement fon ufage,
en difant qu’il fervoit avec le canal^ a recevoir les
eaux du Nil dans le tems de fa crue j on y rete-
noit l’eau dont on avoit befoin pour arrofer les
terres, & on laiflbit retourner le refte dans le
Nil par une des embouchures du canal 3 lorfque
le fleuve étoit diminué.
Pline a auffi regardé le lac de Moeris comme
un véritable canal ( Naturalis Pîiftoria , lib. xxxyr.
cap. 12. ) : M ce ri dis lac us, hoc eft fojfa grandisj
mais il en parle comme s’il n’avoit plus exifte de
fon tems : Ubi fuit Mxridis lacus. 11 ajoute qu il
avoit deux cent cinquante milles,de to u r, ou,
félon Mutien , quatre cent cinquante milles.
(Plin. v. 9.).
Selon Pomponius-Méla, dont le texte paroit
vicieux en cet endroit, le lac n’a que vingt milles
de circuit > mais Voiîius & Gronovius » dans leurs
éditions de Mêla, marquent cinq cens milles.
Auffi les modernes ont-ils diflerté beaucoup fur
l’étendue & la pofition de ce lac fameux j car,
malgré les observations des voyageurs, jointes aux
«témoignages des anciens, ces deux points^ont
Encore été mis en queftion de nos jours. D An-
ville , qui a éclairci tant de points obfcurs dans
la géographie, ancienne, a publie de favans mémoires
fiir l’Égypte, où il difcute la queftion du
lac de Moeris avec la fagacité qui lui eft ordinaire.
il examine d’abord fi ce qu’on rapporte de
ce lac pourroit convenir au lac-dé Feium, & il
prouve d’une manière convaincante «que ce n eft
pas la même chofe, pag. iyo & ftiiv^ Il paroît.
conftant, par le témoignage des anciens, que le lac
de Moeris avoit été creufé. pour recevoir dans les
crûes du Nil une quantité d’eau très-confidera-
ble , réfervée pour arrofer les terres apres 1 inondation.
Or Granger, qui avoit fejourne dans le
Feium, obferve que les terres voifînes du lac
font trop élevées, pour que le lac puifle y répandre
fes eaux après le temps de l’ilîQndfltiQfl. J
Antiquités i Tome l*
Il eft donc clair que le lac de Feium & le lac de
Moeris font deux chofes différentes. Mais fi le lac
dè Feium n'eft pas le Moeris, comment le retrouver,
ajoute d’Anville. Après avoir prouve , par le
paffage de Pline déjà cité, que le Moeris etoit un
véritable canal, il conclut (p. IJO,) de 1 expref-
iion du même auteur, ubi fuit, que ce lac, ouvrage
de l'induftrie 8c .non de la nature , avoir déjà
éprouvé, par un laps de tems connderable , une
dégradation capable de le faire meconnoitre. Le
P. Sicard, qui parcourut l'Egypte avec tant d intelligence
, penfa que le lac de Moeris etoit le
même que le lac nommé Bathen par les habitans
du pays ; & il le marque a'infi dans fa belle cart®
de l'Égypte ancienne, qui fut drelféeen
& préfentée au roi. D’Anville cite auffi le P. M-
card, & reconnoît le Mocris dans le lac Bathen
(p. i <•+.). Ce lac s'étend en longueurau couchant
du Nil, & parallèlement à fon cours : fon étendue,
qui eft nord & fud, répond précifément, dit i l ,
à celle qu'Hérodote. donne au Moeris. De plus,
la longueur que Diodore attribue au canal par
lequel le Moeris reçoit les eaux du Nil, fe rapporte
-très-bien au canal du lac Bathen : atilu
d'Anville, dans fa géographie ancienne, place un
Canal de 45 milles toifes le long du Nil, avec cette
note : Afoeris Herodoto & Diadôro , entre ao°. a5
& 190 1 y' de latitude ; mais à ay milles de ce
canal, il met un lac, Moeris lacus Straboni a
Ptolemoeo. , ' . .
Il ne s'agit plus que d'appliquer au Bathen les
mefures que les anciens donnent au Moeris, en
les réduifant ou les évaluant ; & c'eft une des
opérations de d'Anville.-Cette lagune, félon lui,
paroît terminée au-deffous d Aliénas 5 1 émanation
de la lagune n'eft qu’un canal ordinaire, qui
change de direction pour fe rendre à une coupure
tirée du Bahar-Jufef, & pour continuer encore a
quelque diftance du Nil jufques fous les pyramides.
Il paroît par une carte, que le Bathen revient a
environ 900 ftades de la mefure ordinaire égyptienne.
Pour retrouver les 3600 ftades d’Herodote
& de Diodore, il ne faut, dit d'Anville, que
multiplier par 4 les 900 ftades de longueur; d’ou
il juge que ce qui eft appelé par méprife « .«W »
dans Hérodote & dans Diodore, eft une mefure
de furface. Il n'en feroît pas moins vrai que ce
réfervoir ferait encore l'ouvrage le plus conlide-
rable de l’ancienne Égypte. D Anville ne doute
point que les 45° milles de Mutien cite par Pline,
ne foient tirés du compte de 3600 ftades, a radon
de 8 ftades pour un mille. Les 500 mille de Mêla
ne font qu’un compte rond, plus vague que celui
de 450; & les ito qûe l'on trouve dans Pline,
ainfique les 450 de Mutien, peuvent dériver d un
compte également vague. ,
D’Anville rapporte auffi la defcription que btra-
bon & Ptolémée donnent du Moeris, & qu’il a
fait voir d’avance n’être pas la véritable. Il conclut
que tout ce qu’on lit dans^ les^ancienfc ne