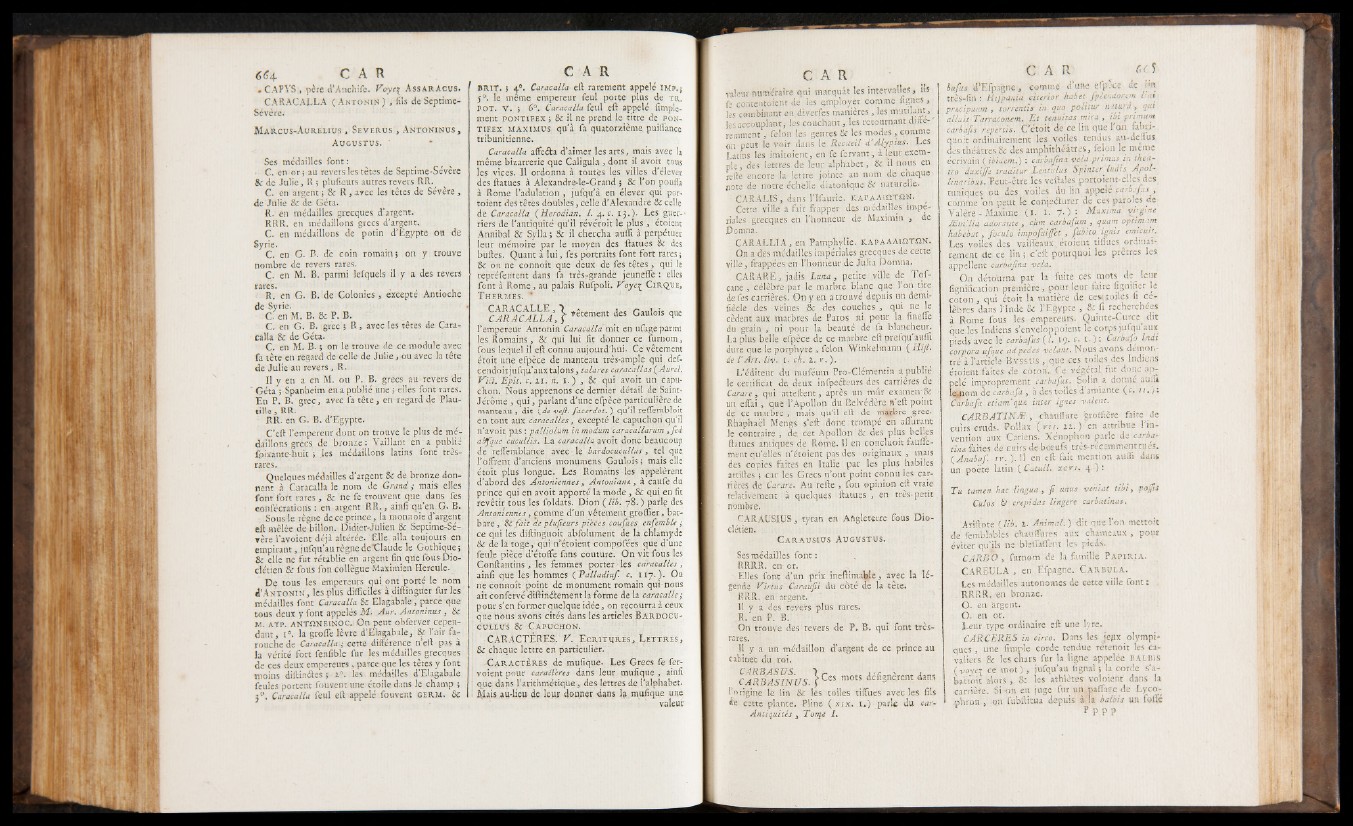
6 6 4 C A R
• CAPYS , père d’Anchife. Voyc^ AssARAcus.
CARACALLA ( Antonin) , fils de Septime-
Sévère.
Ma RCUS-AuRELIUS , SEVERUS , Antoninus,
Augustus. '
Ses médailles font:
• C. en or 5 au revers les tètes de Septime-Sévère
& de Julie j R ; plufieurs autres revers RR.
C. en argent > 8c R , avec les têtes de Sévère,
de Julie & de Géta.
R. en médailles grecques d’argent.
RRR. en . médaillons grecs d’argent..
C. en médaillons de potin d’ Egypte ou de
Syrie.
C. en G. B. de coin romain? on y trouve
nombre de revers rares.
Ç. en M. B. parmi lefquels il y a des revers
rares. . ,
R. en G. B. de Colonies, excepté Antioche
de Syrie. : •
C. en M. B. 8c P. B.
C. en G. B. grec; R , avec les têtes de Cara-r
calla 8c de Géta.
C. en M. B. ; on le trouve de ce module avec
fa tête en regard de celle de Julie, ou avec la tête
de Julie au revers , R.
Il y en a en M. ou P. B. grecs au revers de 1
Géta ? Spanheim en a publié une ? elles font rares.
En P. B. grec, avec fa tê te , en regard de Plau-
tille, RRRR.
en G. B. d’Egypte.
C’eft l’empereur dont on trouve le plus de médaillons
grecs de bronze: Vaillant en a publié
£oixante-huic ? Jes médaillons latins font très-
rares.. | i
Quelques médailles d’argent 8c de bronze donnent
à Caracalla le nom de Grand ; mais elles
font fort rares , 8c ne fe trouvent que dans fes
confécrations : en argent R R ., ainfi qu’en G. B.
Sous le règne de ce prince, la monnoie d’argent
eft mêlée de'billon. Didier-Julien 8c Septime-Sévère
l’avoient déjà altérée. Elle, alla toujours en
empirant, ju f q u ’ a u règne de’Claude le Gothique;
8c elle ne fut rétablie én argent fin que fous Dioclétien
8c fous fon collègue Maximien Hercule.
De tous les empereurs qui ont porté le nom
d’An to n in , les plus difficiles à diftingu'er fur les
médailles font Caracalla 8c Elagabale, parce que
tous deux y font appelés M. Aur. Antoninus , 8c
m . AYP. ANTON einoc.: On peut obferver cependant,
i°. la groffe lèvre d’Elagabale, 8c l’air farouche
de Caracalla,; cette différence n’eft pas à
la vérité fort fenfible fur les médailles grecques
de ces deux empereurs, parce que les têtes y font
moins diftin&es ; i°. les médailles d’Elagabale
feules portent fouvent une étoile dans lé champ ;
3°. Caracalla feul eft appelé fouvent germ. 8c
c A R
brit. ; 4°. Caracalla eft rarement appelé imp. j yq. le même empereur feul porte plus de tr.
pot. y . ; 6°. Caracalla feul eft appelé Amplement
pontifex ; 8c il ne prend le titre de pon-
tifex maximus qu’à fa quatorzième puiffance
tribunitienne.
Caracalla affe&a d’aimer les arts, mais avec la
même bizarrerie que Caligula , dont il avoit tous
les vices. Il ordonna à toutes les villes d’élevet
des ftatues à Alexandre-le-Grand ; 8c l’on pouffa
à Rome l’adulation , jufqu’à en élever qui por-
toiént des têtes doubles, celle d’Alexandre 8c cellç
de Caracalla { Herodian. I. 4. c. 13.). Les guer-*
riers de l’antiquité qu’il révèroit le plus , étoient
Annibal 8c Sylla ; 3c il chercha auffi à perpétuer
leur mémoire par le moyen des ftatues 8c des
buftes. Quant à lui, fes portraits font fort rares;
8c on ne connoît que deux de fes têtes, qui le
repréferttent dans fa trèsrgrande jeuneffe : elles
font à Rome, au palais Rufpoli. Voye^ Cirque,
Thermes. * '
c T r ^ a l l a } Têtement des GauIoîs que
l’empereur Antoiîin Caracalla mit en ufage parmi
les Romains, 8c qui lui fit donner ce furnom,
fous lequel il eft connu aujourd’hui. Ce vêtement
étoit une efpèce de manteau très-ample qui def-
cendoitjufqu’auxtalons, talares caracallas {Aurel.
Vict. Epit. c. 21. n. 1 .) , 8c qui avoit un capuchon.
Nous apprenons ce dernier détail de Saint-
Jérôme , qui, parlant d’ une efpècé particulière de
manteau , dit 'Kde vefi. facerdot. ) qu’ il reffembloit
en tout aux caracalles, excepté le capuchon qu'il
n’avoit pas : palliolum in modum'caracallarum, fe i
m ue cucullis. La caracalla avoit donc beaucoup
de reffemblance avec le‘ bardocucullus , tel que
l’offrent d’anciens monumens Gaulois ; mais elle
étoit plus longue. Les Romains les appelèrent
d’abord des Antoniennes, Antoniane. , à caufe du
prince qui en avoit apporté la mode , 8c qui en fit
revêtir tous les foldats. Dion '{lié. 78.) parlç des
Antoniennes y comme d’un vêtement groffier, barbare,
'St fait de plufieurs pièces coufues ensemble ;
ce qui les diftinguoit abfolument de la chlamyde
8c de la toge, qui n’étoient comp.ofées que d’une
feule pièce d’étoffe fans couture. On vit fous les
Conftantins, les femmes porter-les caracalles,
ainfi que les hommes ( Palladiuf. c, T17. ). Ou
ne connoît point de monument romain qui-nous
ait confervé dîftiridtément la forme de la caracalle ;
pour s’en former quelque idée, on recourra à ceux
que nous avons cités dans les articles Bardocu-
culltjs 8c Capuchon.
CARACTÈRES. V. Ecritures, Lettres,
8c chaque lettre en particulier.
'C aractères de mufîque. Les Grecs fe fer-
voient pour caractères dans leur mufique, ainfi
que- dans l’ arithmétique, des lettres de l'alphabet.
Mais au-lieu de leur donner dans l<t. mufique une
valeur
valeur numéraire qui marquât les intervalles, ils
fe contentoient de les employer comme lignes,
les combinant en diverfes manières, les mutilant,^ 1
les accouplant; les couchant., les retournant différemment
, félon les genres 8c les modes, comme ,
on peut le voir dans le Recueil d'Adypius. Les I
Latins les imitoient, en fe fervant, a leur exem- ,
pie, des lettrés de leur alphabet, 8c il nous en ,
refte encore la lettre jointe au nom de chaque
note de notre échelle diatonique 8c naturelle.
CARALIS, dans lTfaurie, KAFAAipTON.
Cette ville a fait frapper des médailles impériales
grecques en l’honneur de Maximin , de
JDomna.
CARAL LIA, en Pamphylie. KAPAAAU2TON.
On a des médailles impériales grecques de cette
ville, frappées en l’honneur de Julia Domna.
CARARE, jadis Luna, petite ville de Tof-
cane, célèbre par le marbre blanc que l’on tire
de fes carrières. On y en a trouvé depuis un demi-
fiècle des veines 8c des couches , qui ne le
cèdent aux marbres de Paros ni pour la fineffe
du grain , ni pour la beauté de fa blancheur.
La plus belle efpèce de ce marbre eft prefqu’auffi
dure que le porphyre , félon Winkelmann ( Hift.
de l'Art, liv. I . ch. 2. v. ).
L’éditeur du inuféum Pro-Clémenrin a publie
le certificat de deux infpeëteurs des carrières de
Carare, qui attellent, après un mûr exametrSc
un effai, que l’Apollon du Belvédère n’eft point
de ce marbre , mais qu’il eft de mafbre grec.
Rhaphaël Mengs s’ eft donc trompé en affurant
le contraire , de. cet Apollon & des plus belles
ftatues antiques de Rome. Il en concluoit fauffè-
ment qu’elles n’étoient pas des originaux , mais
des copies faites en Italie par les plus habiles
artiftes ; -car les Grecs n’ont point connu les carrières
de Carare. Au refte , fon opinion eft vraie
relativement à quelques ftatues , en très- petit.
nombre.
C A R A U S I U S , t y r a n e n A n g l e t e r r e f o u s D i o c
l é t i e n . .
Carausius Augustus. .
Ses médailles font :
RRRR. error. ,
Elles font d’un prix ineftimafele, avec la légende
Virkis Caraufii du côté de la tête.
RRR. en argent.
Il y a des revers plus rares.
R. en P. B.
On trouve des revers de P. B. qui font très-
rares.
Il y a un médaillon d’argent de ce prince au
cabinet du roi.
C AR B A Sm U S . } Èes raotS dans
l’origine le lin 8c lés toiles tiffues avec les fils
de cette plante. Pline ( xix. u ) parle du ear-
Antiquités , Torqe /.
bafus d’Efpagne, comme dune eip.ee cie mu
très-fin: Hifpqnia citerior habet fplendorun h ni
pr.&cipuum , torrentis in quo politur n uurâ, que
allait Tarraconcm. Et tenuitas mira , ibi -primant
carbajis reperds. C’étoit de ce lin que l’on Cabri-
quoit ordinairement les voiles tencius au-de(fus
des théâtres 8c des amphithéâtres, félon le meme
écrivain {ibidem.') : carbafma vêla primas in thea-
tro duxijfe traditur Lentulus Spinter ludis Apol-
linaribus. Peut-être les veftales portoient-elles des
tuniques ou des voiles du lin appelé çarbafus t
comme on peut le conjecturer dë ces paroles de
Valère - Maxime (I. I. 7- ) *• Maximal virgine
Æmilia adorante, cùm carbafum , quam optimatn
habebat, foculo impofuifet , fubito. ignis emicuir.
Les voiles des vaiffeaux, étoient tiffues ordinairement
de ce lin ; c’eft pourquoi les prêtres les
appellent carbafina vêla.
On détourna par la fuite ces mots de leur
lignification première, pour leur faire fignifier le
coton , qui étoit la matière de ce»! ,toiles fi célébrés
dans l’Inde 8c l’ Egypte , 8c fi recherchées
à Rome fous les empereurs. Quinte-Curce^ dit
que les Indiens s’enveloppoient le corps jufqu aux
pieds avec le car bafus ( /. 19, c. 1 . ) : Carbafo Indi
cqrpora ufque adpedes vêlant. Nous avons démon-
tré à l’article B yssüs , que ces toiles des Indiens
étoient faites de coton., Ce, végétal fut donc appelé
improprement carbafus. Solin a donne auîli
leiporn de carbafa. a des toiles d amiante ( t . r t .) .
Carbafa ctiam qui infer ignés valent.
CARBATINÆ , chauffure groflière faite^ de
cuirs cruds. Pollux ( r n . la..)-'en attribue l'invention
aux Cariens. Xénophon parle de etria.
tins faites dé cuirs de-boeufs très-récemment tués.
. ( Anabaf. iv . ). Il en eft fait mention auiTi dans
un poète latin ( Catu.ll. x e v i. 4-) :
Tu tamen hue lingua, fi mus vehiat tibi, pops
Culos & crepidas lingerc carbatinas.
Ariftote ( l i b . 1. Animal. ) dit que l'on mettoit
de femblables chaulfures aux chameaux , pour
éviter qu'ils ne blella-ilent les pieds.
C A R B O , furnom de la famille Pa p iR.i a .
C A R BU LA , en Efpagne. C a r b u l a .
Les médailles autonomes de cette ville font : .
, RRRR. en bronze.
O. en 'argent.
O. en or.
Leur type ordinaire eft une lyre.
CARCERES in circo. Dans les jejlx olympiques
, une ftvnple corde tendue retenoit les cavaliers
& les chars fur la ligne appelée b a l b is
( voyez ce mot ) , jufqu’au lignai ; la corde s'abattent
alors, & les athlètes voloient dans la
carrière. Si on en juge fur un paffage de Lyco-
I .nhron , -on fubliitua depuis à la battis un ïoffé
P p p p