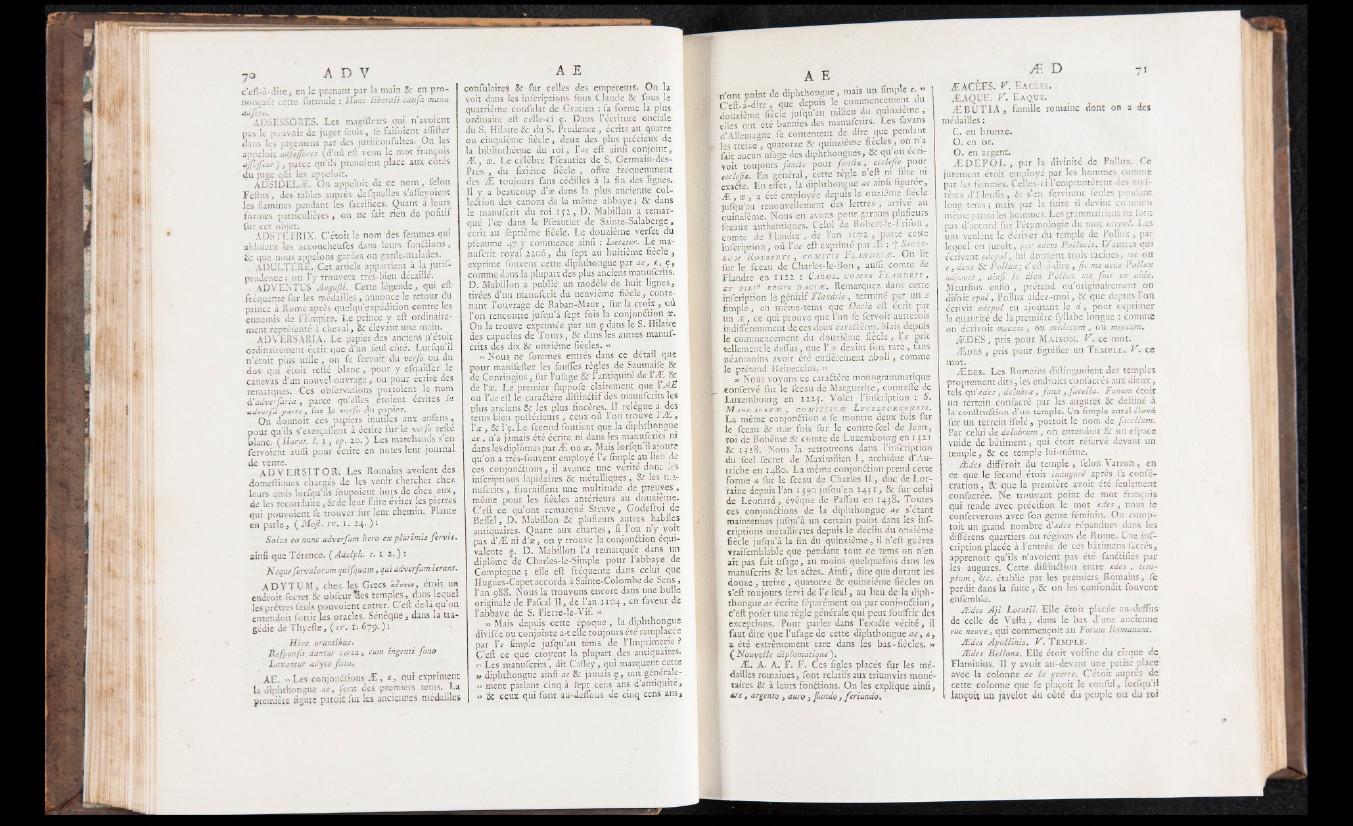
7° A D V
c*eft-à-dire, en le prenant par la main de en prononçant
cette formule : Hune liber ali eau fa manu
adfero. .. ;
ADSESSORES. Les magiftrats qui n avoient
pas le pouvoir de juger feuls, fe faifoient aflifter
dans les jugemens par des jurifconfultes. On les
appeloit adfeffores (d’où eft venu le mot françois
djfcjfeur') , parce qu’ils prenoient place aux cotes
du juge qui les appeloit.
ADSIDELÆ. On appeloit de ce nom, félon
Feftus, des tables auprès defquelles s affeyoient
les flamines pendant les facrifices. Quant à leurs
formes particulières , oh ne fait rien de pofitif
fur cet objet. ------
ADSTETRIX. C’étoit le nom des femmes qui
aidoient les accoucheufes dans leurs fonctions ,
èc que nous appelons gardes ou garde-malades. _
ADULTERE. Cet article appartient à la jurif-
piudence ; on l’y trouvera très-bien détaillé.
. ADVENTUS Au gu fi. Cette légende, qui eft-
fréquente fur les médailles, annonce le retour du
prince à Rome après quelqu’expédition contre les
ennemis de l’Empire. Le prince y eft ordinairement
repréfenté à cheval, de élevant une main.
AD VERS ARIA. Le papier des anciens n’etoit
ordinairement écrit que d’un feul cote. Lorfqu il
n’étoit plus utile, on fe fervoit du verfo ou du
dos- qui étoit refté blanc, pour y efquifler le
canevas d’un nouvel ouvrage, ou pour écrire des
remarques. Ces obfervations portoient le nom
tiadverfaria, parce quelles étoient écrites in
adverfâ parte 3 fur le verfo du papier.
On donnoit ces papiers inutiles aux enfans,
pour qu’ils s’exerçaftent à écrire fur lè verfo relie
blanc. ( Horat. I. i , ep. 20. ) Les marchands s en
fervoient aufli pour écrire en notes leur journal
de vente. . . ,
AD V E R S ITO R . Les Romains avoient des
domeftiques chargés de les venir chercher chez
leurs amis lorfqu’ils foupoient hors de chez eux,
de les reconduire, & de leur faire éviter les pierres
qui pouvoient fe trouver lur leur chemin. Plaute
en parle, (Mojl. i r . l . 24.):
Solus CO nunc adverfum kero cxplurimis fervis.
ainfi que Térence. ( Adelpk. 1. 1 1. ) :
Nequc fcrvulorum quifquam, qui adverfum ierant.
A D Y TUM , chez les Grecs xtmt, étoit ua
endroit fecret & obfcur^es temples, dans lequel
les prêtres feuls pouvoient entrer. C'ell: de-la qu on
entendoit fortir les oracles. Seneque , dans la tra-
gédie de TKyefte, (rr. 1. 679.) :
Hinc or antibus.
Rcfponfa dantur certa. cum ingénu fono
Laxantur adyto fata.
AE. »Les conjonâionsÆ, a, qui expriment
la diphthongue ae, font des premiers tems. La
première figure paroît fur les anciennes médaillés
A E
confulaires & fur celles des empereurs. On la
voit dans les inferiptions fous Claude de fous le
quatrième confulat de Gratien : fa forme la plus
ordinaire eft celle-ci ç. Dans l’écriture onciale
du S. Hilaire & du S. Prudence, écrits au quatre
ou cinquième fiècle, deux des plus précieux de
la bibliothèque du roi, Yae eft ainn conjoint,
Æ , æ. Le célèbre Pfeautier 'de S. Germain-des-
Prés , du fixième fiècle , offre fréquemment
des Æ toujours fans cédilles à la fin des lignes.
Il y a beaucoup d’se dans la plus ancienne collection
des canons de la même abbaye j de dans
le manuferit du roi 152, D. Mabillon a remarqué
l’oe dans le Pfeautier de Sainte-Salaberge ,
écrit au feptième fiècle. Le douzième verfet du
pfeaume 47 y commence ainfi : Lcetetur. Le manuferit
royal 2201$, du fept au huitième fiècle,
exprime fouvent cette diphthongue par ae3 i s ç,
comme dans la plupart des plus anciens manuferits.
D. Mabillon a publié un modèle de huit lignes,
tirées d’un manuferit du neuvième fiècle, contenant
l’ouvrage de Raban-Maur, fur la croix , ou
l’on rencontre jufqu’à fept fois la conionétion as.
On la trouve exprimée par un.ç dans le S. Hilaire
des capucins de Tours, de dans les autres manuferits
des dix de onzième fiècles. »
Nous, ne fommes entrés dans ce detail que
pour manifefter les faufîès règles de Saumaife de
de Conringius, fur l’ufage Sz l’antiquité de 1Æ &
de l’æ. Le premier fuppofe clairement quelAE
ou Yae eft le caraétère diftinétif des manuferits les
plus anciens de les plus fincères. Il relègue des
tems bien poftérieurs , ceux où l’on trouve 1 Æ ,
l’æ , de l’ç. Le fécond foutient que la diphthongue
ae 3 n’a jamais été écrite ni dans les manuferits ni
dans les diplômes par Æ ou æ. Mais lorfqu’il ajoute
qu’on a très-fouvent employé Ye fimple au lieu de
ces conjonctions, il avance une vérité dont les
inferiptions lapidaires de métalliques, de les manuferits
, fourniffent une multitude de preuves,
même pour les fièlcles antérieurs au douzième.
C’eft ce qu’ont remarqué Struve, Godefroi de
Beffel, D. Mabillon & pîufîeurs autres habiles
antiquaires. Quant aux chartes, fi Ton n y voit
pas d’Æ ni d'æ, on y trouve la conjonction équivalente
£. D. Mabillon l’a remarquée dans un
diplôme de Charles-le-Simple pour l’abbaye de
Compiegne ; elle eft fréquente dans celui que
Hugues-Capet accorda à Sainte-Colombe de Sens ,
l’an 988. Nous la trouvons encore dans une bulle
originale de Pafcal II, de l’an 1104, en faveur de
l’abbaye de S. Pierre-le-Vif.
divifée _ — , - - -
par Ye fimple jufqu’au tèms de l’ Impru..
C’eft ce que croyent la plupart des antiquaires.
»3 Les manuferits, dit Cafley, qui marquent cette
M diphthongue ainfi ae de jamais ç , ont generale-
3» ment parlant cinq à fept cens ans d’antiquité,
» & ceux qui font au-delfous de cinq cens ans,
A E 7*
n'ont point de diphthongue, mais un fimple ' - ” 1
C’eft-a-dire, que depuis le commencement du
douzième fiècle jufqu'au milieu du quinzième ,
elles ont été bannies des manuferits. Les favans
■ d'Allemagne fe contentent de dire que pendant
les treize, quatorze & quinzième ficelés, on n i
fait aucun ufage des diphthongues, & qu on ecn-
voit toujours fanlte pour fanlU, «c/e/ie pour
ccclcfu. En général, cette'règle neft ni fure nt
exaifte. En effet, la diphthongue ac ainfi figurée,
Æ , æ, a été employée depuis le onzième liecle
jufqu'au renouvellement des lettres , arrive au
quinzième. Nous en avons pour garants pluheurs
fceaux authentiques. Celui de Robert-le-Frifon ,
comte de Flandre, de l’an 1072, porte cette
infeription, o ù l'« eft exprimé par Æ : t
XUM RoTBIUTI , COMIT I S FlANVRlÆ. Otl lit
fur le fceau de Charles-le-Bon, aufli comte de
Flandre en 1122 : Cà r o l . c o m e s F l a n d r i e ,
e t t i l i 9 r é g i s d a c i æ . Remarquez dans cette
infeription le génitif Flandrien terminé çar^ un e
fimple, en même-tems que Dacis, eft écrit par
un æ y ce qui prouve que l’on fe-fervoit autrefois
indifféremment de ces deux caradères. Mais depuis
le commencement du douzième fîecle , 1e prit
tellement le deffus, que Y æ devint fort rare, fans
néanmoins avoir été entièrement aboli, comme
le prétend Heinecc.ius._33
30 Nous voyons ce cara&ère monogrammatique
confervé fur le fceau de Marguerite, comtefie de
Luxembourg en 1225. Voici, l’infcription : S.
M a r g a r e t æ , c o m i t i s s æ L u c e l b u r g e n s ï s . ;
La même conjon&ion & fe montre deux fois fur
le fceau de une fois fur le contre-fcel de Jean,
roi de Bohême de comte de Luxembourg en 13 21
te 1328. Nous la retrouvons dans l’infcription
du feel fecret de Maximilien I , archiduc d’Autriche
en 1480. La même conjonction prend cette
forme a fur le fceau de Charles II:,- duc de Lorraine
depuis l’an 1390 jufqu’en 1431 * & flir celui
de Léonard, évêque de Paffau en 1438. Toutes
ces conjoii&ions de la diphthongue ae s’étant
maintenues jufqu’à un certain point dans les inferiptions
métallicfies depuis le déclin du onzième
fiècle jufqu’à la fin du quinzième, il n’eft guères
▼ raifemblable que pendant tout ce tems on n’en
ait pas fait ufage, au moins quelquefois dans les
manuferits & les aèfces. Ainfi, dire que durant les
douze, treize , quatorze de quinzième fiècles on
s eft toujours fervi de Ye feul, au lieu de la diphthongue
ae écrite féparément ou par conjonction,
c’eft pofer une règle générale qui peut fouffrir des
exceptions. Pour parler dans l’exaéte vérité , il
faut dire que l’ufage de cette diphthongue ae3 a 3
a été extrêmement rare dans les bas-fiècles. >»
( Nouvelle diplomatique ).
Æ. A. A. F. F. Ces figles placés fur les médailles
romaines, font relatifs aux triumvirs monétaires
de à leurs fonctions. On les explique ainfi,
Are , argento , duro , fiando , feriundo.
Æ D
ÆACÉES. V. Êacées.
ÆAQUE. V. Eaque.
Æ B U T IA , famille romaine dont on a des
médailles :
C. en bronze.
O. en or.
O. en argent.
Æ D E P O L , par la divinité -de Pollux. Ce
jurement étoit employé par les hommes comme
par les femmes. Celles-ci l’empruntèrent des myf-
tères d’Eleufis, de s’en fervirent feules pendant
long-tems} mais par la fuite il devint commun
même parmi les hommes. Les grammairiens ne font
pas d’accord fur l’étymologie du mot adepol. Les
uns veulent le dériver du temple de Pollux, par
lequel on juroit, per adem Pollucis. D autres qui
écrivent edepal3.\\ù. donnent trois racines, me ou
e , deus de Pollux, c eft-à-dire , fie. me deus Pollux
adjuvet , ainfi. le dieu Pollux me foie en aide,
Meurfius enfin, prétend qu’originairement on
difoit epol, Pollux aidez-moi, & que depuis l’on
écrivit edepol en ajoutant le d, pour exprimer
la quantité de là première fyllabe longue : comme
on écrivôit iriftcum, ou medecum , ou meecum.
ÆDES, pris pour Maison. V. ce mot.
Ædes , pris pour lignifier un Temple. V . ce
mot.
Ædes. Les Romains diftinguoient des temples
proprement dits, les endroits confacrés aux dieux,
tels qu‘sdes , délabra, fana , facella. Fanum etoit
un terrein confacré par les augures & deftiné à
la conftru&ion d’un temple. Un fimple autel élevé
fur un terrein ifolé, portoit le nom de facellum.
Par celui de delubrum, on entendoit & un efpace
vuide de bâtiment., qui étoit réfervé devant un
temple, de ce temple lui-même.
Ædes différoit du temple, félon Varron , en
ce que le fécond, étoit inauguré après fa confé-
cration, de que la première avoit été feulement
confacrée. Ne trouvant point de mot françois
qui rende avec précifîon le mot &des , nous le
conferverons avec fon genre féminin. On comptait
un grand nombre tildes répandues dans les
différens quartiers ou régions de Rome. Une infeription
placée à l’entrée de ces bâtimens lacrés,
apprenoit qu’ils n’avoient pas été fanCtifiés par
les augures. Cette diftinCtion entre &des, tem-
plum3 &c. établie par les premiers Romains, fe
perdit dans la fuite, de on les confondit fouvent
enfemble.
Ædes Aji Locutii. Elle étoit placée au-deffus
de celle de Vefta, dans le bas d’une ancienne
rue neuve, qui commençoit au Forum Romanum.
Ædes Apollinis. H. TEMPLE.
Ædes Bêlions. Elle étoit voifine du cirque de
Flaminius. Il y avoit au-devant une petite place
avec la colonne de la guerre. C’étoit auprès de
cette colonne que fe piaçoit le conful, lorfqu’il
lançoit un javelot du côté du peuple ou du rpi