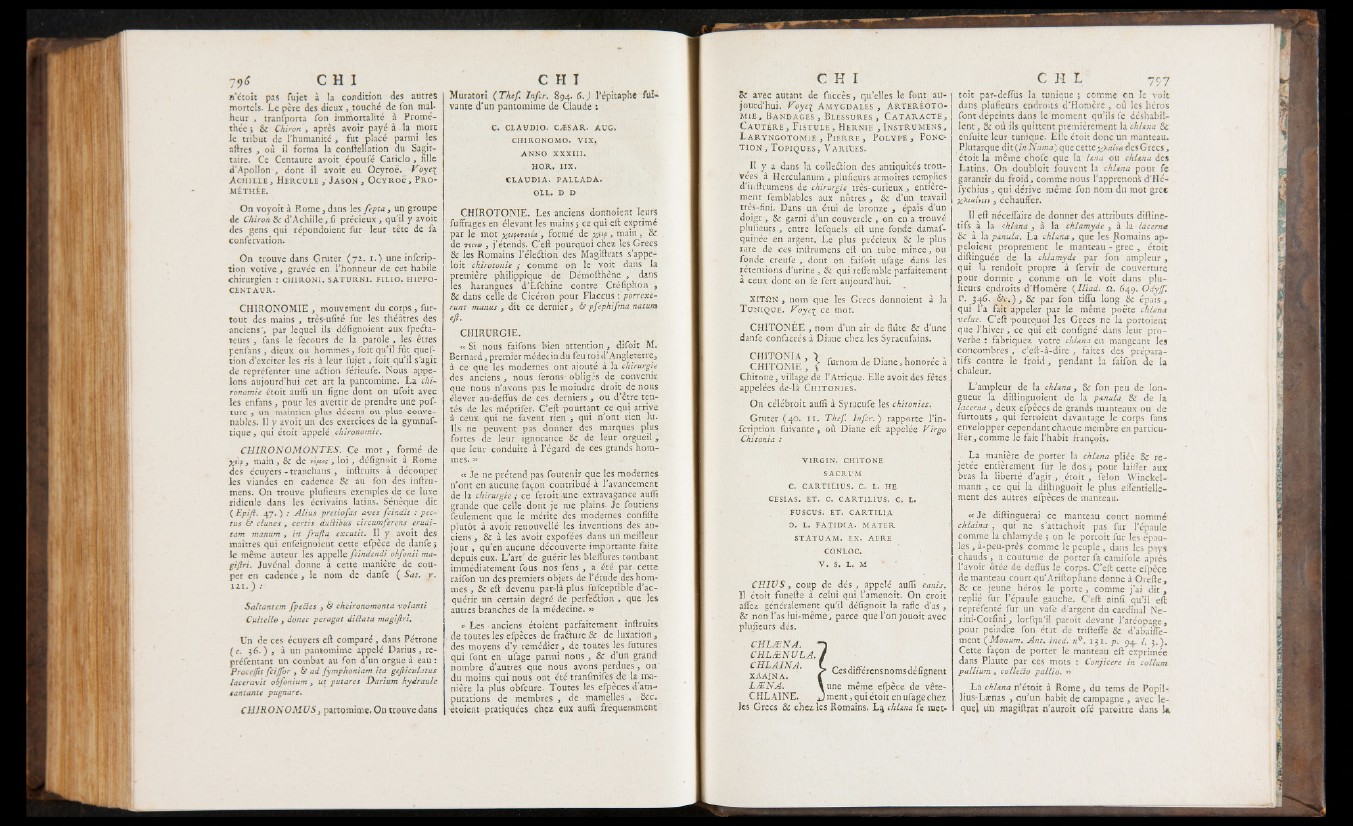
n’étoit pas fujet à la condition des autres
mortels. Le père des dieux , touché de fon mal*
heur , tran(porta Ton immortalité à Prome-
thée î & Chiron> après avoir payé à la mort
le tribut de l’humanité, fut placé parmi les
aftres , où il forma la conftellation du Sagittaire.
Ce Centaure avoit époufé Cariclo, fille
d’Apollon j dont il avoit eu Ocyroë. Voye%
A chille , Hercule , Jason , OcYRoë, Pr o -
MÉTHÉE.
On voyoit à Rome , dans les fepta 3 un groupe
de Chiron 8c d’Achille, fi précieux, qu’il y avoit
des gens qui répondoient fur leur tête de fa
confervation.
On trouve dans Gruter (72. 1.) une infcrip-
tion votive 3 gravée en l’honneur de cet habile
chirurgien : chiro ni. s a t u r n i . f il io . hippo-
CENTAUR.
CHIRONOMIE 3 mouvement du corps, fur-
tout des mains , très-ufité fur les théâtres des
anciens', par lequel ils défignoient aux fpe&a-
t-eurs, fans le fecours de la parole, les êtres
penfans, dieux ou hommes, foit qu’il fût quef-
tion d’exciter les ris à leur fujet, foit qu’il s'agît
de repréfenter une aétion férieufe. Nous appelons
aujourd’hui cet art la pantomime. La chi-
ronomie étoit auflî un figne dont on ufoit avec
les enfans, pour les avertir de prendre une pof-
ture , un maintien plus décens ou plus convenables.
Il y avoit un des exercices de la gymnaf-
tique, qui étoit "appelé ckironomie.
CHIRON O MONTE S. Ce mot, formé de
%ùf 3 main , 8c de vo,««? , lo i, défignoit à Rome
des écuyers - tranchans , inftruits à découper
les viandes en cadence & au fon des inftm-
mëns. On trouve plufieurs exemples de ce luxe,
ridicule dans les écrivains latins. Sénèque dit
( Epift. 47. ) : Alius pretiofas ave s fcindit : pec-
tus & clunes , certis duclibus circumferens erudi-
tam manum , in frufta excutit. Il y avoit des
maîtres qui enfeignoient cette efpèce de danfe 5
le même auteur les appelle fcindendi obfonii ma-
giftri. Juvénal donne à cette manière de couper
en cadence , le nom de danfe ( Sat. r.
n i. ) . -
Saltantem fpecles , & ckeironomonta volanti
Cultello , donec pcragat diftata magiftri. .
Un de ces écuyers eft comparé, dans Pétrone
(e. 36.) , à un pantomime appelé Darius, re-
préfentant un combat au fon d’un orgue à eau :
Procejfit fcijfor , & ad fymphoniam ha gefticulatus
laceravit objonium , ut putares JOarium hydraule
tantante pugnare.
CHIRONOMV'S, partomime. On trouve dans
Muratori ( Thef. Infer. 894. 6 .) l’épitaphe fui-
vante d’ un pantomime de Claude ;
C. CLAUDIO. CÆSAR. AUG.
CHIRONOMO. VIX,
ANNO XXXIII.
. HOR. IIX.
CLAUDIA. PALLADA.
OLL. D D
CHIROTONIE. Les anciens donnoîent leurs
fuffrages en élevant les mains 5 ce qui eft exprimé
par le mot %upotovm , formé de %up, main, &
de revu , j’ étends. C’eft pourquoi chez les Grecs
& les Romains l’éle&ion des Magiftrats s'appe-
loit chirotonie ; comme on le voit dans la
première philippique de Démofthène , dans
les harangues d'Efchine contre Ctéfiphon ,
& dans celle de Cicéron pour Flaccus : porrexe-
runt manus , dit ce dernier, & pfephifma natum
eft.
CHIRURGIE.
« Si nous faifons ' bien attention , difoit M.
Bernard, premier médec in du feu roi d’Angleterre,
à ce que les modernes ont ajouté à la chirurgie
des anciens , nous ferons- obligés de convenir
que nous n’avons pas le moindre droit de nous
élever au-defîus de ces derniers, ou d’-être tentés
de les méprifer. C’eft pourtant ce qui arrive
à ceux qui ne fa vent rien , qui n’ont rien lu.
Ils ne peuvent pas donner des marques, plus
fortes de leur ignorance 8c de leur orgueil,
que leur conduite à l ’égard de ces grands hommes.
»
- ci Je ne prétend pas foutenir que les modernes
n’ont en aucune façon contribué à l’ avancement
de la chirurgie y ce feroit une extravagance aufli
grande que celle-dont je me plains. Je foutiens
feulement que le mérite des modernes confifte
plutôt à avoir renouvellé les inventions des anciens
, 8c à les avoir expofées dans un meilleur
jour , qu’en aucune découverte importante faite
depuis eux. L’art' de guérir les blenures tombant
immédiatement fous nos fens , a été par cette
raifon un des premiers objets de l’étude des hommes
, & eft devenu par-là plus fufceptible .d’acquérir
un certain degré de perfection , que les
autres branches de la médecine. »
c* Les • anciens étoient parfaitement inftruits
, de toutes les1 efpèces de f r a é t u r e d e luxation,
des moyens d’y remédier, de toutes les futures
qui font en ufage parmi nous , & d’un grand
nombre d’autres que nous avons perdues, on
du moins qui nous ont été tranfmifes de la^ manière
la plus obfcure. Toutes les efpèces d’amputations
de membres, de mamelles, 8cc.
■ étoient pratiquées chez eux aufli fréquemment
8c avec autant de fuccès, qu’elles le font aujourd’hui.
Foye{ A m y g d a l e s , A r t e r é o t o -
m i e , Ba n d a g e s , Bl e s sur e s , Ca t a r a c t e ,
C a u t è r e , F i s t u l e , H e r n i e , I n s t r u m e n s ,
L a r y n g o t o m i e , P i e r r e , P o l y p e , Po n c t
i o n , T o p i q u e s , V a r i é e s .
II y a dans la colleétion des antiquités trouvées
à Herculanum, plufieurs armoires remplies
d’inftrumens de chirurgie très-curieux, entièrement
femblables aux nôtres , 8c d’un travail
très-fini. Dans un étui de bronze , épais d’un
d oigt, & garni d’un couvercle , on en a trouvé
plufieurs, entre lefquels eft une fonde damaf-
quinée en argent. Le plus précieux & le plus
rare de ces inftrumens eft un _tube. mince, bu
fonde creufe , dont on faifoit ufage dans les
rétentions d’urine, & qui relfemble parfaitement
à ceux dont on fe fert aujourd’hui.
xiT£2N , nom que les Grecs donnoient à la
T u n iq u e . Voye% ce mot.
CHITONÉE , nom d’un air de flûte 8c d’une
danfe confacrés à Diane chez les Syracufains.
CHITONIF i ^ M M ^ anej h °nor^e à
Chitone, village de l’Atrique. Elle avoit des fêtes
appelées de-là Ch i t o n i e s .
On çélébroit aufli à Syracufe les chitonies.
Gruter (40. 11. Thef. Infer.) rapporte- l’in-
feription fuivantc, où Diane eft appelée Virgo
Çhitonia :
VIRGIN. CHITONÈ
SACRUM
C. ÇARTILIUS. C. L. HE
CESIAS. ET. C. ÇARTILIUS. C. L.
FUSCÜS. ET. CARTILIA
O. L. FATIDIA. MATER
STATUAM. EX. AERE
ÇONLOC. x
V. S, L. M
CH IU S , coup fie dés , appelé aufli canis.
Il étoit funefte à celui qui l’ amenoit. On croit
aflez généralement qu’il défignoit la rafle d’a s ,
& non l’as lui-même, parce que l’on jouoit avec
plufieurs dés.
CHLÆNA. n
CHLÆNULA. ƒ
CHLAINA. f r , ,r
xAAjna I Ces difrerens noms defîgnent
LÆ N A . lu n e même efpèce de vête-
CHLAINE. .J ment, qui étoit en ufage chez
les Grecs & chez les Romains. L% chUna fe mettoit
par-deiïus la tunique j comme on le voit
dans plufieurs endroits d’Homère, où les héros
font dépeints dans le moment qu’ ils fe déshabillent,
& où ils quittent premièrement la chUna 8c
enfuite leur tunique. Elle étoit donc un manteau.
Plutarque dit (in Numa) que cette des Grecs ,
étoit la même chofe que la Una ou chUna des
Latins. On doubloit fouvent la chUna pour fe
garantir du froid, comme nous l’apprenons d’Hé-
fychius, qui dérive même fon nom du mot grec
x^ieniniv, échauffer.
Il eft néceflaire de donner des attributs diftine-
tifs à la chUna , à la chlamyde , à la • lacerna
& à la penula. La chUna, que les Romains ap-
peloient proprement le manteau - grec , étoit
diftinguée de la chlamyde par fon ampleur,
.qui la rendoit propre à fervir de couverture
pour dormir , comme on le voit dans plufieurs
endroits d'Homère (Iliad. £2. 649. Odyjf.
r . 346. &c. ) , 8c par fon tiflu long & épais,
qui l’a fait appeler par le même poète chUna
velue. C’eft pourquoi les Grecs rie la portoient
que l'hiver, ce qui eft configné dans leur proverbe
: fabriquez votre chUna en mangeant les
concombres, c’eft-a-dire , faites des préparatifs
contre le fro id , pendant la faifon de la
chaleur.
L ’ampleur de la chUna, 8c fon peu de longueur
la diftinguoient de la p&nula. 8c de la
lacerna , deux efpèces de grands manteaux ou de
furtouts, qui ferroient davantage le corps fans
envelopper cependant chaque membre en particulier,
comme le fait l’habit françois.
La manière de porter la chUna pliée 8c rejetée
entièrement fur le dos., pour Iaifler aux
bras la liberté d’agir , é to i t , félon Winckel-
mann , ce qui la diftinguoit le plus eflentielle-
ment des autres efpèces de manteau.
. «c Je diftinguerai ce manteau court nommé
chlaina , qui ne s’attachoit pas fur l’épaule
comme la chlamyde 5 on le portoit fur les épaules
, à-peu-près comme le peuple , dans les pays
chauds , a coutume de porter fa camifole après
l’ avoir ôtée de defîiis le corps. C’eft cette efpèce
de manteau court qu’Ariftophane donne à Orefte,
8c ce jeune héros le porte, comme j’ai d i t ,
replié fur l’épaule gauche. C’eft ainfi qu’il eft
repréfenté fur un vafe d’argent du cardinal Ne-
rini-Corfini, lorfqu'il paroît devant l’aréopage,
pour peindre fon état de triftefle 8c d’abaifle-
ment (Monum. Ant. ined. n°. 131. p. 94. /. 2.).
Cette façon de porter le manteau eft exprimée
dans Plaute par ces mots : Conjicere in collum
pallium , collecio pallio. m
. La chUna n’étoit à Rome, du tems de Popil-*
lius-Lænas , qu’un habit de campagne , avec lequel
un jmagiftrat n’auroit ofé paroître dans lu